4
La douceur de Swann
En cristallisant au virage du xixe et du xxe siècle de l’adrénaline pure, Jokini Takamine améliorait un procédé qui déterminait déjà le succès de l’industrie du sucre et de la morphine. Procédé encore très coûteux : remplir un petit flacon d’adrénaline impliquait de sacrifier une centaine de bœufs. Injectée par voie musculaire ou intraveineuse, elle augmente la pression artérielle, accélère le débit cardiaque, dilate les bronches en provoquant l’influx nerveux qui permettra bientôt à William Bayliss de concevoir l’hormone – du grec hormaien : « exciter ». Les glandes surrénales sécrètent la même espèce de dopant dont la diffusion dans le sang entraîne à son tour la production en chaîne d’autres dopants. Ils me soumettent à un narcotrafic en quelque sorte, dont le système neuroendocrinien constitue l’une des branches industrielles. Elle se partage elle-même en deux réseaux de laboratoires : le premier, spécialisé dans la fabrication de substances stimulantes, enclenche le travail de la perception et de la mémorisation ; le second se charge d’une mission de vigilance et d’alerte, en livrant les produits tonifiants dont dépend la résistance de l’organisme à une agression. Dans le premier cas, le dealer – c’est-à-dire le neurotransmetteur qui se propage jusqu’au cerveau pour réactiver ses commandes – s’appelle l’acétylcholine ; dans le second, l’adrénaline.
Aussitôt synthétisée on l’injecta dans la chair des asthmatiques, à qui revenait alors de tester toute nouvelle drogue. Si Proust s’y prêta volontiers, sa vision ne s’y formait pas moins. Sa littérature me restitue la même découverte, mais livrée d’un tout autre point de vue que celui de la médecine, en me transportant dans des sphères que personne n’avait encore perçues comme lui. Pour autant il ne devait pas moins cette découverte aux contraintes de l’asthme. Si l’adrénaline jugulait ses crises, elle exigeait de s’habituer à pratiquer sur soi des piqûres. L’impossibilité de l’administrer par voie orale, car elle s’élimine dans l’estomac, restreignait son utilisation thérapeutique, lorsqu’en 1920 l’industrie pharmaceutique japonaise lança sur le marché une liqueur qui reproduisait plus puissamment les effets de l’adrénaline, et qu’il suffisait d’avaler : l’éphédrine.
Avouez que je n’ai pas de chance, assurait Proust à Gaston Gallimard (en mai 1922). En dehors de tout ce que j’avais déjà, j’ai pris pur avant-hier par hasard un médicament très dangereux de cette façon, j’ai eu le tube digestif brûlé comme par du vitriol, j’ai souffert pendant trois heures un véritable martyre.1 Et de confier à François Mauriac : J’ai été mort. Et je remonte de profundis et encore tout emmailloté comme Lazare.2 À Sydney Schiff, quelques jours plus tard, il précise que l’accident est dû à une prise d’adrénaline à sec3 – mais entend-il sûrement par là éphédrine. Elle dégage un goût particulièrement amer et astringent. Extraite d’une plante appelée ma huang, elle appartenait à la pharmacopée de l’antique médecine chinoise, qui la prescrivait déjà pour libérer la respiration. Les arts martiaux d’Extrême-Orient appréciaient également ses qualités. Les toxicologues supposent qu’elle entrait, mêlée à d’autres stupéfiants sacrés, dans la cuisine du soma, la nourriture divine des anciens Indiens. En 1927, Gordon Alles, un chercheur de l’université de Californie, synthétisa chimiquement son agent actif qu’il nomma amphétamine. Elle révolutionna la médecine du xxe siècle. Elle la révolutionnait déjà il y a plus de trois mille ans. Elle la révolutionne encore, même si nombre de ses dérivés ont intégré la liste des drogues illicites.
Remarquez que cette liste ne sélectionne que des alcaloïdes, à peu près semblables aux neurotransmetteurs dont ils imitent la chimie, et que leur prohibition légale les contraint à une activité souterraine, à des sanctuarisations et à des circuits qui restituent à l’échelle mondiale l’imagerie fonctionnelle du métabolisme humain. L’usage d’une amphétamine – la benzédrine – joua un rôle considérable, dit-on, dans la victoire des aviateurs britanniques lors de la bataille d’Angleterre en 1940. Le succès de l’offensive de l’armée allemande, dans les Balkans au printemps 1941, reviendrait pour une part aussi importante aux effets de la méthédrine, une autre amphétamine, sur des troupes d’assaut qui ne prirent aucun repos pendant les onze jours que dura la campagne.4
Remarquez encore que la plupart des neurotransmetteurs comme les alcaloïdes possèdent le même goût amer ; goût qui offre aux sécrétions glandulaires l’un de leurs caractères spécifiques, alors que les voies digestives préfèrent de loin le sucre. Donnez à un nouveau-né de quelques heures un peu d’eau sucrée, il manifestera son plaisir en éclairant son visage par la détente d’un soulagement. Essayez de lui faire avaler une solution amère, il la recrachera aussitôt en exprimant sa répugnance. La saveur sucrée domine tout autre goût dans le liquide où baigne l’enfant à naître. Il en tire son ressort essentiel. L’être, à ce stade, ne signifie que sucre. Et persiste-t-il à le signifier tout au long de la vie, serait-ce à son corps défendant.
Observez Oriane quand elle aperçoit Swann dans la cohue des invités de Mme de Saint-Euverte, aimantant sur lui ses regards, allumant ses sourires, comme une souris blanche apprivoisée à qui on tend puis on retire un morceau de sucre.5 Le désir amoureux réveille ce conditionnement prénatal. Le goût, mais encore l’odeur, la vue, l’ouïe, le toucher, jusqu’à la profondeur du sentiment se chargent de la soif de sucré. Suscite-t-elle le désir de la caresse, du baiser, de la succion du sein maternel, pas moins que l’attrait de son apport alimentaire. Le taux de sucre dans le sang pose une donnée fondamentale, mesurée en permanence, avec la plus extrême des précisions par l’organisme. Mais, si l’enfant est avide du lait de sa mère et de sa présence, ses besoins de douceur ne dépendent pas exclusivement d’elle. Son appareil digestif ne le dote-t-il pas d’une sucrerie à toute épreuve dont le foie est l’usine ? Si les surplus sont convertis en graisse et stockés comme en réserve monétaire, une masse courante raffinée en glucose parcourt constamment sa circulation sanguine pour ravitailler ses organes – son cerveau en particulier – en lui révélant d’autres perspectives de bonheur. De fait, rassasier l’enfant en lait, le bercer, le consoler ne suffisent pas toujours à le calmer. Lui faut-il encore stimuler, par ses cris, ses pleurs, comme un coureur de fond qui s’épuise méthodiquement, une source de substances compassionnelles aux effets bien plus voluptueux que le sucre, même s’ils se confondent avec sa douceur.
Sans neurotransmetteur, rien n’aurait de goût. Mais, déjà, nous n’aurions de goût à rien. Les glandes endocrines et les nerfs ne sont pas les seuls à en produire ; le système nerveux central en sécrète tout autant, notamment dans le circuit limbique où se constitue comme un Triangle d’or chargé de former ses agents les plus actifs. Là encore, le narcotrafic se répartit en deux principaux réseaux, ceux-ci proprement cérébraux, mais liés par des accords intimes aux messagers neuroendocriniens.
Le premier réseau libère de la dopamine, laquelle réagit aussitôt que s’accentue la pression de l’adrénaline comme en répondant à une injonction. Lui incombe la tâche de motiver l’organisme afin de mieux identifier un danger et d’affronter sa menace. Une décharge d’acétylcholine entraîne également l’élévation du taux de dopamine, avec la même fonction motivante, mais maintenant pour concentrer l’attention, développer une représentation mentale et enregistrer un savoir – du moins, à en croire les théories actuelles de la vie.
L’autre réseau produit de l’endorphine. Il réagit notamment aux variations du taux de glucose dans le sang. Si j’entreprends un jeûne, soit que j’y sois obligé par les circonstances, soit que je me livre volontairement à une ascèse, à un rite de deuil, à un régime amaigrissant ou encore à une course d’endurance, je recevrai de la morphine endogène. Procédure d’alarme maximale, quand la vie commence à être en jeu, elle m’encourage à surmonter les difficultés, en me donnant la force d’oublier ma faim et l’angoisse qu’elle suscite par l’apport d’une substance jusque-là insoupçonnable – ce que les sportifs appellent « le second souffle ». Le coureur de fond l’attend impatiemment, pas moins que le nouveau-né quand il se découvre cette fonction cérébrale à force de chagrin.
Allumez une cigarette, aspirez une bouffée de tabac, remplissez-vous-en les bronches : vous provoquerez un effet semblable à une décharge d’acétylcholine. La nicotine lui offre un substitut alcaloïde. Elle me permet maintenant de passer des commandes à volonté, quitte à bouleverser la nature de mon métabolisme en lui imposant mes propres choix : la fumée que j’aspire, par un jeu d’échos et de contre-échos, induira à son tour un apport d’endorphine. « Je dois au cigare un grand accroissement de ma capacité de travail et une meilleure maîtrise de moi-même », affirmait Freud6 alors qu’il souffrait déjà d’un cancer de la gorge. Ce circuit réagit sous la pression de la plupart des neurotransmetteurs : une décharge de testostérone lui signale également qu’il lui faut diffuser son produit pour associer la conviction du sublime au passage à l’acte sexuel, aux mêmes fins d’encouragement et de gratification, avec un dosage méticuleux de sa ration à la mesure du degré d’urgence qu’il ressent à la demande émise. Plaisir si puissant que je semble le sélectionner coûte que coûte, quitte en me mettre en danger, pour en faire profiter une ambition plus élevée que soi, portée par ma volonté en toute connaissance de cause.
Pourtant une bouffée de tabac laisse dans la bouche le même goût amer qui rebute les jeunes enfants – lesquels se conforment à une loi biologique qui détermine le comportement de tout animal. Les bêtes fuient aussitôt qu’elles flairent l’amertume, alors qu’un aliment sucré les attire irrésistiblement, parfois de très loin. Phénomène qui conditionne la pollinisation des végétaux, pas moins que la domestication des animaux. L’homme à cet égard reste exceptionnel quand, à l’adolescence, il éprouve l’envie de goûter à ce qui lui déplaisait tellement jadis. Encore que la première cigarette n’évoque rien de si agréable, mais continue-t-elle d’agir. Le rite maniaque à quoi elle me soumet ne dépend pas que de la satisfaction de sentir augmenter mes facultés cognitives (notion toujours hasardeuse, il est vrai), ni seulement du désir de m’initier à la saveur amère et de me socialiser plaisamment, voire d’envisager un transport céleste, il tient encore à la faculté insecticide du tabac. La nicotine possède le pouvoir de paralyser les insectes, en particulier les abeilles, et de les tuer au-delà d’une certaine dose. Les apiculteurs l’utilisent encore couramment aujourd’hui pour enfumer une ruche. Les anciens Mexicains lui découvrirent sûrement ce don. La coca, l’éphédra, le datura, le pavot, le cannabis ne le possèdent pas moins, d’autant qu’ils partagent aussi celui de calmer la douleur d’une piqûre d’abeille et de me persuader d’approcher un essaim. Voilà l’insecte indispensable, selon Proust : insecte, serpent ou seringue.
Dans le restaurant de Rivebelle, les soirs où nous y restions, si quelqu’un était venu dans l’intention de me tuer, comme je ne voyais plus que dans un lointain sans réalité ma grand-mère, ma vie à venir, mes livres à composer, comme j’adhérais tout entier à l’odeur de la femme qui était à la table voisine, à la politesse des maîtres d’hôtel, au contour de la valse qu’on jouait, que j’étais collé à la sensation présente, n’ayant pas plus d’extension qu’elle ni d’autre but que de ne pas en être séparé, je serais mort contre elle, je me serais laissé massacrer sans offrir de défense, sans bouger, abeille engourdie par la fumée du tabac, qui n’a plus le souci de préserver la provision de ses efforts accumulés et l’espoir de sa ruche, songe le Narrateur7 en entrevoyant comment fonctionne la chimie d’un alcaloïde : une chimie qui tient tout entière à son art de simuler l’action d’un neurotransmetteur ; ainsi le tabac lorsqu’il imite les effets de l’acétylcholine ; ou l’éphédrine ceux de la dopamine ; ou le luxe d’un restaurant, les parfums qui en émanent, les caresses que l’espace crée alors en pensée, mais qui n’agissent pas moins sur soi comme dans un salon de massage, quand ils parviennent à faire chuter le débit glandulaire de l’adrénaline en calmant la demande d’endorphine, avec pour résultat de réactiver son offre et de rendre plus sensible sa diffusion. Une piqûre d’adrénaline produit le même jeu de bascule par la même sorte de massage. Si je me sens soulagé, c’est que justement je n’ai plus l’impression d’être en demande. Mes glandes se reposent. Elles n’envoient plus leurs messagers jusqu’au cerveau. Le « prix » de l’endorphine ne vaut presque plus rien. Sa « cote » ne dépend que de l’écart entre offre et demande.
Une piqûre de morphine agira de la même manière, moins parce qu’elle apporte réellement le narcotique le plus puissant au corps que parce que l’espace que je perçois change du tout au tout. Si agressif il y a encore un instant, il se révèle d’un tact exquis. Tous les alcaloïdes obéissent à cette injonction tactile, d’une façon ou d’une autre. Les aiguilles d’un acupuncteur également. Ce qu’il leur faut « combattre », c’est le signal adrénalinique et la vigilance, l’alarme, le mauvais sang qu’il suscite, sans quoi je n’aurais pas la notion du mal.
Au casino, un joueur accroché à une table éprouve un soulagement aussi intense sans qu’aucun produit pharmaceutique n’entre en jeu, conditionné par le tourbillon hypnotique qui opère à cette bourse des valeurs où se joue la sensation du bien-être ou du mal-être. S’il suscite une hallucination, il ne commande pas moins les étreintes, les baisers, les tétées de génies invisibles, surgis des profondeurs pour me prodiguer leurs soins et me nourrir de leur courant angélique. Proust observait encore que la lecture peut produire le même effet stupéfiant, quand la vérité ne nous apparaît plus comme un idéal que nous ne pouvons réaliser que par le progrès intime de notre pensée et par l’effort de notre cœur, mais comme une chose matérielle, déposée entre les feuillets des livres comme un miel tout préparé par les autres et que nous n’avons qu’à prendre la peine d’atteindre sur les rayons des bibliothèques et de déguster ensuite passivement dans un parfait repos de corps et d’esprit.8
Que je reçoive du miel en abondance et je cesserai aussitôt de me faire du mauvais sang en me laissant alimenter par les anges et par leur électricité. Toutefois l’abondance de miel n’est pas éternelle. Que son apport disparaisse, et que je sois incapable d’encaisser le choc du retour du signal inquiétant et de ses résonances – alors, par récurrence, les influx nerveux qui assurent mes fonctions vitales s’interrompront, et je mourrai comme électrocuté. Encore que l’électrocution puisse durer des années et se confondre avec la vie, puisque je ne cesse jamais de solliciter l’électricité des anges, dussé-je m’exposer délibérément au danger. Les doigts dans la prise de courant, je risque le choc fatal autant à essayer de m’en dégager qu’à laisser le courant se propager en moi. Ainsi les raisins se sucrent-ils au soleil, songe le Narrateur9 en contemplant les jeunes filles de Balbec après qu’elles ont lui fait la grâce de l’admettre dans leur petite bande, sans se douter du poison qu’il ingère – ou, s’il s’en doute, en préférant ne pas le savoir.
De toutes les nourritures à portée de soi, le miel demeura longtemps celui qui concentrait le plus de sucre. La cuisine des anciens Romains le sollicitait massivement : il nappait les viandes, les poissons, les légumes ; il s’intégrait au pain et au vin ; il imprégnait les cosmétiques et les baumes. Il facilitait le travail de la cicatrisation, atténuait les maux de gorge, favorisait la digestion, mais procurait surtout le sentiment immédiat du bonheur. Aussitôt sur la langue, il produisait l’effet spontané d’une montée en soi. Meli en grec, mel en latin, le miel offrait naturellement à la pensée le concept du melior. Il améliorait. Vertu qui lui réservait une place éminente dans la pharmacopée, mais tenait-elle autant à sa teneur en sucre qu’à sa faculté de dissimuler dans sa consistance l’amertume d’une tout autre espèce de remède, et de la faire avaler, de la faire passer, de la faire digérer. Phar : « transférer » en grec. Mak : « pouvoir ». Ainsi se fabrique le pharmakon. À lui de signifier maintenant le meilleur et le pire, et de donner au miel la charge de véhiculer l’alcaloïde jusqu’au cerveau, avec la grâce de sa détente. Quand je suis malade, l’excipient sucré qui enrobe les gélules que j’ingurgite pour me rétablir obéit toujours à la même prière. Le mi king – la ration de combat des guerriers chinois jadis – les rendait déjà dépendants d’un biscuit miellé cuit avec toutes sortes d’herbes remontantes dont la recette de base, emportée par le flux déferlant des conquêtes mongoles, parvint en Europe au xiiie siècle sous le nom de « pain d’épices ». On le considérait encore comme un médicament, à en croire Proust, vendu par des marchands d’oublies comme cette boutiquière des Champs-Élysées, particulièrement aimable pour nous, note son narrateur, car c’était chez elle que M. Swann faisait acheter son pain d’épices, et par hygiène, il en consommait beaucoup, souffrant d’un eczéma ethnique et de la constipation des Prophètes.10
L’addiction à la morphine, comme à la plupart des alcaloïdes, provoque en règle générale une diminution sévère de la motricité digestive, avec pour conséquence la remontée de la flore intestinale et son exsudation. Elle produit parfois des mycoses spectaculaires, en particulier sur les mains et sur le visage, semblables à une crise eczémateuse. Cocteau en témoigne assez dans son Journal. Elles faisaient entrer Proust dans des périodes aussi douloureuses qui l’obligeaient porter continuellement des gants. Toutefois l’usage de la drogue n’entre pas seulement en jeu dans la crise. Y interviennent la mélancolie, l’inquiétude, la culpabilité. Bref, le mauvais sang. Maladie proprement biblique, mais pas moins raciale, au sens où l’entend le Narrateur. Maladie répertoriée par la médecine du xixe siècle sous le nom de « dégénérescence juive ». Proust en observait les symptômes sur son propre corps. Son humour témoignait que les Prophètes transmettaient cette affection aux enfants d’Israël, en leur annexant le pain d’épices et son soulagement.
Ce pouvoir d’agir sur le corps, sur la parole, sur l’esprit, ce pouvoir que son temps concédait si volontiers à Israël, met en jeu le champ d’influence où s’opèrent la subjectivation des individus pas moins que leur assujettissement et, en somme, le processus de manipulation du sujet et de son addiction à des produits assimilables à des drogues. « Il ne faudrait pas dire que l’âme est une illusion, ou un effet idéologique. Mais bien qu’elle existe, qu’elle a une réalité, qu’elle est produite en permanence », constatait Foucault. Et d’y reconnaître l’un des agents les plus actifs du « biopouvoir ».11 Pouvoir qui en façonnant ma volonté, en la programmant, en la déterminant, commanderait ma pensée, téléguiderait mon geste, ordonnerait ma vie, sans que j’en sois conscient. Le biopouvoir agit en général sans se laisser regarder. Il préfère l’ombre. Il voit, il est partout, il décide de tout, mais ne se voit pas. Pouvoir panoptique autant que biologique, il fait peser son poids de pain d’épices sur l’étoffe mentale et sentimentale du Narrateur.
Cependant, bien avant les conquêtes mongoles, s’élaborait en Inde un produit beaucoup plus concentré en sucre que le miel. Le sanskrit l’appelait sarkara. Expédié des côtes de Malabar, il arrivait en Méditerranée par la même route que l’encens et la myrrhe. Si les Rois mages ne le transportaient pas vers la grotte de Bethléem, c’est sans doute qu’au temps de la Nativité il était encore trop rare, trop coûteux, trop sophistiqué. Les médecins grecs le nommaient sakkharon ; les latins, saccharum ; il nous donne le nom même du sucre et dégage-t-il toujours le goût du chakrat, en sanskrit du « sacré ».
« L’Arabie produit du sucre ; mais celui de l’Inde est plus estimé. C’est un miel recueilli sur les roseaux, blanc comme les gommes, cassant sous la dent ; les plus gros morceaux sont comme une noisette, on ne s’en sert qu’en médecine », notait Pline.12 Performance remarquable : les anciens Indiens réussissaient à acclimater et à développer sur leur sol la culture d’une plante transportée de très loin, probablement des côtes de Malaisie ou de Nouvelle-Guinée où elle pousse à l’état sauvage : la canne à sucre. Une fois les cannes récoltées et broyées afin d’extraire leur jus, on procédait à une cuisson à quoi on mêlait du lait de chaux, selon une technique qui permettait également, sous d’autres latitudes, de raffiner l’opium issu du pavot. Les impuretés, précipitées par percolation au fond du récipient, laissaient émerger une mélasse purifiée, mais encore rousse. De nouvelles refontes, par centrifugation, livraient un jus clarifié qui, cristallisé, donnait du sucre pur. Les Indiens parvenaient déjà à en exporter à Rome au ier siècle de l’ère chrétienne. Pour la première fois dans l’histoire, on extrayait d’un végétal un agent actif parfaitement isolé. Cependant la culture du sucre ne s’adaptait pas à n’importe quel climat et requérait une main-d’œuvre abondante. Les Arabes l’introduisirent en Égypte, en Syrie et jusqu’en Andalousie, avant que les Vénitiens ne s’y initient à leur tour. Ils y acquirent une telle maîtrise qu’au xvie siècle, lors de la visite du roi Henri III à Venise, le doge pouvait lui offrir un banquet dont les mets et le décor ne se composaient que de sucre. « Les nappes, les serviettes, les plats, les couteaux, les fourchettes, le pain étaient de sucre, et si bien imités que le roi demeura agréablement surpris lorsque sa serviette, qu’il croyait de toile, se brisa entre ses mains », racontait Marsilio della Croce.13
Le sucre créait une esthétique qui fit grossir longtemps l’Europe, à exiger déjà des églises qu’elles évoquent des pièces montées. Le goût du baroque, de la rocaille, du rococo accentua encore cette pression. La mode féminine ne s’y conformait pas moins, qui donnait à la favorite royale peinte par Boucher, ou à la reine de France par Vigée-Lebrun, une saveur quelque peu écœurante désormais, à force de rappeler si instamment le sucre. La peinture du siècle suivant le convoquait toujours plus obsessionnellement, à inonder de caramel l’expression d’une attitude ou le velouté d’un visage, à enduire de confiture la lueur d’un regard ou le pathétique d’un serrement de cœur. Le sucre ne devenait-il pas dégoûtant ? Ne se prêtait-il pas aux pires manipulations ? Ne fournissait-il pas au catholicisme, à la monarchie, aux privilégiés, l’outil de domestication des peuples, en confondant l’être avec le bonbon ? Au regard des Lumières, concevoir la Révolution, c’était déjà cesser d’en consommer et, comme l’adolescent au moment où il fume sa première cigarette et boit son premier whisky, apprécier le goût amer qui s’associe au bouleversement hormonal de la puberté. Accéder à la majorité, à la souveraineté, à la liberté, appelait les peuples d’Occident à se donner un nouveau régime, comme les anciens Indiens lorsqu’ils avalaient le soma, ou les anciens Égyptiens lorsqu’ils inhalaient le kyphi. Les anciens Hébreux ne l’envisageaient pas moins en sollicitant l’encens. Le châle de prière que les Juifs utilisent encore retient toujours en soi le souvenir des rites d’enfumage au temple de Jérusalem. Proust, qui ne se nourrissait presque que de fumée, requérait probablement le même genre de linge quand il se livrait à ses fumigations. Du phœnix, l’oiseau qui renaît perpétuellement de ses cendres, naquit le nom de Phénicien, par quoi les Grecs désignaient les Cananéens, y compris les Hébreux. S’il leur ouvrait la route commerciale où trouver leurs cosmétiques et leur alphabet, le phœnix, à se laisser fumer et apprécier plus encore que le miel, les initiait aux notions de voyage, d’espace, d’univers, de cosmos – concept importé par les pythagoriciens –, littéralement alors en langue internationale « l’enfant du sud » : koush mos. « Made in Koush » en quelque sorte.
Voilà pourquoi le Narrateur confond le pain azyme avec le pain d’épices – à traduire en somme l’expression de l’hébreu en français – et pourquoi la marchande des Champs-Élysées tient une boutique de produits certifiés kascher. Par là, la Recherche remonte une filière proprement fantastique, c’est-à-dire astrologique, en suivant une route tout aussi magique que celle des Rois mages, à se laisser guider par l’étoile du Temps. Ce pain-là ne vient-il pas de Terre sainte comme les épices ? Les légendes médiévales n’inscrivaient-elles pas dans sa substance et dans le sabbat qu’elle déchaînait au moins autant de sorcellerie que dans la ration de combat des conquérants mongols ? Prosper youpla boum, c’est le roi du pain d’épices ! Même s’il ne contient sûrement plus aucun agent stupéfiant, cette association d’idées s’est transportée jusqu’aux Champs-Élysées depuis les croisades. Suggérait-elle encore, quand Proust publiait son roman, que la recette du pain azyme exigeait le sang d’un enfant chrétien sacrifié rituellement pour la Pâque.
Adolphe Crémieux, son grand-oncle, avait pris la défense des Juifs de Damas accusés du même genre de crime rituel. Alors, en 1840, ces affaires se réglaient par des supplices et des massacres, mais Crémieux provoqua une campagne de presse internationale, la première en ce genre dans l’histoire, qui obligea le pacha d’Égypte, maître de la Syrie, à convoquer un tribunal pour en juger. À son retour à Paris, après avoir gagné cette cause, Crémieux fut élu président du Consistoire israélite. Plutôt qu’un rabbin, mieux valait se choisir un avocat quand le mythe – à suggérer que les Juifs sont congénitalement constipés et couverts d’eczéma puisque leurs ancêtres mangeaient en secret des Aryens –, mythe répandu non plus seulement par la culture populaire mais par un discours scientifique désormais, semblait s’incruster si profondément dans les songes du xixe siècle que le narrateur proustien relayait cette croyance comme si elle allait de soi. Encore qu’il me faille la déchiffrer comme une énigme, mais dont le travail creuse un impact d’autant plus troublant. Soudain, ce détail, sur lequel j’étais passé cent fois sans entrevoir ce qu’il me signifiait, me crée un vertige que je n’avais encore jamais éprouvé à lire Proust.
Comme dans un avion, à l’annonce de la descente qui met fin au vol, j’observe se dessiner dans la Recherche le sol nouveau qui, d’une abstraction de terre, d’une espèce d’épure conceptuelle entre les nuages, devient peu à peu moins virtuel, pour prendre la forme concrète d’une carte d’état-major, bientôt d’un plan en relief, avec l’attraction d’une force de pesanteur qui, en soulevant ces reliefs, me donne l’impression de réintégrer l’actualité. Effet paradoxal du détail, précisément parce qu’il me prend au dépourvu, qu’il m’attaque par surprise en quelque sorte, en me laissant entrevoir des linéaments, des contrastes et une profondeur de champ jusque-là insoupçonnables. Même ceux qui furent favorables à ma perception des vérités que je voulais ensuite graver dans le temple, me félicitèrent de les avoir découvertes au « microscope » quand je m’étais au contraire servi d’un télescope pour apercevoir des choses très petites en effet, mais parce qu’elles étaient situées à une grande distance et qui étaient chacune un monde, précisait Proust. Là où je cherchais les grandes lois, on m’appelait fouilleur de détails.14 Une actualité dont je sens qu’elle me revient progressivement avec l’énergie d’une attraction à la fois terrestre et cérébrale, une actualité si longtemps resserrée, ramassée, repliée, qu’en se déployant maintenant en soi jusqu’à fleur de peau elle me donne la chair de poule.
Entrer le monde du détail, et de ce détail-là en particulier, ce n’est pas seulement atterrir, c’est se retrouver dans la clinique où Proust fit la découverte de l’adrénaline. Elle dégage de nouvelles images comme d’un film vu au ralenti, d’arrêt sur image en arrêt sur image, avec le même rythme lancinant et le même frein. Voilà des figures monstrueuses, mais qui ne sont si monstrueuses que parce qu’elles me deviennent signifiantes.
En 1821, lord Morton, un membre éminent du Jockey Club, constatait qu’une de ses juments, après avoir été accouplée à un zèbre et donné un hybride, saillie l’année suivante par un étalon de même race qu’elle et à même robe noire, accouchait d’un poulain dont les membres présentaient bizarrement les zébrures de son premier partenaire. Il attira l’attention de Darwin qui reconnut qu’en effet « les ovaires d’une femelle sont parfois affectés par une fécondation antérieure au point que les ovules ultérieurement fécondés par un mâle différent portent nettement les traces de l’influence du premier mâle ».15 Vous croyiez n’avoir qu’un père. Mais non, pas nécessairement. Pourquoi pas deux pères, aussi naturels l’un que l’autre ? Songez-y. Relisez Darwin. Théorie qui connut bientôt un écho remarquable en France, notamment dans le salon de Mme Alphonse Daudet où se retrouvaient régulièrement Charcot, Zola et Drumont, salon que fréquenta bientôt Proust.
« On eût dit que Jacques, en la serrant contre sa poitrine, la moulait à son image », écrivait Zola en publiant Madeleine Ferrat en 1868. Et d’exposer comment s’opérait l’imprégnation d’une femme lorsqu’elle perdait sa virginité. Ainsi, longtemps après son premier coït, l’héroïne de Zola, comme la jument de lord Morton, donne naissance à un enfant issu à la fois de son mari actuel, le père stimulant, et de son premier amant, décédé depuis lors, cependant le père imprégnant qui « laissa la jeune femme éternellement frappée à la marque de ses baisers ».16 Phénomène photographique, en quelque sorte, dont Philippe Hamon remarque qu’il confère à la femme la fonction d’une plaque sensible ; au père imprégnant celle de l’image latente qui impressionne la plaque ; et au père stimulant celle du révélateur qui développe son négatif et en tire un positif.17 Voilà pourquoi Nana ressemble tellement à Lantier, le premier amant de Gervaise. Phénomène qui ne fascinait pas moins Drumont : « L’hérédité apparaît avec un caractère en quelque sorte impérieux. Cette crasse du ghetto, cette saleté proverbiale, dans laquelle le Juif a vécu pendant des siècles, semblent l’avoir imprégné à tout jamais. »18
D’où le constat qu’en tira la médecine nazie : « Un seul rapport sexuel d’un Juif avec une Aryenne suffit pour empoisonner le sang de cette femme pour toujours. Car elle assimile l’âme avec l’albumine. Elle ne pourra plus jamais, même si elle épouse un Aryen, avoir des enfants purement aryens, mais seulement des bâtards dans la poitrine desquels vivent deux âmes. »19 Encore que pour Hitler la visée seule du regard d’un Juif sur une Aryenne suffisait à corrompre la race. Cette étrange construction familiale comme sortie d’une lanterne magique qui superpose des figures angoissantes, sûrement effrayantes, pourtant pas moins captivantes sur les murs d’une chambre d’enfant, à lui assigner deux pères, un gentil et un Juif, ne sécrète pas seulement le mauvais sang du Narrateur. Elle soulève une terreur qui, pour être enfantine, n’est pas moins fonctionnelle en s’accordant avec la théorie de la dégénérescence. Elle lui assigne une dialectique, elle exige une libération. Deux âmes dans le même corps, c’est une âme en trop. Il est vrai que la terreur ne date pas non plus d’hier. Le mythe du père dévoreur d’enfants remonte jusqu’au plus haut la mémoire. Il donne aux hommes l’image même du Temps.
Kronos, au regard des Grecs ; Saturne, au regard des Latins ; Baal Hamon, au regard des Cananéens. Aux âges archaïques, en Orient comme en Occident, au nord comme au sud, on sacrifiait réellement des nouveau-nés au dieu du Temps. Les artistes gréco-romains le représentaient sous les traits d’un vieillard barbu et chauve, couvert d’un voile, tenant une faux et un serpent. La barbe et le crâne glabre rappelaient le grand âge du Temps ; le voile, le deuil qu’il promettait perpétuellement aux vivants ; la faux, la mort ; et le serpent, le démon. Le Temps moissonnait. Il engrangeait, il avalait, il digérait, il évacuait l’engrais où semer la vie et moissonner à nouveau. Il tournait nécessairement en rond, il se mordait la queue, il s’abouchait à son anus, il suçait ses excréments. Il puait. Dieu des esclaves, à la lettre et en image ; dieu des défoncés, des aveugles, des impudiques, des suceurs, des baisés de toute nature. Ce n’est pas pour rien que Saturne a un anneau. Si l’astre du Temps manœuvre la dernière sphère du cosmos, s’il crée l’année, il ne dessine pas moins un anus. Ne lui parle pas des Saturniens, conseillait Proust20 à Antoine Bibesco. « Ceux qui étaient nés sous l’influence de Saturne étaient classés parmi les plus misérables, les moins enviables des mortels : infirmes, gueux, mendiants, paysans sans terre, vidangeurs, fossoyeurs », relevait Erwin Panofsky21 en sériant les représentations du Vieillard Temps dans l’Europe médiévale. Je ne sais pourquoi il n’y mentionne pas les sodomites. Les gravures qui illustrent son essai sont pourtant assez suggestives. Le Temps aime les enfants, il les mange, il allégorise la passion de la chair. Ni pourquoi, non plus, Panofsky ne voit pas s’y superposer la figure du Juif, celles du sabbat, du suceur de sang et de la passion de l’argent.
Il est vrai qu’ensuite Eric Zafran, l’un de ses disciples à l’institut Warburg, retrouva les mêmes traces iconologiques en consacrant une étude détaillée à ce que son maître avait délibérément laissé de côté : Saturne et les Juifs.22 L’association d’idées s’opère au ive siècle avant l’ère chrétienne. C’est peu dire que le proti, le jour de Kronos alors, l’équivalent du saturni dies à Rome, le samedi, n’était pas considéré comme un bon jour au regard de la mythologie. C’était le jour du « mauvais œil ». Mieux valait ce jour-là, si on le pouvait, s’abstenir de régler ses affaires ou d’entreprendre un voyage et rester chez soi à philosopher, de sorte que les Juifs d’Alexandrie choisirent évidemment ce jour pour célébrer le chabbat comme en le vouant à Kronos. Les Grecs n’avaient encore jamais conçu un jour universel de repos hebdomadaire. L’habitude se répandit peu à peu parmi les païens sur toutes les rives de la Méditerranée. Ce fut l’un des principaux vecteurs de la judaïsation de la culture gréco-romaine. « Il n’y a pas un Grec ou un barbare, ni une seule nation à qui notre coutume de s’abstenir de travailler le septième jour ne s’est propagée, et où les jeûnes et l’allumage de lumières, et plusieurs de nos interdictions concernant la question d’aliments, ne sont observés », notait Flavius Josèphe.23 Cependant les rites de Hanouka, la fête des Lumières au début de l’hiver, ne se mêlaient pas moins aux rites des kronia hellènes et des saturnales latines, en inaugurant bien avant la Nativité la célébration de Noël.
Après les semailles, l’arrivée de l’hiver laisse le temps de se reposer un peu, mais également celui de s’inquiéter de la moisson à venir. Les nuits se prolongent, le froid oblige à brûler de plus en plus d’énergie. L’adrénaline accentue sa pression dans le sang. Elle renouvelle sa demande de narcotique à un rythme accéléré, jusqu’à saturer le cerveau. D’où l’envie, bientôt la nécessité de changer de régime. La consommation massive de viande, de graisse, de sucre, de vin procure alors le second souffle que le corps n’est plus en mesure de fournir. Après s’être trop longtemps rationnées, les sociétés humaines ne peuvent guère éviter la crise boulimique des fêtes de fin d’année. Les aliments du réveillon apportent alors au sang les dopants qui, en occultant le signal alarmant, produisent le basculement où s’opèrent la sensation du bien-être et la volupté de l’oubli. « Oui, allons, va te coucher. » Le dîner en l’honneur de Swann impose les conditions mêmes de la crise boulimique. « Mais non, voyons, laisse ta mère, vous vous êtes assez dit bonsoir comme cela, ces manifestations sont ridicules. Allons, monte ! »24
« La statue de Kronos en bronze, les mains étendues, la paume en haut, et penchées vers le sol, de sorte que l’enfant qui y était placé roulait et tombait dans une fosse pleine de feu », qu’observait Diodore de Sicile25 à Carthage jadis, cette statue du Temps se redresse à Combray. S’il est sacrifié aux conventions bourgeoises qui commandent de ne pas tolérer un enfant à table quand on reçoit du monde, l’enfant ne sent pas moins jeté. Cet enfant-là n’est décidément pas comme des autres. Il réclame trop d’attention. Il émet de mauvaises ondes. Il porte « le mauvais œil ». Si petit qu’il soit, il en est conscient. Il sait qu’il doit faire diminuer la pression de sa demande de soins à sa mère. Seulement, la présence de Swann rompt tout à coup les termes du contrat familial. Swann ordonne, à son corps défendant mais ordonne tout de même, quand le père du Narrateur prend soudain la décision de l’exclure du repas de fête ; décision arbitraire qui le livre au supplice du coucher.
Lorsqu’il apprend à devenir propre, à contrôler les mouvements de son sphincter, à se retenir, à ne pas se soulager n’importe où ni n’importe quand, l’enfant admet qu’il lui faut observer une loi à quoi chacun se soumet et qu’il doit être rappelé à l’ordre s’il oublie. Il dirige en lui la pression du signal alarmant qui lui permet de se découvrir un désir de bien faire, une volonté, une responsabilité. Ainsi naît le sentiment de la justice. L’enfant croit volontiers que les méchants sont toujours punis et les gentils récompensés. Seuls les souverains disposent du pouvoir de sanctionner. À l’échelle de l’enfant, il revient à sa famille. Mais, à s’exercer contre lui sans qu’il ait la conviction d’avoir commis une faute, ce pouvoir impose la puissance du mal. Il supplicie les gentils, il fête les méchants. Encore qu’il ne le fait pas exprès, poussé par plus fort que soi, en concédant à Swann une autorité supérieure à la sienne, quoique à son corps défendant également, car Swann n’a rien de terrorisant en soi. N’empêche, il met en jeu le symbole qui change aussitôt la nature de l’espace familial. Car Swann ne porte pas moins « le mauvais œil ». Les Pâques qui réunissent les siens à Combray le rappellent à l’enfant ; cependant elles le lui rappellent comme on respire, sans rien d’explicite, par la seule modification de l’air, de son électricité, de son « toucher ». L’espace ne reste jamais tranquille et ne cesse jamais d’agir sur soi. S’il me caresse, s’il m’embrasse, s’il me dorlote, il n’hésitera pas non plus à me ceinturer, à m’étouffer, à me couper de souffle. Pourquoi agit-il ainsi ? L’enfant l’ignore ; mais il perçoit déjà dans le trouble que le lieu suscite l’objet de sa quête.
Mon grand-père disait : « Je reconnais la voix de Swann. » On ne le reconnaissait en effet qu’à la voix, on distinguait mal son visage au nez busqué, aux yeux verts, sous un haut front entouré de cheveux blonds presque roux, coiffés à la Bressant, parce que nous gardions le moins de lumière possible au jardin pour ne pas attirer les moustiques.26 La nuit envahit toute chose. Le jour n’y changerait pas grand-chose, puisque la ville reste perpétuellement sombre. Ses rues dont les maisons construites en pierres noirâtres du pays, précédées de degrés extérieurs, coiffées de pignons qui rabattaient l’ombre devant elles, étaient assez obscures pour qu’il fallût dès que le jour commençait à tomber relever les rideaux dans les « salles ».27 Cette maison, je ne saurais la décrire. Pourtant je m’en fais une idée assez précise. Mais cette idée dépend d’un outil proprement proustien dont personne ne s’est servi avant lui. Proust n’écrira jamais comme Balzac : « La salle à manger, dallée en pierres noires et blanches, sans plafond, mais à solives peintes, était garnie de ces formidables buffets à dessus de marbre. Les murs, peints à fresque, représentaient un treillage de fleurs. Les sièges étaient en canne vernie et les portes en bois de noyer naturel. »28 Ces informations qui permettraient à un décorateur, au théâtre ou au cinéma, de reconstituer réellement l’espace romanesque, ces informations couvrant le champ visuel du récit, je ne les trouverai jamais dans la Recherche, à baigner dans un flou permanent, parfois dans une obscurité presque complète, comme lorsque Swann se signale en animant non pas le grelot profus et criard qui arrosait, qui étourdissait au passage de son bruit ferrugineux, intarissable et glacé, toute personne de la maison qui le déclenchait en entrant « sans sonner », mais le double tintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers.29 Ce jardin, je ne le vois pas. Ce sont les bruits, les voix, leurs échos, relayés par les odeurs, les saveurs, les sensations tactiles, leur mouvance sensible qui façonnent, en s’intégrant les uns aux autres, le volume du lieu proustien comme une sorte de membrane mobile, plus ou moins oppressante, m’affectant à fleur de peau.
En réalité, Swann émet le même signal que l’enfant, malgré ses efforts de courtoisie, à laisser entrevoir sa mélancolie, sa lassitude, son chagrin, et à ramener encore des profondeurs la charge d’une malédiction que nul ne voudrait porter. Swann s’est mal marié, il se laisse mener par une mauvaise femme, elle le rend aveugle. Pourtant, si l’enfant lui doit d’être malheureux, il ne se reconnaît pas moins en lui, comme s’ils partageaient la même infirmité, encore que le petit ignore en quoi elle consiste exactement. Mais, en cela, le signal se rend d’autant plus oppressant et inquiétant.
Proust songea à être plus clair : Le père de M. Swann était un associé d’agent de change d’une assez grande fortune et en somme sa qualité de Juif passait à peu près inaperçue parce qu’il ne fréquentait guère que des catholiques et donnait tout au plus aux personnes curieuses l’envie de lui demander si c’était vrai que les Juifs étaient forcés de manger un enfant vivant à certains jours.30 Toutefois, la force du mythe ne s’éprouve pleinement que dans la nuit. À s’éclairer, il perd de son élan. Proust abandonna l’allusion au crime d’Israël dans un carnet d’esquisses. Mais, à resurgir dans son roman sous la forme d’un hiéroglyphe, en me laissant le soin de décrypter, il ne me restitue pas moins son impact maniaque.
« Parmi les calomnies engendrées par la haine et le fanatisme, il n’y en a certes pas de plus absurde que celle qui affirme que les Juifs versent le sang à l’occasion de leurs fêtes religieuses », assurait Ernest Renan. « Croire à de pareilles histoires n’est rien moins qu’une folie monstrueuse. »31 À remettre en cause la thèse du crime rituel, Renan et avec lui tant d’autres experts au xixe siècle ne transféraient pas moins au mauvais sang d’Israël la charge de pourrir la vie. En inscrivant dans le mythe du Juif le travail de la tare congénitale et du sadisme héréditaire, ils imposaient seulement une autre lecture du crime. Le supplice du coucher ne convoque pas que les souvenirs d’enfance de Proust, mais ceux des débats de la rue de Bellechasse, à la table de Mme Alphonse Daudet. Dans « l’enfant sacrifié », l’antisémite reconnaissait l’allégorie de la vie qu’Israël étouffe pour y trouver la force de se constituer, de se maintenir, de se renouveler et d’assujettir ; mais, si elle étouffe, c’est que précisément elle épouse la consistance de la membrane spatiale qui agit sur soi, à son corps défendant, en faisant aussitôt la nuit autour de soi – la nuit et l’insomnie.
Ainsi, Swann devient l’auteur inconscient de mes tristesses, explique l’enfant.32 Il pourrait pleurer. Cependant il observe se constituer une image. Phénomène photographique, là encore. Toutefois, il ne sollicite pas l’œil, mais le nez. Cet escalier détesté où je m’engageais toujours si tristement exhalait une odeur de vernis qui avait en quelque sorte absorbé, fixé, cette sorte particulière de chagrin.33 Et l’image mentale de se fixer en soi. Swann ne prive pas seulement l’enfant de sa mère ; il ne provoque pas seulement l’imagination d’une fête inconcevable, infernale, au sein de laquelle nous croyions que des tourbillons ennemis, pervers et délicieux entraînaient loin de nous, la faisant rire de nous, celle que nous aimons ;34 il lui crée le moteur de son roman. Roman affolant, mais qui n’est si affolant que parce que Swann est juif, en dégageant l’odeur de la chambre noire où le petit Marcel devient en retour, sinon le fils imprégné de Swann, du moins son semblable.
Les théologiens chrétiens certifiaient jadis que seule la chair se décompose quand l’esprit persiste. Kant restaurait un clivage comparable, lorsqu’il imposait à l’espace d’épouser une forme exclusivement convexe et extérieure, et au temps de se mouler dans la forme concave du même englobement, refermée sur soi et purement intériorisée. La distorsion entre une existence nécessairement limitée par la naissance et par la mort, si je considère ma trajectoire objectivement et comme de l’extérieur, et l’épreuve d’une puissance infinie, ressentie intérieurement, si je me place subjectivement comme au cœur de cette trajectoire, restituait à l’âge des Lumières les conditions de la double identité de pharmakon : poison et remède, en donnant à l’univers le parfum et le goût de la drogue – à quoi Combray, à présent, associe l’odeur du milieu de la France, confinée, sucrée, confite et vaguement écœurante, pourtant avec quelque chose de délicieusement fané et fade.
Milieu, ou plutôt mille lieues, mille lieues sous les mers, mille lieues au centre de la terre. Milieu du monde, milieu de toutes choses où l’on vit replié sur soi, entre soi et pour soi. Rien ne s’y passe, du moins rien d’imprévu, quand l’incident du dîner en l’honneur d’un Juif ramène l’enfant à son cauchemar habituel. Cependant, s’il convoque les hantises qui peuplaient les songes du xixe siècle, Proust les loge dans un paysage où elles me parviennent délestées de leur portée spectaculaire, réduites à une échelle enfantine. Hantises fluidifiées en quelque sorte, à passer dans le courant de la vie de province où il ne se passe rien, sauf d’infimes incidents, à peine signalés, à quoi je me heurte comme contre une vitre confondue avec la transparence du paysage, avec sa fadeur, avec sa monotonie mais qui, à se briser, provoque en soi un choc d’autant plus saisissant qu’il se donne le pouvoir de me réveiller en changeant soudain l’échelle du détail, quand je comprends qu’il n’est pas un détail.
Comment l’espace, investi maintenant comme pure extériorité, ne deviendrait-il pas aussi oppressant, aussi agressif, aussi flippant qu’un poison, à convier dans son tumulte non seulement le jeu des hallucinations, des spectacles, des supplices, des cruautés les plus atroces, mais l’emprise tragique du pouvoir sur soi, parce que, précisément, les choses prennent autant que de vie que les hommes ?
Seul le temps maintenant, le remède, s’il se constitue symétriquement en pure intériorité, en se détachant de la chronologie qu’indiquent les horloges pour relancer en soi son énergie créatrice et l’élasticité infinie de sa durée, pourrait permettre de se défendre contre la toxicité spatiale et la toxicomanie, sa conséquence nécessaire à quoi chacun paie sa rançon, d’une manière ou d’une autre. Lieu de résistance paradoxal, puisqu’il ne se situe pas dans l’espace, il délimitait au regard de Bergson une ligne de front d’autant plus stratégique que de sa résistance dépendaient les enjeux les plus vitaux – le seul moyen de s’en sortir – alors qu’il élaborait la théorie d’une sorte de guerre entre temps et espace, à séparer la vie concrète, éprouvée dans sa qualité et dans sa volonté pures, de la vie abstraite, sans vécu réel, restreinte en somme à des paramètres quantifiables : succès, fortune, notoriété, maîtrise, science, etc., mais qui n’empêchent pas le sentiment de perdre sa vie et de se nourrir d’illusions pieuses ou cyniques.
Te rappelles-tu ce qu’on nous disait de la Métaphysique d’Aristote ? Avant lui, l’erreur des matérialistes croyant par l’analyse trouver la réalité dans la matière, l’erreur des platoniciens la cherchant en dehors de la matière dans des abstractions ; Aristote comprenant qu’elle ne peut être dans une abstraction, qu’elle n’est pas pourtant la matière elle-même mais ce qui, en chaque chose individuelle, est en quelque sorte derrière la matière, le sens de sa forme et la loi de son développement, demandait Proust à Fernand Gregh.35 Ce qu’on nous disait de la Métaphysique d’Aristote, ou plutôt celui qui en nous disait, s’il lui fut un maître en philosophie, n’appartenait pas pour autant au corps enseignant du lycée Condorcet ou de la faculté de droit mais au cercle familial et au privilège qu’il lui conférait alors – car voilà à quoi se rapporte le souvenir de ce commentaire d’Aristote, encore qu’il faille remonter jusqu’au 7 novembre 1892, et à la vingt et unième année de Proust, pour le retrouver, lorsqu’il invitait Gregh à venir dîner ce soir lundi, à 7 heures précises, seul avec M. Bergson et surtout pas en habit.36
Geliebte Grossmutter… écrivait-il à Adèle Weil, le 5 février 1881, pour lui fêter son anniversaire. « Chère Grand-mère… » Proust n’avait pas encore dix ans. On pouvait sûrement trouver alors, dans la maison d’Auteuil, une vieille bible où un enfant pouvait apprendre l’allemand. N’était-ce pas la langue que parlaient les Weil dans le ghetto de Niedernai jadis (mais il n’y avait pas non plus si longtemps) et qu’ils parlaient encore parfois entre soi, y compris avec les Bergson ? Bible où l’enfant pouvait lire : Und Abraam gab diesem Ort den Namen « Gott sieht », von dem man noch heute sagt, auf dem Berg : Gott lasst sich sehen : « Et Abraham donna à ce lieu le nom de “le Seigneur a vu”, de sorte qu’on dit aujourd’hui, sur la montagne : le Seigneur veille. »37 Berg : Gott ; non pas le mont de Dieu, mais le mont nommé Dieu, où il pourvoit – où il fait voir et en fait voir. Autrement dit en hébreu le mont Moriah, le manifeste de Yah, où l’ange empêcha Abraham de sacrifier son fils Isaac et où s’élèverait Jérusalem. L’allégorie de la littérature, l’écrivain même en langue proustienne : Bergotte.
Et Proust de reprocher à Gaston Gallimard : Ils ne se sont pas aperçus que chaque fois que je parle des romans de Bergotte, on a imprimé les romans de Bergson, en le priant d’en aviser les correcteurs du Côté de Guermantes, en l’occurrence Jacques Rivière et André Breton. Monsieur (le charmant dada qui a revu les épreuves et dont le nom m’échappe par amnésie d’un instant) a cru lire. Jacques Rivière a cru lire !38 Cependant l’incident de cette coquille tenait au fait que la famille de Berek Zbitkower en passant de Pologne en Angleterre avait changé son nom en Berekson, et qu’en s’installant à Paris dans les années 1860 les Berekson changèrent à nouveau leur nom, sans doute pour le rendre plus harmonieux à des oreilles françaises, encore qu’ils sollicitaient comme Swann un anglicisme et qu’ils y impliquaient comme lui un écho en allemand, en prenant le patronyme de Bergson, autrement dit fils du mont. Songeaient-ils au mont du Temple ? Qui sait ? Posez-vous la question avec le même flair que le grand-père du Narrateur : Avant de les avoir vus, rien qu’en entendant leur nom qui, bien souvent, n’avait rien de particulièrement israélite, il devinait non seulement l’origine juive de ceux de mes amis qui l’étaient en effet, mais même ce qu’il y avait quelquefois de fâcheux dans leur famille.
« Et comment s’appelle-t-il ton ami qui vient ce soir ?
– Dumont, grand-père.
– Dumont ! Oh ! je me méfie. » Et il chantait :
« Archers, faites bonne garde !
Veillez sans trêve et sans bruit. »39
Sans quoi Bergotte, en langue proustienne, ne pourrait pas signifier « le livre » ». Il implique entre Proust et son lecteur l’échange du même signe qu’entre Swann et l’enfant de Combray, un signe donné à déchiffrer comme un hiéroglyphe qui, s’il est l’auteur de mes tristesses, ne me donne pas moins mes joies.
Le mont du Temple, jadis, créait le seul lieu où approcher Yah et respirer ses parfums. « À partir de Jéricho on sentait déjà l’odeur des parfums », rapporte la Mischna.40 Transcrite au début de l’ère chrétienne, elle gardait encore la mémoire vivante du Temple. « Puisque, dans ce lieu saint, on égorgeait chaque jour beaucoup d’animaux, qu’on y découpait et brûlait des chairs, et qu’on y lavait les intestins, il est certain que, si l’on l’avait laissé dans cet état, il aurait exhalé une odeur pareille à celle des boucheries », concevait Maïmonide.41 Le Temple maintenait des rites de sacrifices et de stupéfaction semblables, au moins en cela, à ceux des cultes païens. Fallut-il la destruction de Jérusalem en 586, et que le roi de Babylone crevât les yeux du roi de Juda, pour que la lecture du texte saint prît une place aussi exclusive dans la pensée juive, précisément en exil à Babylone, lorsqu’à partir de fragments épars une école rassembla et édita la Bible.
Si le Temple fut reconstruit, s’il recréait son phare au judaïsme, s’il rediffusait ses parfums en convoquant le pèlerinage annuel pour la Pâque, il n’empêchait pas la dispersion d’Israël jusque très loin – en Afrique du Nord, en Espagne, mais également en Perse, en Grèce, en Italie – quand le Cantique des cantiques, maintenant, comparait Israël à une femme et Yah à son amant. Suffisait-il à son odeur d’émaner de la lecture du texte saint, où qu’elle ait lieu. Et, s’il lui commandait de respecter sa loi, il ne lui promettait pas moins le plaisir. « Qu’il me baise des baisers de sa bouche ! Car tes amours sont meilleures que le vin. »42 Admettre un chant aussi profane dans le canon de la Bible offensait la noblesse juive. Que Dieu puisse produire de la jouissance en mettant Israël dans une position féminine n’allait pas de soi. Accepter une telle position bouleversait la symbolique de la Loi. La destruction du second Temple, la défaite de la Judée contre Rome, la fin de la noblesse juive, l’émiettement d’Israël jusqu’en Inde, jusqu’au Sahara, jusqu’en Gaule, soulevèrent la révolution de l’ère talmudique. Dieu, désormais, prenait la présence d’une source d’où s’épanchaient sa justice, son amour et ses soins. « Comment savons-nous que la Chekhina soutient le malade ? » demandait Rabbi Anan. « Parce qu’il est dit : L’Éternel, au-dessus de son lit de douleur, le soutient.43 »44 Et s’évadait-elle de la coupe à fumigations de Proust pour répandre les effluves qui suppléaient à son infirmité. « Rabbi Simon ben Johaï disait : “Vois comme les enfants d’Israël sont chers au Saint, béni soit-il ; partout où ils sont exilés la Chekhina les accompagne : lorsqu’ils étaient en Égypte, la Chekhina était avec eux, puisqu’il est dit : Ne me suis-je pas révélé aux tiens lorsqu’ils étaient en Égypte ?45 Lorsqu’ils étaient à Babylone, la Chekhina est demeurée avec eux : À cause de vous, j’ai été envoyé à Babylone.46 Lorsqu’ils seront libérés, la Chekhina les accompagnera de la même façon, car il est dit L’Éternel, ton Dieu, te prenant en pitié, reviendra de ton exil.47 »48
Bergson ne l’oubliait pas quand il invoquait la source de vie en quoi consistait le temps qu’il inventait. Les lumières allumées pour le chabbat, le partage du pain et du vin appelaient la bénédiction de la Chekhina sur la table et sur tous ceux qu’elle rassemblait. Le rite ne commandait pas qu’un jour de repos hebdomadaire, il formait de nouvelles habitudes mentales à quoi adhérait une masse où se mêlaient tous les peuples de l’Empire, hommes libres et esclaves confondus. « Cette coutume d’une race exécrée a si bien prévalu qu’elle est déjà reçue par toute la terre : les vaincus ont donné leurs lois aux vainqueurs », déplorait Sénèque. Toutefois, il remarquait : « Les Juifs connaissent les raisons de leurs rites ; mais la majeure partie de la nation fait tout cela sans savoir pourquoi elle le fait. »49 Pourtant, s’il était assez facile alors, sous Néron, de distinguer les « Juifs sans le savoir » des Juifs proprement dits – soumis au fiscus judaïcus, l’impôt qui les exemptait de sacrifier au culte de l’empereur –, cette masse plus ou moins judaïsante, déjà si nombreuse au ier siècle à en croire Sénèque, ne célébrait pas le rite du repas sabbatique sans y éprouver du plaisir, quitte à s’épargner de régler la taxe par quoi l’on se déclarait délibérément et publiquement juif. Cependant la dispersion d’Israël dans les campagnes où les Juifs travaillaient encore majoritairement, par tradition, à la culture du vin, de l’olivier, du palmier dattier et à l’élevage pastoral, organisait une société qui n’était guère homogène, répartie en communautés que seules unissaient la lecture du texte saint et la rançon volontaire du fiscus judaïcus, de sorte qu’il existait déjà une gamme très étendue de couleurs « juives ».
Tous les samedis, comme Françoise allait dans l’après-midi au marché de Roussainville-le-Pin, le déjeuner était pour tout le monde une heure plus tôt, raconte le Narrateur. Cette avance du déjeuner donnait au samedi, pour nous tous, une figure particulière, indulgente, et assez sympathique. Au moment où d’habitude on a encore une heure à vivre avant la détente du repas, on savait que, dans quelques secondes, on allait voir arriver des endives précoces, une omelette de faveur, un bifteck immérité. Le retour de ce samedi asymétrique était un de ces petits événements intérieurs, locaux, presque civiques qui, dans les vies tranquilles et les sociétés fermées, créent une sorte de lien national.50 Il restitue ce temps, il y a plus de deux mille ans, où le chabbat inaugurait la célébration d’une fête à la « maison », loin du faste spectaculaire du Temple et de ses sacrifices.
Les fleurs rassemblées par millions, cousues en myriades de guirlandes ou réunies en tapis le long des rues et sur les parvis des temples ou des églises rappellent encore en Inde ou Amérique latine le même faste. Les pétales serrés en masse tendent à la foule le miroir de sa piété, à déchaîner leurs parfums, à dégorger leurs couleurs. Les jaunes, les oranges, les rouges qui au soleil passent le seuil d’une saturation affolante pleurent bientôt de pathétique, en un dernier ressort chromatique, avant qu’avec la nuit les illuminations des cierges et des torches ne reprennent le relais d’une nouvelle passion de la couleur, à s’allier à l’ombre, à vibrer, à chatoyer, à lancer les flèches qui serrent le cœur. Cette piété n’est plus requise au chabbat qu’à l’état d’une miniature. Deux bougies, quelques pétales. À Constantine, jadis, pour fêter Pourim, les familles juives dressaient une petite table où seuls les enfants pouvaient s’asseoir. La vaisselle, les couverts sortaient des « dînettes ». Le mobilier, le linge, jusqu’aux aliments, les cailles, les pommes de terre, les fruits, les pâtisseries réduits à la même taille enfantine, naturellement nains ou remodelés pour se soumettre à la loi qui semblait avoir rétréci toute chose à mes proportions, provoquaient le ravissement, l’enchantement qui me laissait entrevoir que j’étais juif, par exception à la règle commune. Toutefois, en signalant la même exception, par le souvenir d’un rite qui ramène à soi la même sorte d’enchantement, le Narrateur n’affirme pas pour autant qu’il l’est. Comment pourrait-il l’affirmer ? Il se laisse seulement hanter par cette hallucination.
Si elle produit un cauchemar, elle ne retient pas moins la pression de la joie, son goût, son odeur, son tact, même s’ils frôlent à peine le souvenir. Le rite du samedi commande une fête que l’enfant apprécie, où il reconnaît les siens, mais par une attache dont la consistance n’évoque rien d’angoissant ni d’infamant. Rite devenu laïque en somme, fondu au paysage de la campagne française, il ne sollicite plus la Chekhina ni sa bénédiction ; ou, s’il la sollicite, c’est par l’épanchement du flux rassurant qui drape l’étoffe familiale et la tend comme la nappe du déjeuner sur la table, en lui donnant le sentiment de sa cohésion, de sa solidité, de sa confiance en soi. Dès le matin, avant d’être habillés, sans raison, pour le plaisir d’éprouver la force de la solidarité, on se disait les uns aux autres avec bonne humeur, avec cordialité, avec patriotisme : « Il n’y a pas de temps à perdre, n’oublions pas que c’est samedi ! » cependant que ma tante, conférant avec Françoise et songeant que la journée serait plus longue que d’habitude, disait : « Si vous leur faisiez un beau morceau de veau, comme c’est samedi. » Si à dix heures et demie un distrait tirait sa montre en disant : « Allons, encore une heure et demie avant le déjeuner », chacun était enchanté d’avoir à lui dire : « Mais voyons, à quoi pensez-vous, vous oubliez que c’est samedi ! » ; on en riait encore un quart d’heure après.51 Cette insistance à prononcer ce nom samedi, à le faire sonner, à le répéter à plaisir, à restituer l’allégresse qu’il suscitait chez les siens, enclenche un vertige dont le Narrateur ne semble pas conscient. Mais, là encore, comment pourrait-il l’être ? Le Narrateur vit sous l’emprise d’un auteur qui transpose le chabbat dans une maison dépourvue de mémoire juive, sauf quand l’intrusion de Swann la réveille, mais en provoquant aussitôt une crise où cette mémoire des profondeurs, à affleurer, se rend insupportable. Le transport crée forcément un traumatisme, même si l’enfant ne le perçoit que dans le flou perpétuel qui l’entoure.
Le déjeuner du samedi à Combray ne remet pas moins en jeu la mémoire de Proust. Seulement, le transport, à présent, emprunte une autre voie et un autre véhicule. Il n’est plus conditionné par une montée brutale d’adrénaline mais par la diffusion lente de l’endorphine. Le Narrateur agit alors comme sous hypnose : il transmet à son lecteur le signe qu’il est juif sans pour autant le prendre en compte. Une fois l’échange accompli, il ne s’en souviendra plus. La surprise d’un barbare (nous appelions ainsi tous les gens qui ne savaient pas ce qu’avait de particulier le samedi) qui, étant venu à onze heures pour parler à mon père, nous avait trouvés à table, était une des choses qui, dans sa vie, avaient le plus égayé Françoise. Mais si elle trouvait amusant que le visiteur interloqué ne sût pas que nous déjeunions plus tôt le samedi, elle trouvait plus comique encore (tout en sympathisant du fond du cœur avec ce chauvinisme étroit) que mon père, lui, n’eût pas eu l’idée que ce barbare pouvait l’ignorer et eût répondu sans autre explication à son étonnement de nous voir déjà dans la salle à manger : « Mais voyons, c’est samedi ! »52 Le signe vous est confié. À vous de le saisir ou de l’ignorer, peu importe. Cela ne concerne plus le Narrateur. Cela ne se passe plus qu’entre Proust et soi.
La transposition, le jeu de ses sentiments et de ses résonances, jusqu’en ce qu’elles portent de plus douloureux, de plus choquant, ou de plus plaisant, de plus exaltant, à offrir son moteur à la Recherche, ne lui désignent pas moins son objet et son sujet. Comment transposer ? Comment s’en sortir ?
La tradition du sabbat rural initiée par les esclaves des villas alexandrines ou romaines, maintenue par les serfs des domaines féodaux puis par les peuples des campagnes, s’est prolongée jusqu’au xxe siècle, en terre chrétienne comme en terre d’islam. On en trouve encore des traces aujourd’hui. Lors d’une enquête ethnologique, Patrick Pardo assista à un sabbat en Bretagne dans les années 1990, sabbat véhiculé par-delà les millénaires dans sa forme la plus archaïque, démoulée du chabbat proprement dit et vécue comme au degré zéro du judaïsme, pourtant étonnamment vivante encore. À l’issue de la récolte des pommes, le fermier invite ses ouvriers à se partager la « bouteille à signe », le jilgré, un cidre où l’on a fait macérer des graines et des feuilles de datura, selon une recette hallucinogène tout aussi archaïque, et décidément proustienne sans le savoir. « Cette société très provisoirement égalitaire se révèle symboliquement par le fait qu’avant la stigmatisation hygiéniste, relativement récente, le verre unique de service que l’on se passait de main en main a longtemps été l’affirmation implicite d’un “sans classe” (ou plutôt “hors classe”) rassemblant pendant et après les travaux, agricoles ou non, les hommes d’où qu’ils viennent. »53 Le parcours de la « bouteille à signe » n’ordonne pas pour autant une communion spectaculaire, mais le resserrement dans la nuit, la bonne humeur que soulève la drogue, comme dans une free party actuelle en somme. Ces rites pratiqués au niveau le plus populaire, associés à un monde hallucinatoire habité par des génies familiers, redoutables ou favorables, mais toujours facétieux et retors, les djinns en Orient, les dibbouks en Europe, nourrissent la littérature talmudique depuis près de deux mille ans. « Tournons un feuillet, et des recettes magiques nous entrons dans la magie pure », observait Darmesteter en se penchant sur une page du Talmud. « Elle vous racontera les faits et gestes des démons qui mangent et boivent, vivent et meurent, se reproduisent comme nous autres mortels, partageant en cela la faiblesse humaine, mais qui sont ailés, se transportent en un instant par tout l’univers, connaissent l’avenir, et, invisibles, peuvent prendre toute forme qui leur plaît. »54 Retrouvez-les à Combray. S’ils projettent leurs figures monstrueuses sur les murs d’une chambre d’enfant, ils ne possèdent pas moins le don de se retourner comme un gant et de se rendre aimables. Voilà les dealers qui ne cessent de parcourir vos veines, vos nerfs, votre cerveau, et de jouer à la Bourse du bien-être ou du mal-être, mais ils disposent encore du pouvoir de modifier tout ce qui vous entoure, pour le doter de sa portée signifiante, en le distordant, en le contractant, en l’enflant, en le faisant respirer en quelque sorte, comme un être vivant, sans quoi l’espace ne pourrait pas vous toucher.
Jadis, les dieux façonnaient les yeux, la bouche, les doigts, l’anus, bref le corps de l’espace, démultiplié en autant de corps qu’il se trouvait de partenaires pour vous rendre son activité sensible, vous laisser mesurer sa puissance, sa fureur, son indomptabilité, mais vous permettre aussi de vous le concilier, du moins de l’approcher, de l’amadouer, de le flatter. Il restait toujours terrorisant, mais les dieux disposaient encore du don d’absorber l’espace comme des buvards, de lui imposer des directives, et en somme un gouvernement qui, s’il conservait un caractère imprévisible, dément et cruel, n’était plus aussi effrayant en s’acquérant une visibilité, une peinture, une esthétique – imaginaire, hallucinatoire, hypnotique, activée au fond de soi par les mêmes dealers, mais pas moins fonctionnelle, si elle rassurait.
« L’Antiquité classique n’a jamais surmonté le sentiment que l’espace immatériel était quelque chose d’étranger et d’hostile, même, au monde des formes tangibles », notait Panofsky. « Aux époques préhellénistiques, on avait traduit cet espace immatériel, dans les peintures comme dans les bas-reliefs, par une surface opaque, esthétiquement négative ; et même après qu’Empédocle et Anaxagore eurent découvert que l’air était une substance matérielle, les artistes continuèrent à interpréter l’espace comme un composé de solides et de “vides”, plutôt que comme la modification d’un continuum unique. »55 Que le « vide », que le « rien » pût être de la même nature que le « plein », que le « corps » en se comprenant dans la même consistance qui créait son unité ontologique à l’espace, cette idée, si elle pouvait être admise en théorie, ne trouvait pas pour autant d’expression formelle dans l’art gréco-romain, pas plus que dans l’art chrétien. Un artiste, alors, ne pouvait observer que des corps, mais pas un « paysage ».
Ce qu’on appelait la terre, c’est-à-dire non seulement le sol mais le ciel, le cosmos, se confondait avec les corps des dieux, des saints, des princes qui en se détachant de leur enveloppe charnelle, transitoire et mortelle, s’interposaient entre l’espace et le regard pour fournir au monde sa signifiance, sa règle, sa loi. L’art du paysage proprement dit, libéré de toute allégorie, n’apparut en Hollande qu’au milieu du xviie siècle, à partir du perfectionnement des chambres noires, encore qu’il ne dépendait pas moins de la révolution de la première république moderne quand elle s’instaura aux Pays-Bas. Vermeer n’aurait pas pu peindre la Vue de Delft – le plus beau tableau du monde, selon Proust – sans cette révolution technique, théologique et politique.
Spinoza qui fut, dit-on, l’ami de Vermeer, qui aurait même pu lui fournir ses objectifs de prises de vue, ne produisait pas pour autant de paysage en philosophie, bien qu’il participât de près à la même révolution. Cette audace reviendrait à Kant, encore que Spinoza dépeuplait déjà la nature des corps spectaculaires de ses dieux, pour leur substituer un bouillonnement de passions opérant comme les génies et les démons du Talmud. À se miniaturiser, à se rendre invisibles, ils soulevaient le rideau qui, en faisant disparaître le grand spectacle du divin, décidément trop sucré, sécrétait l’art de Vermeer où ces génies, ces démons prenaient de tout autres qualités, pour diffuser les vapeurs, les scintillements, les miroitements qui signifiaient seuls, désormais, comme en faisant basculer le dedans au dehors, à produire une vue photographique d’un réalisme prodigieux, mais qui ne semblait si prodigieux que parce qu’elle pénétrait dans les replis d’un espace mental où personne jusqu’alors n’était jamais entré, pas même les chirurgiens hollandais qui autopsiaient le cerveau du Christ sous le regard de Rembrandt.
C’étaient de ces chambres de province qui – de même qu’en certains pays des parties entières de l’air ou de la mer sont illuminées ou parfumées par des myriades de protozoaires que nous ne voyons pas – nous enchantent des mille odeurs qu’y dégagent les vertus, la sagesse, les habitudes, toute une vie secrète, invisible, surabondante et morale que l’atmosphère y tient en suspens, raconte le Narrateur,56 en me sidérant par la même espèce de prodige en littérature, sans l’aide d’aucun appareil technique, ni objectif de prises de vue, ni pinceau, ni toile, sans allégorie, sans relent spectaculaire, par la seule signifiance de sa voix, de son élan, de son écho affectif, au devoir de réinventer la vue par d’autres moyens que la vue. Écoutez : Un petit coup au carreau, comme si quelque chose l’avait heurté, suivi d’une ample chute légère comme de grains de sable qu’on eût laissés tomber d’une fenêtre au-dessus, puis la chute s’étendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musicale, innombrable, universelle : c’était la pluie.57 Concevez qu’en réalité l’enfant de Combray est aveugle – sans le savoir. Le saurait-il qu’il aurait aussitôt l’envie d’appeler sa mère au secours. Seulement il rêve qu’il voit.
Cela arrive souvent aux aveugles. Durant leur sommeil ils oublient qu’ils ont perdu la vue. Comment ne l’oublieraient-ils pas puisqu’en rêvant ils voient ? Mais un aveugle de naissance n’a pas la moindre idée de son infirmité. Il n’a jamais quitté le rêve. Pourquoi ne verrait-il pas ? Faut-il que sa mère le lui explique ou qu’il le déduise de lui-même. Ce n’est pas facile. Car, même s’il conçoit que ses représentations spatiales ne lui parviennent pas par les réseaux de son nerf optique mais par ceux de ses autres sens, son univers mental ne lui restitue pas moins une « vision ». L’enfant finit tout de même par le comprendre quand il se heurte à l’objet qui lui laisse imaginer en quoi consiste sa malédiction. Si on éloigne le petit quand on reçoit du monde, ce n’est pas sans raison. Une cécité de naissance, plus encore que l’asthme, en langue médicale alors, signifiait la tare et convoquait en soi la théorie de la dégénérescence. Mais encore la cataracte congénitale et le glaucome, causes les plus fréquentes de la cécité des enfants, leur donnaient des « yeux de bœuf » qui les rendaient repoussants, maléfiques, diaboliques. Voilà le cauchemar qui réveille le petit Marcel, encore qu’il ne se cogne pas réellement contre un objet, mais contre Swann, en qui il reconnaît aussitôt un autre aveugle, à se représenter mentalement la cécité.
Ma mère fit remarquer qu’il avait pourtant l’air bien moins triste depuis quelque temps. « Il fait aussi moins souvent ce geste qu’il a tout à fait comme son père de s’essuyer les yeux et de se passer la main sur le front. »58 Ce tic nerveux de Swann, la plupart des aveugles de naissance s’y soumettent. Leurs yeux sans usage fonctionnel leur deviennent un jouet, un outil de plaisir. Ils les touchent, les manipulent, les enfoncent dans leurs orbites. Un médecin y détecterait aussitôt le symptôme le plus manifeste du « blindisme » en terme clinique. Pour autant, Swann ne sait pas qu’il est aveugle. Ou, s’il le sait, il fait semblant ne pas le savoir. Mais, vous qui lisez, n’oubliez pas non plus que vous avez perdu la vue. Vous ne vous en rendez pas compte, seulement maintenant vous agissez comme l’enfant de Combray, frappé par la même malédiction, hanté par le même cauchemar.
Les feuilles, ayant perdu ou changé leur aspect, avaient l’air des choses les plus disparates, d’une aile transparente de mouche, de l’envers blanc d’une étiquette, d’un pétale de rose, mais qui eussent été empilées, concassées ou tressées comme dans la confection d’un nid. Mille petits détails inutiles – charmante prodigalité du pharmacien – qu’on eût supprimés dans une préparation factice, me donnaient, comme un livre où on s’émerveille de rencontrer le nom d’une personne de connaissance, le plaisir de comprendre que c’était bien des tiges de vrais tilleuls.59 Cette assiette remplie de branches de tilleul, si je la vois à présent, ne doit rien à ma vision optique. Si, en ce moment, mes yeux détectent des caractères d’imprimerie, ils opèrent comme des doigts qui effleurent des notes sur un clavier. La lettre ne désigne que l’expression d’un son. En lisant, je joue d’un instrument. Je convertis les signes d’une partition sonore en message vocal en requérant le compagnon qui me raconte ce qui se passe autour de moi. Si je voyais, je n’aurais pas besoin de lui. Ce que me répercute la page, à mesure que les mots défilent, n’est que le miroir de ma cécité, quand à présent un guide s’installe à mes côtés. Sans son récit, je serais plongé dans l’obscurité de signes sans signification. L’assiette n’est ressuscitée que par sa voix. Si elle me touche, c’est que précisément il ne se contente pas de me livrer une information visuelle, comme le faisait Balzac, mais qu’il prend les branches et qu’il les palpe. Tiens, on dirait l’aile transparente d’une mouche, l’envers blanc d’une étiquette, un pétale de rose. Qu’est-ce que cela peut être ? C’est comme s’il me passait l’objet en sollicitant mon propre toucher, à enclencher le phénomène hallucinatoire qui me restitue l’objet en volume, en texture, en senteur, en saveur. Faut-il l’approcher de mes narines, de mes lèvres, pour que m’apparaisse enfin l’image de la tige de tilleul. Sans quoi, la lecture de la Recherche ne serait pas aussi stupéfiante : elle m’apprend que je suis aussi aveugle que le Narrateur.
Je faisais quelques pas du prie-Dieu aux fauteuils en velours frappé, toujours revêtus d’un appui-tête au crochet ; et le feu cuisant comme une pâte les appétissantes odeurs dont l’air de la chambre était tout grumeleux et qu’avait déjà fait travailler et « lever » la fraîcheur humide et ensoleillée du matin, il les feuilletait, les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense « chausson » où, à peine goûtés les arômes plus croustillants, plus fins, plus réputés, mais plus secs aussi du placard, de la commode, du papier à ramages, je revenais toujours avec une convoitise inavouée m’engluer dans l’odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et fruitée du couvre-lit à fleurs.60 Les images visuelles, les ramages du papier peint, les fleurs du couvre-lit, si elles surgissent – et encore sans jamais quitter le flou –, ne se forment qu’à la fin du cheminement où il m’a fallu d’abord sentir la chambre, la flairer, la repérer, et me laisser instruire par les sens qui suppléent à ma cécité. La vision de l’espace ne se reconstitue pas moins, mais d’une tout autre manière que si j’avais encore des yeux pour voir.
Quant aux yeux crevés, justement la Synagogue est aveugle, fait remarquer Charlus au Narrateur.61 L’invention des ampoules électriques a ôté une part de son charme au chabbat. Pourtant la présence d’une lampe, ne serait-ce qu’une veilleuse toute la nuit dans sa chambre, est si pénible qu’il vaut mieux ne rien allumer du tout. On s’habitue très bien à vivre dans la nuit. Elle détend, elle caresse, elle embrasse. Encore qu’il est des familles pieuses qui préfèrent utiliser des bougeoirs, mais pour se déplacer dans le noir cela ne sert pas à grand-chose : on ne peut porter aucune charge ce jour-là, pas même un bougeoir, pas même une clef. On ne peut porter que ses propres vêtements, des aliments ou des livres, parce qu’ils réjouissent sans « peser », mais pas non plus faire porter le poids d’une charge par d’autres. Au septième jour, Dieu s’est assis, à la lettre du mot du chabbat : s’asseoir. On dit plus volontiers s’abstenir – sans allusion sexuelle, puisque au contraire il est recommandé aux époux de faire l’amour ce jour-là. « Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l’étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. »62 Cependant, s’il inaugurait le droit au soulagement, au loisir, aux vacances, s’il asseyait les maîtres et les serviteurs autour de la même table pour appeler sur soi la bénédiction de la Chekhina, le rite ne laissait pas moins éprouver la cécité.
Grand repos, mystérieuse rénovation pour Swann – pour lui dont les yeux quoique délicats amateurs de peinture, dont l’esprit quoique fin observateur de mœurs, portaient à jamais la trace indélébile de la sécheresse de sa vie – de se sentir transformé en une créature étrangère à l’humanité, aveugle, dépourvue de facultés logiques, presque une fantastique licorne, une créature chimérique ne percevant le monde que par l’ouïe,63 quand la vie prend la qualité que requérait Proust, parce qu’alors la vie, en effet, change radicalement, en faisant appel à de tout autres circuits neurologiques que ceux que sollicitent les « clairvoyants ».
Le respect du chabbat, aujourd’hui, commande au moins de ne plus regarder la télévision. Suffit-il de la débrancher pour faire aussitôt tomber la nuit autour de soi. Le Talmud conseille pourtant de se divertir, mais sans céder à la tentation d’assister à un spectacle, quel qu’il soit, comme si la pesanteur dont il fallait de se libérer prenait la consistance de la fonction optique et du regard « public ».
À la fin des années 1880, Mme Straus présenta Proust au comte et à la comtesse d’Haussonville. Historien, membre de l’Académie française, il était l’arrière-petit-fils de Mme de Staël. Sa femme, que Proust appréciait beaucoup et qu’elle n’appréciait pas moins, tenait « l’une des plus hautes positions du faubourg Saint-Germain ». Dès lors, et durant des années, il fréquenta de loin en loin leur salon rue Saint-Dominique ; il en fit le thème d’une des chroniques qu’il livra au Figaro en 1904. Il rencontrait régulièrement chez les d’Haussonville le comte de la Sizeranne, un homme du monde qui, sur le boulevard des Invalides, venant de l’Institut des jeunes aveugles où il enseignait, ne passait pas inaperçu parmi les passants tandis qu’il rejoignait la rue Saint-Dominique. Son visage présentait des orbites enfoncées, dépourvues d’yeux. À l’âge de neuf ans, à la suite d’un jeu qui avait mal tourné, il avait dû subir ce que les chirurgiens appellent une « énucléation bilatérale ». L’industrie des prothèses oculaires n’en était encore qu’à ses balbutiements. Il ne s’en souciait pas. « Les paupières closes de l’aveugle ou ses yeux atrophiés vous causent une impression triste et même pénible », écrivait-il. « Mais, cette première impression surmontée, plus vous avancerez dans la connaissance d’un aveugle, plus vous serez à votre aise. »64 Son ouvrage venait de paraître, alors, en 1889 : Les Aveugles par un aveugle, préfacé par le comte d’Haussonville. « Un aveugle, remarquait d’Haussonville, passe dans la société pour un être inférieur, incomplet, auquel il ne manquerait pas seulement un sens précieux, mais dont les facultés intellectuelles seraient en quelque sorte atrophiées et engourdies. C’est contre ce préjugé que M. de la Sizeranne a voulu protester. »65 Les aveugles se rangent naturellement aux côtés des Juifs et des sodomites parmi les Saturniens, Proust y reconnaissait les siens, en quelque sorte.
Dire « l’église est à cinq minutes d’ici » ou « par là, à cinq cents mètres » revient au même pour un clairvoyant, mais pour un aveugle parcourir « cinq cents mètres » n’a aucun sens. Cinq cents mètres où ? Dans quelles conditions ? Avec quelle prise de risque ? Il exprimera forcément la distance par l’évaluation d’une durée. Faut-il encore qu’il s’aventure dans un lieu et qu’il y repère une succession d’accidents de terrain, d’événements sonores, d’émanations olfactives, en intégrant ses sensations pour se représenter mentalement le lieu. Pour autant, il ne pourra pas dissocier le temps de l’espace.
Voilà une carte postale. Vous voyez aussitôt qu’elle représente une église. Si vous sortiez d’une voiture, vous vous diriez de la même façon : me voilà arrivé place de l’Église. Un aveugle ne peut pas le constater immédiatement. Certes, un compagnon pourra toujours lui dire, comme Balzac à son lecteur : « Vous êtes sur la place de l’Église. » Mais, s’il découvre la place, l’information ne lui dira rien. Elle restera théorique tant qu’il n’aura pas déchiffré l’espace comme un hiéroglyphe. « Nous disons déchiffrer, et l’image n’est pas exagérée ; c’est bien un véritable texte de hiéroglyphes ou d’inscriptions en caractères inconnus que l’on a devant soi », expliquait Darmesteter devant une page du Talmud. « Cela est si vrai que les Juifs eux-mêmes, pour qui cette étude offre bien plus de facilité, n’emploie que ce mot : déchiffrer. »66 L’aveugle est un talmudiste. À cause de quoi je m’avançais dans l’église, quand nous gagnions nos chaises, comme dans une vallée visitée des fées, où le paysan s’émerveille de voir dans un rocher, dans un arbre, dans une mare, la trace palpable de leur passage surnaturel, tout cela faisait d’elle pour moi quelque chose d’entièrement différent du reste de la ville : un édifice occupant, si l’on peut dire, un espace à quatre dimensions – la quatrième étant celle du Temps, note le Narrateur.67
Si, dans cette nef, chaque siècle depuis mille ans produit sa réverbération, renvoyée par la texture d’une tapisserie, le marbre d’un tombeau, le métal d’une pièce d’orfèvrerie comme par les instruments d’un orchestre, en singularisant l’espace et son action sur soi, parce qu’alors il y ressent jusqu’à fleur de peau les effluves du Temps, le Narrateur ne vit pas moins dans un monde où quatre dimensions semblent naturelles, « où les pierres sautent, où les couleurs jouent et rient, où les arbres se battent, gémissent, pleurent », expliquait Pierre Villey68 qui, à la suite de Maurice de la Sizeranne dont il fut l’élève, publia en 1914 Le Monde des aveugles.
La haie laissait voir à l’intérieur du parc une allée bordée de jasmins, de pensées et de verveines entre lesquelles des giroflées ouvraient leur bourse fraîche, du rose odorant et passé d’un cuir ancien de Cordoue, tandis que sur le gravier un long tuyau d’arrosage peint en vert, déroulant ses circuits, dressait, aux points où il était percé, au-dessus des fleurs dont il imbibait les parfums, l’éventail vertical et prismatique de ses gouttelettes multicolores. Tout à coup, je m’arrêtai, je ne pus plus bouger, comme il arrive quand une vision ne s’adresse pas seulement à nos regards, mais requiert des perceptions plus profondes et dispose de notre être tout entier.69 S’il s’invente un double romanesque, le Narrateur ne ment pas pour autant quand il dit qu’il voit. Les parfums des fleurs, pris dans le même flot, mais dont il détache les espèces comme les arômes contenus dans un vin, les proportions des massifs que les senteurs précisent, le chuintement de la pluie répandue par le tuyau d’arrosage, le ressort de son humidité, le bruissement des feuilles dans les arbres, le clapotement de l’eau lui modèlent le volume d’un jardin autour d’un bassin. Il y détecte soudain l’odeur d’une jeune fille, son effronterie, sa vibration. Elle provoque une chaleur, un enlacement, une sensation de tétée, de succion. Cette odeur délicieuse, à mesure qu’il la perçoit et qu’il la détaille, recompose la sphère du paysage en se confondant avec le visage de la jeune fille, associée au parfum des aubépines de la haie où il se tient. Mais s’il s’avance dans la brèche entre les aubépines, tâtant le terrain avec son bâton jusqu’au bord du fossé, s’immobilisant pour mieux l’inhaler, il expose le visage d’un adolescent charmant, mais dont les yeux vitreux, d’un blanc laiteux, à son corps défendant, portent « le mauvais œil » – à moins qu’on l’ait énucléé, ce qui est plus probable, pour lui éviter d’être trop repoussant. L’adolescent passe encore l’essentiel de sa vie à Combray. Ses parents évitent, autant que possible, de le confronter au monde urbain, même s’il entrera bientôt dans la classe de M. de la Sizeranne, quitte à déménager près du boulevard des Invalides. Maintenant il n’ignore plus rien de sa malédiction. À le frapper, elle l’atteint comme la pire des injustices, puisqu’en réalité il voit. Il « voit » à sa manière, mais aussi bien, sinon mieux, que les clairvoyants.
Je la regardais, d’abord de ce regard qui n’est pas que le porte-parole des yeux, mais à la fenêtre duquel se penchent tous les sens, anxieux et pétrifiés, le regard qui voudrait toucher, capturer, emmener le corps qu’il regarde et l’âme avec lui ; puis tant j’avais peur que d’une seconde à l’autre mon grand-père et mon père, apercevant cette jeune fille, me fissent éloigner en me disant de courir un peu devant eux, d’un second regard, inconsciemment supplicateur, qui tâchait de la forcer à faire attention à moi, à me connaître !70 Il a grandi depuis le soir où il a compris en quoi consistait son infirmité. À treize ou quatorze ans, on le traite encore comme un petit enfant. Comment pourrait-il séduire une jeune fille ? La question se pose brutalement. Elle le surprend par sa volupté. Elle le hantera longtemps. Il ne prend pas moins le pari d’écrire le roman d’un aveugle.
Les nouveaux venus qui étaient des écrivains directs, de sensibilité, se seraient fait scrupule de ne pouvoir tout dire, remarquait Proust.71 Quand il découvrait ce que signifiait « manger en papier », il admirait un art intellectuel qui s’ingéniait à taire beaucoup de ce qu’il voulait dire.72 Si son narrateur avouait explicitement qu’il est aveugle, le roman ne serait plus un roman. Ce serait une étude comme celle de M. de la Sizeranne, à vocation savante, militante, généreuse, dont la lecture fournit sûrement à Proust des renseignements précieux, voire l’idée de la Recherche, seulement pour lui il s’agit de réaliser tout autre chose, à quoi personne n’a jamais songé.
« Allons, Gilberte, viens ; qu’est-ce que tu fais ! » cria d’une voix perçante et autoritaire une dame en blanc que je n’avais pas vue.73 L’écho sonore recompose le volume du paysage, la coloration en blanc de la dame précise une sphère négative qui travaille comme une gomme à effacer un dessin. « Dans certains cas, la coloration a une odeur, une saveur qui avertissent l’aveugle de sa présence. Ou une différence de tissu, de forme, de dimension, de poids », expliquait La Sizeranne. « Voici deux chaises semblables, recouvertes toutes deux de soie, de perse, de velours, peu importe, mais l’une en rouge, l’autre en vert ; l’une est un peu plus lourde que l’autre. Quand un clairvoyant voudra désigner ces choses, il dira : la rouge, la verte. Il n’aura même pas remarqué que la verte pèse trois ou quatre cents grammes de moins que la rouge ; qu’elle a une petite différence de moulure, ou que le velours en est plus râpé ; qu’un clou manque à sa garniture. L’aveugle, lui, saisit immédiatement cette différence ; il la retient ; il rapproche dans sa mémoire la dimension tangible de la dimension visible. » Le Narrateur n’agit pas autrement. « Vous le priez d’approcher la chaise rouge ou la chaise verte, il n’hésitera pas pour choisir le siège demandé, il dira aussi, comme vous : “Je me suis assis sur la chaise rouge”, parce qu’il sait que, vivant avec les clairvoyants, il doit parler leur langue. »74
Sans quoi le Narrateur ne pourrait pénétrer comme une espèce d’agent double dans le monde où l’on a des yeux pour voir, en prenant soin toutefois de partager avec son lecteur, par la perception des « petites différences » dont parlait son maître, le signe qu’il est aveugle. Signe que personne ne voit parmi les clairvoyants. La métaphore, si elle est requise comme au chabbat, n’implique pas moins d’éprouver vraiment de loin en loin l’absence de la fonction optique, avec la nécessité d’une intrigue parallèle, sous-jacente au récit visuel ; une intrigue seulement palpable, passée d’une main à l’autre entre Proust et soi, intrigue maintenue le plus souvent à distance, pourtant toujours là, sécrétant la cohérence du roman, à renvoyer aux conditions d’existence d’un véritable aveugle, à son apprentissage de la vie, à son univers sentimental.
Ainsi passa près de moi ce nom de Gilberte, donné comme un talisman qui me permettrait peut-être de retrouver un jour celle dont il venait de faire une personne et qui, l’instant d’avant, n’était qu’une image incertaine. Ainsi passa-t-il, proféré au-dessus des jasmins et des giroflées, aigre et frais comme les gouttes de l’arrosoir vert.75 Que Giberte l’ait désiré, il en est certain. Cela fait longtemps qu’il entend parler d’elle. Il sait qu’elle est blonde, qu’elle a la peau semée de petites taches roses, qu’elle ressemble également à Swann et à Odette, que Bergotte l’emmène visiter les cathédrales, etc. Autant d’informations qui, associées à ce qu’il a senti d’elle, la lui représentent comme à un regard optique, même si elle demeure dans un brouillard proprement proustien. S’il l’avait effrayée, dégoûtée ou apitoyée, elle n’aurait pas diffusé une telle odeur, d’autant qu’elle est à peine nubile. Le Narrateur possède un don merveilleux qui échappe aux clairvoyants. L’odeur charnelle d’une femme lui parvient presque aussitôt qu’elle l’émet. Il excite Gilberte, comment en douterait-il ? Ce relent se charge d’une joie qui ne ressemble à aucune autre, comme si un phare s’allumait et dardait son rayon jusqu’à soi, porté par une force incomparable à celle des effluves floraux. Il ne ment pas, non plus, quand il évoque le geste obscène de Gilberte. Il traduit seulement ses représentations mentales en langue visuelle – encore que la scène qu’il me laisse imaginer semble assez improbable. Gilberte paraît trop petite pour se comporter aussi crûment devant un jeune homme du monde. En revanche, on conçoit plus facilement que, prise au dépourvu par le regard de l’aveugle tâtonnant avec son bâton à travers la brèche entre les aubépines, et par le choc spectaculaire qu’il cause, elle ne se soucie plus de pudeur. En exposant la volupté que soulève le parfum qu’elle répand avec d’autant plus d’énergie qu’il l’excite et qu’elle se découvre cette fièvre sexuelle sans pouvoir la contrôler, un garçon d’une telle innocence la séduit, au sens le plus concret, même s’il n’a pas moins le visage d’un Saturnien. Il le déchiffre en détaillant et comme en effeuillant son odeur. Mais le vocabulaire des clairvoyants est si restreint en matière olfactive qu’il recourt naturellement à la couleur pour préciser ce qu’il flaire, et en quoi les odeurs, autrement dit les « regards » en langue d’aveugle, venant d’une personne, induisent nécessairement une psychologie.
Elle laissa ses regards filer de toute leur longueur dans ma direction, sans expression particulière, sans avoir l’air de me voir, mais avec une fixité et un sourire dissimulé, que je ne pouvais interpréter d’après les notions que l’on m’avait données sur la bonne éducation, que comme une preuve d’outrageant mépris. Il devine que Gilberte se masturbe en l’observant, chose qu’elle ne ferait sûrement pas, du moins pas de la même manière s’il avait des yeux, ce qui la stimule d’autant plus. À se concentrer, à virer à l’aigre, l’arôme le lui apprend. Sa main esquissait en même temps un geste indécent auquel, quand il était adressé en public à une personne qu’on ne connaissait pas, le petit dictionnaire de civilité que je portais en moi ne donnait qu’un seul sens, celui d’une intention insolente.76 Il ne tombe pas moins amoureux d’elle.
Il constate qu’il excite les femmes, qu’il les excite sexuellement, et qu’il génère les arômes qui le font jouir, du moins qu’il en est responsable, sans pouvoir faire le partage entre ce qui est proprement obscène dans sa séduction, et proprement « naturel ». La malédiction lui a conféré une beauté dont il ignore la consistance. « Je ne sais pas trop ce qui est beau. À part la beauté. La beauté, je suis sûr que c’est beau », disait un enfant aveugle. « La mer, c’est très beau, à cause de l’odeur, du bruit des vagues, et aussi des coquillages qu’on trouve quand on creuse dans le sable. Ce qui est important dans la beauté, c’est l’odeur et la douceur. » Le Narrateur ne fait pas de différence entre un visage et un paysage, si ce n’est que l’on peut tenir un visage entre ses mains, cependant il forme comme un paysage en miniature. On n’a jamais fini de le déchiffrer. Le Narrateur n’éprouve que des parcours, des voyages, des explorations. S’aventurer dans un lieu ou faire la connaissance d’une personne, cela revient au même, c’est comme pénétrer une sphère et recevoir des ondes qui, dans l’un ou l’autre cas, produisent le même genre d’effets sur la peau ; des ondes douées de la même sorte de mobilité tactile, thermique, olfactive, sonore agissant sur soi malgré soi – pas plus qu’il ne perçoit de différence entre l’odeur d’une femme et la couleur de ses yeux, de ses cheveux, de sa peau.
Si le sens de la vue lui manque, il ne le comprend qu’en théorie. Se heurter à un objet, se cogner contre un mur, trébucher dans un escalier, c’est sûrement pénible, mais cela n’apprend rien sur la vision. Savoir ce en quoi consiste vraiment « voir » ne cesse de l’intriguer, d’autant qu’il saisit à présent ce que veut dire « être amoureux ». Et de se confier à son lecteur. Ne partagent-ils pas la même infirmité, ou le même don, car le lecteur, non plus, ne fait pas la différence, quand il lit, entre l’odeur et la couleur.
Ses yeux noirs brillaient, et comme je ne savais pas alors, ni ne l’ai appris depuis, réduire en ses éléments objectifs une impression forte, comme je n’avais pas, ainsi qu’on dit, assez d’« esprit d’observation » pour dégager la notion de leur couleur, pendant longtemps, chaque fois que je repensais à elle, le souvenir de leur éclat se présentait aussitôt à moi comme celui d’un vif azur, puisqu’elle était blonde de sorte que, peut-être si elle n’avait pas eu des yeux aussi noirs – ce qui frappait tant la première fois qu’on la voyait – je n’aurais pas été, comme je le fus, plus particulièrement amoureux, en elle, de ses yeux bleus.77 « Vif azur », « noir » signifient en langue d’aveugle une nuance aromatique, une hauteur de fréquence dans un éventail olfactif, avec une direction de regard, l’animation d’une pensée portée sur soi, à y percevoir autant de degrés et de qualités que dans un prisme.
Le manque d’esprit d’observation dont il fait part, à rendre sa langue visuelle si déroutante et si attachante, lui rappelle qu’il ignorait encore, alors, quand il la « vit », que les yeux de Gilberte étaient noirs, frappants justement parce qu’on ne s’y attend pas dans une nature blonde. L’information visuelle qui lui est parvenue depuis lors s’amalgame au récit, pour le rendre plus exact, en recomposant rétrospectivement la scène de leur première rencontre. Quand je lis, à visualiser les lieux et les personnes, j’agis comme lui. Je rectifie en permanence ma configuration des choses et des êtres. Je ne le fais pas moins dans la vie courante. Les yeux noirs de Gilberte, il les voyait sans les voir, mais il préférait observer des yeux bleus. Toutefois, ses yeux noirs le frappaient à leur manière, à confondre précisément la couleur noire avec la qualité pornographique que Gilberte lui a laissé entrevoir par l’un des relents de son parfum charnel.
Cette année-là, quand, un peu plus tôt que d’habitude, mes parents eurent fixé le jour de rentrer à Paris, le matin du départ, comme on m’avait fait friser pour être photographié, coiffer avec précaution un chapeau que je n’avais encore jamais mis et revêtir une douillette de velours, après m’avoir cherché partout, ma mère me trouva en larmes dans le petit raidillon, contigu à Tansonville, en train de dire adieu aux aubépines, entourant de mes bras les branches piquantes. Des parents ne pourraient pas se comporter de cette manière avec un adolescent pubère, s’il n’était pas aveugle. Lui non plus. « Ô mes pauvres petites aubépines, disais-je en pleurant, ce n’est pas vous qui voudriez me faire du chagrin, me forcer à partir. »78 La scène semble ridicule si l’on n’entrevoit pas le mode d’existence d’un garçon qui, à treize ou quatorze ans, n’a encore jamais été scolarisé, même si sa mère et sa grand-mère ont veillé de près à son éducation, sans pour autant se rendre compte qu’il est devenu un homme. « Il est rare à la vérité que l’enfant aveugle trouve dans sa famille, pauvre ou riche, une bonne éducation. Parfois on le méprise, on le relègue dans un coin, et il souffre matériellement ou moralement. Parfois, au contraire, il est choyé, adulé ; tous les membres de sa famille sont à ses pieds. Chacun se plie à ses moindres caprices ; comment voudrait-on qu’un enfant ainsi élevé ne devînt pas insupportable ? La cécité n’est pas un talisman contre l’orgueil », remarquait La Sizeranne.79
Le Narrateur n’est pas orgueilleux. Seulement il sait qu’il est séduisant. Peu importe qu’on lui ait retiré ses yeux morts, qu’on le coiffe comme une poupée, qu’on l’habille avec élégance, qu’on le photographie comme pour lui suggérer qu’il est présentable, voire aimable ; même avec « le mauvais œil », il n’en a jamais douté. On voit avec son corps, on peut très bien se passer d’yeux. En réalité, on voit avec ses capteurs sensibles et ses neurotransmetteurs.
Sa mère et sa grand-mère envisagent maintenant de le faire entrer à l’Institut des jeunes aveugles. Elles ont déjà entrepris des démarches en ce sens. Elles m’aimaient assez pour ne pas consentir à m’épargner de la souffrance, elles voulaient m’apprendre à la dominer afin de diminuer ma sensibilité nerveuse et fortifier ma volonté.80 Cela bouleverse les habitudes. Jusqu’à présent, la vie était réglée. On passait l’hiver à Paris. Et, dès que les beaux jours arrivaient, on partait pour Combray, où sa mère et sa grand-mère s’occupaient entièrement de lui, tandis que son père regagnait Paris pour ses affaires et rejoignait de loin en loin les siens. Mme Proust se conformait aux mêmes habitudes quand elle s’installait avec ses enfants à Auteuil chez ses parents, en laissant à son mari le choix – rester boulevard Malesherbes où il avait son cabinet ou les retrouver à la campagne (ce qui était alors la campagne). De sorte que l’image du père du Narrateur s’égare toujours dans une vapeur opaque, qu’il soit présent ou non dans le récit. J’ignore en quoi consistent ses traits. Quelle est la couleur de ses yeux ? La forme de son nez ? Sa pilosité ? Barbu ? Chauve ? Il ne s’est jamais laissé caresser le visage par son fils. En revanche, je me fais une idée assez exacte de son volume, car il s’impose par la voix.
Combray, de loin, à dix lieues à la ronde, vu du chemin de fer quand nous y arrivions la dernière semaine avant Pâques, ce n’était qu’une église résumant la ville, la représentant, parlant d’elle et pour elle aux lointains. Pourtant cette église, je ne pourrais pas non plus dire à quoi elle ressemble exactement vue de l’extérieur, à l’exception de son clocher. Lui, en revanche, je le vois. Si je disposais de pâte à modeler, je pourrais le reconstituer en réduction pour vous le montrer, parce qu’il sonne en me réverbérant le paysage, tenant serrés autour de sa haute mante sombre, en plein champ, contre le vent, comme une pastoure ses brebis, les dos laineux et gris des maisons,81 justement comme un clocher miniature posé sur une couverture de laine donnés à toucher.
« L’enfant aveugle qui n’a jamais vu un édifice, une maison, un bœuf, un navire, etc., n’aura de ces choses qu’une idée très vague si vous vous bornez à lui en faire la description », expliquait La Sizeranne. Voilà encore ce que Proust reprochait à Balzac. « Monuments, animaux, plantes, etc., doivent être mis entre ses mains, afin qu’il se rende compte de toutes leurs particularités. Sans doute il est difficile d’introduire dans une classe la colonne Vendôme ou un éléphant du Jardin des Plantes, mais il existe des jouets très bien faits qui représentent tout cela en carton ou en d’autres substances, et l’on s’en sert pour ce genre d’enseignement. »82 Les clairvoyants ne les requièrent pas moins. Les poupées existent depuis toujours, mais la mode des petits trains, des petites voitures, des maquettes en tout genre, survenue à Paris au xixe siècle, a probablement été portée par la nécessité, pour les enseignants du boulevard des Invalides, de faire fabriquer ces objets pour leurs élèves. Aveugles ou non, ils attirent tous les enfants. Ils y éprouvent le même plaisir.
« Allons, prenez les couvertures, on est arrivé. » Et dans une des plus grandes promenades que nous faisions de Combray, il y avait un endroit où la route resserrée débouchait tout à coup sur un immense plateau fermé à l’horizon par des forêts déchiquetées que dépassait seule la fine pointe du clocher de Saint-Hilaire.83 Vous vouliez le savoir ? – Eh bien, la vision, c’est la découverte de quelque chose de si grand, de si vaste qu’il vous faut d’abord le sentir en miniature. N’hésitez pas, enveloppez, palpez tant que vous voudrez le modèle réduit du clocher posé sur votre couverture. Voilà un paysage. Seulement, vous ne pouvez pas vous en tenir là. Il vous faut partir en promenade, aller sur le terrain du paysage, repérer à loisir un parcours à votre bâton, et faire attention à la sonnerie du clocher tous les quarts d’heure, en se rappelant la maquette sur la couverture. Vous entendez ? Intégrez les résonances de la cloche jusqu’au plus lointain à tout ce que vous voyez déjà, le vent, l’humidité, les odeurs, etc., pour comprendre en quoi consiste la vision des clairvoyants. Regardez à présent le pointe du clocher si mince, si rose, qu’elle semblait seulement rayée sur le ciel par un ongle.84 Ce faisant, Proust agit comme un professeur à l’Institut des jeunes aveugles, à solliciter une impression tactile, l’ongle qui chatouille la paume de ma main, pour l’amplifier d’images visuelles, mais qui ne dépendent pas moins du toucher.
Regardez cette table. Je m’y assois. Je passe la main sur la nappe. Je la lisse. Je sens que la table est plate. Mais plus je déplace la main vers la droite, plus je fais d’effort pour aller le plus loin possible, plus je sens que la table épouse une forme courbe remontant peu à peu jusqu’à la verticale sous mes doigts. Je déplace la main vers la gauche, en faisant le même effort : même sentiment. Un aveugle de naissance a l’impression d’être assis au centre d’une sphère. Au bout de ses doigts, l’espace s’arrondit pour se perdre en une sorte de brume. Ses mains forment le centre de la sphère. S’il manipule une fourchette, il la verra se modeler comme en matière translucide, où il reconnaît un métal, une forme, un manche, des dents. Ses doigts détecteront des détails infimes. Mais à la retourner, à la redresser, à la mettre dans tous les sens, pour enregistrer ses paramètres, il inscrira la fourchette dans la sphère virtuelle de ses mains. S’il la fait tinter contre une assiette, la sphère de la fourchette se remplira d’un son qui illuminera sa matière translucide, superposée à la sphère de l’assiette, mais se distinguant d’elle.
S’il la pose sur la table devant soi, la fourchette lui apparaîtra à plat, mais toujours entourée de sa sphère. S’il l’éloigne pour la passer à son vis-à-vis, alors il lui semblera que le nimbe de la fourchette remonte peu à peu la courbe de table, en diminuant de taille. Quand il ne pourra plus la toucher qu’avec le bout d’un doigt, elle lui apparaîtra comme un petit astre suspendu à la verticale. Si son vis-à-vis s’en saisit, l’astre s’effacera comme en s’éloignant dans le brouillard. Si son vis-à-vis la fait cogner contre un verre, alors la sphère de la fourchette s’éclairera à nouveau comme une lune où la fourchette se loge et se meut à l’état fœtal, en quelque sorte, plus ou moins lointaine, selon son intensité sonore, se déplaçant suivant la direction du son, si bien qu’un dîner fourmillera d’astres intégrant la vision.
Si l’on place un plat chaud au centre de la table, un aveugle verra surgir une grande étoile colorée par ses ondes thermiques – en noir pour le Narrateur, la couleur frappante, signal qu’il faut s’approcher de l’objet avec précaution. Cependant les odeurs du plat le coloreront autrement. Il irradiera bientôt. (Encore qu’il ne s’agit pas de couleurs optiques, ce n’est qu’une manière de parler.) Les perceptions se réfractent comme en projetant un film en soi. Seulement, pour un aveugle, la « salle de cinéma » forme l’intérieur d’une boule, où les objets ne cessent de remonter des pentes courbes, pour se diluer dans un ciel d’un blanc opaque, à resurgir comme des étoiles, des nuées, des galaxies portées par des vagues sonores, olfactives, sentimentales, etc., en déployant cette espèce de membrane émanée d’une infinité de bulles plus ou moins gonflées, plus où moins caressantes, plus ou moins mobiles, qui le touche en permanence. Toutefois, cette sphère ne lui restitue pas moins son environnement familier, naturel, banal, en somme. Comment vous dire cela ? Vous savez qu’il y a une géométrie plane et une géométrie dans l’espace. Eh bien, pour moi, le roman ce n’est pas seulement de la psychologie plane, mais de la psychologie dans le temps. Cette substance invisible du temps, j’ai tâché de l’isoler, disait Proust.85 Le temps que concevait Kant, et Bergson à sa suite, le temps dessine l’englobement d’un pur intérieur sensible. Mais qu’est-ce qu’un dessin ? Pour entrer vraiment dans son intériorité, faut-il que je reconstitue son mode d’existence et que je le vive au plus intime depuis l’instant de sa naissance.
L’enfant de Combray ne vit que dans un univers courbe. Le trajet que la pointe de son bâton balise lui trace un chemin en terrain à peu près plat ; mais au-delà, hors de portée du bâton, l’espace s’arrondit vertigineusement autour de soi, comme le vitrail qu’il observe à l’église, qu’il ne peut décrire que parce qu’il rend compte de sa vision : elle tremblait et ondulait en une pluie flamboyante et fantastique qui dégouttait du haut de la voûte sombre et rocheuse, le long des parois humides, comme si c’était dans la nef de quelque grotte irisée de sinueuses stalactiques que je suivais mes parents.86 Seul le rappel du clocher en modèle réduit sur la couverture de laine lui rappelle que Combray se situe sur un immense plateau. Cependant, cela reste très mystérieux, un monde aussi plat.
Sauf en chemin de fer – parce que, sur les rails, les roues du wagon roulent si vite que l’espace s’étend devant soi comme la nappe sur la table. Vous comprenez pourquoi il vaut mieux prendre le chemin de fer pour se faire une idée de la vision des clairvoyants. Là, pour se déplacer, un bâton est inutile, la matière du train assure la continuité entre la main et le sol. La vitesse, le frissonnement continu qu’elle provoque font que la main semble lisser la nappe sans jamais rencontrer autre chose que du plat ; du moins tant que le train ne freine pas pour entrer en gare et s’arrêter, parce qu’alors, là, c’est comme si l’on se retrouvait soi-même à l’horizontale, en remontant une courbe vertigineuse.
Ainsi, de gare en gare, on passe d’une boule à l’autre. Quand il repart, le train descend la pente d’une nouvelle sphère, immense, mais une sphère tout de même, qui semblera plate à pleine vitesse pour se recourber ensuite dans l’autre sens. En réalité, l’espace ne cesse jamais d’être courbe. Allez savoir pourquoi les clairvoyants imaginent qu’il est plat. Comment font-il pour ne pas se rendre compte de ces montées et de ces descentes si vastes, si stupéfiantes, si émouvantes, quand le train passe d’une sphère à l’autre ? L’indicateur des chemins de fer, le plus enivrant des romans d’amour, songe Swann.87 Il a bien raison. Swann ne pourrait pas le concevoir s’il n’était pas aveugle, même s’il n’en parle jamais et si tout le monde croit qu’il est clairvoyant.
J’aurais surtout voulu être aussi chauve, confie l’enfant à son lecteur.88 Car il a palpé le visage de Swann. Il l’a « photographié ». Il a détaillé ses lèvres, sa moustache, son nez busqué de Juif. Il a caressé son front remontant si haut qu’il semble ne plus finir, suivant une courbe où un duvet à l’odeur rousse se réduit à une soie à peine palpable, mais délicieuse, frémissante sous le doigt, avant de laisser la place à une grande masse bombée splendidement lisse, solide et mélodieuse, tiède et rassurante, arrondie d’une chevelure bouclée courant en arc de cercle d’une oreille à l’autre autour de sa nuque. La peau d’une calvitie est si douce. Swann est sûrement très beau. S’il se dégarnissait autant que lui, s’il façonnait son nez en lui donnant la même courbure juive, peut-être que lui aussi parviendrait à voir comme les clairvoyants, à parler leur langue, à agir de la même façon ?
Swann apprendra à l’enfant que devenir aussi chauve que lui ne servirait à rien dans ce dessein, et qu’il n’est pas non plus un véritable aveugle, encore qu’il sache entendre et parler leur langue. N’empêche, c’est à ce crâne si doux que le Narrateur reconnaît Swann sous ses doigts.
« Toutes les précautions dont Proust s’entoure pour dire que Haas n’est pas Swann montrent assez qu’il a voulu cacher que Haas était Swann », présumait Michel Braudeau.89 Cependant, pour l’enfant de Combray, Swann exposait une calvitie aussi franche que celle de Flaubert ou de Cézanne, bien loin du personnage que j’imaginais jusqu’à présent, lequel se confondait, en effet, avec Haas, le jeune homme aux cheveux blond-roux et à l’élégance charmante peint par James Tissot dans Le Cercle de la rue Royale, saisi comme aujourd’hui sur le papier de Vogue ou de Harper’s Bazar par un grand photographe de mode. L’enfant pouvait bien me signaler qu’il aurait voulu être aussi chauve que Swann, je ne voyais pas pour autant sa calvitie. L’information semblait se contredire par ailleurs. Elle créait encore une incongruité, une détonation, un de ces détails incompossibles propres à Proust dont il valait mieux ne pas se soucier, parce que je ne comprenais pas ce qu’il me signifiait, ni pourquoi il distinguait Swann entre tous.
« Si la sensibilité est une sorte de guitare que nous avons en nous-mêmes et que les objets extérieurs font vibrer, on a tant raclé sur cette pauvre mienne guimbarde que quantité de cordes en sont cassées depuis longtemps, et je suis devenu sage parce que je suis devenu vieux. Beaucoup de cheveux vous réchauffent la cervelle : or, me voilà chauve », constatait Flaubert.90 Il n’était pourtant pas si vieux : il n’avait que trente-deux ans alors, en 1853, quand il livrait cette confidence. Swann atteint à peu près le même âge, et le même état d’âme, lorsque débute le roman. « Je ne peux pas dire comme je trouve que Swann change, dit ma grand-tante, il est d’un vieux ! » Ma grand-tante avait tellement l’habitude de voir toujours en Swann un même adolescent, qu’elle s’étonnait de le trouver tout à coup moins jeune que l’âge qu’elle continuait à lui donner.91 Ce n’est jamais agréable de perdre ses cheveux. Swann n’en avait déjà plus beaucoup quand il rencontra Odette. Elle le constate elle-même : « Il n’est pas régulièrement beau, si vous voulez, mais il est chic : ce toupet, ce monocle, ce sourire ! »92
« L’alopécie s’établit peu à peu sur la surface entière du vertex, mais elle s’y prononce inégalement. Les deux angles frontaux-temporaux de la dépilation, en s’arrondissant peu à peu, tendent à se rejoindre l’un à l’autre, derrière un îlot de cheveux restés solides au sommet du front et que la langue vulgaire appelle “le toupet” », précisait le docteur Sabouraud, dans une étude de la calvitie publiée en 1902. Le processus décalvant, lui parmi d’autres, mais lui avec une cruauté particulière, parce qu’il touche directement au visage et aux critères de son esthétique, offre une mesure au temps. « De plus en plus rongé sur les bords, le toupet en arrive à une forme indécise ovalaire. Finalement il disparaît, réduit à une touffe de quelques cheveux rares, dont quelques-uns s’obstineront à demeurer solides. »93 Si Swann a pris le même tic que son père, tic que l’enfant confond avec le sien, c’est qu’à ramener sa main de ses yeux à son front il se plaît à caresser sa calvitie jusqu’à la nuque. C’est une disgrâce, mais c’est aussi une douceur.
« Ce pauvre Swann, il est toujours gentil, mais il a l’air bien malheureux », songe Oriane94 le soir où elle le rencontre chez Mme de Saint-Euverte. Peu lui importe qu’il soit devenu tout à fait chauve, Swann l’attire toujours autant – oui mais comme un morceau de sucre, par son goût. Cependant la disgrâce de son visage, la duchesse ne peut pas ne pas la remarquer, elle coïncide avec sa passion pour Odette : il y a laissé sa jeunesse, sa gaieté, sa désinvolture. Voilà, il ressemble maintenant à son père.
Les boucles rousses qui s’accrochent à ses oreilles lui donnent l’air d’un rabbin, avec un nez imposant, de toute évidence, puisqu’il semblera finalement énorme et tuméfié sous les doigts du Narrateur. Objectivement, de l’extérieur, Swann est laid, selon les critères communément admis. En tout cas, il n’est pas joli, joli ! assure Brichot.95 Seulement, le Narrateur ne le voit qu’avec ses mains. Arrivée à son terme, à n’épargner de la chevelure qu’une bordure découpée comme au compas, la calvitie de Swann s’accorde parfaitement avec le volume de ses mains. Pour un aveugle, toucher une sphère, ne serait-ce qu’une demi-sphère, c’est merveilleux. On comprend que Swann se laisse volontiers masser le crâne par l’enfant. Désormais, il est le seul, avec Oriane, à pouvoir le trouver « beau ».
Si ses doigts glissent si bien sur la peau de Swann, c’est à cause de l’excès de sébum, à quoi il doit d’être chauve. Imaginez-le avec les traits de Cézanne dans ses autoportraits quand il n’hésite pas à faire miroiter les courbures de son nez et de son crâne, tandis que les mains du Narrateur, à polir le même crâne, se représentent les traits délicats, d’une élégance exquise, de l’homme du monde le plus raffiné de Paris.
« Il y avait là toute une juiverie malpropre, de grasses faces luisantes, des profils desséchés d’oiseaux voraces, une extraordinaire réunion de nez typiques », observait Zola96 en décrivant la Bourse dans L’Argent. Le temps assignait à la laideur la tâche de modeler si universellement et si profondément l’âme et le corps du Juif que Nietzsche – lui si persuadé pourtant d’échapper à cet édifice mental – s’y soumettait à son tour en examinant Socrate : « On sait, on voit même combien il était laid. » Socrate était aussi chauve que Swann. « Mais la laideur, objection en soi, est presque une réfutation chez les Grecs. En fin de compte Socrate était-il un Grec ? »97 Et de conclure : « Le socratisme, c’est le journalisme juif : je n’en dis pas plus. »98
Nucingen et à sa suite tous les Juifs qui investissaient la littérature française au xixe siècle exposaient des traits d’une laideur repoussante, du moins selon les règles classiques. À se représenter un Juif beau, le narrateur proustien bouleversait les données du temps, encore qu’il ne caressait pas moins un visage cézannien. Il est vrai qu’en poussant Lucien Leuwen dans les salons aristocratiques d’une ville de garnison française, Stendhal avait déjà songé à inventer un beau Juif, mais ce Swann avant la lettre – cette espèce de Rothschild de seconde génération, fait aux manières de l’ancienne noblesse comme Heine ou Haas, séduisant par son dandysme autant que par son intelligence – demeurait encore clandestin, couché sur les pages d’un roman qui resta inachevé. Il n’eut pas moins un retentissement considérable quand les héritiers de Stendhal le publièrent, d’abord en 1855 dans une version tronquée, puis en 1896 en totalité. Encore qu’il faille à son lecteur associer le nom de Leuwen – « lion » en flamand – à l’emblème de David qui, avant qu’Israël ne se reconnaisse dans l’étoile, donnait son symbole de la nation juive ; savoir que les Juifs des Pays-Bas prirent volontiers ce patronyme, synonyme de Juif en quelque sorte, lorsqu’ils s’enregistrèrent à l’état civil, en l’épelant généralement Leven ou Lewin ; et enfin entrevoir dans les traits de Leuwen père ceux de James de Rothschild, pour lui supposer une telle filiation, car explicitement Stendhal n’affirme jamais que son héros est juif. Ce fait, qui n’est pourtant pas anodin et que le roman ne cesse de commenter en le contournant, passe inaperçu au regard de la plupart de ses lecteurs, aujourd’hui encore.
Le portrait de Haas parmi les dandies du faubourg Saint-Germain à la fin du Second Empire, dans le Cercle peint par Tissot, ressuscite le charme et la psychologie du héros stendhalien. Il renvoie l’image de Swann à seize ans, au collège, avec Charlus. Dans ce temps-là il avait un teint de pêche et, ajouta-t-il en mettant chaque syllabe sur une autre note, il était joli comme les amours.99 Les Guermantes gardent cette image en tête, parce qu’ils ont caressé Swann, en pensée et en actes. Les années passant, elle s’inscrit toujours dans la « sphère » de Swann, image fœtale en somme, qui fait qu’il reste le favori d’Oriane, car sous les doigts, comme le Narrateur, elle retrouve en lui la même douceur de peau.
« La calvitie, qui passe dans l’opinion publique pour un signe de sénilité précoce, n’est pas une maladie de vieillard, c’est une maladie des jeunes, des très jeunes gens », notait Sabouraud. « Les plus précoces s’annoncent à seize ans, commencent nettement à dix-huit, et ont amené la dénudation totale du vertex à un âge qui varie entre vingt et trente ans. »100 Cela est arrivé à Swann comme à Cézanne. Cela n’a rien d’exceptionnel.
« Dans sa jeunesse, Maurice de Rothschild, dit Momo, était très joli garçon », racontait la duchesse de Clermont-Tonnerre. Le Narrateur entendra parler de lui : Ces stupides abréviations sont un signe de l’incompréhension que l’aristocratie a de sa propre poésie (le judaïsme a d’ailleurs la même puisqu’un neveu de Lady Rufus Israël, qui s’appelait Moïse, était couramment appelé dans le monde : « Momo ».)101 Voilà le cousin germain de Swann, à moins que ce ne soit son frère. « Ses parents, pour l’enlever aux coûteuses étreintes des dames de Paris, l’envoyèrent explorer l’Abyssinie », précisait la duchesse. « Il manqua mourir de la dysenterie et perdit ses cheveux. Aujourd’hui, un peu épaissi, il a l’air d’un rajah. »102 Proust l’a assez bien connu, bien mieux qu’il n’a connu Haas. Montesquiou l’adorait. Il avait beaucoup de succès. On le surnommait « don Juan de Rothschild ». Proust comparait sa beauté à celle d’Ida Rubinstein, la vedette de la troupe des Ballets russes. Si Heine ou Haas en leur temps profilaient déjà le don Juan juif, ils étaient loin d’être aussi beaux et aussi admirés que Maurice de Rothschild. Albert Cohen qui apercevait des fenêtres de son bureau à la Société des Nations le parc de Prégny, la résidence genevoise du baron, reconnaissait en lui son Solal. Mais s’il fut un grand séducteur, il aima toujours la même femme, comme Solal, jusqu’au dernier jour – sa cousine par alliance, Emma de Gramont, fille du duc de Lesparre. À cause des différences de religion, on ne pouvait envisager un mariage. Son père, le baron Edmond, le mécène du mouvement sioniste, avait accepté de financer une expédition montée par Joseph Halévy et Jacques Faitlovitch en Éthiopie auprès des Falashas (les Juifs éthiopiens dont on ne savait alors presque rien). Comme son fils s’intéressait à la botanique et à l’entomologie autant que Proust, le baron eut l’idée d’organiser une mission scientifique qui doublait la mission auprès des Falashas et il lui proposa d’en prendre la direction afin de s’éloigner de Paris et d’oublier Mlle de Gramont. L’expédition dura deux ans. Il n’oublia pas la jeune fille, devenue entre-temps la princesse Pierre d’Arenberg. Cependant, à son retour, en 1906, il avait vingt-cinq ans alors, il était chauve.
Le soir du dîner de Combray, Swann provoque le même effet spectaculaire. La grand-tante du Narrateur n’en revient pas. Toutefois, dans le récit qu’il en tire, l’enfant répercute l’image de Swann que sa mère et sa grand-mère lui ont décrite, celle d’un jeune homme coiffé à la Bressant (c’est-à-dire par un crêpelage qui dissimule sa tonsure naissante). Si les conversations qu’il surprend lui apprennent que Swann a changé, il ignore en quoi consiste le changement. Et il l’ignorera jusqu’au jour où il touchera son crâne et se rendra compte de sa douceur. Si à Paris, ensuite, Swann retrouve parfois sa chevelure, c’est que le Narrateur masque la calvitie de son éducateur, comme il masque sa propre cécité.
La nécessité de traduire la langue d’un aveugle en langue visuelle ne dédouble pas seulement le corps du Narrateur mais ceux de tous les êtres qui l’entourent, Swann en particulier. Il lui faut recomposer leur image en les adaptant aux critères esthétiques des clairvoyants mais en leur gardant les qualités qu’il y perçoit ; quitte à dérouter, inévitablement, son lecteur. Avec l’art d’un grand prothésiste, il se donne des yeux pour voir en même temps qu’il restitue à Swann une chevelure – au moins virtuelle, lorsque Swann va dans le monde ou qu’il en reçoit –, pour l’habiller, pour lui donner une consistance mondaine qui, sans renier sa douceur, distingue son élégance, encore qu’elle se conforme à des stéréotypes qu’il n’apprécie guère. Toutefois, à Combray, on ne s’habille pas ; du moins on ne fait pas autant d’efforts que dans un salon. Voilà déjà en quoi le côté de Guermantes s’oppose au côté de chez Swann. Chez lui, Swann se passe volontiers des soins de son coiffeur. Il ne peut s’empêcher de caresser sa calvitie. Elle le rend affreux, du moins elle lui rappelle son père, mais de la toucher, de la lisser, c’est agréable. Cette espèce de massage produit une sensation dont il ne se doutait pas qu’elle lui plairait autant, à découvrir en lui la douceur qu’il ignora si longtemps. Geste d’intérieur, forcément, mais à Combray, chez des voisins qu’il connaît depuis toujours, il peut se montrer comme dans son intérieur.
Observez Charles Haas photographié par Nadar. Il ne semblerait pas aussi chic s’il n’était pas poudré. Les hommes du monde se poudraient alors couramment comme au xviiie siècle. Leiris, Sachs ou Cocteau se conformaient encore à cette habitude dans les années trente. « Faites attention ! Vous allez lui mettre de la poudre de riz ! » disait Mme de Chevigné à Cocteau pour épargner à son petit chien d’éternuer.103 Imaginez un grand entonnoir en carton que l’on ajustait autour du visage préalablement enduit de fond de teint. Un domestique n’avait plus qu’à diffuser lentement la poudre qui, en s’imprégnant, donnait à la peau l’aspect d’une soie douce, mais sèche. La poudre ne gommait pas seulement les rides, les tâches, les verrucosités, elle éliminait les luisances en harmonisant le volume du front, des pommettes, du nez, du menton, avec le même effet qu’un lifting. Se rendre dans un salon, alors, obligeait les hommes du monde à se soumettre aux mêmes contraintes plastiques, quitte à révéler, lorsqu’on les approchait de près, l’artifice des cosmétiques et des postiches, au besoin. Cette habitude remontait très loin dans le temps. Elle a disparu à mesure que la chirurgie esthétique a pris son relais – encore qu’aujourd’hui, si vous êtes invité sur le plateau d’une émission de télévision, une maquilleuse ne vous enduira pas moins le visage de fond de teint et de poudre. Les « salons » inventaient la télévision avant la lettre. La chronique mondaine, musicale ou littéraire des journaux assurait déjà la fonction d’une antenne. Mais elle ne codifiait pas moins les critères esthétiques que le Narrateur prend nécessairement en compte.
Cependant, pénétrer dans le salon de la duchesse de Guermantes, c’était encore autre chose – comme quitter l’univers de la télévision pour accéder à un plateau de cinéma. Vous n’y étiez pas seulement en vue, vous y deveniez une espèce de dieu, si j’en crois le Narrateur. Les projecteurs qu’on utilise dans un studio ne sont si lumineux que parce qu’ils opèrent un travail céleste sur le corps. Maquiller un acteur ne suffit pas au cinéma, faut-il encore que la lumière écrase le volume de son visage pour le rendre sublime et visser sur la caméra des objectifs à longues focales qui produisent la même harmonie céleste.
Néanmoins, dans le rôle d’un grand séducteur, un metteur en scène hésitera toujours à engager un acteur chauve, même si dans la vie il est réellement très séduisant. Le Narrateur se confronte au même dilemme. Au cinéma, un crâne glabre paraîtra toujours trop proéminent. On ne verra que lui. Il ne se fera jamais oublier. Les lumières n’y changeront rien, ni les objectifs. Il semblera toujours trop sphérique. Ce ne serait pas crédible. John Malkovich portait une perruque pour jouer Valmont. Or, à aller du côté de Méséglise et à l’explorer, je découvre que Swann est aussi chauve que Malkovich au naturel, comme en sortant d’une salle de cinéma et en le voyant en « vrai ».
Les critères de l’esthétique actuelle, appliqués au corps humain, découlent encore des règles de l’art classique élaborées à Athènes, à Alexandrie ou à Rome jadis. Les photographes de mode y obéissent toujours. Les cinéastes également. Le don Juan juif, l’amant des duchesses, l’homme le plus élégant de Paris, en me laissant entrevoir qu’il ressemble à Cézanne, ne décompose pas seulement la construction visuelle du roman quand elle s’accorde aux stéréotypes de la peinture de James Tissot, il me signale que le Narrateur est aveugle. Il me le signale furtivement, à entrouvrir une porte sur l’existence que mène réellement l’enfant de Combray pour la refermer aussitôt. Mais, sans ce signe, Swann ne serait pas Swann.
Durant des années, un coiffeur sut admirablement dissimuler sa tonsure. Les boucles, quand on sait les crêper avec art, recomposent une chevelure qui ne requiert pas même de postiche. Chaque soir, après qu’un léger crêpelage ajouté à la brosse de ses cheveux roux avait tempéré de quelque douceur la vivacité de ses yeux verts, il choisissait une fleur pour sa boutonnière et partait pour retrouver sa maîtresse à dîner chez l’une ou l’autre des femmes de sa coterie, note le Narrateur en écoutant Swann lui raconter sa vie.104 Si les progrès de sa calvitie lui donnent la mesure du temps, le regard d’Oriane, quand il se pose amoureusement sur lui, suffit à le maquiller, à le poudrer, à diminuer le volume de son nez, à effacer l’envolée de son front, à lui rendre la crinière de ses seize ans.
« Tiens, vous voilà, mais il y a des éternités qu’on ne vous a vu », dit à Swann le général de Froberville qui, remarquant ses traits tirés et en concluant que c’était peut-être une maladie grave qui l’éloignait du monde, ajouta : « Vous avez bonne mine, vous savez ! »105 En réalité, les invités de Mme de Saint-Euverte le trouvent aussi « changé » que Maurice de Rothschild à son retour d’Éthiopie.
– Tiens, tu as vu ton ami M. Swann ?
– Mais non, cet amour de Charles, je ne savais pas qu’il fût là, je vais tâcher qu’il me voie.106
Cependant la duchesse de Guermantes possède le pouvoir de rendre séduisant l’homme le plus laid, d’une manière autrement plus puissante que sur un plateau de cinéma, pour peu qu’elle l’élise, en dirigeant sur lui les regards. Si Swann est si beau, c’est que le lecteur le regarde avec les yeux d’Oriane – encore que Mme de Gallardon lui fait remarquer que les « traits tirés » lui donnent l’air d’un rabbin : Oh ! je sais qu’il est intelligent, ajouta-t-elle en voulant dire par là intrigant, mais cela ne fait rien, un Juif chez la sœur et la belle-sœur de deux archevêques !107
« Swann chauve ? Proust ajoute un trait – arbitraire – qui l’éloigne de Haas, qui fait qu’on ne saurait penser à Haas. Mais justement, ce trait est le plus invraisemblable qui soit », relevait Henri Raczymow.108 Comment imaginer Swann avec le crâne luisant et un grand nez busqué pas moins luisant ? Comment pourrait-il séduire la duchesse de Guermantes ? Pourtant, quand il proposait à Albert Cohen d’« élever un monument à la mémoire de Proust »,109 Georges Cattaui, à associer Swann à Solal, ne pouvait pas ne pas songer à Maurice de Rothschild et au parfum de la princesse d’Arenberg dans les salons de Paris ou dans ceux de Genève. Seulement, la calvitie et le nez juif émettent des signaux que j’ai préféré longtemps oublier, ou fait semblant de ne pas voir, comme le général de Froberville, pour épouser l’esthétique des clairvoyants et parler leur langue. Si j’ajoute à ces signaux la cécité, je reconnaîtrai Paul de Tarse, quand il se nommait encore Saül, sur le chemin de Damas.
Si la Synagogue est aveugle, c’est qu’elle ne voit pas les vérités de l’Évangile, rappelle Charlus au Narrateur, en convoquant à son tour le souvenir de Saül tâtonnant avec son bâton comme le petit Marcel sur le sentier de Méséglise. Israël vit dans le même univers courbe que l’enfant de Combray. Voir n’a aucun sens sans tâtonnement ni déchiffrement, sauf à confondre la vision avec le miel que nous n’avons qu’à prendre la peine d’atteindre sur les rayons des bibliothèques et de déguster ensuite passivement dans un parfait repos de corps et d’esprit. Que je ne puisse guère me passer de miel, ne m’empêche pas d’étudier en quoi consiste mon infirmité. La cécité et la calvitie, au-delà de ce qu’elles signifient en langue proustienne, ne mettent pas seulement en jeu le tact, elles façonnent la mémoire de Proust. La mémoire volontaire, qui est surtout une mémoire de l’intelligence et des yeux, ne nous donne du passé que des faces sans vérité, précisait-il dans une interview qu’il conçut quand parut Du côté de chez Swann en 1913, par quoi il délivrait le manifeste de sa littérature. Mais qu’une odeur, une saveur retrouvées dans des circonstances toutes différentes, réveillent en nous, malgré nous, le passé, nous sentons combien ce passé était différent de ce que nous croyons nous rappeler. »110 En retrouvant la vue, Paul resta chauve. « Je suis pharisien », affirmait-il, « fils de pharisiens. C’est à cause de notre espérance en la résurrection des morts que je passe en jugement. »111 Le fondateur du christianisme, s’il libérait ses fidèles du vœu de respecter le chabbat, ne se souciait pas moins de le sanctifier dans son intérieur, comme Bergson à sa manière, lequel était aussi chauve.
– Je sais qu’il est converti, et même déjà ses parents et ses grands-parents. Mais on dit que les convertis restent plus attachés à leur religion que les autres, que c’est une frime, est-ce vrai ?
– Je suis sans lumières à ce sujet. […]
– Oriane, ne te fâche pas.112
S’il séduit autant la duchesse, c’est que précisément, par un paradoxe que Proust éprouva sûrement en soi, sans quoi Proust ne serait pas Proust, Swann ressemble de plus en plus à un rabbin, de l’extérieur et à l’intérieur.
Patrick Mimouni
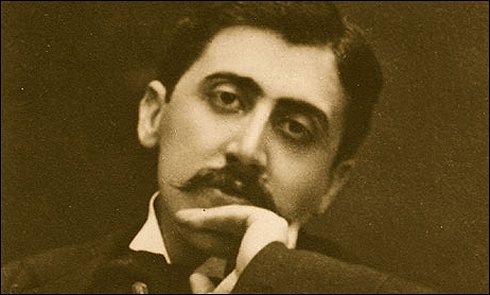







Je trouve que c’est un peu long. Mais c’est très instructif. Je me rends compte maintenant que j’aime beaucoup le sucré, pourtant c’est très néfaste pour les dents.
T’apercevoir
Hier, avant- hier peut- être, il m’ a semble m’apercevoir.
Depuis, tant de choses me reviennent à l’esprit, tant de choses…
Cette pièce de théâtre par toi écrite, costumes Madame Mimouni, répétitions exigeantes au près des quelques enfants qui y participons par toi- meme, ce jour de pluie où nous avions eu trop peu de spectateurs, encouragements de Madame King, et puis tant d’autres souvenirs d’enfance.
Tous ces longs moments partagés pendant le long ennui qu’est ou qui était l’enfance, t’en souviens tu Patrick?
Je lis et relis votre texte comme on décide d’aller vers un enchantement…