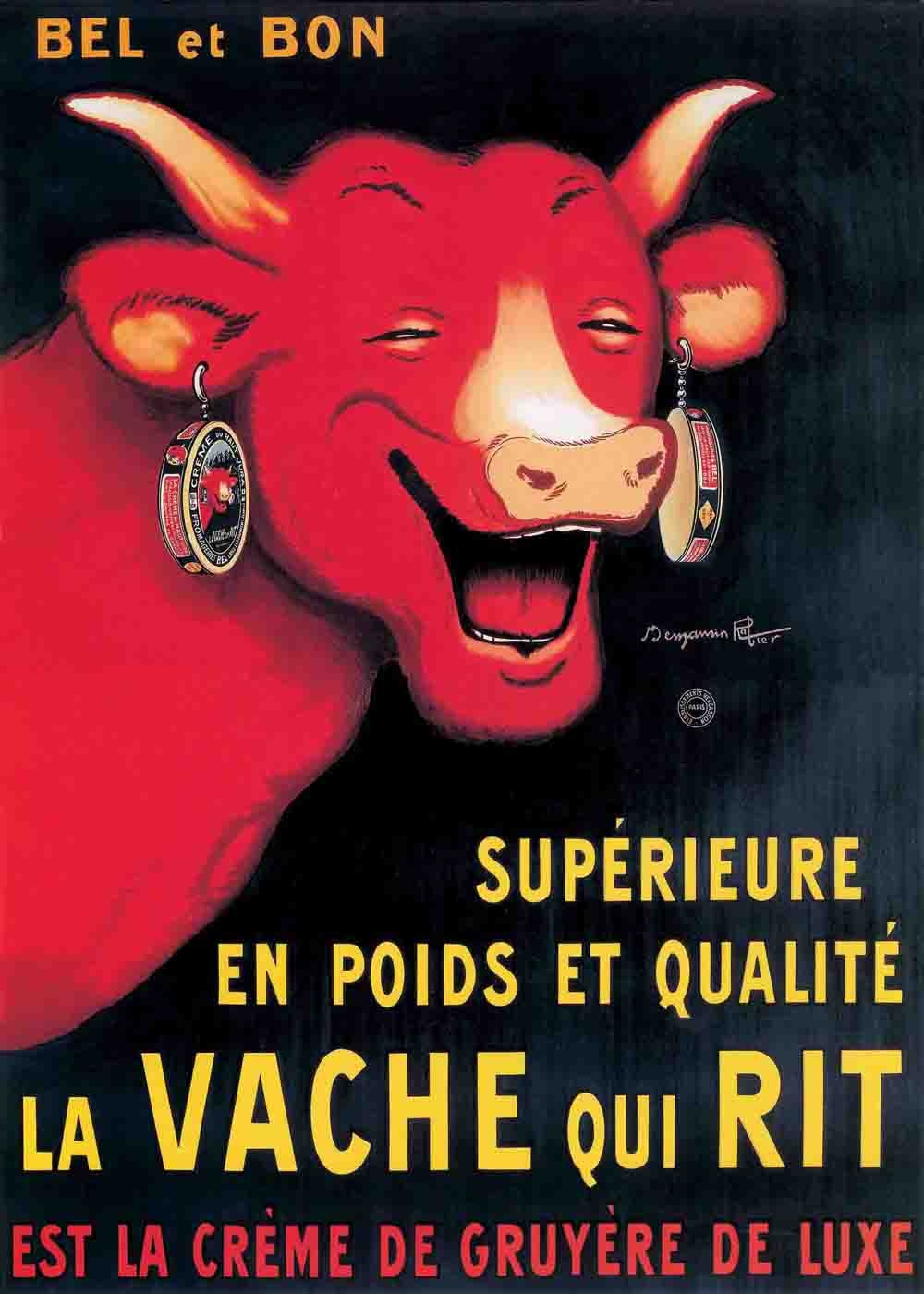3
Qu’est-ce que c’est que cet être ?
« Je vois, Juliette, que tu aimes le mal.
— Beaucoup, Monsieur, il me tourne la tête.
— Tu iras loin, mon enfant… »[1]
Le théâtre de Sade remplit de joie ses acteurs ; une joie d’enfant sûr de son succès dans le spectacle de l’horreur. Suffit-il d’y travailler pour apprécier son humour, pas moins qu’un forain engagé au stand du Train de l’Enfer ou du Maître du Mal à la foire du Trône. C’est ce qui rendait si drôle le tournage de Salo (l’adaptation des Cent Vingt Journées de Sodome au cinéma), le plus difficile pour les acteurs consistant à s’empêcher de rire, observait Pasolini.[2] « Cet “affreux livre, cet abominable ouvrage”, etc., a été le plus grand élément de grotesque dans ma vie. J’ai maintes fois cuydé en crever de rire ! » assurait Flaubert[3] en évoquant Juliette.
Le rire qui parvient de Sade, ce rire de l’acteur en scène à réveiller le mal, à l’extraire de son quartier réservé, à présenter sa population, ce rire qui gagnait le public de Charenton et affolait tant son médecin chef, ce rire, Socrate n’en percevait-il pas déjà l’écho lorsqu’il organisait l’agencement sadien de sa propre caverne ? N’y reconnaissez-vous pas le théâtre de l’hôpital ? Ces hommes enchaînés à leur lit, soulagés seulement par la jouissance que leur procure l’amnésie pharmaceutique, les yeux rivés sur un spectacle atroce, otages d’un opérateur monstrueux, ne sont-ils pas prisonniers de l’Être suprême en méchanceté ? À prétendre, remarquait Sade, que « l’enfer consistait dans la privation de la vue de Dieu ; dans ce cas l’enfer commence déjà en ce monde. »[4] Socrate ne le concevait pas moins. S’il s’abstenait de décrire la cinématographie qui arrime si puissamment les prisonniers de la Caverne à leur lit, n’est-ce pas parce que ces scènes exigeaient l’art de la pornographie que Sade inventerait, mais dont Socrate (du moins à le croire réellement doué de la vision d’un prophète érotomane) anticipait la création ? « Quand vous avez vu que tout était vicieux et criminel sur la terre, leur dira l’Etre suprême en méchanceté, pourquoi vous êtes-vous égarés dans les sentiers de la vertu ? »[5] À renverser la thèse stoïcienne et à retrouver son empreinte négative, Sade concevait maintenant, avec autant de rigueur, le pathos pornographikos. Seulement affecte-t-il la pensée avec bien plus d’impact que le logos spermatikos, non seulement parce qu’il sécrète de la jouissance ou du rire, mais qu’il fait dépendre le positif du négatif, en révélant tout l’appareillage imaginaire en soi. D’où son inépuisable ironie. Mais ne l’avions-nous pas toujours su ? prédisait Socrate.
« Ce que j’ai vu ce soir est inimaginable. J’arrive de chez Le Cuziat, comme vous le savez. Il m’avait signalé qu’il y avait un homme qui se rend chez lui pour se faire flageller. J’ai assisté à toute la scène, d’une autre pièce, par une petite fenêtre dans le mur », racontait Proust à Céleste. « Il s’agit d’un gros industriel qui fait spécialement le voyage du nord de la France pour cela. Figurez-vous qu’il est là, dans une chambre, attaché à un mur par des chaînes cadenassées, et qu’une espèce de sale individu, ramassé on ne sait où et qu’on paie pour cela, lui tape dessus à coups de fouet, jusqu’à ce que le sang gicle de partout. Et c’est alors seulement que le malheureux a la jouissance de tous ses plaisirs…
J’étais si écrasée d’horreur que je lui dis :
— Monsieur, ce n’est pas possible, ça ne peut pas exister !
— Mais si, Céleste, je ne l’ai pas inventé.
— Mais, Monsieur, comment avez-vous pu regarder ça ?
— Justement, Céleste, parce qu’on ne peut pas l’inventer. »[6]
La littérature de Sade requérait nécessairement le travail en chambre noire. Le lieu, alors, consistait en un cabinet d’observation où les panneaux disjoints d’une boiserie permettaient, à qui savait être discret, d’épier une réunion libertine dans la pièce voisine. Au siècle suivant, les bordels de Paris profitaient des progrès de l’industrie optique pour substituer à la fente pratiquée dans la cloison un outil plus raffiné et plus commode, sous la forme d’un miroir sans tain souvent, mais parfois aussi d’un objectif : un judas. Suffisait-il de s’approcher de l’œilleton et d’y fixer son œil.
« Je revoyais Proust à la Cour brûlée chez Mme Straus, où un jour, pendant que nous faisions de la photographie dans une chambre noire, Bizet et moi l’avions entendu s’évanouir à moitié dans un angle de la pièce pour une cause mystérieuse », notait Fernand Gregh[7] en se reportant à Trouville durant l’été 1892. Le comte Primoli, ami intime des Straus, également photographe expérimenté, offrait alors à ces jeunes gens de les initier à son art. Déjà âgé, mais pas vieillard vénérable du tout, se souvenait Proust[8]. Mais oui, Monsieur, me dit-il, c’est archiconnu, il y a bien longtemps que je le sais. La première année que Monsieur était à Balbec, Monsieur le marquis s’enferma avec mon liftier, sous prétexte de développer des photographies de Madame la grand-mère de Monsieur. Le petit voulait se plaindre, nous avons eu toutes les peines du monde à étouffer la chose.[9] Du maître d’hôtel de Balbec au Narrateur, la confidence ne révèle pas seulement l’homosexualité de Saint-Loup, elle assigne encore à la chambre noire une fonction érotique. Mais, pour autant, ne contredit-elle pas la technique de l’image qu’elle met en jeu, ni le concept qui en découle.
L’outil est décrit par un sage chinois, Mo Zi (Maître Mo), au Ve siècle avant l’ère chrétienne : « Le trou vide est un point qui permet l’entrée d’une image lumineuse, où la lumière des pieds, arrêtée en bas, forme le haut de l’image, et la lumière de la tête, arrêtée en haut, forme le bas de l’image, de sorte qu’un homme éclairé brille comme s’il émettait de la lumière. »[10] Les Grecs donnèrent à cet outil si fabuleux, et si généreux de conséquences actuelles, le nom de sténopé — le « petit trou » — et les Latins celui de camera obscura. Outil parmi les plus archaïques de l’histoire humaine, dont la construction est à la portée d’un enfant, du moins théoriquement, car là encore le secret de sa fabrication attendit jusqu’au XVIe siècle, et l’âge d’or de la peinture vénitienne, pour être divulgué. Il est vrai que le travail en chambre noire ne tolère guère que quelques opérateurs, maître et disciples, et qu’il exige une initiation, sans quoi son procédé, même publié, resterait impénétrable.
Si l’allégorie de la Caverne dans La République de Platon ne délivrait pas tout à fait le secret de fabrication du sténopé, elle n’en posait pas moins les bases théoriques et pratiques : une chambre maintenue délibérément dans l’obscurité comme la cella d’un temple ; un écran de projection sur quoi le regard se fixe par force ; enfin des images en mouvement, produites par un jeu d’ombres animé par des acteurs mimant des dieux, eux-mêmes découpés par des flammes, et au-delà du foyer par les rayons du soleil pénétrant par une porte percée dans la roche. Et Socrate de conseiller au spectateur de trouver le moyen de se détacher de l’écran, de rompre sa chaîne, de se retourner et d’observer derrière soi l’appareillage, nécessairement caché, même si Socrate conçoit qu’il n’a jamais été qu’oublié par soi. De fait, la présence de la chambre noire dans l’histoire humaine ne se détecte qu’à infimes indices — quelques notes laconiques laissées à la suite de Mo Zi par Aristote, Alhazen, Roger Bacon, Léonard de Vinci, Constantin Huygens, John Ruskin, etc. — qui, s’ils dessinent la carte du monde depuis vingt-cinq siècles, surnagent comme éparpillés à la surface d’un lac où l’amnésie reste la norme.
« Puisqu’il le sait, pourquoi ne le dit-il jamais ? » se demandait Freud en découvrant ça. Mais s’agit-il seulement d’éprouver le travail clandestin de la sexualité en soi ? Ou d’exhumer l’outil de réfraction qui, pour façonner l’écran de l’inconscient, produit réellement par ailleurs d’admirables effets spéciaux, des apparitions fantastiques, des hallucinations d’autant plus captivantes que leur opérateur maîtrise bien mieux le phénomène hallucinatoire que s’il recourait à la pharmacopée classique. « J’ai souvent été frappé, en regardant dans une camera obscura lors d’une journée sombre, par l’exacte ressemblance de l’image avec les plus beaux tableaux des maîtres anciens », relevait Ruskin[11] en entrevoyant l’usage que les peintres faisaient de l’appareil depuis des temps immémoriaux.
Les planches de l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert présentaient des modèles très élaborés de machines à peindre : une espèce de chaise à porteurs entièrement close, où le peintre s’asseyait pour enregistrer l’image que lui renvoyait une lentille à peu près identique au « caillou » utilisé aujourd’hui au cinéma ; ou encore une sorte de table, comme celle que Chardin représente dans L’Enfant au toton, où l’image apparaît sur le verre dépoli qui lui sert de plateau, réfractée par l’objectif de prise de vue fixé dans la boîte entre ses pieds. Mais déjà, au milieu du XVe siècle, en livrant le portrait des Arnolfini, Van Eyck exposait un miroir courbe où l’on reconnaît parfaitement l’œil d’une caméra actuelle, cependant sa technique, même s’il en éventait le secret, relevait de la sorcellerie au regard du néophyte. Elle en relève encore. Notez que le peintre en tirait les conséquences déontologiques en signant, non plus « Johannes de Eyck pinxit ou fecit » — il peignit ou il fit —, mais « Johannes de Eyck fuit hic » — il fut ici. L’étude de Ruskin, pas moins que les leçons de Primoli dans la chambre noire de Mme Straus, amenèrent sûrement Proust à entrevoir à son tour le jeu sensuel et conceptuel d’un tel objet, à l’approcher, à le manipuler.
« Dites donc, baron, vous n’allez pas me croire mais quand j’étais gosse, je regardais par le trou de la serrure mes parents s’embrasser. C’est vicieux, pas ? Vous avez l’air de croire que c’est un bourrage de crâne, mais non je vous jure, tel que je vous le dis ». Et M. de Charlus était à la fois désespéré et exaspéré par cet effort factice vers la perversité qui n’aboutissait qu’à révéler tant de sottise et tant d’innocence. Et même le voleur, l’assassin le plus déterminés ne l’eussent pas contenté car ils ne parlent pas de leur crime ; et il y a d’ailleurs chez le sadique — si bon qu’il puisse être, bien plus, d’autant meilleur qu’il est, — une soif de mal que les méchants agissant dans d’autres buts ne peuvent contenter, relève le Narrateur[12] en observant un bordel qui ne ressemble pas moins au théâtre de l’hôpital que la caverne socratique. Agacement sadien, c’est-à-dire toxicomaniaque, où s’éprouve le besoin du pharmakon — de la dope, peu importe quoi —, d’une dope dont Proust comprend, selon la leçon de Sade, qu’en enclenchant la soif du mal elle rend plus nécessaire encore de se sentir bon. Voilà sans doute pourquoi les acteurs, à jouer Sade, rient tellement en scène. « Le tournage avait été si détendu que la première projection fut un choc : comment avions-nous pu faire quelque chose d’aussi terrible sans nous en apercevoir ? » racontait Hélène Surgère[13] en sortant de la salle où l’on venait de projeter Salo, alors que le film provoquait une émeute.
« Moi, je pense, parfois, que l’existence de ce pauvre vieux [Sade] a été uniquement faite pour me divertir. Quelles créations ! quels types ! et quelle observation des mœurs ! Comme c’est vrai ! Quelle élévation de caractères (dans les vits !), que de lyrisme et quelles bonnes intentions ! » constatait gaiement Flaubert[14]. Fut-il aussi le premier romancier à former le concept du scénario. « Mon scénario est écrit ; mais je vais le laisser reposer », annonçait-il à la princesse Mathilde[15]. Les éditeurs parisiens, aux temps des Illusions perdues, se servaient déjà peut-être du mot, mais Flaubert lui donnait son acception actuelle, sans dissimuler, quand il travaillait à Madame Bovary, qu’il partait de La Femme de trente ans, ou qu’il tirait L’Éducation sentimentale du Lys dans la vallée du même Balzac. Invention remarquable. Et de confier à sa nièce : « Tu n’as pas dû y comprendre grand-chose, d’après ce que je t’en ai dit, et, après avoir relu mes quatre pages de scénario, j’ai le regret de t’en avoir parlé. »[16] Travail captivant ; travail d’adaptation, mais d’adaptation à quoi ? Le génie de Flaubert n’est pas moins grand que celui de Balzac, mais que produit-il en y logeant son propre champ hallucinatoire avec le surcroît d’intensité de sa vision, de son écoute, de son sens de la mise en scène, sinon cette sorte de saturation que Proust appelait une intoxication ?
Nous aimons les lourds matériaux que la phrase de Flaubert soulève et laisse retomber avec le bruit intermittent d’un excavateur. Car si, comme on l’a écrit, la lampe nocturne de Flaubert faisait aux mariniers l’effet d’un phare, on peut dire aussi que les phrases lancées par son « gueuloir » avaient le rythme régulier de ces machines qui servent à faire les déblais. Heureux ceux qui sentent ce rythme obcesseur ; mais ceux qui ne peuvent s’en débarrasser, qui, quelque sujet qu’ils traitent, soumis aux coupes du maître, font invariablement « du Flaubert », ressemblent à ces malheureux des légendes allemandes qui sont condamnés à vivre pour toujours attachés au battant d’une cloche. Aussi, pour ce qui concerne l’intoxication flaubertienne, je ne saurais trop recommander aux écrivains la vertu purgative, exorcisante, du pastiche, témoignait Proust[17]. Mais, à se « prendre » pour Flaubert pour l’exorciser en soi, n’anticipait-il pas ses propres ravages, si bien qu’aujourd’hui le conseil semble me viser, et me condamner maintenant à me poser la plus cruelle des questions proustiennes : comment se sortir, comment décrocher, comment se désintoxiquer de Proust ? — Oui mais, si un peu d’intoxication est dangereux, ce qui en guérit, ce n’est pas moins d’intoxication, mais plus d’intoxication, mais toute l’intoxication ! Pasticher Proust, c’est déjà éprouver sa logique saturante — logique aussi délirante en apparence que celle de Socrate ou de Sade. Il est vrai que là où Sade convoquait la litanie de ses supplices pour construire sa théologie du mal et la loger dans le poumon d’acier, de merde et de foutre où son lecteur est sommé de jouir d’abjection et d’apprécier son enfer, Proust comme Socrate préfère la vision que procure le sentiment amoureux quand il franchit le seuil de l’érotomanie, mais à m’emmener dans le lieu hallucinatoire caressé par sa langue, ce lieu si engageant, il opère une addiction plus redoutable encore.
Revoilà mon passeur, mon dealer proustien. Mademoiselle Albertine est partie ! Comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie ! Il y a un instant, en train de m’analyser, j’avais cru que cette séparation sans s’être revus était justement ce que je désirais, et comparant la médiocrité des plaisirs que me donnait Albertine à la richesse des désirs qu’elle me privait de réaliser, je m’étais trouvé subtil, j’avais conclu que je ne voulais plus la voir, que je ne l’aimais plus. Mais ces mots : « Mademoiselle Albertine est partie » venaient de produire dans mon cœur une souffrance telle que je ne pourrais pas y résister plus longtemps. Ainsi ce que j’avais cru n’être rien pour moi, c’était tout simplement toute ma vie.[18] Petite déflagration du signe, un signe qui ne serait qu’aléatoire, anecdotique et même comique s’il ne venait relayer une autre déflagration qui m’ébranle tout entier. Le tout était surtout pour moi une affaire d’hygiène — expliquait Proust à Ramon Fernandez ; il faut se purger du vice si naturel d’idolâtrie et d’imitation. Et au lieu de faire sournoisement du Michelet et du Goncourt en signant (ici les noms de tels ou tels de nos contemporains les plus aimables), d’en faire ouvertement sous forme de pastiches, pour redescendre à ne plus être que Marcel Proust.[19]
Décidée en 1923 lors d’une conférence internationale, l’interdiction de produire et de vendre de l’héroïne, si elle conduisit les laboratoires pharmaceutiques à cesser d’en fabriquer, profita aussitôt aux officines clandestines qui prospéraient depuis longtemps déjà sur la Côte d’Azur et dans la région parisienne, pour faire bientôt de Paris la capitale de l’héroïne, celle où le marché américain se nourrissait ; et cela, durablement, jusque dans les années 1970, avant que son trafic n’explose et ne se mondialise. Remarquez que la gloire posthume de Proust, le succès de la Recherche et l’ampleur des études proustiennes se développent avec la même synchronie. Remarquez aussi que s’interdire Proust, le prohiber avec la décision la plus résolue, voire le haïr, n’aide nullement à le quitter. La mesure répressive et le jeu de ses intérêts ne font qu’accentuer sa pression paradoxale sur soi — d’autant qu’elle relève d’un phénomène que Proust étudia à fond. Il en émane une pesanteur, une inertie, une vitesse acquise à mon corps défendant et la sensation d’une accélération irrésistible. Cependant cette pression, cette oppression m’ouvre une autre perspective proustienne à quoi je n’avais guère songé, qu’il me faut explorer en m’obligeant à reconsidérer sa leçon d’anatomie et à me rallonger sur sa table de dissection, là où je retrouve Swann impuissant à quitter Odette, ou Marcel à l’annonce de la mort d’Albertine, ou Charlus enchaîné sur son lit comme le prisonnier de Socrate, là dans sa langue, en son cœur, au point le plus douloureux, avec le devoir maintenant de reconnaître que, quoi que je fasse, il n’est plus possible de m’en sortir.
Lire et relire A la recherche du temps perdu ne guérit pas du chagrin, mais le déplace par un retrait et un retour inlassables, d’une fréquence hypnotique dont Proust ressentait la période à lire et à relire Flaubert, et contient-il, ce bruit intermittent d’excavateur ou de projecteur de cinéma, ce que l’actualité garde de plus atroce. C’est ce qui rendait déjà si mélancolique le docteur Benassis, le médecin de campagne de Balzac, qui pour soi ne croit pas en la médecine : « Je n’ai plus d’autre but dans la vie que celui de la quitter. Je ne veux rien faire pour en prévenir ni pour en hâter la fin ; mais je me coucherai sans chagrin pour mourir, le jour où la maladie viendra. »[20] La mélancolie du docteur Bovary, si elle semble d’une autre nature, n’aboutit pas moins à la même fin. Il est vrai que Flaubert lui adjoint un indispensable pharmacien qui, lui, ne partage pas sa lassitude. Le scénario de La Femme de trente ans, comme celui du Lys dans la vallée ou du Médecin de campagne, reprenait le seul thème qui intéressait Balzac et, maintenant, Flaubert : le processus irréversible qui met en jeu le rapport à l’ange rêvé que Socrate découvrait quand il se déclarait à Phèdre et qu’il nommait, précisément, érotomania. « Il s’agit d’individus originairement excentriques dont le développement psychique anormal a pu être ramené à l’influence de tares héréditaires ou à une maladie du cerveau pendant l’enfance. Le fond de tout le trouble est l’illusion d’être distingué et aimé par une personne qui d’ordinaire appartient à une classe supérieure de la société », relevait Krafft-Ebing[21]. Et de définir l’affection sous le nom de « paranoïa érotique ». La psychiatrie, jusque dans sa perspective freudienne, portait tellement d’attention à l’hystérie qu’elle mit longtemps à distinguer ses signaux de la sémantique de l’érotomanie, et à pressentir en quoi elle livrait une source de savoir inépuisable, jusqu’à ce que Jacques Lacan y trouve sa vocation. Cependant Socrate, jadis, y concevait la chambre où mon passeur me laisse entrevoir qu’en réalité il n’y a pas de passage, mais seulement, au débouché de la mémoire, l’impasse de la raison et la raison de l’impasse.
Regardez la chambre qu’Emma Bovary découvre le jour de ses noces : « Une boîte en coquillage décorait la commode ; et, sur le secrétaire, près de la fenêtre, il y avait, dans une carafe, un bouquet de fleurs d’oranger, noué par des rubans en satin blanc. C’était un bouquet de mariée, le bouquet de l’autre ! » Le bouquet de la précédente Mme Charles Bovary, morte quelques mois auparavant. « Elle le regarda. Charles s’en aperçut, il le prit et l’alla porter au grenier, tandis qu’assise dans un fauteuil (on disposait ses affaires autour d’elle), Emma songeait à son bouquet de mariage, qui était emballé dans un carton, et se demandait, en rêvant, ce qu’on en ferait, si par hasard elle venait à mourir. »[22] Si le bouquet réveille une association d’idées, Flaubert la laisse délibérément en suspens. Le bouquet ? — Quoi ? — Peu importe ! Suffit-il que le bouquet agisse. Travail captivant, là encore. Ainsi quand, un an plus tard, Emma se prépare à quitter sa maison pour emménager avec Charles à Yonville, « un jour qu’en prévision de son départ elle faisait des rangements dans un tiroir, elle se piqua les doigts à quelque chose. C’était un fil de fer de son bouquet de mariage. Les boutons d’oranger étaient jaunes de poussière, et les rubans de satin, à liseré d’argent, s’effiloquaient par le bord. Elle le jeta dans le feu. Il s’enflamma plus vite qu’une paille sèche. Puis ce fut comme un buisson rouge sur les cendres, et qui se rongeait lentement. Elle le regarda brûler. Les petites baies de carton éclataient, les fils d’archal se tordaient, le galon se fondait ; et les corolles de papier, racornies, se balançant le long de la plaque comme des papillons noirs, enfin s’envolèrent par la cheminée. »[23]
Si la combustion du bouquet ne provoque pas forcément en soi les mêmes effets qu’un agencement sadien, elle ne réclame pas moins la même attention, la même posture, la même visée, le même cadrage, la même prise de vue. Événement extraordinaire au regard de Proust : il n’est pas possible à quiconque est un jour monté sur le grand Trottoir roulant que sont les pages de Flaubert, au défilement continu, monotone, morne, indéfini, de méconnaître qu’elles sont sans précédent dans la littérature.[24] Pourtant ce n’est qu’un bouquet qui flambe et qu’une femme qui l’observe. N’empêche : la révolution est accomplie, observait Proust ; ce qui jusqu’à Flaubert était action devient impression. Les choses ont autant de vie que les hommes.[25] Faut-il encore que la vie, maintenant, prenne la consistance d’une hallucination.
Qu’à la doter d’un regard clinique on garantisse que la conscience n’en est pas affectée n’empêchait pas Flaubert de rapporter ce regard au travail hallucinatoire de son siècle — et de se retrouver en correctionnelle, en suivant les leçons socratiques, même si pour autant Socrate ne contestait pas les données positives de la médecine, mais des données qui installaient selon lui l’insensibilisation de l’anesthésie et son amnésie en soi[26]. Si ce savoir-vivre assure ma propre durée, n’est-ce pas parce que la perte de ce que je ne peux plus estimer, ni même reconnaître, se double de l’armure de rituels maniaques qui me rendent aveugle et sourd aux signes qui me percutent, et leur langue insignifiante ? Mais comme après un accident de la route, en sortant d’un coma traumatique, si je conçois, en toute logique, qu’il me suffit de naître — coûte que coûte, comme si de rien n’était, comme si rien ne s’était passé —, il s’est pourtant passé quelque chose, quelque chose qui change radicalement la vie, quoique je ne puisse plus savoir en quoi.
D’ordinaire, une valeur, qu’elle soit comptabilisée positivement ou négativement, reste toujours égale à elle-même. Que vous ayez mille euros crédités ou à découvert à votre banque, ne change rien à l’objet en soi constitué par mille euros. Seulement imaginez qu’il s’agisse de mille milliards de milliards d’euros, alors le gain ou la perte d’une telle valeur — quand sa saturation empêche qu’on puisse réellement l’évaluer — modifie profondément son objet. Imaginez maintenant que ce soit votre enfant que vous ayez gardé ou perdu, vous entrerez dans la chambre où le positif et le négatif qui dessinent l’image en soi ne sont plus interchangeables ni équivalents ; là où la puissance du négatif, son effet de stupéfaction, détermine seule l’image, désormais, à pouvoir la surexposer, la fondre, la flasher comme le bouquet de Mme Bovary, et la nier en enveloppant non plus un objet mais une hallucination. « Si les accidents du monde, dès qu’ils sont perçus, vous apparaissent transposés comme pour l’emploi d’une illusion à décrire, tellement que toutes les choses, y compris votre existence, ne vous sembleront pas avoir d’autre utilité, et que vous soyez résolus à toutes les avanies, prêts à tous les sacrifices, cuirassés à toute épreuve, lancez-vous, publiez ! » recommandait Flaubert[27]. Et se donnait-il la vocation de rendre compte d’un phénomène qui, s’il dépend du sentiment, change la nature du roman, jusqu’à la nature de la langue.
La camera obscura qui permettait jadis aux astronomes d’approcher le ciel, et aux prêtres ou aux sorciers de faire apparaître dieux et démons sur le mur d’un sanctuaire ; cette machine à produire des apparitions dont les voyants, les médiums, les prestidigitateurs usèrent tellement à travers le temps ; ce lieu où étudier l’image qui conféra leur maîtrise aux peintres, pas tant parce qu’il leur suffisait de décalquer son dessin que parce qu’enfermés dans cette chambre ils exerçaient leur main et leur pensée aux leçons de la lumière ; ce lieu, cette chambre, cet outil de réfraction, Flaubert l’investissait, non plus seulement en peintre, mais en cinéaste. « Avez-vous jamais cru à l’existence des choses ? Est-ce que tout n’est pas une illusion ? Il n’y a de vrais que les rapports, c’est-à-dire la façon dont nous percevons les objets », témoignait-il[28]. La révolution de vision, révolution de représentation du monde qui découle — ou est exprimée — par sa syntaxe, est peut-être aussi grande que celle de Kant déplaçant le centre de la connaissance du monde dans l’âme, songeait Proust[29]. Je gage qu’il ne perdait pas de vue le rôle que Sade jouait dans cette révolution. Si la France l’avait reçu en pornographe, l’Allemagne l’avait lu en philosophe, en multipliant aussitôt sur son sol les rééditions de Justine et de Juliette. Comment Kant aurait-il pu l’ignorer ? L’ignorât-il qu’il ne prenait pas moins en compte les mêmes données. « Il faut savoir prendre son parti sur l’horreur de ce qui fait bander, et cela pour une raison bien simple : c’est que cette chose, telle affreuse que vous vouliez la supposer, n’est plus horrible pour vous dès qu’elle vous fait décharger. »[30] L’esthétique kantienne ne rend pas seulement l’écho de la langue de Sade, elle fixe l’extraordinaire degré de saturation qu’il atteint. Degré réfractant dont Flaubert tire sa vision cinématographique : Toutes les parties de la réalité sont converties en une même substance, aux vastes surfaces, d’un miroitement monotone. Aucune impureté n’est restée. Les surfaces sont devenues réfléchissantes. Toutes les choses s’y peignent, mais par reflet, sans en altérer la substance homogène. Tout ce qui était différent a été converti et absorbé, observait Proust[31]. Le rendu de la vision, sans, dans l’intervalle, un mot d’esprit ou un trait de sensibilité, voilà en effet ce qui importe le plus à Flaubert au fur et à mesure qu’il dégage mieux sa personnalité et devient Flaubert.[32]
À la fin de sa vie, Proust confiait à Jean de Pierrefeu qu’il n’était jamais entré — ce qu’il regrettait, car cela l’aurait beaucoup tenté — dans un cinéma.[33] La confidence m’émeut d’autant que le cinéma, dont Proust répercute le concept, n’existait pas encore en son temps, même si l’outillage était là. Faut-il attendre le tournant des années vingt et trente pour que Renoir, Buñuel, Hitchcock ou Ozu filment comme Flaubert « filmait », en donnant au verbe filmer l’intransitivité que Flaubert donnait à écrire. Écrire tout court. Pas seulement décrire. Développer le négatif que le scénario présente, non pour en tirer un cliché positif, mais une tout autre espèce d’image, à tenter de ressusciter le négatif du négatif, en quelque sorte : l’étape où la lumière se réfracte pour impressionner l’étoffe sensible comme la caresse sur la peau, là où l’image se façonne comme de la lumière entre les mains dans le mouvement tournant, enveloppant, modelant la forme focale dont les paramètres subsistent en soi hors du temps, dans l’enrobement sentimental où cesse l’amnésie du Narrateur, car épinglant de ci de là un feuillet supplémentaire, je bâtirais mon livre, projette-t-il, je n’ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe.[34]
« Les petites baies de carton éclataient, les fils d’archal se tordaient, le galon se fondait… » La plupart de ses contemporains auraient écrit : éclatèrent… se tordirent… se fondit… Mais comme en observant ses créatures avec des jumelles optiques et en restituant sa vision, Flaubert notait : « éclataient… se tordaient… se fondait… » Encore que Baudelaire déjà, et Stendhal avant lui, maniaient parfois l’imparfait de la même manière : « Julien s’arrêtait ébahi au milieu de la cour. »[35] « Le rêve commençait par une musique… »[36] Cet imparfait, relevait Proust, si nouveau dans la littérature, change entièrement l’aspect des choses et des êtres, comme font une lampe qu’on a déplacée, l’arrivée dans une maison nouvelle, l’ancienne si elle est presque vide et qu’on est en plein déménagement. C’est le genre de tristesse, fait de la rupture des habitudes et de l’irréalité du décor, que donne le style de Flaubert, ce style si nouveau quand ce ne serait que par là. Cet imparfait sert à rapporter non seulement les paroles mais toute la vie des gens. L’Éducation sentimentale est un long rapport de toute une vie, sans que les personnages prennent pour ainsi dire une part active à l’action. Parfois le parfait interrompt l’imparfait, mais devient alors comme lui quelque chose d’indéfini qui se prolonge : « Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, etc., il eut d’autres amours encore », et dans ce cas par une sorte de chassé-croisé c’est l’imparfait qui vient préciser un peu : « mais la violence du premier les lui rendait insipides ». Quelquefois même, dans le plan incliné et tout en demi-teinte des imparfaits, le présent de l’indicatif opère un redressement, met un furtif éclairage de plein jour qui distingue des choses qui passent une réalité plus durable : « Ils habitaient le fond de la Bretagne… C’était une maison basse, avec un jardin montant jusqu’au haut de la colline, d’où l’on découvre la mer. »[37]
« Il y a vraiment chez Flaubert une obsession de Sade. Il se creuse la cervelle pour trouver un sens à ce fou. Il en fait l’incarnation de l’Antiphysis et va jusqu’à dire, dans ses plus beaux paradoxes, qu’il est le dernier mot du catholicisme », notaient les Goncourt[38]. Les puritains ne le concevaient pas moins, à leur manière, en se donnant une mission qui n’impliquait pas seulement de chasser les papistes, de fermer les monastères, de vider les églises de tout ornement, d’obliger les clercs à fonder une famille, mais d’associer encore les deux sens que recouvre le mot antiphysis — « contre-nature » — et d’en mesurer l’étendue. « L’horreur de la nature. Il n’y a pas un arbre dans Sade ni un animal », expliquait Flaubert[39]. En amorçant le mouvement des Lumières par le rappel de l’impératif stoïcien, des principes de son ascèse et de la grandeur de son hygiène, la réhabilitation de la nature par Spinoza diffusait l’esthétique qui ravalait les artifices de l’âge baroque à une époque révolue. Mais le mouvement ne lançait pas que la mode du jardin à l’anglaise. Il coïncidait avec la création par la police royale des premières brigades de pédérastie à Paris au milieu du XVIIe siècle. Et chassaient-elles également les Juifs clandestins et les prostituées. Si elles se souciaient de remédier à une tout autre forme de contre-nature que ce à quoi songeait l’auteur de L’Ethique, leur action ne dépendait pas moins de la même exigence esthétique.
La mixité des sexes exposait les enseignants au péril de rendre aux familles des filles enceintes. Mieux valait prendre le risque que se nouent entre adolescents des relations homosexuelles. Avant l’invention des méthodes modernes de contraception, toutes les sociétés s’imposaient cette exigence. Seulement l’Église romaine se faisait un devoir d’éduquer les filles, de consacrer les plus vertueuses au service de Dieu ; de donner également aux familles le moyen d’établir des filles qui, de fait, dans une société aussi contingentée que l’était l’ancienne France, ne pouvaient pas toutes se marier ; un devoir aussi de réserver aux impudiques une retraite où faire pénitence et se relever ; de sorte qu’on comptait sous l’Ancien Régime presque autant de religieuses que de religieux, rassemblées en communautés régulières ou détachées dans le monde séculier. Un aussi grand nombre de femmes célibataires, à qui on concédait la gestion de leur économie et l’autonomie de leur vie intime dans les limites des règlements de leur ordre — règlements drastiques, il est vrai, mais qui leur laissaient les moyens de les contourner et de les transgresser — constitue un phénomène exceptionnel dans l’histoire. D’autant que le goût de vivre en communautés exclusivement masculines était encore plus apprécié, puisque le clergé catholique depuis le XIe siècle imposait le célibat à tous les niveaux de sa hiérarchie, avec les mêmes moyens de céder au péché qui scandalisaient tant Luther et réjouissaient tant Sade.
La sodomie, dès qu’elle fut pénalisée, non plus seulement en théorie, mais en pratique par un édit de l’empereur Justinien en 533, convoqua aussitôt devant un tribunal de Constantinople plusieurs hauts dignitaires de l’Église, lesquels furent condamnés à être castrés et mis à mort. La sodomie servit également de prétexte à Philippe le Bel pour éliminer les Templiers. Luther, en confondant la cour pontificale avec la putain de Babylone, mettait toujours en jeu le même motif. Voltaire le rappelait également. Zola ne le signalait pas moins. Notre siècle en rend encore l’écho. Il est vrai que, déjà sous Justinien, on soupçonnait le pouvoir impérial d’user de ce moyen pour s’emparer des biens des sodomites[40]. De fait, le roi de France renfloua considérablement son trésor en liquidant l’ordre du Temple. La Réforme profita plus encore à l’économie des États qui la décidèrent. Le capitalisme naissant en Angleterre, en Hollande, en Suisse ou dans les pays rhénans, assis maintenant sur des bases luthériennes ou calvinistes, s’alimenta à une source d’or thésaurisé depuis un millénaire, à spolier l’Église catholique en recourant aux méthodes dont les princes usaient déjà avec Israël. Mais la nationalisation des principautés ecclésiastiques par les dynasties protestantes — celle qui permit notamment à la maison de Hohenzollern de proclamer sa souveraineté héréditaire en Prusse — ne changea pas moins le paysage politique et militaire de l’Europe. Pour autant la présence d’un peintre de l’école de Raphaël, appelé publiquement Il Sodoma à la cour de Rome, au moment où Luther l’explorait, laisse entendre que les conclusions qu’il en tira n’étaient pas, non plus, si mal fondées. Les procès en sodomie ne restaient pas moins exceptionnels sous l’Ancien Régime. On n’en compte qu’une quarantaine en France dont les victimes furent le plus souvent des clercs. « On ne se doute pas de l’extrême analogie entre les croyants en Dieu et les bougres », remarquait Sade[41].
La chair réfutait l’amour, elle ne désirait que du plaisir. Les pécheurs sollicitaient une aventure forcément brève, proposée par des signes à peine perceptibles. La chasteté ne fixait qu’un idéal au fidèle. S’il se retenait de toute publicité, le péché restait toujours tolérable. Qui le saurait ? Et, une fois l’acte accompli, s’ouvrait la perspective du repentir. La sodomie, au sens théologique — c’est-à-dire tous les rapports sexuels qui ne visaient pas à la procréation dans les liens du mariage —, s’adaptait parfaitement à la nécessité du célibat dans l’Église. S’y inventait, en somme, la culture moderne du sexe. « Le clin d’œil dans la rue, la décision, en une fraction de seconde, de saisir l’aventure, la rapidité avec laquelle les rapports homosexuels sont consommés, tout cela est le produit d’une interdiction », expliquait Foucault[42]. Mais que vaut l’interdit, s’il ne vise pas à prohiber l’acte mais seulement à imposer la discrétion à l’acteur, et à lui apprendre à se taire, voire à se confesser sous le sceau de la même discrétion ? Les textes de loi qui punissent aujourd’hui le trafic de drogue n’empêchent pas ce trafic. Au contraire c’est la prohibition de la drogue qui le rend possible. Une activité illégale ne pourrait pas progresser si durablement et si puissamment, malgré les moyens considérables mis en œuvre pour en venir à bout depuis près d’un siècle — ou à cause des mêmes moyens, justement, et du jeu de leur séduction —, sans s’inscrire au plus profond de l’âme humaine et de ses besoins, au moins autant que la sexualité.
En ramenant à lui la formule de Casanova : « Le meilleur moment, dans l’amour, c’est quand on monte l’escalier », Foucault songeait : « Un homosexuel dirait plutôt : “Le meilleur moment, dans l’amour, c’est quand l’amant s’éloigne dans le taxi. C’est lorsque l’acte est consommé et le garçon reparti que l’on commence à rêver à la chaleur de son corps, à la qualité de son sourire, au son de sa voix. C’est le souvenir plutôt que l’anticipation de l’acte qui importe avant tout dans les relations homosexuelles. »[43] Il en est des plaisirs comme des photographies. Ce qu’on prend en présence de l’être aimé n’est qu’un cliché négatif, on le développe plus tard, une fois chez soi, quand on a retrouvé à sa disposition cette chambre noire intérieure dont l’entrée est « condamnée » tant qu’on voit du monde, concevait Proust[44]. Foucault requérait précisément dans sa théorie Un amour de Swann, mais « bien qu’il s’agisse ici d’une relation entre un homme et une femme, il faudrait, en la décrivant, prendre en compte la nature de l’imagination qui l’a conçue », objectait-il[45]. De fait, Proust évoque sans cesse la nécessité du retour à la chambre noire — là où s’éteignent les Lumières, mais où s’entrevoit un autre jour dans les ténèbres : cette réalité que nous risquerions fort de mourir sans l’avoir connue, et qui est tout simplement notre vie. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c’est la littérature. Cette vie qui en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien que chez l’artiste. Mais ils ne la voient pas, parce qu’ils ne cherchent pas à l’éclaircir. Et ainsi leur passé est encombré d’innombrables clichés qui restent inutiles parce que l’intelligence ne les a pas « développés ».[46] Mais, si donner plus d’importance au souvenir de l’acte érotique qu’à son anticipation définit aussi exclusivement l’homosexualité que le supposait Foucault en se penchant sur Proust, ce mouvement de la mémoire n’appartient pas moins au judaïsme.
Durant des siècles, au regard de la théologie chrétienne, Israël constitua également une espèce de vice ou de drogue, frappée par les mêmes interdictions que Sodome, avec le paradoxe que l’interdit de la sodomie découlait de la loi juive. Cependant le Talmud l’envisageait d’une manière tout aussi paradoxale : « Il n’y avait pas, dit-on, de prostituée au monde avec qui Rabbi Eléazar ben Dordia n’ait pas couché. Un jour il apprit qu’il en existait une, dans un port lointain, qui demandait pour salaire une bourse de dinars. Il prit avec lui une bourse de dinars. Pour rejoindre la prostituée, il traversa sept rivières. Tandis qu’il couchait avec elle, la femme laissa échapper un vent et dit : “De même que ce vent ne reviendra pas d’où il vient, le repentir d’Eléazar ben Dordia ne sera pas accepté”. Rabbi Eléazar partit. Il alla s’asseoir au milieu des montagnes et des collines et s’écria : “Montagnes et collines, priez pour moi !” “C’est plutôt pour nous-mêmes que nous devrons prier, lui répondirent-elles, car il est dit Les montagnes s’éloigneront et les collines chancelleront”.[47] Alors il s’écria : “Cieux et terre, priez pour moi !” Les cieux et la terre lui répondirent : “C’est pour nous-mêmes que nous devrons prier, car il est dit Les cieux s’évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement”.[48] “Soleil et lune, priez pour moi !” ”C’est pour nous-mêmes que nous devrons prier, car il est dit La lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion”.[49] “Étoiles et planètes, priez pour moi !” “C’est pour nous-mêmes que nous devrons prier, car il est dit Toute l’armée des cieux se dissoudra”.[50] “Je ne peux donc compter que sur moi-même”, se dit alors Rabbi Eléazar ben Dordia. Il se mit la tête entre les genoux et sanglota avec tant de douleur qu’il rendit l’âme. Une voix céleste annonça : “Rabbi Eléazar ben Dordia est attendu dans le monde à venir.” […] Rabbi Juda Ha-Nassi pleurait en pensant à Rabbi Eléazar ben Dordia. Il disait : “L’un met des années à gagner l’éternité, tandis que l’autre l’acquiert en un moment !” Il disait aussi : “Non seulement les pécheurs repentis seront bien accueillis, mais encore ils seront appelés Rabbis.” »[51]
Ainsi ouvre, au regard du Talmud, le lieu qui permet de se penser en même temps avant et après ; c’est-à-dire d’archiver les songes nécessaires à la traduction du livre saint qui anticipe et façonne le livre à venir, par le retour à un passé révolu à jamais, dans un univers brisé désormais et sans remède. Avalement en soi et arrachement à soi tout à la fois, en quoi consiste précisément la traduction du sens, qui, à ce regard, est la fois antérieure à la rédaction et principe de la rédaction. Car le repentir, s’il est désintéressé, agit comme une réminiscence, enrobé par le même hasard, par le même imprévu. À se charger d’un intérêt prévisible, il perdrait aussitôt son sens, en se laissant happer par l’ordre implacable de l’oubli, d’où sa puissance hallucinogène. Si elle procurait la grâce du pardon et de la vie éternelle jadis, l’amnésie en cessant ne produit pas moins maintenant, au regard de Proust, la résurrection et la joie en littérature, sauf que ce n’est plus une affaire de religion, mais de drogue spirituelle, soutenue cependant par la même quête, par la même vocation. « La Recherche est tournée vers le futur, non vers le passé », remarquait Deleuze[52]. S’il contredisait Foucault, la contradiction se comprenait dans le paradoxe même de la chambre noire, lieu de réfraction et de révélation, mais forcément aussi lieu d’épreuve, lieu de douleur, lieu de supplice, là où Flaubert entendait le dernier mot du catholicisme.
Le récit de la vie de Samson, ou de celle d’Œdipe, invitait déjà le lecteur ou le spectateur à se mettre en pensée à la place du supplicié. Et sollicitaient-ils tous deux l’aveuglement — sans doute parce que les premiers acteurs à être traînés et exposés devant les foules furent des princes défaits à qui on avait crevé les yeux. « Nietzsche suggérait qu’Œdipe, par opposition à Prométée, c’était le mythe sémite des Grecs, la glorification de la Passion et de la passivité. Œdipe, le Caïn grec », assurait Deleuze[53]. Ou plutôt le Samson grec. Le châtiment de l’énucléation donnait leur signature aux conquérants assyriens et babyloniens. Les princes hébreux, aux temps bibliques, durent sûrement méditer cette promesse. Le récit légendaire du supplice de Samson renvoie à la chronique (probablement historique) des tortures infligées à Sédécias, le dernier roi de Juda lors de la chute de Jérusalem et de la destruction du premier Temple. « Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence ; puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d’airain et on le mena à Babylone. »[54] D’où la charge symbolique et prophétique qui pèse sur le devenir aveugle dans la littérature biblique — jusqu’en sa perspective chrétienne, puisque Saül de Tarse, sur le chemin de Damas, en sera frappé à son tour. L’énucléation de Samson ou celle d’Œdipe attirait la pensée dans la chambre noire où elle pouvait devenir indivise et se réfracter sur un écran mental. La brisure des tables de la Loi, la destruction du Temple, la crucifixion du Messie lui offrent un appareil de projection et une image concrète. À chacun, désormais, de remarcher dans ses pas, de retrouver ses stations et de les endurer jusqu’à ce que la mort lui cède son soulagement.
« Pourquoi ne mangez-vous pas, Monsieur ? Comment voulez-vous tenir à ce régime ? — Céleste, examinez bien la chose. Réfléchissez : quand on a fait un bon repas, on est lourd, on n’a pas l’esprit libre », objectait Proust[55]. Ses fumigations ne lui permettaient guère que d’avaler deux bols de café au lait et deux croissants par jour. Encore qu’il lui arrivait d’avoir ce qu’il appelait une fringale : l’envie brusque d’une sole, d’un fruit ou d’un sorbet que Céleste faisait venir de l’hôtel Ritz. « S’il y avait de l’excès en lui, c’était dans la modestie de la nourriture, d’une part, et dans la domination du travail, de l’autre », observait-elle[56]. Car ce régime, si aberrant qu’il soit, ne requiert pas moins le don de soi, quitte à sacrifier une bonne part de son espérance de vie au profit d’une ambition plus haute, ambition vaine peut-être, mais qui sait ?
L’obole, obolos, la pièce de monnaie courante en ancienne Grèce, signifiait déjà le « don ». Le mot, à peine déformé, obelios désignait également une pâtisserie, encore assez rudimentaire, sorte de petite crêpe cuite sur un galet chauffé par des braises, que l’on servait enduite de miel et roulée en forme de cornet. On en vendait surtout devant les temples. Elle permettait à qui l’achetait d’accéder au sanctuaire pour en faire présent au dieu. Offrande la plus modeste, celle des misérables, ce pourquoi, sans doute, le christianisme en fit son signal de reconnaissance. Seulement il opérait un retournement essentiel : ce n’était plus au fidèle de remettre son présent aux dieux, mais au Messie maintenant de se sacrifier et de se partager, comme le pain et le vin que les Juifs bénissent au repas du shabbat.
Le temple convoquait les foules autour de son parvis ; la synagogue leur ouvrait les portes de la maison d’étude : salle d’assemblée, lieu de lecture, de débats, de prière, mais également auberge où s’éprouvait la plus-value du shabbat. Sans le rite de ce repas, la judaïsation de l’empire romain ne serait pas accomplie si massivement. On dénombrait près de sept millions de Juifs sous tutelle impériale au début du premier siècle de l’ère chrétienne, à proportion de 10 % de sa population, sans compter une masse probablement plus importante de sympathisants et de prosélytes. Dispersés alors en d’innombrables sectes, tous se reconnaissaient à cette nourriture qui rappelait la galette azyme préparée pour la Pâque. En se donnant bientôt la forme symbolique de la pièce de monnaie universelle elle retint longtemps en lui le nom d’obole — oblata en latin, l’offerte, l’oublie en vieux français — jusqu’à ce que l’Église romaine ne lui préfère celui d’hostia, d’hostie, de victime.
Repas peu consistant, mais précisément essentiel, il programmait un régime anorexique où Proust ne se reconnaissait pas moins. Le judaïsme recommandait déjà le jeûne à titre de rite de deuil et d’action de grâces, mais s’agissait-il de ne se priver de nourriture que sept jours par an. Les carêmes d’avant Pâques et d’avant Noël portaient la durée du jeûne annuel à quatre-vingts jours — périodes durant lesquelles, sous peine de mort (en théorie car, que l’on sache, la peine, décrétée sous Charlemagne, n’a guère été appliquée), les chrétiens devaient se contenter d’un seul repas par jour, de pain, de fruits secs et d’eau, à l’exception du dimanche où leur était permis de s’alimenter à leur guise. Régime qui attirait autour des églises les marchands d’oublies, seule manne publiquement consommable hors des jours de fête. Ils formèrent une corporation au XIIIe siècle sous le patronage de saint Honoré. Boulanger du pauvre, au sens littéral comme au sens mystique, installé dans une échoppe ou parcourant les rues, l’oublieur cuisait à la demande une hostie entre deux plaques de fer qu’il enfonçait dans un brasero. Si la sienne n’était pas consacrée, ses fers n’y imprimaient pas moins des symboles évangéliques, en particulier celui de la coquille de Saint-Jacques. Le pèlerinage à Compostelle échelonnait sur ses routes ces vendeurs ambulants, à quoi cette marque servait de réclame, en quelque sorte, pas moins que de garantie de bonté, et offraient-ils souvent leur unique source de ravitaillement aux pèlerins. Les fers prirent bientôt la forme d’un rayon de cire, comme prélevé sur une ruche, où l’on coulait une « gaufre ». Les affamés en mangent encore sur le trottoir. La France entreprenant de se constituer aux Antilles et dans l’océan indien des îles à sucre, il commençait à saupoudrer les crêpes (dites alors « oublies d’étrier » probablement parce que, roulées en cornet, il suffisait d’une main pour les manger, l’autre pouvant conduire un cheval) et les gaufres (dites « oublies de supplication » car elles exigeaient les deux mains comme pour se recueillir pieusement), quand à la fin du XVIIIe siècle une nouvelle oublie apparut, cuisinée à partir d’une pâte à crêpe enrichie d’œufs, de levure de bière et de sucre, sans qu’il fût nécessaire de la laisser reposer, de sorte qu’on pouvait la partager dans des petits moules à enfourner sur commande. Durant la Révolution une marchande à la criée, au jardin du Palais-Royal, lui aurait donné son nom : « C’est la belle Madeleine, qui vend des gâteaux tout chauds ! Tout chauds ! » Alexandre Dumas prétendait qu’il tenait la recette d’une pâtissière du roi Stanislas Leszczynski, nommée forcément Madeleine. En réalité, la recette de la madeleine s’inventa aussitôt que l’usage de la levure de bière se répandit dans les cuisines françaises. Cependant aucun écrivain, avant Proust, ne remarqua qu’elle épousait la forme évangélique de la coquille de Saint-Jacques. Mais, probablement, doit-il ce regard à ses aïeux, marchands d’oublies à Illiers.
Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d’un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en moi.[57] Les pèlerins levés à l’aube, harassés par le parcours à pied de Chartres à Illiers, éprouvaient déjà le même frisson, dû autant à la peine endurée sur la route vers Compostelle qu’à la soudaineté du réconfort quand, parvenus devant l’église Saint-Jacques à la tombée de la nuit, ils savouraient une oublie. Sur la place du Marché, tassée parmi les maisons du bourg, l’épicerie Proust faisait face à l’église. Outre des oublies, on y vendait du vin chaud, du lait, du bouillon. Valentin Proust appartenait à une famille de notables (peut-être des drapiers ou des meuniers), mais déclassé par quelque revers de fortune il avait épousé Virginie Torcheux, une simple oublieuse — on disait plutôt « marchande de plaisirs » depuis le XVIIIe siècle, cependant le mot créait l’équivoque, maintenant on préférait dire « épicière » —, et il tenait boutique avec elle. Tout petit commerce, animé par la vocation du service qu’il rendait aux affamés. Vocation dont le verbe oublier — faire l’obole au sens originel — rend toujours l’écho. L’oublie, à vous nourrir, à apaiser votre faim, votre soif, votre chagrin, agit comme en effaçant une dette, comme en oblitérant, comme en raturant son montant sur une traite. Songez qu’à présent votre créancier vous fait la grâce de ne plus se souvenir de ce que vous lui devez ; d’un geste généreux, il vous laisse quitte, il passe, il oublie.
« Allez… j’oublie ! » L’affirmer n’a rien d’anodin : il définit l’essence de la charité juive. J’oublie, je pardonne. Si le Juifs associaient à Dieu le délice d’un peu de pain à tremper dans un peu de vin, et si les chrétiens y conçurent l’eucharistie, le moelleux de la madeleine proustienne, la chaleur du thé qui l’imprègne comme en continuant d’infuser en elle, ne restituent-ils pas la même image mystique, et ce qu’elle vise de sublime, voire de dément ou de dérisoire, à associer au souvenir — le souvenir tout court, celui qui met en jeu la vie, le souvenir d’un amnésique qui sort de sa léthargie par un éblouissement spontané, le souvenir dont dépend A la recherche du temps perdu — l’oublie ?
En marge d’une recette de madeleine, les rédacteurs d’un livre de cuisine se plaisaient récemment à renverser l’image et à en tirer, à leur tour, un négatif : « Qu’on se le dise : la tante de Marcel Proust n’était pas si folle que cela. Pas au point en tout cas de tremper des madeleines dans son thé ! Dans son manuscrit original, l’écrivain (son biographe l’atteste formellement) avait évoqué noir sur blanc des biscottes pour le thé de sa tante. Mais l’éditeur, M. Gallimard, exigea de remplacer les biscottes en madeleines, pour s’écarter des sulfureux soupeurs qui trempaient à l’époque des biscottes un peu partout dans les lieux publics de Paris. L’auteur résista mais l’éditeur obtint gain de cause. »[58] Remarque stupide, d’une vulgarité atroce. Cependant, à déplacer l’objet et à le faire tremper dans une pissotière, ceux-là se demandent encore : « Qu’est-ce que c’est que cette pute ? » Remarquez que le nom, Madeleine, ne pose pas moins la question. « Cette femme, Luc l’appelle une pécheresse ; Jean la nomme Marie de Magdala ; et nous croyons qu’il s’agit de cette Marie de qui Marc assure que sept démons ont été chassés. Or, que désignent les sept démons, sinon l’ensemble des vices ? » déclarait le pape Grégoire le Grand[59] au VIe siècle en apportant sa caution doctrinale au culte d’une sainte dont la mission évangélique sanctifiait déjà les routes des principaux pèlerinages en Occident, à qui l’Église consacrerait bientôt des milliers de lieux de dévotion, en l’associant au culte de saint Jacques — comme de Vézelay à Compostelle.
« Tu vois cette femme ? » faisait remarquer Jésus à Simon le Pharisien. « Je suis entré dans ta maison et tu ne m’as pas donné d’eau pour mes pieds ; mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as pas donné de baiser ; mais, depuis que je suis entré, elle n’a pas cessé de me baiser les pieds. Tu ne m’as pas oint la tête d’huile ; mais elle m’a oint les pieds de parfum. Grâce à cela, je te le dis, beaucoup de péchés lui seront remis, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on remet peu aime peu. »[60] Ainsi, au regard du Christ, s’en tenir à la mesure en toutes choses, y forcer ses scrupules, y trouver son équilibre, ne retient guère de sens ; alors que les excès les plus scandaleux, les fautes les plus offensantes, les péchés les plus répugnants promettent au pécheur une position d’autant plus favorable dans l’estime de Dieu qu’il sera descendu bas dans l’indécence : faut-il encore que se produise un retournement en soi, que le pécheur se repentisse et ne pas perdre de vue cette condition essentielle et désintéressée. Cependant, à celui qui se permet peu d’écarts, qui résiste de son mieux aux vices, qui se conforme autant que possible aux règles de la pudeur manquera la dynamique où se joue précisément le sens de la vie, son ressort et sa puissance de retour.
« Là où les repentis se tiendront, les justes parfaits ne pourront se tenir », affirmait Rabbi Abahou, « car il est dit Paix, paix à celui qui était loin et à celui qui était près ![61] Donc d’abord à celui qui était loin, et seulement ensuite à celui qui était près. »[62] Comptabilité qui, en substituant à la logique du juste milieu l’exigence de la plus-value existentielle, requiert nécessairement en soi la présence, sinon d’un dealer, du moins d’un créancier. « Un créancier avait deux débiteurs », supposait Jésus. « “L’un lui devait cinq cents deniers, l’autre cinquante. Comme ils ne pouvaient le rembourser, le créancier leur fit grâce à tous deux. Lequel donc l’aimera le plus ?” Simon répondit : “Celui qui lui devait la plus forte somme.” Jésus lui dit : “Tu as jugé correctement.” »[63] C’est qu’oublier n’est pas le tout ; faut-il aussi apprécier le sentiment de reconnaissance, et plus encore la force du ressort qui le guide. Le souci de préserver sa santé, la vigilance à avoir face au désir de jouissance et à ses dangers, l’horreur légitime à éprouver pour la passivité imposaient des contraintes morales qui assignaient à tous ceux qu’affectaient publiquement les passions humaines le rang le plus bas, le plus redoutable, le plus déshonorant dans la hiérarchie des valeurs et des contre-valeurs de la culture gréco-romaine. Elle ne les tolérait pas moins, comme on tolère aujourd’hui les toxicomanes. S’agissait-il déjà de repérer les défoncés, selon une hygiène qui, au fond, n’a guère varié et commande de les repousser aux marges de la cité, là d’où sort Madeleine, avilie par la fange qui rend d’autant plus remarquable la place que lui accorde la littérature évangélique. Place des plus hautes : revient à Madeleine non seulement de reconnaître le Sauveur et de se compter parmi ses disciples, mais de le parfumer amoureusement et significativement, c’est-à-dire de lui donner l’onction qui fait précisément de Jésus le Messie à la lettre et en image : celui qui est oint.
« Naissait à Bethléem le tribun universel des peuples, le grand représentant sur la terre de l’égalité, de la liberté et de la république, le Christ », affirmait Chateaubriand. « C’est la société avec l’égalité des hommes entre eux, l’égalité sociale de l’homme et de la femme, c’est la société sans esclaves, ou du moins sans le principe de l’esclavage. L’histoire de la société moderne commence au pied et de ce côté-ci de la croix. »[64] Soutenir que la chrétienté, durant quinze siècles, n’avait jamais présenté que sa préface à la Révolution française n’allait pas de soi. Que lui importait ? Au temps où les armées de la République rayaient de la carte les États pontificaux, fonder la démocratie chrétienne valait bien ce tour de force mental.
« Soyez de bons chrétiens et vous serez d’excellents démocrates », certifiait alors Pie VII[65]. La Révolution américaine s’appuyait sur la même thèse, à ceci près que la culture puritaine qui l’avait forgée se donnait pour vocation de renverser la tyrannie de l’Église de Rome, et de purifier, précisément, l’idéal chrétien de toutes traces de catholicisme, conçu comme le ferment de l’arbitraire monarchique et du paganisme accroché au corps du roi comme à celui du pape, sous les oripeaux d’un faste offensant la dignité humaine. Les Lumières allemandes formulaient le même argument. Kant prolongeait Luther. Et invoquait-il la religion, pourvu qu’elle fût réformée et encadrée par la science, en réservant aux Lumières françaises le privilège du discours anticlérical et athée, encore qu’à sa manière Rousseau prolongeait Calvin, et le déisme des encyclopédistes celui de Port-Royal. Ainsi le culte de Madeleine, qui avait si bien évangélisé l’Occident, s’achevait par la détestation quasi universelle, à la fin du XVIIIe siècle, de la curie apostolique et romaine renommée la putain de Babylone, à l’égale de la reine de France alors. Les Lumières — d’où qu’elles vinssent — s’accordaient au moins sur ce point : à savoir que l’Église catholique réunissait en soi tous les vices de l’obscurantisme, ramenée à la fange d’où Jésus l’avait extraite, là où elle retrouvait la Synagogue. Sauf les Lumières juives précisément, non que Moses Mendelssohn, leur promoteur, songeât à prendre la défense du catholicisme, mais qu’il demandât au jour qui se levait de reconsidérer le statut de la nation sur laquelle s’était édifié le temps jusqu’à l’âge de raison : « Vous me dites que mes conclusions sapent les fondements du judaïsme, et vous m’offrez la sécurité à l’étage supérieur ! »[66] Chateaubriand reproduirait le même raisonnement, en se tournant à son tour vers Jérusalem.
« La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu’un si grand nombre d’hommes, après que la nature les a affranchis depuis longtemps de toute direction étrangère, restent cependant volontiers, leur vie durant, mineurs, et qu’il soit si facile à d’autres de se poser comme leurs tuteurs », regrettait Kant[67] en appelant chacun à sortir de l’adolescence et de ses masturbations, et à constituer la république adulte universelle. Mais accéder à la majorité n’impliquait pas seulement de perdre ses mauvaises habitudes, ni de remettre en cause l’autorité paternelle et la sagesse de la tradition : fallait-il encore qu’en devenant majeur on devienne majoritaire, quand théoriquement la science, de par sa nature gracieuse, faite pour éliminer l’ignorance, détenait le pouvoir de former la majorité. En tout cas, la Révolution française l’entendait ainsi et promettait d’y veiller. Cependant, si les Lumières juives — c’est-à-dire la Haskala, « l’Intelligence » en hébreu — se pliaient à ce programme et imposaient le culte du savoir aux enfants d’Israël, elles n’observaient pas moins une faille menaçante dans l’édifice rationnel qu’elles étayaient. Comment la nation juive pourrait-elle sortir réellement de l’état de minorité sans perdre la mémoire et disparaître ? Vouée à n’être qu’une minorité, était-elle nécessairement et à jamais mineure ? À supposer qu’ils puissent s’affranchir de toute tutelle, les majeurs (au sens kantien) ne se réduiront-ils pas inéluctablement à une minorité ? Et que signifie être majoritaire s’il exige l’amnésie ? — Ces questions, soulevées par le refus hassidique d’adhérer aux mots d’ordre de la Haskala, et par les objections mêmes que Mendelssohn énonçait déjà en se laissant emporter par le courant des Lumières, trouvaient à Paris, au tournant du XIXe et du XXe siècle, un écho remarquable, là où justement on l’y aurait prévu le moins.
Chaque jour j’attache moins de prix à l’intelligence, admettait maintenant Proust[68] dans l’une des premières esquisses où il laissait percevoir la saveur de l’oublie — non d’une madeleine encore, mais d’un peu de pain grillé trempé dans du thé. Alors je me rappelai : tous les jours, quand j’étais habillé, je descendais dans la chambre de mon grand-père qui venait de s’éveiller et prenait son thé. Il y trempait une biscotte et me la donnait à manger. Et quand ces étés furent passés, la sensation de la biscotte ramollie dans le thé fut un des refuges où les heures mortes — mortes pour l’intelligence — allèrent se blottir, et où je ne les aurais sans doute jamais retrouvées, si ce soir d’hiver, rentré glacé par la neige, ma cuisinière ne m’avait proposé le breuvage auquel la résurrection était liée.[69] Si l’intelligence n’y est pour rien, ce n’est pas parce qu’elle serait trop abstraite (du moins selon Proust, ce en quoi il se détache de son maître Bergson) — car, par nature, l’intelligence a soif de concret —, ni qu’elle se rendrait impuissante à enregistrer ce phénomène, comme en manquant d’une dose de surintelligence — l’intelligence est déjà bien assez intelligente —, mais que l’idée de redonner vie à ce qui est mort, non seulement l’idée mais le fait, le fait constaté par soi, le fait décrit en détail à la manière d’une expérience scientifique, l’intelligence ne peut pas le prendre réellement en compte, sauf à l’attribuer au travail du délire. Pourtant qui n’a pas revu ses morts en rêve ? Qui ne leur a pas parlé ? Qui ne s’en est pas réjoui ? Parfois, au moment de s’endormir, on les aperçoit, on veut fixer et définir leur charme, alors on s’éveille et on ne les voit plus, on s’y laisse aller et avant qu’on ait su les fixer on s’est endormi, comme si l’intelligence n’avait pas la permission de les voir.[70] C’est que les heures ne sont pas seulement passés mais mortes, à retenir les morts en elles. Sans cela, le moment où m’est offert de les retrouver, je ne l’accueillerais pas avec une telle joie, comme une grâce, en effet, au moins comme un répit, un sursis, une remise de peine, avant que le travail de la raison ne reprenne son relais pour mettre la résurrection à distance et me persuade qu’il serait absurde de nier sa consistance hallucinatoire.
Encore que la réminiscence provoquée par la cuillerée de thé où se décompose l’oublie dépende d’une expérience d’une autre nature que le rêve, au sens strict, puisque Proust la vit éveillé et qu’il peut d’autant mieux en éprouver la portée affective, mais également détailler ses phases et témoigner du bouleversement qu’elle induit, comme on le ferait à étudier sur soi les effets d’une drogue — ou plutôt de la drogue — sauf à donner au mot « rêve » la signification que lui crée Baudelaire : « l’illusion à décrire » élargie encore par Flaubert au travail de toutes choses sur soi, et non plus seulement d’un stupéfiant pharmaceutique.
Si je n’étais pas si faible, si j’avais vraiment assez de volonté pour me lever, pour partir, je voudrais aller mourir aux Oublis, dans le parc où j’ai passé tous mes étés jusqu’à quinze ans. Nul lieu n’est plus plein de ma mère, tant sa présence, et son absence plus encore, l’imprégnèrent de sa personne. L’absence n’est-elle pas pour qui aime la plus certaine, la plus efficace, la plus vivace, la plus indestructible, la plus fidèle des présences ?— écrivait Proust[71] en revenant aux Oublis. Songeait-il à la propriété des Weil à Auteuil où il naquit, où il passa en effet les étés de son enfance, où il revenait encore lorsqu’il achevait cette phrase, vers 1894, peu avant que la maison et son parc ne disparaissent, avalés par le laminoir du percement de l’avenue Mozart. Songeait-il probablement aussi à Illiers, au Pré Catelan de son oncle Amiot et à l’épicerie de ses grands-parents Proust face à l’église Saint-Jacques. La boutique existe toujours, fermée depuis des années, reprise par des marchands d’oublies qui, si hallucinants qu’ils soient, ne sont pas moins généreux. Songeait-il surtout à ce qui n’a plus lieu d’être, là où se constitue l’amnésie, quand plus tard, l’absence porta d’autres enseignements plus amers encore, qu’on s’habitue à l’absence, que c’est là la plus grande diminution de soi-même, la plus humiliante souffrance de sentir qu’on ne souffre plus.[72]
L’espoir de la venue du Messie, de la résurrection des morts et de l’accès des siens à la vie éternelle constitue le fondement de la recherche talmudique. Cependant elle y conçoit moins un dogme qu’un sentiment ; un sentiment donné à chacun à éprouver, à recueillir et à interpréter dans l’acte même de songer au kaddish — la prière des morts. Et à son vœu pathétique — né sur les ruines de Jérusalem, à dessein de réparer le monde, monde pourtant irrémédiablement brisé : « Chaque jour la malédiction augmente, et par quel mérite le monde peut-il survivre ? Par le kaddish — c’est-à-dire par la “sanctification” » dit le Talmud[73]. Les pharisiens l’énonçaient pour clôturer une journée d’étude à la synagogue, mais l’usage s’imposa bientôt de prononcer également ce vœu lors des funérailles et des cérémonies en mémoire des disparus.
Depuis plusieurs nuits, rapporte le Narrateur, mon père, mon grand-père, un de nos cousins veillaient et ne sortaient plus de la maison. Leur dévouement continu finissait par prendre un masque d’indifférence, et l’interminable oisiveté autour de cette agonie leur faisait tenir ces mêmes propos qui sont inséparables d’un séjour prolongé dans un wagon de chemin de fer. D’ailleurs ce cousin (le neveu de ma grand-tante) excitait chez moi autant d’antipathie qu’il méritait et obtenait généralement d’estime.
On le « trouvait » toujours dans les circonstances graves, et il était si assidu auprès des mourants que les familles, prétendant qu’il était délicat de santé, malgré son apparence robuste, sa voix de basse-taille et sa barbe de sapeur, le conjuraient toujours avec les périphrases d’usage de ne pas venir à l’enterrement. Je savais d’avance que maman, qui pensait aux autres au milieu de la plus immense douleur, lui dirait sous une tout autre forme ce qu’il avait l’habitude de s’entendre toujours dire : « Promettez-moi que vous ne viendrez pas “demain”. Faites-le pour “elle”. Au moins n’allez pas “là-bas”. Elle vous avait demandé de ne pas venir. »
Rien n’y faisait ; il était toujours le premier à la « maison », à cause de quoi on lui avait donné, dans un autre milieu, le surnom, que nous ignorions, de « ni fleurs ni couronnes ».[74]
« Ni fleurs ni couronnes », dans un faire-part de deuil, se réfère à une tradition juive dont l’origine remonte, dit-on, à l’Égypte antique. Formule qui s’entend à la lettre et en image : elle prescrit un deuil qui réprouve tous rites d’embaumement et d’embellissement funéraire ; mais à Paris, au temps de Proust, elle permettait surtout de signaler aux relations du défunt, qui pouvaient l’ignorer, son appartenance au culte israélite. Les lecteurs habitués à déchiffrer la rubrique nécrologique des journaux comprenaient alors ainsi « ni fleurs ni couronnes » — même si, à présent, son usage n’est plus aussi codé. Signal dont le but était moins d’interdire d’envoyer réellement des fleurs en hommage au disparu, que de prévenir des malentendus bien plus embarrassants, notamment dans les lettres de condoléances. Soucieux d’y répondre à la mort de son grand-oncle Louis Weil, de commenter ce même signe pour consoler Laure Hayman (la maîtresse de son oncle), et lui ôter l’idée d’une gaffe que le deuil rendait plus cruelle, Proust lui assure : Quand le bicycliste a eu rejoint avec votre couronne l’enterrement sans fleurs (c’était la volonté de mon oncle), quand j’ai su que c’était vous, j’ai éclaté en sanglots, moins de chagrin que d’admiration. […] On n’a pas pu mettre la couronne sur le char. Mais, arrivés au cimetière, quand on l’a dit à Maman, elle a voulu qu’on enterre mon oncle avec cette seule couronne puisque seule vous ne l’aviez pas su, et c’est ce qui a été fait.[75]
« Ni fleurs ni couronnes » ne constituait pas moins une manière de parler et de se dire juif dans les rites de la société israélite d’alors. Mais révélait-elle aussi combien l’appartenance au judaïsme était une affaire privée. Ni le patronyme ni les apparences sociales ne pouvaient en rendre compte à eux seuls sans équivoque ; et dans nombre de cas, en définitive, c’était par cette prière symbolique qu’on délivrait ce secret en soi, si surprenant parfois, sous le sceau de la même discrétion. Ainsi, serait-ce comme l’innocente Laure Hayman dans sa bévue — puisque seule vous ne l’aviez pas su —, à son tour, le lecteur de la Recherche, en se confrontant à cette anomalie, voire à cette révélation, doit maintenant se poser la question : se pourrait-il que la grand-mère maternelle du Narrateur soit juive ? Il n’y aurait rien de si étonnant à ce qu’elle le soit. Cependant, quand il parvient à ce passage du Côté de Guermantes, le lecteur a admis depuis longtemps que la famille maternelle de Marcel appartient à une bonne bourgeoisie catholique d’origine paysanne. Nombre d’éléments en témoignent — la piété de la tante Léonie, les dévotions de l’enfant narrateur à l’église de Combray, les réflexions quelque peu antisémites de son grand-père — et ils peuvent lui donner l’idée que Proust a voulu, par désir plus ou moins conscient, dissimuler, effacer et, en somme, oublier cette particularité familiale.
Or voilà que « ni fleurs ni couronnes » vient imprimer sur cette page de la Recherche sa marque juive, comme sur un faire-part de deuil, et comme pour reposer au lecteur une question qui, pourtant, semblait avoir été résolue depuis longtemps. Il est vrai que le Narrateur précise que le surnom, donné à son cousin dans un autre milieu, était ignoré par sa famille — fait d’autant plus troublant qu’il est livré sans commentaire. Le surnom ne suggère pas moins que ce cousin, habitué des enterrements juifs, est très probablement juif. Et, en le désignant comme le neveu de ma grand-tante, le Narrateur laisse supposer qu’il n’est pas, non plus, une « pièce rapportée » dans sa famille maternelle, d’autant qu’il prend soin de l’inscrire dans l’univers de Combray :
— Mon Dieu ! vous parlez de Combray : a-t-on pensé à prévenir Legrandin ?
— Oui, ne vous tourmentez pas, c’est fait, dit mon cousin dont les joues bronzées par une barbe trop forte sourirent imperceptiblement de la satisfaction d’y avoir pensé.[76]
« Ni fleurs ni couronnes », conjugué maintenant à « joues bronzées par une barbe trop forte », compose un portrait qui n’est pas très loin de celui d’un rabbin, surtout dans ces circonstances. Fait invraisemblable à qui lit la Recherche comme un roman de Balzac — mais pourquoi ne pas la lire autrement ? Ce cousin ne reparaîtra plus au regard du lecteur et, s’il crée un incident, c’est sans se rattacher à aucune intrigue, ni même à aucune logique classique, car si l’on s’en tient à la trame narrative, et au contexte qu’elle induit depuis le début de son cycle, la famille maternelle du Narrateur ne peut pas être juive. Et pourtant elle l’est, comme les Weil l’étaient. Le lecteur, au fond, admet assez facilement cette contradiction. Elle tient à l’énigme du génie de Proust, et à la manière dont ses particules narratives se fluidifient et changent de nature dès que l’on tente de trop les approcher et les identifier.
Car le fait détonnant d’abord — dans la mesure où le « je » du Marcel du roman se superpose naturellement au « je » du Marcel réel — c’est moins de découvrir que sa famille maternelle soit juive, qu’elle ne le soit pas, précisément. À moins de percevoir qu’il y a un temps où elle est juive, et un temps où elle ne l’est pas : deux temps contradictoires qui s’impliquent parfois dans le même moment. À cet égard, « ni fleurs ni couronnes » — la formule en soi, ce qu’elle suggère, comme le personnage qui l’incarne et lui offre une présence sensible — produit, au fond, une réminiscence à la manière de la madeleine de Combray : « J’avais oublié que j’étais juif, et voilà que, comme en buvant une gorgée de thé et en la laissant amollir un peu de biscuit sur ma langue, le rappel de cette prescription de deuil fait surgir un rabbin auprès de ma grand-mère mourante. » Néanmoins le Narrateur n’éprouve pas ce sentiment, pas même en silence, pas même en se taisant délibérément, et s’il s’oblige pourtant à inscrire dans sa phrase l’effet de ce dédoublement, et les éléments qui permettent de recréer son bouleversement au regard de la logique comptable du temps et de l’espace, c’est plutôt comme en en passant le relais à son lecteur et en le lui offrant à éprouver, sans rien lui imposer.
« La mort de la grand-mère : c’est un récit d’une pureté absolue », écrivait Barthes. « Je veux dire que la douleur est y pure, dans la mesure où elle n’est pas commentée (contrairement à d’autres épisodes de la Recherche) et où l’atroce de la mort qui vient, qui va séparer à jamais, n’est dit qu’à travers des objets et des incidents indirects. »[77] Ne croyez pas que Proust s’est laissé inspirer par la mort de sa mère, ou par celle de sa grand-mère Weil, ou encore de son grand-oncle et de l’incident de la couronne florale de Laure Hayman, pour composer la séquence de la mort de Mme Bathilde à l’hôtel de Guermantes, sans se rendre compte de ses « contradictions », car la séquence, longuement remaniée, constitue l’un des sommets de son art. Il y peint, comme dans un diptyque, un volet symétrique à la disparition de la tante Léonie dans Combray — à la différence près que c’est au lecteur qu’est donnée de réaliser, par lui-même maintenant, la réminiscence. Réaliser, au sens que Proust donnait à ce verbe : non seulement rendre réel, mais atteindre au réel qu’implique sa littérature. Guidé en cela par le signal de « ni fleurs ni couronnes », mais aussi par l’intrication de plus en plus sensible de deux trames chronologiques divergentes dans sa phrase.
Je ne voulais pas que ma mère remarquât trop l’altération du visage, la déviation de la bouche ; ma précaution était inutile : ma mère s’approcha de grand-mère, embrassa sa main comme celle de son Dieu, la soutint, la souleva jusqu’à l’ascenseur, avec des précautions infinies où il y avait, avec la peur d’être maladroite et de lui faire mal, l’humilité de qui se sent indigne de toucher ce qu’il connaît de plus précieux, mais pas une fois elle ne leva les yeux et ne regarda le visage de la malade, note le Narrateur.[78] « Jusqu’à l’ascenseur » : la présence d’une telle installation, d’une invention toute récente en 1898, quand est censée se passer cette séquence, dans un vieil hôtel aristocratique paraît assez peu vraisemblable — d’autant qu’auparavant personne ne s’est jamais servi de cet ascenseur, et qu’ensuite personne n’en servira plus. Proust prend soin de le signaler. Ah ! ces maudites jambes ! déplore Françoise en se confiant à un valet des Guermantes. En plaine encore ça va bien (en plaine voulait dire dans la cour, dans les rues où Françoise ne détestait pas de se promener, en un mot en terrain plat), mais ce sont ces satanés escaliers.[79] Ainsi semblent se superposer deux mondes dans la Recherche : le monde des escaliers et le monde des ascenseurs. Allez au musée Nissim de Camondo, rue de Monceau, construit des années 1910. Il reproduit à s’y méprendre l’architecture et le décor d’un hôtel du faubourg Saint-Germain pétri par le XVIIIe siècle. Boiseries, meubles, objets vous renverront le parfum de l’Ancien Régime. Pourtant, en ouvrant une porte, vous n’y découvrirez pas moins un ascenseur, conçu du reste dans le même style Louis XVI, lambrissé et vitré, mais qui dégage maintenant le parfum de la IIIe République. Vous y éprouverez un travail spécialement proustien et le bouleversement des notions qu’il opère.
« Je vous trouve tous aussi assommants les uns que les autres avec cette affaire », dit la duchesse de Guermantes qui, au point de vue mondain, tenait toujours à montrer qu’elle ne se laissait mener par personne. « Elle ne peut pas avoir de conséquence pour moi au point de vue des Juifs pour la bonne raison que je n’en ai pas dans mes relations et compte toujours rester dans cette bienheureuse ignorance », enregistre le Narrateur[80]. Instant tout aussi troublant, puisque personne n’ignore que Swann, un Juif s’il en est au regard du Narrateur, appartient au cercle des amis intimes de la duchesse. Ainsi Oriane semble glisser d’une identité à l’autre, d’un être à l’autre, d’un monde à l’autre. Mais, en restituant cette sorte d’hallucination, Proust ne vous fait pas moins respirer l’odeur de Paris durant l’affaire Dreyfus.
— Et cette robe de chambre qui sent si mauvais, que vous aviez l’autre soir, et qui est sombre, duveteuse, tachetée, striée d’or comme une aile de papillon ? demande le Narrateur à la duchesse de Guermantes. — Ah ! ça, c’est une robe de Fortuny. Votre jeune fille peut très bien mettre cela chez elle. J’en ai beaucoup, je vais vous en montrer, je peux même vous en donner si cela vous fait plaisir. Mais je voudrais surtout que vous visitiez celle de ma cousine Talleyrand. Il faut que je lui écrive de me la prêter, lui répond-elle[81], comme s’il lui semblait tout naturel que sa robe de chambre sente si mauvais et que Marcel se permette cette réflexion ; il est vrai qu’Oriane se lance, elle-même, dans un commentaire stupéfiant — mais pas moins charmant. Ainsi le détail, le « point » détonnant, invraisemblable, voire aberrant dans la Recherche, semble transmettre à l’événement comme un contrecoup sensible et mental qui pousse le lecteur à lui porter plus d’attention, à y revenir et l’observer toujours plus près.
Ces contrecoups intègrent particulièrement leurs dissonances au roman du Narrateur et des Guermantes ; roman principal de la Recherche, mais curieusement fluidifié, comme sans substance qu’aléatoire, écrit comme au fil de l’eau, en suivant le cours de la Vivonne, sans anticipation ni projet, sauf d’aller vers Guermantes, lieu pourtant intangible. Cependant, de loin en loin, le flux d’élégance aristocratique et le phrasé musical qui s’en dégage s’affrontent à de soudaines ruptures tonales, comme en secouant l’embarcation du Narrateur par un lapsus sortant de sa propre bouche, en le sidérant de scabreux, autant qu’elles prennent son lecteur au dépourvu, un instant, avant que le courant du phrasé n’absorbe l’ondulation en surface, et n’efface le remous comme un mauvais rêve, ou une pensée absurde ou obscène, mais où semble s’être accrochée par une griffe fugitive l’énigme du désir d’écrire. De sorte qu’à une telle énigme, posée par sa musicalité dissonante, la langue proustienne semble n’offrir en écho qu’une enveloppe d’acoustique mentale d’une radicale étrangeté aristocratique, où se libèrent des interrogations sans autre réponse qu’au Temps retrouvé l’éclair de la réminiscence, comme si l’énigme rejoignait son point de départ. Cela tient sûrement à l’élégance de cette langue et à sa manière d’appeler à un questionnement avec tellement de retenue que sa sollicitation peut entièrement m’échapper, et ce d’autant que je me laisse bercer d’aristocratisme sans songer que je pourrais aussi me heurter à du tragique. Là où je reviens à « ni fleurs ni couronne ». Travail que Proust aurait mal maîtrisé, ou n’aurait pas pris la peine de réviser — c’est là, notamment, la thèse de Willy Hachez, expert en chronologie proustienne qui analysa longuement, à cet égard, les innombrables erreurs de la Recherche, même si pourtant le Côté de Guermantes fut minutieusement corrigé par Proust.
Ainsi maintenant me faut-il faire un choix : les aberrations rencontrés au fil du récit et les détonations que j’y entends ne m’empêchent pas de lire A la recherche du temps perdu comme une histoire « dans le journal », rapportée et commentée par un journaliste génial, mais qui parsèmerait sa prose de coquilles sur quoi je peux généreusement passer. Mais je peux aussi m’arrêter. Et reprendre à mon tour un tel travail. Pourquoi pas ? Un travail où le regard fonde deux temps, désormais : le temps où j’oublie que je suis juif ; et le temps où je m’en souviens. Temps spécialement proustiens à mon regard, temps disjoints, et comme entrelacés, lesquels coïncident parfois pour créer une tension, une torsion du sentiment en élaborant une syntaxe hautement paradoxale, qui dépend de mon regard, autant que du regard que les autres me portent et se portent. Cependant, si je reste libre de croire que l’inclusion de « ni fleurs ni couronnes » n’est qu’anodine ou saugrenue, il me faut tout de même admettre qu’une telle syntaxe a bouleversé la vie de Proust et, au-delà de lui, l’histoire de son siècle. Evelyne Bloch-Dano s’y réfère inévitablement dans sa biographie de Jeanne Weil en soulignant que « ce cousin, avec sa barbe et de son surnom de funérailles juives, semble tout droit sorti de la famille »[82] Et, en signant le bon à tirer du Côté de Guermantes en 1920, comme jadis en refermant sa lettre à Laure Hayman, je ne puis croire que Proust ne songeait pas aux questions qu’une telle inclusion soulèverait, et qu’il suscitait délibérément.
Le consistoire israélite de Paris délégua tout naturellement, lors de l’agonie de Mme Proust, certains de ses membres pour assister ses proches. Ainsi « c’est un rabbin, écrit Mme Bloch-Dano, ultime geste d’un fils pour sa mère juive, qui devant la foule du Tout-Paris récita la prière des morts ».[83] La société israélite d’alors ne tenait guère à exposer des traditions qui l’auraient séparée de la communauté nationale, mais dans de telles circonstances, quand le deuil frappait, il eut été indigne de ne pas montrer qu’on était juif, « montrer » au sens le plus banal, mais aussi le plus douloureux. Reste que la cérémonie d’un rabbin psalmodiant le kaddish devant le cercueil d’une relation ou d’un ami connu sans doute pour ses origines juives, mais par une information qui jusque-là était demeurée abstraite, avait de quoi stupéfier beaucoup de ceux qui suivaient le cortège funèbre, qu’ils fussent juifs ou non, par le rappel qu’il opérait.
Yitgaddal vèyitqaddash sh’meh rabba… : « Magnifié et sanctifié soit le Grand Nom, dans le monde qui sera renouvelé, et où il ressuscitera les morts, et les élèvera à la vie éternelle, et rebâtira Jérusalem… » Matthieu Galley, dans son Journal — écrit pourtant bien des années après la mort de Mme Proust —, donne la mesure du bouleversement d’un tel rite, dans l’ordre intime, mais également social, ce d’autant que Galley partageait avec Proust la particularité qu’il était juif par sa mère : « 21 mars 1968 : Cimetière Montmartre, onze heures. Enterrement de tante Yvonne K. La famille proche, quelques amis, tous descendants d’Abraham. Cette petite troupe se dirige à pas menus vers le quartier juif. Toutes les tombes ont des noms caractéristiques. Derrière moi, j’entends des gens dire : “Tiens, les Halphen sont là ? Et les Cohen, c’est là-haut, tu vois, et les Kahn en bas.” Une promenade… Donc, tous ces gens, normaux, cossus, bourgeois. Arrive le corbillard. Soudain, toutes les têtes masculines se couvrent de melons et d’édens — que je n’avais pas remarqués à la main des propriétaires : autant de rabbins devant le mur des Lamentations, comme par miracle, remplacent les braves Français d’un instant plus tôt. » Galley souligne : « Plus tard, on fait la queue pour aller jeter une pelletée de terre dans la fosse (horrible, plutôt une fleur au moins). »[84] Réflexion qui ramène encore à « ni fleurs ni couronnes ». Mais plus remarquable dans ce récit : l’emploi des deux temps proustiens — celui du « brave Français, normal, cossu, bourgeois », et celui du « rabbin devant le mur des Lamentations » —, le passage d’un temps à l’autre, et la manière dont ils diffusent l’événement et l’émotion à y saisir. Cependant Galley était loin d’être naïf, et je gage qu’il n’aurait jamais imaginé un spectacle aussi détonnant, à son tour, qu’un Juif pieux se couvrant réellement d’un melon devant le mur des Lamentions, si ce n’est pour y éprouver l’esthétique où se comprenait la culture judéo-française du siècle dernier, où s’appréciaient également son style et la causticité de son esprit — l’esprit même de Mme Straus —, son temps perdu et son temps retrouvé.
Le lycée Condorcet formait alors l’élite intellectuelle de la société israélite de Paris : Proust, Bergson, mais également les Darmesteter, Reinach, Blum, Halévy, ces derniers par fratries entières, qui offraient au salon de Mme Straus son fonds de philosophes, d’érudits, d’esthètes, d’hommes politiques, de journalistes en vue. Emmanuel Berl, Raymond Aron, Claude Lévi-Strauss en sortiraient à la génération suivante. Paris ne comptait que trente mille Juifs sur près d’un million d’habitants dans les années 1880, cependant ils donnaient le ton dans les quartiers où ils s’échelonnaient selon leur degré de réussite sociale et d’intégration à la bourgeoisie française, d’est en ouest en suivant la ligne des Grands Boulevards, du Marais, du Sentier, de la Bourse, jusqu’au faubourg Poissonnière où demeuraient les Weil, et au faubourg Saint-Honoré où se situaient maintenant les Proust ; lieux qui, sans être peuplés majoritairement par des enfants d’Israël, n’étaient pas moins considérés comme des « quartiers juifs » sur la carte imaginaire de Paris, ce qui n’empêchait pas la duchesse d’Uzès de se loger aux Champs-Élysées, ni les Cahen d’Anvers rue de Grenelle. « Enfants petits-bourgeois, sortis des boutiques paternelles ; enfants grands bourgeois (on est grand bourgeois à huit ans) que nous envoyait le boulevard Haussmann ; Juifs minables, ardents à conquérir les prix, que nous envoyait le IXe, le Xe arrondissements ; Juifs glorieux, déjà séduits par la paresse, venus du VIIIe, voire de ce lointain XVIe dont alors commençait le prestige ; élèves bien pensants de l’école Fénelon, pieux troupeau, amené, gardé, remmené par les prêtres, et qui passait parmi nous comme l’eau d’un fleuve sacré, traversant, toujours bleue et pure, un lac aux eaux mêlées et parfois troubles », se souvenait Daniel Halévy[85]. Pour donner le ton au lycée Concordet, il n’appréciait guère ses semblables. N’oubliez pas que juif, sans majuscule, avant de désigner une identité religieuse, n’était qu’un nom commun en français, synonyme d’avare, de traître, de vicieux. Agir en juif : agir en faux-cul. Dans les lycées parisiens de l’après-guerre, on disait plutôt « agir en Suisse ». Mais, s’il adaptait à l’actualité, le mot sollicitait la même injonction. Halévy n’adhéra pas moins à la cause de Dreyfus dès que sa cousine Straus transforma son salon en quartier général de sa défense, en se rangeant toutefois au plus loin des Rothschild, parmi les socialistes et les anarchistes du mouvement dreyfusard, sous le drapeau d’Emile Zola, de Bernard Lazare, de Charles Péguy, avec qui il fonda les Universités populaires — là où précisément Saint-Loup rencontre Bloch. Ses travaux sur Proudhon et sur Nietzsche lui valurent une audience qui gagna bientôt la mouvance de l’Action française. Son soutien au maréchal Pétain et son appel à la collaboration avec Hitler parachèveraient la trajectoire que Proust anticipa en créant Bloch, encore qu’Halévy n’était juif que par son grand-père paternel, ce qui lui permit d’échapper à la sélection raciale imposée par Vichy.
Comme les Weil, les Halévy ou les Rothschild, la majorité des Juifs parisiens étaient issus de la mosaïque des principautés de l’Allemagne rhénane. La paix négociée au traité de Westphalie y avait établi la liberté de culte entre catholiques, luthériens et calvinistes — expérience nouvelle au XVIIe siècle en Europe. Les Juifs y trouvèrent des conditions favorables à une vie paisible et s’y installèrent en nombre. La bienveillance de princes déjà éclairés leur offrait l’asile d’une Judengasse réellement fermée par une enceinte dans les grandes villes, mais réduite plus banalement à une rue dans les bourgs et les villages. Ils ne s’y heurtaient pas moins aux règlements corporatifs qui les cantonnaient, pour la plupart, à des activités misérables de chiffonnage et de colportage. L’interdit qui, depuis le décret d’expulsion de 1394, frappait les Juifs sur le sol du royaume de France, avait laissé à quelques grands seigneurs en Alsace ou en Lorraine le privilège d’accueillir Israël sur leurs terres, à titre de nation étrangère, dont les ressortissants étaient strictement contingentés et assignés à résidence dans des juiveries. En étendant ses frontières à l’ensemble de la rive gauche du Rhin, la République leur concéda la nationalité française, du moins en théorie, car dans les faits obtenir un passeport pour Paris n’était pas si facile à qui voulait quitter le ghetto. Hormis quelques facteurs de cour et quelques fripiers clandestins, Paris n’avait pas plus connu de Juifs depuis des siècles quand eut lieu ce mouvement migratoire soigneusement encadré par les fonctionnaires du Premier Empire, et seuls les plus doués, les plus entreprenants ou les plus savants d’entre eux réussirent à se faire accorder ce droit, de sorte que les familles comme celle de Proust qui gagnèrent alors la capitale durent s’adapter à un tout nouveau mode d’existence et produire de tout nouveaux archétypes.
Au faubourg Saint-Honoré, les Rothschild permettaient d’observer ce phénomène mieux que personne. Sitôt introduit dans le salon des Straus, Proust passa sa vie à étudier cette famille et ses familiers, et il n’est guère de personnages de la Recherche dont les modèles présumés ne lui sont pas attachés de près ou de loin. Aucune autre famille patricienne, bancaire ou industrielle, n’a jamais créé de style. Cependant, à leur tour, les historiens du goût ne distinguent les données du style Rothschild qu’en projetant le style Proust sur le plan décoratif. À évoquer son charme et sa spécificité, ils y impliquent nécessairement le roman d’émancipation juive toujours induit par ce nom, serait-ce à leur corps défendant. Ainsi les repérages de son adaptation d’A la recherche du temps perdu au cinéma conduisirent inévitablement Luchino Visconti au château de Ferrières élevé par James de Rothschild, encore habité par ses descendants alors, où il retrouva intact le décor du faubourg proustien, quand déjà le bal costumé, donné dans ce même château par les Guy de Rothschild pour célébrer le centième anniversaire de la naissance de Proust, avait ressuscité le côté de Guermantes et celui de chez Swann mieux peut-être qu’aucun film y réussira jamais.
Quant au livre intérieur de ces signes inconnus (de signes en relief, semblait-il, que mon attention explorant mon inconscient allait chercher, heurtait, contournait, comme un plongeur qui sonde), pour sa lecture, personne ne pouvait m’aider d’aucune règle, cette lecture consistant en un acte de création où nul ne peut nous suppléer, ni même collaborer avec nous, écrivait Proust[86]. Et déléguait-il à Swann la charge d’ouvrir le livre et de le confronter à l’enfant Narrateur en lui posant la question même de la lecture : signifiant quoi ? — à la façon de ces hiéroglyphes dont le déchiffrage est difficile, mais qui, seuls, donnent une vérité à lire.[87]
Schwan : cygne en yiddish[88]. À tracer son sillage sur l’eau de la langue proustienne comme la nacelle du nouveau-né Moïse sur le Nil, il constitue l’énigme que son nom formule en soi, pour peu que le petit Marcel l’entrevoie. Or comment ne l’entreverrait-il pas ? Tiens ! « Une visite, qui cela peut-il être ? » mais on savait bien que cela ne pouvait être que M. Swann.[89] Cependant, à mesure qu’il revient inlassablement vers l’enfant, conduit par l’habitude, mais une habitude de plus en plus troublante au regard de l’enfant, jusqu’à le soumettre à la crise initiale et initiatique du baiser de Combray comme le petit Proust à sa première crise d’asthme sur le chemin de Boulogne et à son initiation à la morphine, se révèle peu à peu la double vie de Swann ; double vie qui ne cessera plus de se dédoubler, relayée par les noms — Méséglise, Guermantes, Bergotte, Odette, Oriane, Charlus, etc. — qui lancent à leur tour leur défi à l’enfant comme autant de chiffres à déchiffrer. Or, à glisser sémantiquement et homophoniquement, le schwan yiddish, qui conduit par l’anglais et le français jusqu’au cygne, lequel, glissant à son tour, percute le signe, ne s’arrête pas là pour autant et opère bien d’autres remous signifiants. Car, à prendre à rebours son sillage, il pose nécessairement la question : comment traduire « signe » en yiddish ? — Schild.[90] Child. Enfant trouvé dans la langue, sur qui se penche Proust pour rendre vie à Swann comme la fille du pharaon sur Moïse pour le sauver des eaux du Nil. Cher Charles Swann, que j’ai connu quand j’étais encore si jeune et vous près du tombeau, c’est parce que celui que vous deviez considérer comme un petit imbécile a fait de vous le héros d’un de ses romans, qu’on recommence à parler de vous et que peut-être vous vivrez.[91] Or, avant d’en arriver là, le Narrateur a appris depuis longtemps à son lecteur que Charles Swann est justement le neveu de lady Israël. Et de préciser que la famille de son mari, qui était à peu près l’équivalent des Rothschild, faisait depuis plusieurs générations les affaires des princes d’Orléans.[92] Enfant d’Israël, le fils Swann crée ainsi dans la maison de Combray, en même temps que dans la littérature française, un événement fantastique. Admettez qu’il puisse suffoquer le petit Marcel. Un jour qu’il était venu nous voir à Paris après dîner en s’excusant d’être en habit, Françoise ayant, après son départ, dit tenir du cocher qu’il avait dîné « chez une princesse », — « Oui, chez une princesse du demi-monde » avait répondu ma tante en haussant les épaules sans lever les yeux de sur son tricot, avec une ironie sereine.[93] Admettez aussi qu’il puisse soulever les ricanements des siens.
Pourtant un Juif s’était déjà introduit dans la littérature française, et au faubourg Saint-Germain, en déchaînant des sarcasmes bien plus féroces. « Ui, mon envand, che suis le paron te Nichingenne… — Le baron de Nucingen ne doit pas, ne peut pas rester dans un chenil pareil. Ecoutez-moi ! Votre ancienne femme de chambre Eugénie… — Icheni ! te la rie Daidpoud […]. Che la gonnais, s’écria le millionnaire en riant. Ichénie m’a gibbé drendre mille vrans. »[94] Il est vrai que Balzac peignait là un Juif d’exception pas moins qu’un Juif symbolique qui induit, en cela, une loi de sa Comédie humaine. Et procède-t-elle du même événement fantastique que Proust étudiera à son tour, mais en l’observant d’un tout autre point de vue que Balzac, cependant à partir des mêmes données sociologiques, on pourrait presque dire familiales, puisque Swann est, en quelque sorte, le fils de Nucingen. Événement dans la société parisienne, comme dans toute l’Europe occidentale et bientôt jusqu’en Orient, événement consubstantiel à la Révolution française, quoiqu’il semblât mineur, d’abord, au regard de cette Révolution qui, en libérant les Juifs du ghetto, constituait une nouvelle figure hébraïque dégagée de ses références traditionnelles, religieuses ou culturelles : un Juif pleinement émancipé et acquis à l’actualité. « Fa de vaire viche ! s’écria Nucingen, il n’y a que le nom te Rotschild qui faille mile égus, ed encore quant ille ette zigné au pas t’ein pilet. »[95] À étudier ce mouvement d’émancipation et à lui garder l’accent des Judengasses de l’Allemagne rhénane, Balzac ne lui porte pas moins un regard spécialement français. Et rend-il compte de l’impact du nom de Rothschild sur l’imaginaire de la société française. En elle, plus particulièrement, car il ne semble pas qu’au XIXe siècle en Angleterre, en Allemagne, en Autriche ou en Italie, c’est-à-dire dans les pays où les différentes branches de cette famille fleurirent, elle n’inspira des sentiments aussi passionnés ni aussi contrastés qu’en France. Songez déjà que, sans elle, nous n’aurions ni Nucingen, ni Leuwen, ni Swann, ni Charlus.
Jacob Rothschild naquit dans le ghetto de Francfort, où sa famille comme les Weil dans celui de Niedernai avait longtemps végété. Il s’installa à Paris en 1811 pour y ouvrir bientôt une banque. En passant par Londres, où il se forma, il en avait gardé l’usage du prénom de James sans se forcer à le retraduire en Jacques, à cause de l’habitude acquise sans doute, mais encore par une sorte de dandysme que renforçait son anoblissement par l’empereur d’Autriche, avec le titre de baron. Le fait serait insignifiant si Proust n’avait compris ce même enjeu dans le nom de Swann quand, en partant de schild, et en jouant sur l’homophonie de « signe » et de « cygne », il préféra, à la forme allemande schwan, la forme anglaise swan. Jeu complexe, puisque l’homophonie ne s’entend qu’en français et qu’elle semble restituer l’itinéraire de James de Rothschild, en prenant en compte que pour la première fois depuis la fin du XVe siècle, depuis l’expulsion des Juifs d’Espagne et l’invention du ghetto, le judaïsme se reconnaissait dans une image splendide, et dans ce nom de Rothschild qui, en démentant l’antique malédiction, symbolisait maintenant la fortune. Révolution sentimentale dans l’histoire juive, mais pas seulement juive.
Le fameux portrait de la baronne James de Rothschild par Ingres donne la mesure du prestige qu’avait acquis cette famille en France, et du rang qu’elle occupait déjà, sous la monarchie de Juillet, dans la hiérarchie des élégances parisiennes. Balzac tire de son salon, rue Laffitte, cette autre loi de la Comédie humaine, quand, en 1834, dans La Duchesse de Langeais, en comparant le faubourg Saint-Germain et la Chaussée d’Antin, il constate : « Là où il n’était besoin que d’un grand cœur, il faut, de nos jours, un large crâne. L’art, la science et l’argent forment un triangle social où s’inscrit l’écu du pouvoir et d’où doit procéder la moderne aristocratie. Un beau théorème vaut un grand nom. Les Rothschild, ces Fugger modernes, sont princes de fait. »[96] Balzac rendait hommage à des hôtes qu’il appréciait ; il dédia d’ailleurs à James et à Betty de Rothschild deux de ses nouvelles ; mais fussent-ils princes de fait, il ne perdait pas de vue les avanies que la noblesse d’Ancien Régime leur réservait parfois. Et de faire dire à la vicomtesse de Beauséant que « Mme de Nucingen laperait toute la boue qu’il y a entre la rue Saint-Lazare et la rue de Grenelle pour entrer dans mon salon. »[97] Ce qui n’empêcherait pas la baronne d’y être bientôt invitée et reçue avec honneur. Mais, outre l’accent du ghetto, Balzac leur gardait en pensée des desseins quelque peu méphistophéliques, en faisant largement école. « Après l’aristocratie de la naissance, c’était maintenant l’aristocratie de l’argent ; c’était le califat des comptoirs, le despotisme de la rue du Sentier, la tyrannie du commerce aux idées vénales et étroites, aux instincts vaniteux et fourbes », déplorait Huysmans[98] dans À rebours en 1884. Notez que le mot Sentier avait déjà pris son sens actuel. Car c’est ainsi que se construit la géographie sentimentale de Paris, pas moins que la sociologie nationale. « “Le patron ? Un vrai juif ! Et vous savez, les juifs, on ne les changera jamais. Quelle race !” Et il cita des traits étonnants d’avarice, de cette avarice particulière aux fils d’Israël, des économies de dix centimes, des marchandages de cuisinière, des rabais honteux demandés et obtenus, toute une manière d’être usurier », rapportait Maupassant dans Bel-Ami en 1886[99] au moment même où l’adolescent Proust le croisait dans le salon de Mme Straus, quand Drumont publiait La France juive, alors que la présence du banquier juif dans la littérature française devenait incontournable et que d’un écrivain à l’autre, d’un livre à l’autre, la même séquence semblait s’enchaîner. « Ah ! ce Gundermann, ce sale juif, qui triomphe parce qu’il est sans désir ! C’est bien la juiverie entière, cet obstiné et froid conquérant, en marche pour la souveraine royauté du monde, au milieu des peuples achetés un à un par la toute-puissance de l’or. Voilà des siècles que la race nous envahit et triomphe, malgré les coups de pied au derrière et les crachats. Lui a déjà un milliard, il en aura deux, il en aura dix, il en aura cent, il sera un jour le maître de la terre », poursuivait Zola[100] dans l’Argent en 1891.
« C’était, dans une avant-scène, le gros Naiderberg enrichi par dix faillites, Naiderberg, dont les exécutions à la Bourse se soldent par des achats de villas à Cannes et de grands hôtels en Suisse, Naiderberg, bouffi, boursouflé de graisse malsaine avec sa face de lèpre blanche et son allure de suffète ; puis, en suivant le rang dans les loges, les trois frères Helmann, l’air de squelettes d’oiseaux avec leurs épaules hautes, leurs maigres torses en proue de navire et leurs museaux de peseurs d’or, lèvres minces, nez plus minces et yeux plus minces encore, mais d’une luisance jaune de métal sous leurs clignotantes paupières », ajoutait Jean Lorrain[101] dans Monsieur de Phocas en 1901. Et l’on pourrait continuer indéfiniment. Si je m’y attarde autant, c’est que l’enchaînement de tous ces Nucingen, Walter, Gundermann, et autres Naiderberg et Helmann, compose évidemment la généalogie de Swann, puisque tous ces noms reviennent au même, et qu’ils épèlent, chacun à leur manière, celui de Rothschild. Littéralement signe rouge en yiddish, dont Proust comprend les enjeux, plus clairement encore, dans le second patronyme qu’il donne à cette famille : Israël (en retenant d’ailleurs dans le prénom de l’oncle de Swann — sir Rufus Israël — le rouge de Rothschild, et donne-t-il également sa teinte rousse à la chevelure de Charles et à celle de Gilberte) : « Israël, du moins c’est le nom que portent ces gens, qui me semble un terme générique, ethnique, plutôt qu’un nom propre. On ne sait pas, peut-être que ce genre de personnes ne portent pas de noms et sont seulement désignées par la collectivité à laquelle elles appartiennent. Cela ne fait rien ! Avoir été la demeure des Guermantes et appartenir aux Israël !!! clame le baron de Charlus[102]. Remarquez toutefois que Charlus compose l’anagramme de Ruschal. Amusez-vous à changer les voyelles comme en hébreu où seules les consonnes comptent : vous entendrez Roschil.
Peu après la publication du Côté de chez Swann, en décembre 1913, un certain Harry Swann, dont on ne sait rien sinon que sa lettre était postée depuis Saint-Maur, écrivit à Proust pour se plaindre qu’il ait utilisé son patronyme sans son accord — peut-être parce que ce nom, qui n’avait rien de spécialement juif avant de s’inscrire dans le roman proustien, par cette charge subite et déplorable de son point de vue, devenait lourd à porter. Proust ne s’en soucia nullement ; néanmoins en décembre 1920, il songea soudain à lui répondre : Quand j’ai fait paraître il y a huit ans (et écrit il y en a douze) Du côté de chez Swann, j’étais déjà fort malade, et pour beaucoup de noms, je me suis servi tout simplement, comme faisait Balzac, de noms réels appartenant à des gens existants. Mais ce ne fut pas le cas pour mon héros, car je ne connaissais et n’avais entendu parler d’aucun Swann. Le prototype de Swann était M. Charles Haas, Haas, l’ami des princes, l’israélite du Jockey. Mais ce n’était qu’un point de départ.[103]
Charles Haas était le fils du caissier de James de Rothschild ; du caissier comme on disait au temps de Balzac, c’est-à-dire l’un de ses principaux fondés de pouvoir. En prenant la succession de son père, il continuait à siéger dans les conseils d’administration des affaires liées aux Rothschild, tandis que son érudition et son goût pour le XVIIIe siècle lui conféraient dans cette famille — dans un rôle qu’il partageait avec Émile Straus, Charles Ephrussi, Robert de Montesquiou et quelques autres — une autorité de connaisseur en matière d’achats d’œuvres d’art. Mais il illustrait également, comme déjà Heinrich Heine en son temps, l’archétype du beau Juif amateur de femmes de monde. Dans sa préface à la correspondance entre son oncle et Mme Straus, Suzy Mante-Proust racontait que « la comtesse de B[roissia], à la suite d’une rupture avec Charles Haas, montra tant d’émotion en le rencontrant dans le monde que son mari, dans le coupé qui les ramenait chez eux, lui dit sévèrement : “Madame, M. Charles Haas est votre amant.” La pauvre femme, complètement bouleversée, répondit : “Si cela pouvait être encore…” »[104] Painter signale une autre conquête de Haas : la marquise d’Audiffret, qui lui donna en 1881 une fille, Luisita, qu’il reconnut en 1890. Cependant Philippe Jullian, dans sa biographie de Montesquiou, opère une curieuse incidente, en notant un détail dont il n’est pas sûr qu’il l’ait compris comme Proust, même s’il entrevoyait, par ailleurs, le même secret : « Haas connaît la peinture presque aussi bien que le monde. Dans les dîners il réveille l’intérêt sans alarmer les convictions ; il ne supporte la médisance qu’extrêmement drôle et sait être discret. Tant de qualités vont souvent aux dépens du naturel : “Ce Haas, comme il est obtenu… ” disait Degas. »[105] De la même façon qu’Oriane, à propos de l’empereur d’Allemagne, disait qu’il a quelque chose d’amusant, d’obtenu comme un oeillet vert, c’est-à-dire une chose qui étonne et ne plaît pas infiniment, une chose qu’il est étonnant qu’on ait pu faire, mais qu’on aurait fait aussi bien de ne pas pouvoir.[106] La duchesse évoquait par là l’homosexualité de Guillaume II. Issue sans doute d’un dîner chez les Straus, Proust enregistra l’expression « obtenu ». Formule rare, il est vrai, formule dont Proust s’est soucié de préserver le sens particulier qu’il prenait alors dans cette coterie. Or, par la même formule, Degas n’en suggérait pas moins quant à Haas. « Montesquiou a la tête pleine de Balzac, quand il rencontre chez des cousins un homme charmant, barbe rousse et yeux verts, dont les femmes raffolent, que les hommes estiment pour sa belle conduite pendant la guerre et sa connaissance en objets d’art ; Charles Haas s’intéresse à ce petit Montesquiou si vif sous ses airs rêveurs », précisait Jullian. « Un garçon du monde passionné de littérature ne pouvait trouver plus sage conseiller, un peu trop sage même. Ce mentor que l’on rencontre aussi à Dieppe présente Robert à des beautés qui ont brillé aux Tuileries, Mme de Pourtalès, la princesse de Sagan, piaffantes, empanachées, impeccables comme des chevaux de cirque. »[107] Ainsi, vers 1875, Haas semble avoir inauguré la tradition du voyage de l’éraste et de l’éphèbe sur les plages de la côte normande, en compagnie du jeune Montesquiou ; tradition que Montesquiou restaurera en 1887, en compagnie du jeune Jacques-Emile Blanche ; puis Blanche, lui-même, en 1891, en compagnie du jeune Proust.
« Comment ? Vous avez connu Swann, baron, mais je ne savais pas. Est-ce qu’il avait ces goûts-là ? demanda Brichot d’un air inquiet. — Mais est-il grossier ! Vous croyez donc que je ne connais que des gens comme ça. Mais non, je ne crois pas », dit Charlus les yeux baissés et cherchant à peser le pour et le contre. Et pensant que puisqu’il s’agissait de Swann, dont les tendances si opposées avaient été toujours connues, un demi-aveu ne pouvait qu’être inoffensif pour celui qu’il visait et flatteur pour celui qui le laissait échapper dans une insinuation : « Je ne dis pas qu’autrefois, au collège, une fois par hasard », dit le baron comme malgré lui, et comme s’il pensait tout haut, puis se reprenant : « Mais il y a deux cents ans ; comment voulez-vous que je me rappelle ? vous m’embêtez », conclut-il en riant. « En tous cas il n’était pas joli, joli ! » dit Brichot, lequel, affreux, se croyait bien et trouvait facilement les autres laids. « Taisez-vous, dit le baron, vous ne savez pas ce que vous dites ; dans ce temps-là il avait un teint de pêche et, ajouta-t-il en mettant chaque syllabe sur une autre note, il était joli comme les amours. »[108] Voilà comment débute la chronologie de la Recherche, bien avant la naissance du Narrateur.
Mais, si l’invention du nom de Swann a abondamment été commentée, celle du nom de Charlus n’a guère suscité d’interprétations. Le nom propre, pourtant, sa couleur phonétique, son spectre lumineux en imaginaire tout comme les notes musicales qu’il émet, la qualité de son signal, la substance personnelle, sociale, historique qu’il recouvre, les tentations auxquelles il soumet le lecteur, le roman de la désillusion et du désenchantement qu’il induit, mais également le mystère étymologique qu’il fixe en lui, la joie qu’il procure à qui parvient à le pénétrer ne cessent de produire le questionnement proustien. C’est que pour Proust, soulignait Barthes, « le Nom propre dispose des trois propriétés que le Narrateur reconnaît à la réminiscence : le pouvoir d’essentialisation (puisqu’il ne désigne qu’un seul référent), le pouvoir de citation (puisqu’on peut appeler à discrétion toute l’essence enfermée dans le nom, en le proférant), le pouvoir d’exploration (puisque l’on “déplie” un nom propre exactement comme on fait d’un souvenir) : le Nom propre est en quelque sorte la forme linguistique de la réminiscence. Aussi l’événement (poétique) qui a “lancé” la Recherche, c’est la découverte des Noms ; sans doute, dès le Sainte-Beuve, Proust disposait déjà de certains noms (Combray, Guermantes) ; mais c’est seulement entre 1907 et 1909, semble-t-il, qu’il a constitué dans son ensemble le système onomastique de la Recherche : ce système trouvé, l’œuvre s’est écrite immédiatement. »[109]
Le nom de Charlus apparaît dans ses cahiers d’esquisses précisément au tournant de 1910. Proust l’avait longtemps appelé Quercy ou Guercy, où l’on peut déjà entendre comme une contraction de Guermantes et de Rothschild. Proust était assez familier du faubourg Saint-Germain et de la lecture de Saint-Simon pour savoir qu’en aucun cas le frère cadet d’un duc français ne peut porter le titre de baron. Et renforce-t-il le sentiment de cette contraction en soi, d’autant qu’à l’époque de Proust, plus encore qu’à celle de Balzac, il n’était aucun nom en France, et bien au-delà, qui comprît en lui un tel excès de sens que celui de Rothschild, tant dans l’ordre de la fortune que de celui de la haine que lui vouaient les antisémites.
Encore que les propos venimeux contre les Rothschild n’empêchaient nullement les écrivains de fréquenter leurs salons ni de danser à leurs bals. Mirbeau racontait à Paul Hervieu comment Maupassant avait annoncé à tout le monde, y compris à « des gens qu’il ne saluait plus depuis des années », sa dernière bonne fortune : « Oui, mon cher, je vais chez le baron Ferdinand de Rothschild, à Londres, passer trois semaines. Nous partons soixante de Paris, tout ce qu’il y a de plus chic dans le grand monde. Je verrai les plus grandes dames de l’Angleterre et les plus grands lords. »[110] Il y aborda également Henry James. Et Maupassant d’écrire, en été 1888, à Mme Straus chez qui il avait rencontré son hôte : « Je suis en Angleterre depuis quinze jours, et j’ai vu défiler dans le manoir Rothschild une quantité de gens illustres, à commencer par le fils du prince de Galles. »[111] L’enfant Proust aperçut sans doute les équipages de Ferdinand de Rothschild sur les routes de Boulogne et d’Auteuil, mais il approcha le baron de plus près chez les Straus. On lui reconnaissait un si grand goût qu’il tenait à Londres un rôle d’arbitre des élégances comparable à celui qui revenait à Paris à Haas, à Sagan ou à Montesquiou — et il inspira probablement un peu à Wilde le personnage de lord Henry dans Le Portrait de Dorian Gray.
L’exposition des maîtres anciens à la Royal Academy de Londres, peint par Henry Brook en 1886 (aujourd’hui à la National Portrait Gallery), le représente au milieu d’un groupe d’amateurs, en redingote grise et haut-de-forme noir, en rappelant la peinture de James Tissot et son Cercle de la rue Royale (là où, selon le Narrateur, il faut chercher l’image de Swann), mais, lui, Ferdinand de Rothschild, d’une stature plus haute et plus imposante que celle de Charles Haas dans le Cercle, cependant pas moins élégante, la barbe virile et les bras croisés, avec un regard curieusement solitaire et mélancolique. Veuf de sa cousine Evelina, morte en couches en 1866, le baron l’avait beaucoup pleurée et ne s’était jamais remarié, délaissant le monde des affaires, quoique poursuivant une intense activité mondaine jusqu’à ce que les remous provoqués par l’affaire de son cousin Rosebery et le procès Wilde ne l’obligent à plus de discrétion. Proust s’en souviendrait : « C’est édifiant, je ne dis pas, il va tous les jours au cimetière lui raconter combien de personnes il a eues à déjeuner, il la regrette énormément, mais comme une cousine, comme une grand-mère, comme une soeur. Ce n’est pas un deuil de mari. […] — Ce que vous dites est absurde, interrompit vivement M. de Guermantes, Mémé n’a rien d’efféminé, personne n’est plus viril que lui.[112] L’un de ses biographes attribue à Ferdinand de Rothschild une excentricité préméditée : « Il donnait, par exemple, un bal à une date trop rapprochée pour que ses invitées n’aient pas le temps de préparer leur toilette ; après quoi, l’hôte trop pressé se rattrapait en commandant pour elles à ses frais les dernières créations des couturiers pour la réception suivante. » Et « à Noël, il envoyait un couple de faisans à tous les employés d’omnibus de Londres. »[113] Proust ne s’en souviendrait pas moins : J’aimerais assez connaître un garçon des wagons-lits, un conducteur d’omnibus. Du reste ne soyez pas choqué, conclut le baron, tout cela est une question de genre.[114]
Barthes souligne encore que « c’est parce que le Nom propre s’offre à une catalyse d’une richesse infinie, qu’il est possible de dire que, poétiquement, toute la Recherche est sortie de quelques noms. Encore faut-il bien les choisir — ou les trouver. C’est ici qu’apparaît, dans la théorie proustienne du Nom, l’un des problèmes majeurs, sinon de la linguistique, du moins de la sémiologie : la motivation du signe. Sans doute ce problème est-il ici quelque peu artificiel, puisqu’il ne se pose en fait qu’au romancier, qui a la liberté (mais aussi le devoir) de créer des noms propres à la fois inédits et “exacts” ; mais à la vérité, le Narrateur et le romancier parcourent en sens inverse le même trajet ; […] l’un décode, l’autre code, mais il s’agit du même système et ce système est d’une façon ou d’une autre un système motivé, fondé sur un rapport d’imitation entre le signifiant et le signifié. »[115] Or, à admettre que ces coïncidences ne soient pas dues au hasard, il me faut concevoir que le nom de Charlus constitue une sorte d’envers, de verlan du nom de Swann, comme pour illustrer la réversibilité de la présence du Juif et de la tante au cœur du sentiment proustien ; sentiment que Proust éprouva sûrement au plus intime de lui, mais dont il sut tirer, au-delà de soi, un extraordinaire outil d’observation du réel. Et à étudier le baron Ferdinand chez Mme Straus, chargeait le nom de Rothschild, déjà si hautement signifiant, d’un dandysme plus captivant encore que celui qu’observait Balzac un demi-siècle plus tôt dans le salon de la baronne James.
Les boiseries du XVIIIe siècle — dont on faisait encore peu de cas sous le Second Empire, quand les travaux d’Haussmann détruisaient nombre de vieux hôtels —, ces boiseries présentaient autant d’intérêt au regard de Ferdinand de Rothschild qu’une peinture ou un meuble, et on lui prête l’idée originale d’avoir su préserver le décor autant que l’objet d’art. Démonter soigneusement un « salon » pour le remonter tout aussi soigneusement dans un autre lieu, comme aujourd’hui les revival rooms des musées américains, crée un effet de transposition étroitement lié à l’art de Proust sur un plan littéraire, ne serait-ce que parce qu’il ne cesse lui-même de démonter et de remonter le salon Straus pour l’installer tant dans l’appartement des Swann qu’à l’hôtel de Guermantes. Sans ce travail de montage et de remontage, une porte ne pourrait pas s’ouvrir, comme par mégarde, pour révéler un ascenseur. Même si, modestement, Ferdinand de Rothschild précisait : « Ma famille peut se voir ou non attribuer le phénomène, c’est une question de point de vue, mais le fait est bien à l’origine du renouveau du décor intérieur du XVIIIe siècle. Les pièces ont été reconstruites avec des matériaux d’origine, et avec le souci de respecter l’ordonnancement de l’époque, tout en s’adaptant aux exigences modernes. »[116] L’une de ses trouvailles, les boiseries du salon de Samuel Bernard rue du Bac, qu’il avait fait remonter dans l’hôtel de son cousin Edmond au faubourg Saint-Honoré, a rejoint aujourd’hui le musée de Jérusalem. Or, précisément, Proust attribue cette idée décorative au baron de Charlus, lequel avait fait transporter chez lui une grande partie des admirables boiseries de l’hôtel de Guermantes au lieu de les échanger, comme son neveu, contre un mobilier modern style.[117] Mais l’aveu amoureux du baron au Narrateur part aussi d’un prétexte décoratif : Vous offrez à votre derrière une chauffeuse Directoire pour une bergère Louis XIV. Un de ces jours vous prendrez les genoux de Mme de Villeparisis pour le lavabo, et on ne sait pas ce que vous y ferez. Pareillement, vous n’avez même pas reconnu dans la reliure du livre de Bergotte le linteau de myosotis de l’église de Balbec. Y avait-il une manière plus limpide de vous dire : « Ne m’oubliez pas ! »[118] Formule pourtant pleine d’énigme, mais qui s’éclaire quand on sait qu’en Angleterre le myosotis est appelé Forget me not ou Love me. Pourtant, à s’en tenir à la trame du roman et à son contexte historique, les Rothschild, de toute évidence, ne peuvent pas coïncider avec les Guermantes, pas plus que les Weil avec la famille maternelle du Narrateur. Ils ne coïncident pas moins, ou plutôt ils se déplacent et basculent l’un vers l’autre, en créant à la Recherche la tension et la vibration du regard de Proust — tant il suffit d’oublier que les Rothschild sont juifs pour voir les Guermantes — et ramène-t-il au cheminement de son enfance du côté d’Auteuil.
Non loin du 96, rue La Fontaine, où se trouvait la maison de campagne des Weil, partait la rue Pierre-Guérin, qui remontait vers le village d’Auteuil, en s’arrêtant rue Boileau. Près ce carrefour, une grande porte cochère se signalait qui ouvrait sur le dédale des cours de l’hôtel de Verrières, entouré d’écuries d’Ancien Régime et de boutiques échelonnées au revers de ses ailes sur la rue d’Auteuil. Le grand portail a disparu, mais certains des bâtiments qui l’enserraient sont encore visibles aujourd’hui, submergés par l’urbanisme terne du XVIe arrondissement. Alors, dans les années 1870, quand Proust naquit, l’hôtel de Verrières, enclos dans un domaine secret que les villageois appelaient le « château d’Auteuil », imposait son modelage aristocratique dans ce quartier populaire, provincial et presque rural. Il laisse d’ailleurs encore entrevoir ses élégances architecturales au milieu des commerces actuels qui enchevêtrent pharmacie, fleuriste et Monoprix à ses abords. Bâti pour une danseuse d’opéra sous Louis XV, et voué aux plaisirs, il abritait dans des annexes une salle de bal et un théâtre, détruits dans années 1950 quand Eugène de Rothschild, l’héritier de son oncle Ferdinand, céda ce domaine à EDF pour laisser la place à des bureaux où loge maintenant la direction du CNRS. Néanmoins le peu qui reste du parc garde cette particularité qu’enclavé par des constructions sur tous ses côtés il demeure presque invisible à un regard extérieur. Le percement de la rue Michel-Ange, à la fin du Second Empire, l’avait déjà rétréci, avec l’élévation d’immeubles le long de cette rue, mais lui avait valu un nouveau portail qui, en doublant celui de la rue Boileau, ouvrait à travers ses grilles une vue étroite sur son parc. Face à ce portail, sur le terrain libéré de l’autre côté de la rue Michel-Ange, on venait de construire, en ses années 1870, l’École normale israélite orientale, conçue sur le modèle de l’École normale supérieure, afin de former les instituteurs et les professeurs qui prendraient en charge l’enseignement du français et des Lumières, autant que de la culture juive, auprès des communautés séfarades sortant à peine alors de leur misère et de leurs ténèbres sur toutes les rives de la Méditerranée ; école où enseignerait, au siècle suivant, Emmanuel Levinas — et qui se consacrait déjà à l’étude du Talmud ; école que fonda Adolphe Crémieux, le grand-oncle de Proust, le chef de sa famille, le témoin de Jeanne Weil à son mariage, école qu’il présida de 1860 à 1880.
Président du consistoire israélite de France de 1843 à 1850, puis de l’Alliance israélite universelle de 1863 à 1866, personnage de la vie parisienne, célèbre avocat, animateur du Parti républicain, député, sénateur, ministre de la Justice dans le premier gouvernement de la IIIe République (à qui, incidemment, les miens comme tous les Juifs d’Algérie doivent leur nationalité française), Crémieux consacra sa vie à construire le judaïsme français, et son salon, rue Bonaparte, prenait un relais brillant, à la fois littéraire, politique et mondain, dans la société de la monarchie de Juillet, du Second Empire et des débuts de la IIIe République, quand commence la Recherche. George Sand, Alexandre Dumas, Lamartine, Rossini, le duc de Broglie, la princesse Mathilde, Gambetta, Arago sont cités notamment parmi ceux qui le fréquentaient. « C’est dans ce salon éclectique, véritable école de littérature et de pensée, qu’Adèle Berncastel, la grand-mère de Proust avait grandi. Orphelines de bonne heure, ses sœurs et elle avaient été élevées par Crémieux, qu’elles regardaient comme leur père », signale Diesbach[119].
Ainsi la rue Michel-Ange perçait le secret du château d’Auteuil centré sur le jet d’eau d’un bassin à la Hubert Robert. On peut toujours l’entrevoir. Aveuglé aujourd’hui par le béton des bâtiments du CNRS, mais ombré alors par les arbres de son parc, ce paysage offrait à l’enfant Proust le motif d’une rêverie qui, en enjambant le siècle, le ramenait aux amours clandestines du maréchal de Saxe et de Mlle de Verrières que l’hôtel avait abritées ; amours dont naquit Aurore Dupin, la grand-mère de George Sand. De sorte que Proust, rien qu’à remonter la rue La Fontaine en allant du côté de chez les Rothschild, pouvait observer rue Michel-Ange la rencontre de deux mondes — celui de l’étude talmudique, côté pair, et du libertinage parisien, côté impair — absolument étrangers l’un à l’autre, mais qui ne se regardaient pas moins, maintenant, d’un trottoir à l’autre de cette même rue.
Hôtel de Rothschild, 5, rue Michel-Ange. École normale israélite orientale, 6, rue Michel-Ange. La proximité d’une telle école et de la maison de campagne des Weil où les Proust passaient près de six mois par an, le fait que sa famille était liée de très près à sa fondation et à sa gestion créent évidemment un rapport entre l’auteur de la Recherche et ce lieu d’étude. L’asthme obligeait l’enfant, puis l’adolescent Proust à garder la chambre. Ses absences du lycée Condorcet durant presque toute une année l’obligèrent même à redoubler une classe. Et il n’y aurait rien d’étonnant à ce que les Weil aient demandé à l’école de la rue Michel-Ange de détacher un professeur ou un étudiant pour lui servir de répétiteur. Les talmudistes de l’époque étaient extraordinairement lettrés, y compris en matières grecque et latine, et les siens pouvaient naturellement recourir à cette solution, sans même songer à lui donner une éducation religieuse.
Au nom du Ciel… auquel nous ne croyons hélas ni l’un ni l’autre, écrivait Proust[120] à Mme Straus — laquelle ne déclara pas moins au prêtre qui tenta de la convertir lors de son premier mariage avec l’auteur de Carmen : « J’ai trop peu de religion pour en changer ! » Henri Raczymow, dans sa biographie de Maurice Sachs (dont la grand-mère s’était remariée avec Jacques Bizet), remarque : « Quelles surprenantes pratiques religieuses chez cette Mme Straus, née Halévy. Certes, le père de Jacques, Georges Bizet, n’était pas juif. Mais c’est elle et nul autre qui tint à ce que son fils fût à sa naissance catholiquement baptisé et eût pour parrain et marraine… le baron [Edmond] et la baronne Salomon de Rothschild. Singuliers “israélites” que ces Halévy, Straus et autres Rothschild qui pratiquent un christianisme de pure convention mondaine, et sont en réalité rigoureusement athées. »[121] Alors que, de son côté, la duchesse de Clermont-Tonnerre souligne que sa tante, la baronne Salomon — qui porta effectivement Jacques Bizet sur les fonts baptismaux — était « farouchement israélite », d’une piété orthodoxe, qu’elle rompit avec ses sœurs, la duchesse de Gramont et la princesse de Wagram, après leurs mariages, et qu’« elle se brouilla avec Hélène, sa fille unique, parce qu’elle aussi épousa un chrétien, le baron van Zuylen »[122]. Toutes choses qui semblent contradictoires, mais peignent assez bien la société juive de Paris, société extravagante s’il en est.
Au demeurant, si Hélène de Rothschild provoquait tant de remous, ce n’est pas tant parce qu’elle avait épousé un chrétien que parce qu’elle affichait avec un panache magnifique son goût pour les femmes. Son embonpoint et son allure virile lui valaient le surnom de la Brioche dans les cercles lesbiens, où vous reconnaissez le profil de l’amie de Mlle Vinteuil. Un scandale éclata quand elle publia un recueil de poésies saphiques écrit avec Renée Vivien, une jeune Américaine qu’elle avait enlevée à Natalie Barney, laquelle deviendrait un temps la compagne de sa cousine Clermont-Tonnerre. Cette petite bande entourait la baronne Adolphe de Rothschild et sa belle-sœur, la baronne Alphonse. L’adolescent Proust les croisa sûrement chez Mme Straus, également leur belle-sœur. « Si la vieille baronne Alphonse entrait trébuchante, les yeux vagues, Mme Straus lui apportait aussitôt la crème et le thé réconfortants ; elle lui murmurait rapidement : “Ferrières… belle robe de Worth… Comment vont les oiseaux de la grande volière ?… Voici le dernier tableau acheté par Emile…” » se rappelait la duchesse de Clermont-Tonnerre[123]. La cour des Tuileries sous le Second Empire se racontait déjà les aventures d’une petite bande de libertines, volontiers tribades. Les rapports de la brigade des mœurs à la préfecture de police de Paris n’en témoignent pas moins[124]. Une petite bande très en vue, à l’origine de la coterie du prince de Galles, animée par la princesse de Metternich, la marquise de Galliffet, la comtesse de Pourtalès, la princesse de Sagan, et déjà la baronne Alphonse, dans tout l’éclat de sa jeunesse alors. Proust les cite toutes parmi les amies intimes d’Oriane, en réservant toutefois à la baronne une place à part : Mme de Villeparisis avait présenté Bloch à Mme Alphonse de Rothschild, mais mon camarade n’avait pas entendu le nom et, croyant avoir affaire à une vieille Anglaise un peu folle, n’avait répondu que par monosyllabes aux prolixes paroles de l’ancienne Beauté quand Mme de Villeparisis, la présentant à quelqu’un d’autre, avait prononcé, très distinctement cette fois : « la baronne Alphonse de Rothschild ». Alors étaient entrées subitement dans les artères de Bloch et d’un seul coup tant d’idées de millions et de prestige, lesquelles eussent dû être prudemment subdivisées, qu’il avait eu comme un coup au coeur, un transport au cerveau et s’était écrié en présence de l’aimable vieille dame : « Si j’avais su ! » exclamation dont la stupidité l’avait empêché de dormir pendant huit jours. Ce mot de Bloch avait peu d’intérêt, mais je m’en souvenais comme preuve que parfois dans la vie, sous le coup d’une émotion exceptionnelle, on dit ce que l’on pense.[125]
« L’argent est le Dieu de notre époque et Rothschild est son prophète », remarquait Heinrich Heine[126] — l’un des poètes préférés de Karl Marx, bientôt son ami et son correspondant à Paris, où il l’y accueillit en 1844, à l’époque où le futur auteur du Capital publiait ses thèses sur La Question juive, lesquelles se résumaient au mot de son mentor parisien sur les Rothschild. Heine y mettait d’autant plus d’ironie qu’il était aussi alors, depuis déjà des années, non seulement l’un des favoris du baron James, entretenu par lui, mais encore le chevalier servant de sa femme et, disait-on, son amant. « Mme James est accouchée d’un gros garçon dont la façon ne me paraît pas avoir coûté grand-chose à James, il faut toujours que ces Juifs gagnent à tout ce qu’ils font, même ce qu’ils ne font pas », confiait alors Balzac à la comtesse Hanska en diffusant ce même écho[127]. Qui sait si Heine ne présenta pas Marx à Betty de Rothschild « car elle était vraiment princesse, soupirait-il ; c’était la reine de Judée. »[128]
Lazare Weil, qui se conçut assez d’audace pour quitter les bords du Rhin et s’établir à Fontainebleau en 1799, où il y créa la petite fabrique de porcelaine qui fut à l’origine de la fortune de Proust, maria à Paris en 1812 son fils, Baruch, à une jeune fille de Trèves issue d’une vieille lignée de rabbins à laquelle appartenait également Karl Marx. Tradition plus que millénaire dans les familles juives, l’alliance du commerce et de l’école talmudique ne produisait pas moins des tensions souvent douloureuses entre les deux côtés de la famille : le côté Kafka, « la boutique », au regard de l’auteur du Procès, et le côté Löwi (le patronyme de sa mère), « la maison d’étude ». En janvier 1892, à la synagogue de la Victoire, Proust servit comme garçon d’honneur au mariage de sa cousine, Louise Neuburger, avec Henri Bergson. S’y perpétuait la même tradition. Gustave Neuburger, le bras droit d’Alphonse de Rothschild à la banque de la rue Laffitte, unissait sa fille au descendant d’une lignée aussi pieuse et instruite que celle des Marx, quand ils s’appelaient encore Lévi, et qui ne bouleverserait pas moins l’histoire.
Phénomène qu’Hannah Arendt observait en Allemagne, mais il émanait de toute communauté juive en voie d’émancipation, en Occident comme en Orient. Et, si le monde commençait d’adhérer au même modèle, Proust comme Kafka y décelait une spécificité juive — là où les Guermantes se distinguent au faubourg Saint-Germain. M. Greffulhe au régisseur de Bois-Boudran : « Je vous présente le duc de Guiche qui avait ses deux baccalauréats à quatorze ans ; le duc de Guiche est docteur (à Guiche : docteur en quoi ? — Guiche : pas docteur ; licencié ès sciences) ; licencié ès sciences, docteur, toute la boutique ! racontait Proust[129] à Bertrand de Fénelon. Guiche était le fils aîné d’Agénor de Gramont et de Marguerite de Rothschild. Par l’expression « Maison Greffulhe » ou « Maison Rothschild », la langue française désignait maintenant des banques autant que des dynasties aristocratiques, et qui s’alliaient à Vallière, splendide spécimen du style familial, en présence de Proust. Les débuts des fiançailles ont été étonnants, M. de Gramont et M. Greffulhe ayant le même caractère, et peu faits l’un et l’autre pour s’accommoder d’un semblable. M. Greffulhe à Guiche : « C’est assez gentil Vallière. C’est pas vilain du tout. Il y a un petit lac. C’est gentillet. Dame, je ne pense pas que votre père ait la prétention de comparer cela à Bois-Boudran, n’est-ce pas ce serait à mourir de rire, etc. etc. » Mais peu à peu Guiche était devenu la chose à M. Greffulhe, et devenu par là même une chose admirable, supérieure à ce que les autres possèdent, observait-il, malmené dès son arrivée à Vallière par le duc de Gramont qui, en l’invitant à signer le registre du château, lui martela : « Votre nom, Monsieur Proust, mais… pas de pensée ! »[130] Car, s’ils laissaient déjà entrevoir les traits du duc de Guermantes, Henry Greffulhe et Agénor de Gramont ne se rangeaient pas moins « du côté de la boutique » au regard de Proust. « La base en était la mentalité des pères, hommes d’affaires arrivés qui n’avaient pas une très haute opinion de leur réussite et rêvaient pour leur fils de destinées plus hautes. C’était la version sécularisée de l’antique croyance juive selon laquelle ceux qui “étudient” — la Torah ou le Talmud, c’est-à-dire la loi de Dieu — sont l’élite authentique du peuple et ne doivent pas à se soucier de tâches aussi vulgaires que gagner de l’argent ou travailler dans le but d’en gagner. Ce qui ne veut pas dire que dans cette génération il n’y eut pas de conflit entre père et fils ; au contraire, la littérature de l’époque en est pleine », remarquait Arendt. « Mais en général ces conflits étaient résolus par la prétention des fils à être des génies, ou, dans le cas des nombreux communistes issus de familles aisées, à faire le bonheur de l’humanité — à se fixer, de toute manière, des buts plus élevés que l’argent. »[131]
Les Bergson s’installèrent à Auteuil, dans une petite villa au 18 avenue des Tilleuls, non loin de chez les Weil. En 1893, ils donnèrent naissance à une fille prénommée Jeanne comme Mme Proust, car les cousines étaient très liées, enfant qui se révéla bientôt sourde et muette. « Je suis sûr que plusieurs traits de la philosophie d’Henri Bergson s’expliquent par cette source inconnue », supposait Jean Guitton[132]. Bergson enseignait alors au lycée Henri IV. Samuel Zbitkower, son arrière-grand-père, personnage illustre dans le monde hassidique, avait fait une fortune qui valait à sa famille le surnom de « Rothschild de Varsovie ». Il y avait élevé une synagogue comparable à la Rothschild-Schule de la rue de la Victoire. Son petit-fils, Michael Zbitkower, était président de la communauté juive de Varsovie lorsqu’un autre de ses descendants publiait Matière et Mémoire. La tradition hassidique restait encore vivante parmi les siens. À sa manière, si excentrique qu’elle fût, Bergson la cultiva toute sa vie et la transmit à ses disciples. Pensionnaire à l’institut Derenbourg-Springer, il y avait reçu une éducation talmudique, quand l’institut prêtait ses locaux au séminaire israélite de Paris où se formaient les rabbins français. Quelques années auparavant, son cousin, Arsène Darmesteter, s’y était lui-même instruit, avant de perdre sa vocation rabbinique pour rejoindre le lycée Condorcet, bachelier à seize ans, licencié à dix-huit, en lui ouvrant la voie. Désormais laïc et athée, Darmesteter n’offrait pas moins son expertise à la baronne Nathaniel de Rothschild qui formait une collection de manuscrits hébraïques et d’objets liturgiques juifs qu’elle léguerait au musée de Cluny. L’enfant Proust le croisa probablement chez Mme Straus. Et il s’intéressa peut-être à cette collection. En tout cas, quand il commença à fréquenter le cabinet de Bergson — lequel ne s’ouvrait guère que pour lui alors — Proust put étudier de près la pensée d’un talmudiste hors pair, aussi éloigné de la pratique du culte que Darmesteter, mais pas moins savant.
« En lisant ces pages où les objets les plus disparates semblent naturellement se donner la main, où tout se mêle et tout se heurte dans la splendeur d’un sauvage désordre, on croit assister au déroulement d’une immense rêverie qui ne connaîtrait d’autres lois que celles de l’association d’idées », concevait Darmesteter[133] en posant sur le Talmud le regard qui mettait à distance le Juif et sa mémoire, non qu’il ne sût la déchiffrer — il la déchiffrait mieux que personne — mais en archéologue à présent, dans un monde où l’amnésie devenait la norme. « Il n’est pas jusqu’aux discussions les mieux circonscrites où ce désordre n’arrive à se donner carrière. Pour éclaircir, par exemple, un point de discussion, on a besoin d’une citation — une citation d’une ligne. Croyez-vous qu’on se contente d’indiquer par une incidente le nouvel argument ? Il va se développer tout au long avec ses tenants et ses aboutissants, si bien que, pour l’embrasser dans toute son étendue, il faudra oublier l’objet primitif et capital qui l’avait fait invoquer. »[134] Or, si la nécessité de l’oubli jusqu’au cœur du raisonnement constitue l’originalité de la langue talmudique, précisément parce qu’elle me permet de déterrer un objet archéologique et de m’y reconnaître, elle ne dépend pas moins du sentiment.
Ils ont tous oublié que je suis juif. Moi pas, confiait Proust à Emmanuel Berl, un autre de ses cousins[135]. Mais, s’il est difficile d’imaginer l’auteur d’A la recherche du temps perdu en Juif, et bien plus difficile de se le représenter à l’étude du Talmud, cela tient encore à la définition du judaïsme français et à son histoire. Le culte pouvait bien prendre une forme cérémonielle et inévitablement visible, quelque précaution qu’on prenne pour ne pas heurter les principes plus anticléricaux que laïcs de la IIIe République ; l’étude, elle, demeurait une affaire strictement privée, insue et tue. Ne relevait-elle pas, au regard des Lumières et du Progrès, d’un délire scolastique et cabalistique qu’il eût été mal venu d’exposer dans un tel contexte, sauf à passer pour un Juif arriéré, inassimilable et, en somme, fanatique ? N’y revenait-on pas comme un pervers redécouvre les rites et le goût de la drogue ou du vice — là où, précisément, Sodome se regarde dans Jérusalem comme d’un trottoir à l’autre de la même rue, en exigeant la même dissimulation, la même clandestinité, voire la même honte, en tout cas la même langue, où manger du papier ? L’étude — telle que la comprenait Proust — réclamait nécessairement la solitude et cette sorte de désordre à quoi Darmesteter reconnaissait la signature du Talmud, désordre que Proust préférait nommer obscurité en y retrouvant les contours de sa chambre noire, sa formation bergsonienne et sa nostalgie hassidique. Ainsi notait-il sur l’un de ses carnets (l’un des carnets offerts par Mme Straus pour le nouvel an 1909) où il y esquissait son roman : Seul mérite d’être exprimé ce qui est apparu dans les profondeurs. Et habituellement, sauf l’illumination d’un éclair, ou par des temps exceptionnellement clairs, enivrants, ces profondeurs sont obscures. Cette profondeur, cette inaccessibilité pour nous-même est la seule marque de la valeur — ainsi peut-être qu’une certaine joie. Peu importe de quoi il s’agit. Un clocher, s’il est insaisissable pendant des jours, a plus de valeur qu’une théorie complète du Monde. Voir dans le gros cahier l’arrivée devant le Campanile — et aussi Zohar.[136]
Or lire le Zohar — littéralement en hébreu « la Splendeur », le livre phare du hassidisme —, lire le Zohar est pratiquement impossible à qui n’a au moins un peu pénétré l’esprit du Talmud. « Mes amis, mes proches, moi-même, constatait Berl, auraient été bien surpris de me voir, dans mon lit, entre un volume du Zohar et une traduction dactylographiée de “l’Alphabet du rabbin Akiva”, que je ne peux pas lire dans le texte, qui, probablement, sont inintelligibles en français et auxquels, néanmoins, j’ai souvent réfléchi depuis dix ans. »[137] Si, à la fin de sa vie, Berl ne l’avait pas évoquée, qui se serait douté qu’il se livrait à une telle étude ? Berl, figure si symbolique de la société israélite de Paris, le disciple de Darmesteter et de Bergson, l’ami d’Anna de Noailles, de Jean Cocteau, d’André Malraux, de Drieu La Rochelle, ce Juif qui ne semblait plus avoir de juif que le nom, peut bien même l’évoquer, reste qu’il est difficile de l’imaginer en Juif, y compris à ses propres yeux. « Quand je me reporte à mon enfance, si je regarde les choses dans l’ensemble, et du dehors, il semble presque bizarre que je sois juif. » Et de relever : « On se rappelle que le grand-père de Michel Debré était rabbin parce que son père est un médecin célèbre et que lui-même est Premier ministre. S’il s’agissait de petites gens qui donc s’en soucierait ? Qui s’en souviendrait ? Quelques personnes telles que moi qui n’ont pas oublié la bonté du rabbin Debré, le petit bureau de la rue du Marché à Neuilly, où il tâchait de m’apprendre l’alphabet hébreu. Mais nous ne devons pas être très nombreux. »[138]. Et, aujourd’hui, qui se souvient que l’aïeul des Debré était rabbin ? Qui peut même le concevoir tant cela paraît stupéfiant désormais ? Mais si le terme de talmudiste prend une couleur toute aussi hallucinante quand on l’applique à Proust, c’est que, plus encore que les Debré, il a acquis la qualité d’un monument français : qu’il y a là contradiction dans les termes ; une contradiction dont Proust, lui sûrement mieux que personne, a entrevu, mesuré, éprouvé la portée, de sorte que sa recherche elle-même résulte de cette contradiction.
Le sentier qui mène par le côté de Guermantes jusqu’au cœur du faubourg Saint-Germain, et la promesse que son narrateur tient d’approcher au plus près l’aristocratie parisienne, pouvaient combler les attentes d’un lecteur de L’Action française, soucieux de retrouver, sous le « pays légal » dominé par la « juiverie républicaine », le « pays réel », foncièrement royaliste, catholique et antisémite. Proust laisse percevoir qu’une telle conception imprègne le Marcel du roman, pas exagérément mais incontestablement, du moins jusqu’aux abords du Temps retrouvé. Comment ne l’imprégnerait-elle pas ? Elle se comprend à son tour dans le roman de Swann et de son retour au judaïsme. Et s’implique-t-il nécessairement dans la trame chronologique de l’affaire Dreyfus et dans l’anticipation de ce que sera le XXe siècle par Proust.
Je ne savais pas écrire, n’ayant jamais su travailler, mais je savais bien que j’avais l’oreille plus fine et plus juste que bien d’autres, ce qui m’a permis de faire des pastiches, car chez les écrivains, quand on tient l’air, les paroles viennent bien vite. Mais ce don, je ne l’ai pas employé et, de temps en temps, à des périodes différentes de ma vie, celui-là, comme celui aussi de découvrir un lien profond entre deux idées, deux sensations, je le sens toujours vif en moi, mais pas fortifié, et qui sera bientôt affaibli et mort. Pourtant il aura de la peine, car c’est souvent quand je suis le plus malade, que je n’ai plus d’idées dans la tête ni de forces, que ce moi que je reconnais parfois aperçoit ces liens entre deux idées, comme c’est souvent à l’automne, quand il n’y a plus de fleurs ni de feuilles, qu’on sent dans les paysages les accords les plus profonds. Et ce garçon qui joue ainsi en moi sur les ruines n’a besoin d’aucune nourriture, il se nourrit simplement du plaisir que la vue de l’idée qu’il découvre lui donne, il la crée, elle le crée, il meurt, mais une idée le ressuscite, comme ces graines qui s’interrompent de germer dans une atmosphère trop sèche, qui sont mortes : mais un peu d’humidité et de chaleur suffit à les ressusciter.
Et je pense que le garçon qui en moi s’amuse à cela, doit être le même que celui qui a aussi l’oreille fine et juste pour sentir entre deux impressions, entre deux idées, une harmonie très fine que tous ne sentent pas. Qu’est-ce que c’est que cet être, je n’en sais rien, concluait Proust[139] au tournant de 1909 en passant de Contre Sainte-Beuve à la Recherche
L’être inconnu qui prend ici l’apparence d’une graine morte, mais qui n’en finit plus de reprendre vie, et de se constituer dans l’intermittence, se retrouve comme par hasard — mais, là encore, est-ce si étonnant ? — dans le regard de Walter Benjamin quand, en 1927 (alors qu’il vient de décider un éditeur à lui confier la tâche de traduire A la recherche du temps perdu en allemand et qu’il accomplit un voyage à Paris en suivant les pas de Proust), il emmène Gershom Scholem contempler un objet spécialement proustien : « Benjamin me traîna au musée de Cluny, raconte Scholem, pour me montrer avec un enthousiasme sans bornes, dans une collection d’objets rituels juifs exposée là, deux grains de blé sur lesquels une âme fraternelle avait gravé en entier le Shéma Israël. »[140] Ces objets appartenaient à la collection de la baronne Nathaniel de Rothschild. Proust étudia-t-il ces extraordinaires miniatures talmudiques chez elle ou plus tard lorsqu’elle les légua au musée de Cluny ? La chose en soi n’a guère d’importance : le fait est que le lecteur de la Recherche peut les aborder à son tour sous le nom de papiers japonais.
Et comme dans ce jeu où les Japonais s’amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d’eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés s’étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l’église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé.[141] Hélas, rien n’est plus décevant que de tenter aujourd’hui la même expérience. Cela tient peut-être à la mauvaise qualité des papiers japonais que le marché parisien offre actuellement ; en tout cas, à les plonger dans un aquarium, ils ne révèlent guère qu’une matière d’éponge, somme toute assez banale, qui ne fait guère illusion ; sauf à requérir la collaboration d’ingénieurs en effets spéciaux, ce qui serait lamentable, même pour les besoins d’un film. Il est vrai que le Narrateur entend parfois dans le mot asiatique un son familier à son auteur et guère difficile à décrypter. Ainsi, la salle à manger des Swann, sombre, note-t-il, comme l’intérieur d’un Temple asiatique peint par Rembrandt.[142] Manière de parler, encore, et de faire rimer pagode et synagogue, du moins au regard de Proust et de son humour, où se perçoit encore la distance qui le sépare de son narrateur, et la variation perpétuelle de l’oubli qu’une telle distance comprend dans ce « je » littéraire, mais où se devinent peut-être aussi les grains talmudiques qu’enrobent les petits papiers asiatiques.
« Plus l’objet était petit, plus il semblait susceptible de contenir, sous la forme la plus concentrée, tout le reste » — observait Hannah Arendt alors qu’elle revenait après guerre au musée de Cluny sur les pas du traducteur allemand de Proust ; « d’où le bonheur de Benjamin à constater que deux grains de blé pussent contenir tout le Shéma Israël, essence même du judaïsme, la plus minuscule essence apparaissant sur la chose la plus minuscule, origines, chacune, d’un développement auxquelles nul produit, quant à sa signification, ne peut être comparé. En d’autres termes, ce qui fascina profondément Benjamin depuis le début ne fut jamais une idée, ce fut toujours un phénomène. »[143] Mais, s’il est une phénoménologie benjaminienne, implique-t-elle autant l’œuvre de Talmud que celles de Proust et de Baudelaire qui ensemble décidèrent de sa vocation de traducteur et de son destin d’homme.
Le Shéma Israël gravé sur les miniatures talmudiques prononce, là encore, moins une prière qu’une promesse en soi et à soi : Shéma Israël, Adonay élohénou, Adonay éhad… : « Écoute Israël, l’Éternel notre dieu, l’Éternel est un. Béni soit à jamais le nom de son règne glorieux. Tu aimeras l’Éternel ton dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, et de tous tes moyens. Que les commandements que je te prescris aujourd’hui soient gravés dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras dans ta maison, en te couchant ou en te levant. Attache-les en signe sur ta main, et porte-les comme un fronteau entre tes yeux… » Voilà la première section de Shéma, encore est-elle incomplète, et en existe-t-il deux autres tout aussi longues pour le retenir en entier. Concevez quelle maîtrise il fallut au graveur de ces grains de blé. Hélas encore, disparus ou égarés aujourd’hui à Paris dans quelque réserve du musée du Judaïsme de la rue du Temple, je n’ai pu les observer. En pensée, pourtant, je ne contemple pas moins leur art — et pas seulement dans sa virtuosité. C’est que ces grains talmudiques énoncent le Shéma en exposant le kaddish : métaphore ou allégorie, peu importe, disons en langue proustienne le signe, le lien à saisir entre les deux idées, les deux vœux, les deux mondes, les deux temps du Juif oublié en soi, à l’image de Swann et de la syntaxe si détonnante de la Recherche.
En vous, Charles, tout est joli, aussi bien ce que vous portez que ce que vous dites, ce que vous lisez et ce que vous faites, lui avoue Oriane[144]. Seulement l’aveu ne précède que d’un instant l’annonce de la maladie mortelle qui le frappe et le ruine au regard du Narrateur, avec le paradoxe que seule la duchesse, maintenant, parvient à le trouver beau.
Soit à cause de l’absence de ces joues qui n’étaient plus là pour le diminuer, soit que l’artériosclérose, qui est une intoxication aussi, le rougît comme eût fait l’ivrognerie, ou le déformât comme eût fait la morphine, le nez de polichinelle de Swann, longtemps résorbé dans un visage agréable, semblait maintenant énorme, tuméfié, cramoisi, plutôt celui d’un vieil Hébreu que d’un curieux Valois.[145] Le Marcel de fiction, armé même d’un regard clinique, ne traverse pas moins la vie comme un somnambule. N’oubliez pas qu’avec lui vous avez affaire à un cas qui n’est pas banal. N’oubliez pas non plus que le cancer qui ronge Swann se confond avec la déferlante antisémite, et qu’elle n’épargne personne. D’ailleurs peut-être chez lui, en ces derniers jours, la race faisait-elle apparaître plus accusé le type physique qui la caractérise, en même temps que le sentiment d’une solidarité morale avec les autres Juifs, solidarité que Swann semblait avoir oubliée toute sa vie, et que, greffées les unes sur les autres, la maladie mortelle, l’affaire Dreyfus, la propagande antisémite, avaient réveillée. Il y a certains Israélites, très fins pourtant et mondains délicats, chez lesquels restent en réserve et dans la coulisse, afin de faire leur entrée à une heure donnée de leur vie, comme dans une pièce, un mufle et un prophète. Swann était arrivé à l’âge du prophète, constate-t-il en prenant aussitôt ses distances avec lui. Et de conclure que, désormais, l’idée de causer avec lui pouvait m’être agréable ou non, mais n’affectait en quoi que ce fût mon système nerveux.[146] Cependant il examine avec beaucoup d’attention combien devenir juif, ne plus pouvoir le dissimuler, encore moins l’oublier, voire l’exposer et le publier délibérément, revient à devenir toxicomane.
De la même manière, durant longtemps, la métamorphose de M. de Charlus en tante ne concerne en rien le Marcel du roman, même s’il lui porte autant d’attention. De fait, les étapes de la Recherche sont scandées par celles qui décrivent en détail le cancer du baron. Étapes d’un devenir tante qui, pour n’avoir apparemment aucun rapport avec la métamorphose de Swann en Juif, ou celle du Narrateur en client à l’année de maisons de repos (en clair de cliniques de désintoxication, désintoxication forcément vaine), ne composent pas moins la chronique de la même sorte de malédiction jusqu’au seuil où atteindre la chambre noire.
1. Sade, Histoire de Juliette, Pléiade, p. 310.
2. Pier Paolo Pasolini, cité par Hélene Surgere, in Dossier de presse de Salo, en ligne, cineclubdecaen.com.
3. Gustave Flaubert, Lettre à Jules Duplan, vers le 20 octobre 1867.
4. Sade, Histoire de Juliette, Pléiade, p. 528.
5. Ibid., p. 536.
6. Céleste Albaret, Monsieur Proust, Laffont, p. 240.
7. Fernand Gregh, cité par Brassaï, Marcel Proust sous l’emprise de la photographie, Gallimard, p. 168.
8. Marcel Proust, Correspondance avec Mme Straus, Livre de poche, p. 40.
9. Marcel Proust, Albertine disparue, Pléiade, t. IV, pp. 259-260.
10. Mo Zi — cité par Renée Taton, in Histoire générale des sciences, PUF, T. I, pp. 193-194.
11. John Ruskin, cité par David Hockney, Savoirs secrets, Seuil, pp. 215-216.
12. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Pléiade, t. IV, pp. 405-406.
13. Hélene Surgere, Dossier de presse de Salo, en ligne, cineclubdecaen.com.
14. Gustave Flaubert, Lettre à Jules Duplan, vers le 20 octobre 1857.
15. Gustave Flaubert, Lettre à la princesse Mathilde du 20 juillet 1873.
16. Gustave Flaubert, Lettre à sa nièce Caroline du 22 août 1872.
17. Marcel Proust, A propos du “style” de Flaubert, in Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 594.
18. Marcel Proust, Albertine disparue, Pléiade, t. IV, p. 3.
19. Marcel Proust Correspondance, Plon, t. XVIII, p. 380.
20. Honoré de Balzac, Le Médecin de campagne, Pléiade, t. IX, p. 574.
21. Richard von Krafft-Ebing, Traité clinique de psychiatrie, Maloine, p. 484.
22. Gustave Flaubert, Madame Bovary, Pléiade, t. I, p. 320.
23. Ibid., p 353.
24. Marcel Proust, A propos du “style” de Flaubert, in Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 587.
25. Ibid., pp. 588-589.
26. Platon, Phèdre, 275a
27. Gustave Flaubert, Préface aux “Dernières Chansons” de Louis Bouilhet — cité par Guy de Maupassant, Gustave Flaubert, La Revue Bleue, 19 janvier 1884.
28. Ibid., p.1.
29. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 299.
30. Sade, Les Cent Vingt Jounées de Sodome, Pléiade, t. I, p. 282.
31. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 269.
32. Marcel Proust, A propos du “style” de Flaubert, in Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 588.
33. Marcel Proust, Correspondance, Plon, t. XIX, p. 76.
34. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Pléiade, t. IV, p. 610.
35. Stendhal, Le Rouge et le Noir, Panthéon, p. 221.
36. Charles Baudelaire, Les Paradis artificiels, Pléiade, p. 488.
37. Marcel Proust, A propos du “style” de Flaubert, in Contre Sainte-Beuve, Pléiade, pp. 594-595.
38. Edmond et Jules de Goncourt, Journal, Laffont, t. I, p. 683.
39. Ibid., p. 525.
40. Procope de Césarée, Anecdocta, II, 34-36 — cité par John Boswell, Christianisme, tolérance sociale et homosexualité, Gallimard, pp. 224-225.
41. Sade, Histoire de Juliette, Pléiade, t. III, p. 744.
42. Michel Foucault, Dits et Ecrits, Gallimard, t. II, p. 1148.
43. Ibid., pp. 1148-1149.
44. Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, Pléiade, t. II, p. 227.
45. Michel Foucault, Dits et Ecrits, Gallimard, t. II, p. 1149.
46. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Pléiade, t. IV, p. 474.
47. Isaïe, 54, 10.
48. Ibid., 51, 6.
49. Ibid., 24, 23.
50. Ibid., 34, 4.
51. Talmud, Avoda Zara, 17a.
52. Gilles Deleuze, Proust et les signes, PUF, p. 10.
53. Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux, Minuit, pp. 156-157, avec un renvoi à Friedrich Nietzsche, Naissance de la Tragédie, Chap. 9, Classique de poche, pp. 90-91.
54. Second livre des Rois, 25, 7.
55. Céleste Albaret, Monsieur Proust, Laffont, p. 105.
56. Ibid., p. 96.
57. Marcel Proust, Du coté de chez Swann, Pléiade, t. I, p. 44.
58. Julie Deffontaines et Nicolas Fichot, à la rubrique Madeleines, in Le patrimoine des fiches-recettes de soeur Marie M., édité en ligne, cuisinesretrouvees.com.
59. Grégoire le Grand, Homélie sur les évangiles, 33, 1.
60. Luc, VII, 44-47.
61. Isaïe, 57, 19.
62. Talmud, Berakhot, 34b, et Sanhédrin, 99a (variante).
63. Luc, VII, 41-43.
64. Chateaubriand, Mémoirs d’outre-tombe, Pléiade, t. II, p. 312.
65. Pie VII, cité par Chateaubriand, ibid., t.I, p. 748.
60. Moses Mendelssohn, Jérusalem — cité par Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, Calmann-Lévy, p. 80.
67. Emmanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières ? Pléiade, t. II, p. 398.
68. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 211.
69. Ibid., p. 212.
70. Ibid., p. 235.
71. Marcel Proust, La confession d’une jeune fille, in Les Plaisirs et Les Jours, Pléiade, p. 85.
72. Ibid., p. 88.
73. Talmud, Sota, 49a.
74. Marcel Proust. Le Côté de Guermantes, Pléiade, t. II, p. 636-637.
75. Marcel Proust. Correspondance, Plon, t. II, p. 64.
76. Marcel Proust. Le Côté de Guermantes, Pléiade, t. II, p. 637.
77. Roland Barthes, Longtemps je me suis couché de bonne heure, in Œuvres complètes, Seuil, t. V, pp. 467-468.
78. Marcel Proust. Le Côté de Guermantes, Pléiade, t. II, p. 615.
79. Ibid., t. II, p. 334.
80. Marcel Proust, Le Côté de Guermantes, Pléiade, t. II, p. 535.
81. Marcel Proust, La Prisonnière, Pléiade, t. III, p. 552.
82. Evelyne Bloch-Dano. Madame Proust. Grasset, p. 232.
83. Ibid., p. 341.
84. Matthieu Galley, Journal 1953-1973, Grasset, p. 383.
85. Daniel Halévy, Pays parisiens, Grasset, p. 101.
86. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Pléiade, t. IV, p. 458.
87. Ibid., p. 458.
88. Paul Wexler, Two-tiered relexification in yiddish, Mouton, p. 163.
89. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Pléiade, t. I, p. 15.
90. Paul Wexler, Two-tiered relexification in yiddish, Mouton, p. 413.
91. Marcel Proust, La Prisonnière, Pléiade, t. III, p. 705.
92. Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, Pléiade, t. I, p. 509.
93. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Pléiade, t. I, p. 18.
94. Honoré de Balzac, Splendeurs et misères de courtisanes, Pléiade, t. VI, pp. 473-474.
95. Ibid., p. 520.
96. Honoré de Balzac, La Duchesse de Langeais, Flammarion, p. 68.
97. Honoré de Balzac, Le Père Goriot, Pocket, pp. 99-100.
98. Joris-Kark Huysmans, A rebours, Folio, p. 347.
99. Guy de Maupassant, Bel-Ami, Pléiade, p. 242.
100. Emile Zola, L’Argent, Folio, p. 481.
101. Jean Lorrain, Monsieur de Phocas, Edition du Boucher, p. 13.
102. Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, Pléiade, t. II, p. 123.
103. Marcel Proust, Correspondance, Plon, t. XIX, p. 660.
104. Susy Mante-Proust, préface à Marcel Proust, Correspondance avec Madame Straus, Livre de poche, p. 7.
105. Philippe Julian, Robert de Montesquiou, Perrin, p. 49.
106. Marcel Proust, Le Côté de Guermantes, Pléiade, t. II, p. 815.
107. Philippe Julian, Robert de Montesquiou, Perrin, p. 49.
108. Marcel Proust, La Prisonnière, Pléiade, t. III, p. 803.
109. Roland Barthes, Proust et les noms, in Œuvres complètes, Seuil, t. IV, pp. 68-69.
110. Octave Mirbeau, cité par Nadine Satiat, Guy de Maupassant, Flammarion, pp. 386-387.
111. Guy de Maupassant, cité par Nadine Satiat, ibid., p. 387.
112. Marcel Proust, Le Côté de Guermantes, Pléiade, t. II, p. 797.
113. Frederic Morton, Les Rothschild, Gallimard, p. 171.
114. Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Pléiade, t. 13.
115. Roland Barthes, Proust et les noms, in Œuvres complètes, Seuil, t. IV, pp. 71-72.
116. Ferdinand de Rothschild, French Eightheenth Century Art in England — cité par Paulince Prevost-Marcilhacy. Les Rothschild, bâtisseurs et mécènes, Flammarion, p. 164.
117. Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, Pléiade, t. I,I p. 116.
118. Marcel Proust, Le Côté de Guermantes, Pléiade, t. II, p. 843.
119. Ghislain de Diesbach. Proust, Perrin, p. 11.
120. Marcel Proust, Lettres, Plon, p. 462.
121. Henry Raczymow, Maurice Sachs, Gallimard, page 53.
122 Elizabeth de Clermont-Tonnerre. Mémoires, Grasset, t. I, page 225.
123. Ibid., p. 201.
124. Rapport d’avril 1873 sur la liaison de la marquise de Galliffet et de la baronne Alphonse de Rothschild — cité par Gabriel Houbre, Le Livre des Courtisanes, Tallandier, p. 196.
125. Marcel Proust, Le Côté de Guermantes, Pléiade, t. II, pp. 795-796.
126. Heinrich Heine, Lutèce, La Fabrique, p. 183.
127. Honoré de Balzac, cité par Pierre Assouline, Le Portrait, Gallimard, pp. 104-105.
128. Heinrich Heine, Anna Troll, rêve d’une nuit d’été, XVII, publié en ligne, mediterranees.net.
129. Marcel Proust, Correspondance, Plon, t. IV, p. 199.
130. Ibid., p. 198.
131. Hannah Arendt, Walter Benjamin 1892-1940, Allia, pp. 60-61.
132. Jean Guitton, postface à Jean Mihaud, A Bergson, la patrie reconnaissante, Imprimerie nationale, p. 168.
133. Arsène Darmesteter, Le Talmud, Allia, p. 20.
134. Ibid., p. 34.
135. Emmanuel Berl, Patrick Modiano, Interrogatoire, Gallimard, p. 27.
136. Marcel Proust, Carnets, Gallimard, pp. 101-102.
137. Emmanuel Berl, Sur les Juifs, in Essais, Falois, pp. 566-567.
138. Ibid., p. 566.
139. Marcel Proust. Contre Sainte Beuve, Pléiade, p. 303-304.
140. Gershom Scholem. Benjamin et son Ange, p. 31 — cité par Ami Bouganim, Walter Benjamin, le rêve de vivre, Albin Michel, p. 80.
141. Marcel Proust. Du côté de chez Swann, Pléiade, t. I, p. 47.
142. Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, Pléiade, t. II, p. 497.
143. Hannah Arendt. Walter Benjamin, Allia, p. 30.
144. Marcel Proust, Le Côté de Guermantes, Pléiade, t. II, p. 871.
145. Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Pléiade, t. III, p. 89.
146. Ibid. p. 89.