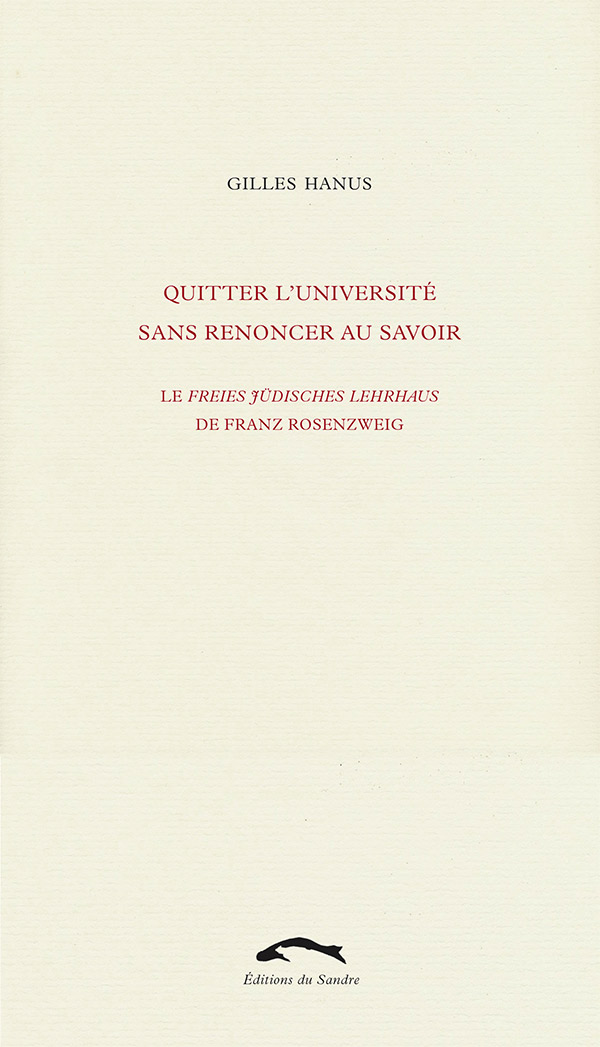L’étude juive, l’étude talmudique : un des nœuds secrets où s’ordonnent, depuis vingt siècles, les plus grands malentendus, les plus dégoûtantes approximations, les plus opportunistes, les plus médiocres et les plus lâches figures de l’ignorance. Les Chrétiens l’ont conspuée bien tôt, dès l’Évangile, vouant au malheur les « Scribes et les pharisiens hypocrites (ignorant à quel point le Talmud, stupéfiant de hardiesse, portait jusque dans la chair du « pharisien » le scalpel de la lucidité, préférant seulement à l’insulte l’ironie vertigineuse du traité Sota 22a – faut-il encore savoir que le Talmud, non seulement fascine et se « célèbre », mais encore se lit, et qu’il a des pages…)
Puis on y piocha, selon qu’on était ou non électrisé par de grandes figures médiévales (Rachi, Maïmonide) ; coups de pioche comme ceux, plus tard, de l’érudition dite bibliste : coups au hasard, quand, jour après jour, les talmudistes soumettaient à leur jet d’acide le moindre verset de la Torah, le moindre dictum des Maîtres – non pour leur faire rendre l’âme, mais rendre gorge. Forcer le texte, tel fut toujours l’art et l’éthique du talmudiste ; éthique, moins de l’interrogation (si polie, si philosophique) que de l’interrogatoire, mais d’un interrogatoire confiant, et donc furieux, violent, imposé au texte ; il n’y a que ce qu’on sait indestructible, parce qu’on le vit tel au quotidien, qu’on peut attaquer ainsi à l’obus de l’intelligence ; pendant ce temps, d’autres, dominicains, moinillons ou réputés philologues, se contentèrent de fléchettes plus ou moins empoisonnées ; eux, leurs propres textes, ils leur réservaient les encensoirs.
Mais le plus beau, c’est encore l’oubli. Oui, oubli parmi les nations, bien sûr, ce qui ne s’accuse pas, après tout ; que les plus grands penseurs de la France médiévale (voire, de la France tout court) eussent été Rachi et les maîtres tossafistes, stupéfiants génies de l’étude juive, qu’est-ce que la France pouvait bien en faire, après tout, dans ce qui n’avait jamais été une œuvre de sa langue ? Mais les Juifs, mieux encore, oublièrent ; oublièrent d’abord l’intelligence (c’est ce qu’on oublie en premier, car on garde bien longtemps la tradition) ; puis ils oublièrent tout l’édifice, ils oublièrent la Torah, ils oublièrent leur singularité, sinon pour la voir rappeler, vertement, dans les petites brimades que l’Occident, un peu rancunier tout de même, leur faisait subir.
C’est parmi ces Juifs-là, moins souffrants peut-être que les Kafka ou les Roth, exposés à la fureur antisémite de la bourgeoisie austro-hongroise que rendait folle la main protectrice des Habsbourg, que naquit Franz Rosenzweig, dont l’aventure (je dis ici celle de la vie et celle de la pensée, une seule et même chose, évidemment, évidence qui lui apparut, et qui n’apparaît en général que dans un pieux mensonge) est d’une importance absolue. Elle a certes été reçue comme telle par quelques uns, parce qu’ils en étaient à leur tour affectés ; puis elle a été reçue comme telle par l’Université, qui ne manque jamais, quand il n’est plus possible d’ignorer un événement de la pensée, d’affecter de l’avoir toujours su – et ce parce que, par définition, l’Université (comme la Religion, d’ailleurs) sait tout. La culture, elle, est tout ; c’est plus ou moins la même chose.
Car c’est d’abord dans l’université que Franz Rosenzweig s’est déployé, et dans l’université allemande, de surcroît ; c’est à dire, pour faire écho aux fines et profondes analyses de Jean-Claude Milner sur le sujet, dans celle dont l’objet fut le savoir, « absolu », pour des raisons qui tiennent à l’aventure protestante, et à son enracinement dans la Bible. On connaît le parcours : commençant dans Hegel, le bourgeois juif Rosenzweig décide, à travers quelques discussions marquantes avec des esprits affûtés de son milieu, de se convertir au Christianisme, « comme tout le monde » ; puis, alors que le parcours de l’oubli est presque entièrement opéré, il fait volte-face, et, revenant au Judaïsme, d’abord par son refus de la conversion, ensuite par l’affiliation à Hermann Cohen, et enfin par son étude systématique des textes juifs, il invente ce qu’on appellera plus tard, avec Lévinas commenté par Benny Lévy, « la pensée du retour ».
Cela, c’est de la doxographie. C’est-à-dire un matériel pour l’université. Des professeurs, sans conteste, pourront gloser les évolutions de la pensée de Rosenzweig, débusquer tel germe dans son Hegel, ou telle survivance dans son Étoile ; les professeurs pourront donc faire de l’œuvre de Rosenzweig un objet de savoir, à faire valoir pour, que sais-je ? la compréhension des problèmes et des avancées de l’éthique contemporaine.
On ne dira jamais assez, c’est-à-dire, qu’on me pardonne ma lourdeur, on doit répéter et répéter que cette attitude, à l’égard de la pensée, ce regard sur la pensée, ne sont et n’ont jamais été que son enterrement. L’étude universitaire est, et a été, la mise à mort de la pensée. Un exemple, un pour mille : Zunz, le fondateur de la Wissenschaft des Judentums » ; ce petit-fils de rabbin, comment définit-il son ouvrage savant ? « Il nous reste à assurer au Judaïsme des funérailles décentes ». Et là, c’est parce que la mort est bien plus hétérogène au Judaïsme qu’au Christianisme qu’on y voit malgré tout une profanation ; mais on est bien léger : qui osera nier que le Christ est mort en croix ? Qui osera nier que l’Université fut d’abord chrétienne ? La mort, n’est-ce pas, somme toute, l’origine de l’Universitas chrétienne, son origine ontologique ?
Or ce petit livre, où Gilles Hanus décrit pas à pas les étapes de la formation de cette petite maison d’étude, fondée par Rosenzweig à Francfort, qu’on n’ose pas appeler un stieblech, a un mérite qui le rend précieux : il n’est pas doxographique, parce qu’il ne décrit pas des dogmes successifs, ou des données objectives successives, ou une œuvre successive ; il décrit de la vie, et la vie n’est pas successive ; la vie est, au contraire, rétive à la succession, parce qu’elle est neuve, sans quoi elle n’est plus de la vie.
Première nouveauté rencontrée par Rosenzweig : précisément, la nouveauté de la vie, par opposition au caractère intératif, et mortel, de cette Wissenschaft dont Gilles Hanus précise qu’il y avait excellé. Renoncement, donc, à l’université, pour la vie. On ne peut pas choisir les deux à la fois.
Mais cette première nouveauté n’était que la préparation de la grande nouveauté qui allait, dans le récit de Gilles Hanus, jouer le rôle du centre, de l’astre rayonnant dont les rayons nourriraient toute sa vie intérieure ; centre d’une intuition qui, et c’est le grand mérite de ce livre, garde et renouvelle toujours son caractère de vitalité : le etwas.
Etwas, quelque chose, c’est le motif auquel Rosenzweig suspend son mouvement intérieur ; et, je voudrais le marteler, parce que etwas est profondément vivant, etwas est, mieux que résistant, destructeur pour sa réduction doxographique.
Qu’est-ce donc que cet etwas ? C’est d’abord ce à quoi Rosenzweig se raccroche, parce qu’il faut bien, dans son désarroi de petit juif ignorant devant l’immensité inintelligible de cet « être juif » où il veut persévérer. Quelque chose d’où il part ; car il part de quelque chose, et non pas de rien ; il part… de ce qu’il est juif, tout simplement.
Cet etwas, à l’exposer alentour, à le mesurer à tout l’entourage de Rosenzweig, il n’a l’air de rien ; eh bien c’est précisément pourquoi il le martèle. Libéré du germanisme délirant de son maître Hermann Cohen, qui voyait dans un rêve hâtif causé par la séquence luthérano-kantienne, se mêler la destinée spirituelle du peuple juif et du peuple allemand, Rosenzweig, aiguillé par etwas, tient la dragée haute aux trois grandes postures totales des juifs allemands qui l’entourent : le Judaïsme libéral, le Sionisme et la néo-orthodoxie. Les héritiers infidèles de Mendelssohn, qui avaient cru le suivre sur la voie de la réduction du Judaïsme à des notions ; la présence autoritaire (et jugée nihiliste par Rosenzweig – sans appel), de Gershom Scholem, que désespérait la survivance de la présence juive en Allemagne (qu’on ne réponde pas par la lucidité historique du bonhomme ; il n’est pas ici question de lucidité historique, il est question d’occuper la place qu’on occupe ; en l’occurrence, le lieu où je vis, avec etwas, pour le temps qu’il m’est donné de vivre) ; l’obsession légaliste d’un Shimshon Raphael Hirsch, « fondement d’un système rigide et étroit, laid malgré toute sa magnificence. »
J’ose dire que c’est avec Hirsch que Rosenzweig est le plus dur, et qu’il a raison de l’être, au nom du etwas. On l’ignore, mais une certaine orthodoxie regarde dans Hirsch un abîme de profondeur ; il faut dire que le Judaïsme avait rarement fait l’expérience des rhéteurs, et les grands effets de manche lyriques de Hirsch en imposèrent, ce qui en dit long, à bien de ses successeurs.
Qu’est-ce donc que cet etwas, avais-je demandé ? Rien d’autre que moi ; non pas moi regardé dans quelque miroir narcissique, mais moi en tant que, oui, je suis l’objet d’un enseignement – Torah : non une loi ; un enseignement. « Si je ne suis pas moi, qui sera moi pour être enseigné ? » demande Etwas à Rosenzweig. Dans ce point de vérité, abyssal, gît toute la valeur inoubliable de la vie de Rosenzweig. Peu importe le reste, peu importent les études savantes ou non qui s’ensuivirent ; elles n’ont de moindre valeur que si elles laissent passer à leur travers l’écho du etwas.
De cela, Rosenzweig tire la conséquence, inéluctable : « considère, écrit-il à R. Hallo, que nous n’avons pas créé une « religion », ni des « personnalités religieuses », ni rien non plus de ce qui, en plus de cela, appartient à une civilisation achevée. Chez nous, on a toujours vécu sobrement, tout comme aujourd’hui encore, où, tout autour de nous, le monde exsude à nouveau de vie religieuse. Nous sommes les seuls – les meilleurs d’entre nous, à vivre tout à fait sobrement, c’est-à-dire avec Dieu mais sans « religion ».
Et Gilles Hanus de conclure : « Rosenzweig attribue même à la Révélation la tâche de nous débarrasser de la vision religieuse du monde : « La révélation n’a qu’une chose à accomplir : rendre le monde à nouveau non religieux (unreligiös) ».
Là est le sommet du livre.
La suite, ce sera la fondation d’un lieu, où Rosenweig étudiera et enseignera ; là-dessus, il est permis de contester la pertinence de ce cycle, de cette conception de l’enseignement du texte juif ; peu importe, c’est là une question de talmudiste, et ce n’est pas le lieu de la formuler.
Car il nous faut regarder une dernière fois, depuis le etwas, le quelque chose qui l’avait mu, en opposition au « tout ou rien » qu’on avait brandi autour de lui relativement à la question juive, ce « tout ou rien » qui requérait tous et chacun de prendre sa carte du parti libéral, ou du parti sioniste, ou du parti orthodoxe ; il faut regarder une dernière fois depuis la nouveauté vitale qui s’éveilla dans Rosenzweig la portée de cette expérience. Rosenzweig se libère du dogmatisme ; bien sûr ; de tous les dogmatismes : sioniste, libéral, moral, kantien, néo-kantien, et pour finir orthodoxe. Mais dire cela, c’est rester encore bien loin du etwas ; c’est être, en quelque sorte, voltairien, c’est-à-dire journalistique. Etwas, ce n’est pas qu’il dise qu’il est chic, finalement, d’être libre, d’être un penseur libre ou un libre penseur ou toute autre foutaise de ce genre. Etwas, cela veut dire que je ne lâche pas, que je cède pas sur le sérieux de penser qui est exactement la même chose que le sérieux de vivre, qui est exactement la même chose que le sérieux d’être moi ; car, rappelons-le, il n’est sérieux d’être moi que pour penser et pour vivre.
Et ce que Rosenzweig a reconnu, d’une intuition fulgurante parce qu’il ignorait tout, dans la Torah, c’est la parole même de ce sérieux. A l’opposé, il y a la chose la moins sérieuse du monde, la plus bouffonne du monde, la plus abjecte du monde, qu’il appelle d’abord, timidement, tout, et puis qu’il appelle ensuite, plus hardiment, la religion. Les effets de manche de la religion. Les impensés de la religion. Les superstitions de la religion. Religion religieuse, religion sioniste, religion de la culture. Toutes nos religions. Qui, effectivement, sont bien encore les exsudations de notre époque. Et contre quoi travaillent, verset après verset, dire après dire, l’intelligence prophétique, puis l’intelligence talmudique.
L’événement absolu de la vie de Rosenzweig, qui lui fit faire retour, dans l’expression consacrée par Benny Lévy, au Judaïsme, c’est cet irréductible du sérieux qui l’a installé, immédiatement, à rebours de l’homme religieux, dans la posture de l’étude, du lernen.
Bien des hommes, après, font retour ; ils font retour à la religion juive, comme d’autres font et feront retour à la nation ; comme d’autres font et feront retour à la culture ; de pareils retours, ce sont des « tout ou rien », ce sont des retours à « de grandes choses » qui ne sont jamais soi, ce ne sont pas des retours ordonnés par etwas.
Qu’il faille qu’un etwas nourrisse sans jamais tarir tout le mouvement de l’existence ; qu’il faille que la sobriété du etwas s’impose sans fard aux comédies du tout ou rien, de la grandeur, de la gloire, qu’elles soient, selon la province qu’on fréquente, la culture de France-Culture ou le rituel de la grande synagogue : c’est dire les ténèbres du tout ou rien, du fétichisme, allez, de l’idolâtrie de toutes ces « grandeurs » où jamais un homme ne pourra se reconnaître, sinon à se nier comme etwas.
Au fond, l’aventure de Rosenzweig nous dit qu’il n’y a jamais eu que bien peu d’hommes, si un homme est cet etwas.