Il y a une dizaine de jours, une tribune parue dans le Monde et un entretien sur YouTube semblaient sourire aux amis de la langue : une tribune angoissée appelant le jeune ministre de l’éducation à sauver l’écrit, signée entre autres de Mme Badinter et de M. Debbouze, et une interview du jeune Président de la République par un jeune youtubeur, où l’on voit le manager en chef de la nation revêtir, ou hanter à nouveau, après un Blanquer qu’avait étrangement suivi un bref ministre sociologisant, le costume de Jules Ferry ; boucle schizoïde qui, en vérité, repasse le cercle indestructible qui s’est noué entre la IIIe et la IVe République, des hussards noirs à l’américanisation (lisez La Peau de Malaparte), de sorte que la Ve, elle, n’aura été pensée qu’en manière d’exorcisme, voulue par un de Gaulle trop hanté par la fin, trop profondément et désespérément nihiliste pour proposer, à la France mourante, autre chose que le rempart de sa personne.
Il est bien triste, tout de même, de constater sur pièces comme le combat, concernant la langue, est perdu d’avance, quand, malgré toute sa bonne volonté, on voit l’hôte de l’Elysée subir la langue managériale qui troue aussitôt le dire qu’il voudrait énoncer : « C’est un sujet où il faut être intraitable et clair et on le sera maintenant » ; Monsieur le président, vous eussiez dû dire : « C’est une question où il convient d’être intraitable et clair, et nous le serons désormais » ; « sujet » est un mot de promoteur immobilier, et la parole de l’autorité se revêt du « nous », et non du pronom indéfini, voyons !
« Nous vivons aussi dans notre société avec une minorité, des gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité. Ça a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s’il n’y avait pas eu d’attentat terroriste et Samuel Paty » ; Monsieur le président, bel effort pour retrouver le « nous », hélas soldé aussitôt par votre « ça » ; il fallait dire (du seul point de vue de la langue ; vos allusions n’appartiennent qu’à vous) : « Dans la société où nous vivons, certains membres d’une minorité, détournant leur religion, en viennent à défier la République et la laïcité. Le pire en a déjà résulté : souvenons-nous des attentats terroristes, souvenons-nous de Samuel Paty. » Car tout de même, Monsieur le Président, « les attentats terroristes et Samuel Paty », je ne suis pas linguiste, mais enfin ! Vous ne pouvez pas enchaîner, dans un complément d’objet direct, un énoncé au sens propre (les attentats terroristes) et un énoncé symbolique (Samuel Paty), dont la charge est démonitisée par la conjonction « et », qui joue leur égalité dans le régime du sens !
Une dernière : « Je suis favorable à l’approche expérimentation, évaluation » ; mais non ! Il fallait dire : « Je suis favorable à l’approche expérimentale, qui nous permettra de produire une évaluation de ces nouvelles règles. »
Certes, on pourra juger que vous êtes là saisi, comme toujours, par le démon de la gouvernance, bref, des techniques décidément managériales que l’idéologie anglo-saxonne a imposées à l’univers entier, et que votre « évaluation » promet une nouvelle voie sans issue offerte à des experts qui, nous le savons tous, sont le nom privilégié du néant dont la teinte est, depuis bientôt un siècle, sociologique ; mais pour parer au plus pressé, ces enfilages de substantifs, « l’approche expérimentation, évaluation », n’avez-vous jamais le sentiment qu’ils produisent un effet faiblement paradoxal, à savoir qu’ils deviennent, par leur télescopage, insubstantiels ?
Je me suis contenté de citer les premières paroles rapportées par cet article, et toute la langue qui s’y déploie porte déjà les stigmates de la décomposition. Je n’ose continuer ma lecture, de peur de trouver encore un « impacter » qui désormais nous persécute jusque dans les halls de gare.
Mon ambition n’est pas ici de me gausser, mais seulement d’avoir contribué à rappeler, alors que l’affaire est dans le sac depuis bien longtemps et pour des raisons immenses, que tout cela (cette fausse « bonne volonté »), ment. D’un mensonge éhonté, universel, accablant. D’un mensonge absolu touchant la langue.
J’ai parlé de IIIe République : nul ne niera qu’on y pratiquait, jusqu’à la nausée d’ailleurs, la belle langue. Nous n’avons pas le temps de la définir ; tant pis pour ceux qui en ignorent déjà le souvenir. La langue de Giraudoux ou de Montherlant, accablée certes par des surréalistes plus pressés que profonds, se voulait belle. Belle, sans aucun doute, avait été celle de Baudelaire et de Mallarmé, qui, chacun à sa façon, méditaient la langue classique et la malédiction française, celle de l’inféodation de la langue française à la politique. « La belle langue française est parlée par la meilleure partie des gentilshommes de la cour et par les meilleurs des écrivains de ce temps », écrivait Vaugelas. Citation essentielle qui expliquait, dans la bouche de Jean-Claude Milner au cours d’un séminaire, le Bourgeois gentilhomme, œuvre d’un Molière toujours crucial qui y signifiait la béance de cette particularité française, si nettement désavouée aujourd’hui par notre premier magistrat. Mais là n’est pas la question, car un deuxième mensonge, tout aussi monstrueux que le premier, s’était formulé chez les écrivains aussitôt après la deuxième guerre mondiale : celui de la « langue pauvre ». Dites, si vous préférez, « langue épurée », « langue vraie », « langue essentielle », « langue au scalpel », dont ne résulta, depuis quelques écrivains du Nouveau Roman, qu’un effet vital – certes. bénéfique : détruire le mensonge de la belle langue.
Or cette langue, si l’on peut dire, symptomatique, certes portée avec talent par Marguerite Duras en manière de geste sacrificatoire (celui d’une France dont la fausse grandeur avait par exemple conduit son mari au Lager), se prit à croire à elle-même, et à fixer comme norme ses maigreurs, ses pauvretés ; elle devint en cinquante ans la langue de toute la petite bourgeoisie intellectuelle qui, en France, après la disparition de la figure du grand écrivain (que dire du « grand poète », aussi chimérique que le dodo ou la licorne ?), donna le ton. Ton du Monde, ton de France Culture, ton inlassablement modulé par des interviewers penchés, et embrayé, d’une voix tantôt primesautière, tantôt mourante, mais toujours courte, par tout écrivain digne de ce nom qui, en manière de travail pratique, concret, en le rapportant à son artisanat propre, n’avait jamais servi à autre chose, depuis des décennies, qu’à raboter jusqu’à en mettre la chair à vif, la belle langue, pour lui substituer cette fausse épure, ce sabir maigre, sentencieux, qui esthétise à l’extrême ses truismes, ses banalités et ses sécheresses pathologiques. Certes, des gens savent encore parler, quoique leur parole, hélas, ne sache d’ordinaire qu’emprunter les travées confortables du parler universitaire où, par définition, jamais rien de nouveau ne surgit (puisqu’on y commente, distinguo oublié mais crucial) – si bien que, devant la défaillance des vocations poétiques, l’ennui s’empare du français. Mais quand ceux qui tiennent le rôle de la création, tirés sur la voie de la chétivité par des éditeurs entièrement convertis aux techniques managériales et commerciales qui hypostasient le règne du grand nombre, ne sont plus que les interprètes toujours plus fluets, toujours plus essoufflés, d’une langue qu’ils servent avec tant de servilité, avec tant d’esprit de sérieux, eh bien la langue qu’ils parlent démontre qu’elle n’est plus affaire que de réduction narcissique sur la petite autofiction dont chacun est prié, désormais, de ratisser sagement son pré carré, en faisant mine de narrer.
Prestige des écrivains ! Prestige nettement terni, ces temps derniers, certes. Mais ils servent encore, dans cette France dont l’autoritarisme politique aura été, sans doute depuis son origine, le secret. Ils servent à fixer la langue, à la murer aujourd’hui dans sa version amoindrie, abrégée, facile et raide, pompeuse en fait et même dévote (car rien n’est plus bigot, rien n’est plus grenouille de bénitier que cette langue coupée de son souffle, de sa réinvention, de sa surprise, de ses irresponsabilités dont la responsabilité incombait à ceux qui prétendaient écrire, et font bien, aujourd’hui, de protester comme ils le font à longueur d’ondes que « c’est très dur », que « c’est très difficile » ; Madame Duras, visionnaire, n’avait-elle pas répondu ainsi à Libé qui lui demandait « Pourquoi écrivez-vous ? » : « Je crois que ça finira en 2027. Fini d’un seul coup, personne n’écrira plus. »
Peu importe que je désigne d’un seul coup la république des Lettres : c’est au moins à ça qu’auront servi les sociologues : faire entendre que les grands nombres sont déterminants. Même si, en ce qui concerne la classe porte-plume, celle-ci a beau se masser aux épisodes risibles de la « rentrée littéraire », elle demeure toute petite.
C’est dit : le crime contre la langue n’est ni le fait du petit banlieusard, ni même du Président de la République (définitivement sorti des affres gaulliennes touchant la fin de la France et ses chênes qu’on abat, si bien qu’il n’a là rien à sauver, il n’a qu’à manager) ; il est le fait des éditeurs et des écrivains, tissés ensemble dans leur clique par la loi minuscule de leur marché.
Mais là n’est pas l’important.
Ce qui est important, c’est de savoir que l’abaissement de la langue entraîne l’abaissement de l’homme. Que l’abaissement de la parole, de la pensée, procède de l’abaissement de la difficulté, de la profondeur, de la maîtrise, bref, du niveau requis de l’invention littéraire, « enfer ou ciel, qu’importe ! » qui étaient la tâche des vrais écrivains, quelles que fussent les mauvaises intentions de « la cour » (qui sont toujours mauvaises) les concernant.
D’une certaine manière, il est toujours vaguement honteux, aujourd’hui, d’écrire en langue française, parce son destin, depuis 70 ans, n’aura consisté qu’à conjurer, par tous les moyens dont dispose le marché – ils sont illimités, comme tout ce qui concerne notre société contemporaine – le retour de la belle langue (qu’elle retourne, qu’elle doive retourner, un jour, est inévitable, tant qu’il demeure de l’homme).
Laquelle belle langue, redisons-le car nous ne sommes pas si naïfs, avait passé des Républiques entières à mentir, en effet.
Sauf quand était vraiment advenue, inimitable, irréfutable, inutilisable, la Beauté.
Ce qui fait rire, dans la tribune du Monde, c’est qu’elle fait mine de croire capable un ministre de sauver la langue. Ni un ministre, ni une télévision, ni un « nous tous » ne sauveront la langue.
Cela ne peut être le fait que de quelques uns.
Que ces « quelques uns », qui font le choix de la servir quand tout l’interdit, le fassent sans en attendre ni récompense, ni gloire, ni postérité, c’est la loi d’airain, désormais, de toute vie d’écriture, française ou autre, car rassurons-nous, il n’y a plus que la langue française qui meure. Le marché éditorial, chacun le sait, est une affaire internationale.
Quant à la vie intellectuelle, il y a belle lurette qu’on a en a oublié jusqu’à l’existence.
Et pourtant, dans de toutes petites poches recélées toujours par l’espace, par le lieu, dans un fil invisible qui relie quelques jeunes à quelques vieux, elle perdure. Simplement, on a envie de dire : « Laissez-la leur. La langue n’appartient ni aux sociologues, ni aux experts, ni aux ministres. La langue est le bien de ceux à qui elle offre, loin de toute politique, l’occasion d’une beauté, et, plus rarement, d’une vérité qui, seules, en définitive, la justifient. »
Parce que ce sont ceux-là, les crût-on à l’arrière-garde, qui ont en vérité la charge de tous les hommes qui parlent – tant qu’il en demeure.




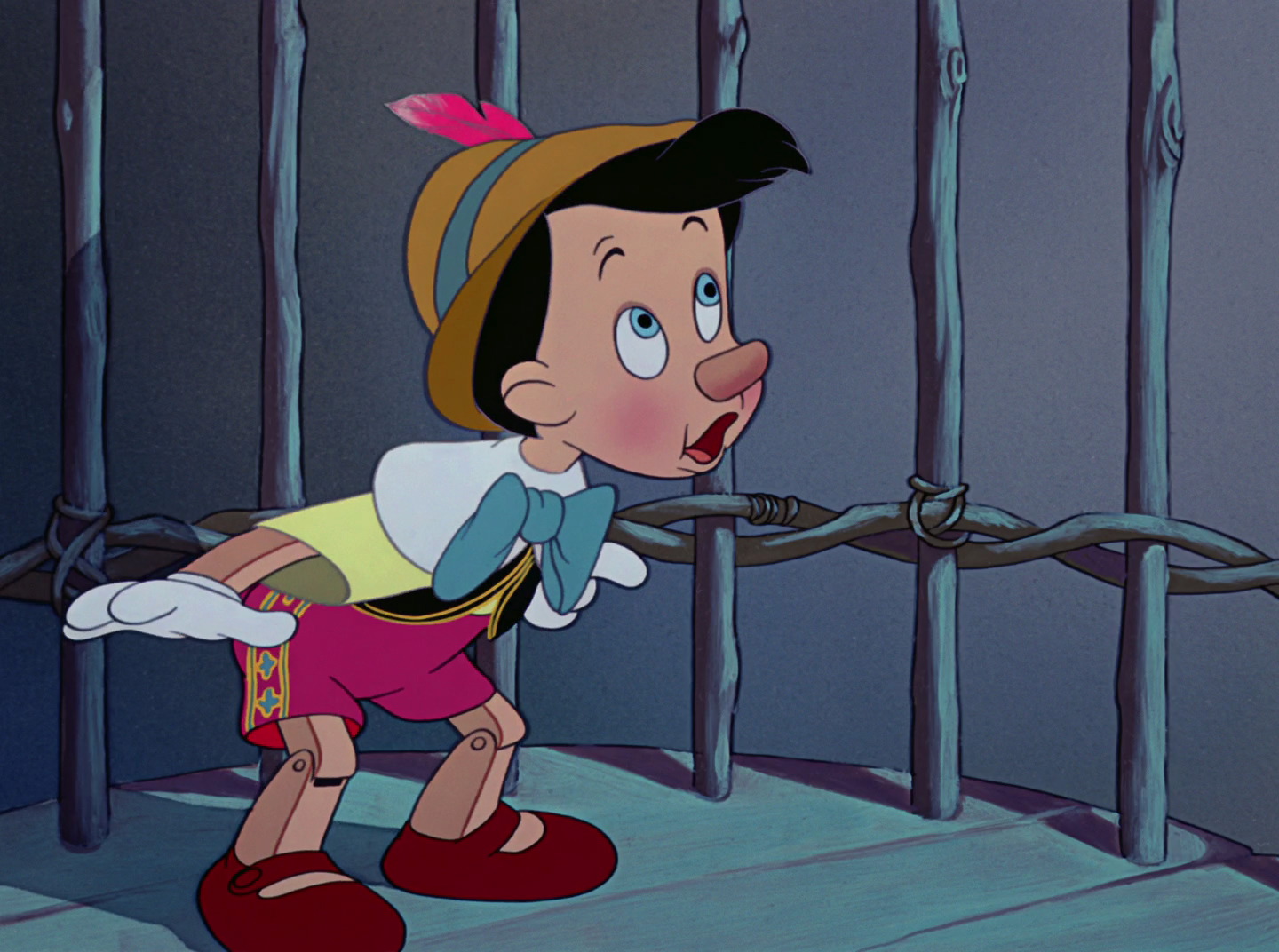


Merci pour votre conclusion réconciliante.
Amicalement de la Suède –
Maja