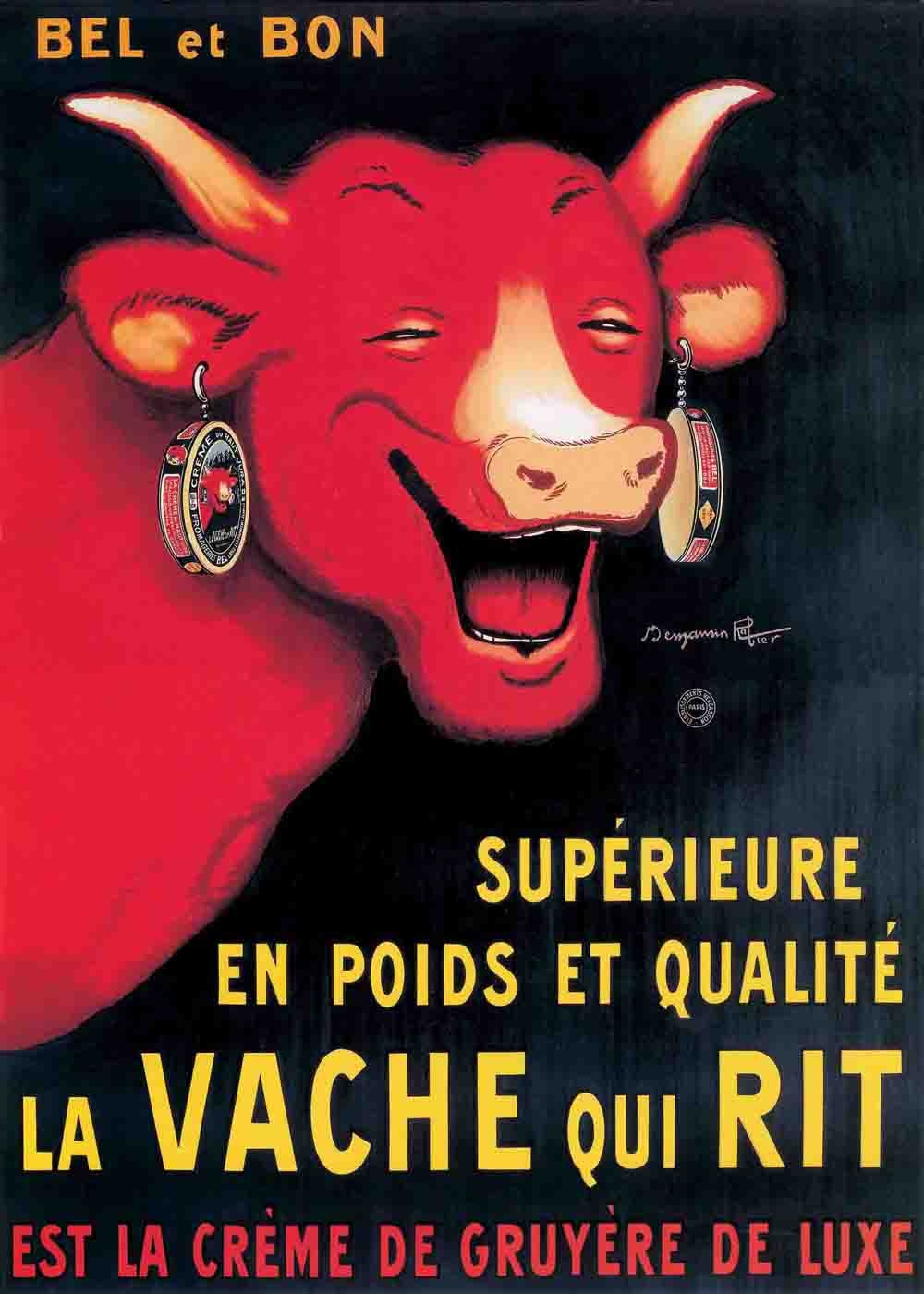6
L’être tout le monde
Au hiéroglyphe synonyme d’infini, lequel dessinait le profil d’un dieu les bras ouverts pour soutenir le ciel, les anciens Égyptiens associaient le plus grand nombre de leur système numérique : le million. Le dieu était le millionnaire. Les remèdes égyptiens, les nectars, les cosmétiques, les parfums, les bijoux, les amulettes laissaient apprécier cette qualité en transférant à l’objet le pouvoir de se démultiplier en pensée, par un art qui nous stupéfie encore, avec le don de susciter les récits qui restituent l’impact sur soi de ce transfert imaginaire.
Les caravaniers et les marins à qui revenait la charge de diffuser ses produits, en les véhiculant en acte, estimaient d’autant mieux leurs vertus. La célébration du Nouvel An égyptien, transposée au Levant, sollicitait déjà les mêmes vœux qu’aujourd’hui. Prières à quoi une triade de divinités répondait naturellement. « Sous des noms variables de ville en ville, notait Braudel, elle groupait un roi des dieux, une déesse-mère et un dieu jeune dont le sort, chaque année, était de naître, mourir et renaître. »[1] Exporté le panthéon égyptien se simplifiait, s’épurait, se structurait, sans mobiliser pour autant les théologiens. L’objet, sa faculté d’animer le désir, de construire des symboles, de délier des discours, y suffisait à soi seul. Baal imposait sa puissance en allégorisant le multiplicateur ; Ashéra en rendant vie à Eshmoun idéalisait la beauté ; Eshmoun ressuscitait la santé. Santé, prospérité, bonheur, le cadeau de Noël requiert toujours les mêmes données. Elles n’envoient pas que le signal de la fête, elles impliquent les notions mathématiques qui commandent d’éloigner de soi la soustraction et la division. L’investissement dans l’objet se charge d’une force inquiétante. Le pouvoir qu’on lui concède crée un ressort qui n’agit pas que dans un sens : ce qu’il peut faire, il peut aussi de le défaire. D’où la nécessité de délester l’objet des spéculations, des incertitudes, des menaces qu’il réveille, et de saisir sa vertu hypnotique, thérapeutique, salutaire, immédiate, persistante à jamais ; nécessité que Bergson rappelait inlassablement en célébrant la qualité à l’état pur.
Lors de son périple en Bretagne avec Hahn, en 1895, à l’époque de Matière et Mémoire, quand naquit le projet de Jean Santeuil, Proust alla peut-être à Josselin chez la duchesse de Rohan. L’indemnisation de la noblesse d’Ancien Régime sous la Restauration, en dédommagement de ses biens spoliés, lui avait permis de reconstruire ses châteaux et de remembrer ses terres. Proust aurait pu observer le même genre de paysage dans bien d’autres régions françaises, mais les Rohan gardaient, outre le privilège de demeurer sur leur fief, le souci d’une esthétique qui faisait de Josselin une espèce de chef d’œuvre.
Des tours géantes et massives surgies des remparts d’une forteresse féodale y protégeaient un admirable logis de la Renaissance restauré sous le Second Empire dans le style néo-gothique. En lui ôtant un peu d’authenticité, il ne rehaussait pas moins le domaine d’une maison ducale dont la lignée remontait au-delà de l’an mille. Si l’on pouvait construire sur le temps, c’est qu’il se confondait avec l’objet le plus désirable — pas la propriété territoriale morcelable en hectares, non — l’objet incessible, le domaine où s’inscrire et se nommer, la terre dans l’acception médiévale du terme, acception dont Bergson retrouvait le sens en l’appelant le temps. Y éprouver seulement la nostalgie de l’Ancien Régime réduirait banalement sa vertu, laquelle résisterait à tous les changements de régimes, pour façonner un climat, une harmonie, un agencement écologique qui resterait incomparable.
Edifiée au XIe siècle, remaniée au XVe dans le style flamboyant, Notre-Dame du Roncier rassemblait le village et sa paysannerie autour de son porche, à l’ombre du logis ducal, d’autant que Jules de La Morandière, un disciple de Viollet-le-Duc requis par la duchesse, avait récemment rendu sa splendeur médiévale à cette église. Sa nef dallée des pierres tombales des Rohan, ses vitraux frappés à leurs armes où un élève d’Ingres avait ressuscité les figures de leurs ancêtres, préfiguraient la chapelle des Guermantes à Saint-Hilaire de Combray et sa lumière de saphir et de miel. Ne fût-ce qu’à peine entrevue, la grandeur des Rohan renvoyait sûrement un éclat aussi fantastique à un enfant de Josselin que la grandeur des Guermantes à l’enfant de Combray. Pour autant, Proust ne songeait pas moins que jadis à La Ferté-Vidame, sur une terre aussi parfaitement française, Saint-Simon concevait un tout nouvel enjeu à la littérature, encore qu’il l’exhumait du fond des âges : des millions.
Maintenir son rang tenait à ce prix. Le faubourg Saint-Germain, fût-il passé par l’épreuve de l’exil et de la misère, ne cessait d’y penser. « Un titre de baron, de vicomte, cela s’achète ; une croix, cela se donne ; mon frère vient de l’avoir, qu’a-t-il fait ? Un grade, cela s’obtient. Dix ans de garnison, ou un parent ministre de la guerre, et l’on devient chef d’escadron », remarquait Mathilde de la Mole. « Une grande fortune !… c’est encore ce qu’il y a de plus difficile et par conséquent de plus méritoire. Voilà qui est drôle ! C’est le contraire de tout ce que disent les livres… Eh bien ! pour la fortune, on épouse la fille de M. Rothschild. »[2] En livrant Le Rouge et le Noir, Stendhal ne prédisait pas seulement l’union de Robert de Saint-Loup et de Gilberte Swann, il étudiait le processus hallucinatoire à quoi la noblesse se vouait forcément, à ôter à l’argent sa vulgarité à ses yeux pour lui substituer la donnée virtuelle de la conquête et y puiser l’aliment de son faste et de ses vertiges. Observez Le Rouge et le Noir dessiner les défis sur le tapis d’une table de jeu. Regardez-les colorer alternativement les cases du cylindre d’une roulette française. Rouge, noir, pair, impair, passe, manque. Entendez le croupier solliciter les mêmes paris, envisager les mêmes risques que Julien Sorel. Et, s’il s’y perdait, il n’y éprouvait pas moins le sens de la grandeur que requérait Bergson.
« “Serait-il bien possible, se disait-il, que je fusse le fils naturel de quelque grand seigneur exilé dans nos montagnes par le terrible Napoléon ?” À chaque instant, cette idée lui semblait moins improbable. “Ma haine pour mon père serait une preuve… Je ne serais plus un monstre !” »[3] Stendhal exhumait à son tour un songe du fond des âges qui n’allait plus cesser d’affecter son siècle. Si le souci des millions était nécessaire, il ne suffisait pas à faire tournoyer la bille sur le cylindre de la roulette : fallait-il encore se soucier d’un nom à l’état pur. « Carol (les frères Thierry l’eussent orthographié Karawl) était le nom glorieux d’un des plus puissants chefs venus jadis du Nord pour conquérir et féodaliser les Gaules. Jamais les Carol n’avaient plié la tête, ni devant les Communes, ni devant la Royauté, ni devant l’Eglise, ni devant la Finance. Chargés autrefois de défendre une Marche française, leur titre de marquis était à la fois un devoir, un honneur, et non le simulacre d’une charge supposée ; le fief d’Escrignon avait toujours été leur bien. Vraie noblesse », concluait Balzac, « pure de tout alliage. »[4] Cependant, alors sous la Monarchie de Juillet, la théorie aryenne ne s’appréciait pas de la même manière en France et en Allemagne.
En Allemagne, l’Aryen naissait avec les Lumières. Il confondait la noblesse avec le peuple. Il constituait l’être majoritaire — sur tous les plans : démographique, spatial, mesurable ; qualitatif, existentiel, biologique. L’Aryen fabriquait déjà en série le produit « bio » à la portée de toutes les ménagères de bonne volonté. En France, s’il célébrait la noblesse d’Ancien Régime, l’Aryen livrait un produit de très haute gamme, forcément minoritaire, affronté à la race atrocement vulgaire des Gaulois qui, même à moitié simiesques, prenaient le pouvoir. « “Les Gaulois triomphent !” fut le dernier mot du marquis. »[5] Entendez le dernier soupir de Charles X au château de Prague. Ou les soupirs de Chateaubriand ruiné après la Révolution de Juillet — Révolution qu’il avait pourtant suscitée, à quoi il ne refusait pas moins d’adhérer. S’il prenait le même parti en passant le même pont des soupirs, Balzac était encore loin de prendre le produit « bio » au sérieux, et il se moquait de la saga aryenne autant que Saint-Simon se moquait des chimères généalogiques de l’aristocratie française.
La langue du duc n’est jamais si gaie que lorsqu’elle ravale les prétentions de ses semblables dans son fiel et son écume, ce qui ne l’empêchait pas de nourrir les mêmes chimères ou de faire semblant d’y croire. À tenir son rang, à gagner des places, à conforter sa position, l’homme de cour ne se reconnaissait que des rivaux. Toutefois, à établir le bilan des pertes de jeu au passif, et celui des rentes à l’actif que générait la machinerie de la cour de France, et à charrier tant de chiffres, Saint-Simon découvrait la puissance hallucinogène du capital, sans quoi sa langue ne serait pas si nouvelle.
« Depuis que les rois sont devenus les chambellans de Salomon baron de Rothschild, les Juifs ont à Venise des tombes de marbre. Ils ne sont pas si richement enterrés à Jérusalem », songeait Chateaubriand. La langue du vicomte n’est pas moins nouvelle. « Chose étrange pourtant que ce mépris et cette haine de tous les peuples pour les immolateurs du Christ ! Le genre humain a mis la race juive au Lazaret et sa quarantaine, proclamée du haut du Calvaire, ne finira qu’avec le monde. »[6] L’auteur des Mémoires d’outre-tombe offrait à Israël une vocation plus universelle que jamais, mais toujours plus ambivalente. Si le Juif de Jérusalem lui tendait le miroir des larmes où s’observer jadis, le Juif rothschildien lui présentait maintenant le miroir des vanités où se jauger à l’aune des valeurs les plus méprisables. En revanche, la Juive lui devenait d’autant plus désirable, à suggérer le même objet, seulement perçu d’un tout autre point de vue, sans quoi Le Rouge et le Noir n’aurait pas pu prévoir que le duc de Gramont épouserait Mlle de Rothschild à l’époque où Proust naîtrait.
« Dans cette race », observait Chateaubriand, « les femmes sont beaucoup belles que les hommes ». Il profitait d’une halte sur sa route pour étudier à Venise la population de la Giudecca — sauf qu’alors, en 1833, la Giudecca n’était nullement habitée pas des Juifs, lesquels se rassemblaient encore dans le ghetto historique par obligation légale, mais ce nom, Giudecca, qui signifie le lieu du jugement (guidizio), autrement dit la douane en vieux vénitien, à évoquer phonétiquement la juiverie, lui rappelait son goût pour les filles d’Israël. Et de déduire qu’elles avaient échappé « à la malédiction dont leurs pères, leurs maris et leurs fils ont été frappés. »[7] Il est vrai que, sans le rappel de la malédiction, Israël, personnage déjà si romanesque, n’aurait pas pu prendre une valeur si ambiguë. Admettre que les Juives étaient immunisées au mal vénérien, en particulier — origine de tous les maux —, expliquait leur pouvoir de séduction. Pour se refaire une beauté et une santé, toutes les courtisanes prétendaient qu’elles étaient juives. Au bordel où Bloch l’initie, le Narrateur en entend encore l’écho : Pensez donc, mon petit, une Juive, il me semble que ça doit être affolant ! Rah ![8]
« Heureux Juifs, marchands de crucifix, qui gouvernez aujourd’hui la chrétienté, qui décidez de la paix ou de la guerre, qui mangez du cochon après avoir vendu de vieux chapeaux, qui êtes les favoris des rois et des belles, tout laids et tout sales que vous êtes ! ah ! si vous vouliez changer de peau avec moi ! » L’homme qui admirait jadis dans le génie du christianisme « un peuple qui pût résister au temps », celui qui lançait ce défi : « Montrez-moi ailleurs un exemple d’une législation aussi miraculeuse dans ses effets, et nous écouterons ensuite vos railleries sur le pays des Hébreux »[9], ne nourrit plus que ce rêve : « Si je pouvais au moins me glisser dans vos coffres-forts, vous voler ce que vous avez dérobé à des fils de famille, je serais le plus heureux des hommes. »[10] Il est vrai que lui aussi allait dîner chez les Rothschild. Et alors ? « Le roast-beef égalait la prestance de la tour de Londres ; les poissons étaient si longs qu’on n’en voyait pas la queue ; des dames, que je n’ai aperçues que là, chantaient comme Abigaïl. »[11] S’il ajoutait à sa mélancolie la nostalgie des belles Juives, il n’estimait pas moins que la réussite de ses hôtes créait la pire des offenses à Dieu en honorant le roi de ses assassins. L’écho naissant, mais déjà fracassant d’une telle fortune s’enflait en France, relayé par nombre de témoignages : Histoire édifiante et curieuse de Rothschild, le roi des Juifs ; Grand Procès entre Rothschild Ier, roi des Juifs, et Satan, dernier roi des imposteurs, etc. Chateaubriand le renvoyait à son tour, durant un autre itinéraire, désormais sur la route de Paris à Prague, où il allait faire sa cour à Charles X en exil.
Comment peindre le portrait de l’antéchrist en personne, associé maintenant à la machine à vapeur, à la locomotive, au chemin de fer dont James de Rothschild prenait la tête industrielle, à la lettre et en image, en donnant au nom de Swann un sens qui, s’il lui valait un prestige terrifiant, ne saturait pas moins sa couleur maudite ? Ingres n’est pas Zola, il ne peignait pas encore la « bête », et déléguait-il à son élève Hippolyte Flandrin le soin de donner un pendant viril au portrait de la reine de Judée. Si la figure d’une Juive pouvait créer un chef d’œuvre, il prévoyait que celle de son mari (qui, en l’espèce, était aussi son oncle) ne générerait qu’un tableau horrible, au moins en pensée. Pour autant Ingres ne perdait pas de vue qu’il s’agissait de peindre les millions, mais les millions à l’état pur offerts comme l’étoile de la volupté dans la paume d’une main céleste. Au lieu de donner la mesure de la richesse, d’allégoriser sa puissance, de la réduire à un chiffre monstrueux, le portrait de Betty de Rothschild laissait éprouver une qualité affective incomparable — ce qui le distingue de celui de Juliette Récamier par David ou de Germaine de Staël par Gérard. La fortune des Necker ou celle des Récamier furent aussi célèbres que celle des Rothschild, symbolisées également par une banque, une femme, un salon, une chronique, une littérature, une icône, mais les Rothschild, eux, permettaient au XIXe siècle d’inventer les « millionnaires ».
Devenue objet d’art, la banque ne devenait pas moins l’objet érotique où se dédoublait Israël, chargeant les deux mains comme dans une hallucination : d’un côté les millions, de l’autre zéro. Ce qu’il y a de plus haïssable, et ce qu’il y a de plus enviable, uni dans le même être, encore qu’il ne cesse basculer en soi.
Comment ne pas déplorer qu’en assignant une valeur comptable à la grandeur on dénature inévitablement sa vertu par la suggestion d’une masse monétaire affolante et d’une vanité insupportable ? À formuler la question, Bergson n’oubliait pas qu’il était le gendre du directeur général de la banque Rothschild. Et posait-il un problème tout aussi mathématique qu’éthique qui reste plus actuel que jamais. La grandeur suggère forcément une mesure. Comment s’en passer ? Comment, dans les faits, l’estimer à sa seule qualité dynamique, vitale et durable ? Le point théorique est la télépathie, expliquait Proust à Guiche. Bergson trouve que si le jour où une femme meurt au Cap, sa fille en a la vision à Paris, ce n’est pas là un fait extraordinaire ; mais que l’extraordinaire est que ces phénomènes se produisent si rarement. La conscience selon lui ne résidant nullement dans le cerveau, les diverses consciences devraient être tout naturellement en communication.[12] Suffit-il d’éprouver qu’on ne voyage jamais dans l’espace, mais dans la mémoire qui appartient à tout le monde, pour se doter de la puissance de l’objet le plus désirable : celui qui fait sortir de ses limites en opérant le rapport de l’individu au plus grand nombre, avec une élasticité prodigieuse, comme en se lançant sur le tremplin où se confondre avec le moteur de la création et, précisément, avec sa grandeur. S’il n’était pas le seul, auprès de Proust, à lui laisser entrevoir une telle ressource, Bergson lui apportait le génie d’un calcul dont l’écho, renvoyé sans cesse depuis lors, rend toujours ce voyage si désirable.
Ce voyage, Balzac l’envisageait déjà, quitte à épouser le regard du docteur Moreau. « L’homme, sous la pression d’un sentiment arrivé au point d’être une monomanie à cause de son intensité, se trouve souvent dans une situation où le plongent l’opium, le haschisch et le protoxyde d’azote. Alors apparaissent les spectres, les fantômes, alors les rêves prennent du corps, les choses détruites revivent alors dans leurs conditions premières. » Ainsi s’instillait-il dans le cerveau de Rubempré au moment où il se prépare à se pendre à la grille de sa cellule au Palais de Justice. « La demeure de saint Louis reparut telle qu’elle fut, il en admirait les proportions babyloniennes et les fantaisies orientales. Il accepta cette vue sublime comme un poétique adieu de la création civilisée. En prenant ses mesures pour mourir, il se demandait comment cette merveille existait inconnue dans Paris. Il était deux Lucien, un Lucien poète en promenade dans le Moyen Âge, sous les arcades et les tourelles de saint Louis, et un Lucien apprêtant son suicide. »[13]
Cette machine à remonter le temps comme dans un roman moderne de science-fiction, avec le pouvoir de transporter son héros six siècles en arrière, en confondant l’hallucination avec la vie restaurée à l’état pur, Balzac n’aurait pas pu l’imaginer sans avoir goûté au haschisch sous les lambris de l’hôtel de Lauzun, mais pour en apprécier la vertu romanesque et lui donner sa portée lui fallait-il encore éprouver la passion de son siècle pour l’archéologie, pour les panoramas historiques, pour les reconstitutions d’époque. Au seuil de la mort, Rubempré fait le même vœu que Viollet-le-Duc — ce en quoi il se distingue du narrateur proustien : le héros de Balzac ne soucie pas d’autobiographie ; il ne s’agit plus revoir sa grand-mère, mais de contempler les grands travaux de saint Louis.
Les amateurs d’antiquités avaient commencé à se faire remarquer dans les voitures du XVIe siècle en inaugurant ce qu’on appelait alors le Grand Tour : Venise, Florence, Rome, Naples, bientôt Athènes, Constantinople, Alexandrie… Les grands musées actuels leur doivent l’origine de leurs collections. Cependant l’objet archéologique ne délivrait pas qu’un sentiment esthétique, il possédait le don de constituer l’histoire, d’inventer le roman historique et d’y transporter le touriste. À solliciter la télépathie, Bergson s’installait dans le même genre de machine à remonter le temps. En s’offrant un véhicule plus sophistiqué, il accomplissait d’autant mieux le Grand Tour en pensée, et créait-il un concept merveilleux en promouvant l’être hétérogène.
Songez : l’hétérogène ne change pas, il est le changement. L’hétérogène ne s’altère pas : il est l’autre à l’état pur. Comment s’altérerait-il puisque, s’altérant, il deviendrait nécessairement l’homogène. Le transport en commun que Bergson concevait appelait chacun à s’ouvrir aux autres, à leur tendre la main, à se solidariser, à se secourir. Quoi de plus désirable ? Seulement l’autre ne prenait de sens qu’à définir et à exclure le même. Les autres, c’était tout le monde — sauf le même, autrement dit le miroir des vanités, la surface réflexive, répulsive, répugnante où chacun se voit comme les autres voient chacun.
Je me m’étais jamais fait agresser, je veux dire agresser physiquement. Ç’avait failli m’arriver plusieurs fois, mais il ne m’était jamais rien arrivé, jusqu’à une nuit il y a quatre ou cinq ans. J’avais pris un taxi pour rentrer chez moi. Je n’avais plus d’argent liquide pour le régler. Je lui ai demandé de m’arrêter devant une billetterie. Je m’apprêtais à rejoindre le taxi quand un type a surgi pour m’arracher les billets de banque que je venais de saisir, par un geste qui me sembla d’une violence folle, encore que le coup ne me fit pas mal — enfin pas vraiment mal, il est vrai que je ne lui opposais aucune résistance et qu’il avait l’air d’avoir aussi peur que moi. Vous imaginez ? Soudain j’étais dans un film. Je vivais la scène, et c’était comme si j’y assistais de l’extérieur, avec l’impression de rêver, de faire un cauchemar. Pourtant je savais parfaitement que ce cauchemar était réel, mais s’opérait le dédoublement grâce auquel, probablement, je n’ai pas senti passer le coup, comme si je déléguais la tâche de souffrir à ma place à un double de moi.
Sans ce double, je serais dépourvu du regard qui me permet de me « filmer » lorsque la vie se dote d’une qualité cinématographique. Il ne réclame pas nécessairement que je me confronte à une agression. Toutefois, pour se produire, il exige au moins que je surprenne une menace. La qualité d’un film, serait-il une comédie, tient essentiellement à sa faculté d’activer une menace. Il en est de toutes sortes : militaires, politiques, économiques, épidémiques, amoureuses, spirituelles, mystiques, etc. Les menaces, ce n’est pas ce qui manque. Les moments de bonheur, eux, ne retiennent jamais le même enjeu. La joie ne requiert pas un double de soi pour jouir à sa place, ce qui la rend d’autant plus impudique à qui l’observe en en étant privé. Si ce regard porté sur soi me paraît extérieur, il ne me donne pas moins la faculté de me loger dans la caméra où être tout le monde en pensée, et apprécier dans la menace la dynamique effrayante, en tout cas stupéfiante, et cependant stimulante de la vie en train de se faire.
Le devoir de passer périodiquement un casting ; l’angoisse que suscite le risque d’être éliminé ; la crainte du harcèlement ; la nécessité d’entrer dans des rapports de force ; le souci de discréditer un concurrent, d’en dénigrer un autre ; bref de passer par des procédures peu engageantes, selon une règle du jeu cynique, peut-être, mais universelle, ce devoir s’impose à tous. L’abaissement à quoi s’était résolu Baudelaire pour obtenir les faveurs de Sainte-Beuve, avec le bénéfice d’un article élogieux, sidérait Proust, non qu’il crût que Baudelaire fût une espèce de saint, mais parce qu’il observait s’accomplir le dédoublement entre le virtuose, le manœuvrier, disons mieux le truqueur qui porte en soi l’outil de signification, et le poète qui signifie. Et de conclure : l’homme qui vit dans le même corps avec tout grand génie a peu de rapport avec lui.[14] Pour autant, ce rapport, si ténu soit-il, ne cessera pas de l’intriguer.
« Non, me disait Lucien [Daudet] (et il aimait vraiment Marcel), non, mon petit Jean, Marcel est génial. Mais c’est un insecte atroce. Vous le comprendrez un jour », confiait Cocteau à son Journal. « Je ne croyais pas Lucien. J’avais été cependant étonné, lorsque la gloire lui vint, de voir Marcel lâcher tous ses anciens amis et ne plus vivre qu’avec le groupe de la NRF, avec des critiques (l’infâme Souday entre autres — un porc) auxquels il offrait, au Ritz, des dîners monstres. »[15] Cocteau parvenait aux mêmes conclusions en étudiant Proust. C’est peu dire que Cocteau profilerait à son tour la même figure détestable.
Pourtant, sans ce truc, comment pourrais-je amortir le coup quand j’en reçois un, en prenant mes distances avec le double de moi qui se fait jeter, qui décidément n’a pas de chance et porte le mauvais œil ? Sans ce truc, comment pourrais-je être tout le monde ? Le double qui souffre à ma place reste le même en soi. Mais, restant le même, il ne cesse de s’altérer, sans quoi je ne le convoquerais pas pour absorber mes affects les plus douloureux et, partant, les plus répugnants, comme dans un intestin. Je ne le supporte plus. Heureusement qu’en moi l’autre est là à l’état pur. Néanmoins, cet autre ne semble pas non plus très sympathique, malgré sa télépathie supposée.
Être tout le monde, ce n’est pas seulement détenir l’objet le plus désirable, c’est m’observer tel que les autres me voient. Les autres, eux, ne voient jamais que le truqueur en soi — avec ce paradoxe : ce que j’appelle l’autre, les autres l’appellent le même : celui qui, justement, me renvoie mon image dans le miroir des vanités.
Se loger dans le même corps que le truqueur ne lui suffit pas, le poète fait mieux : il parle au truqueur — du moins il transmet quelque chose qui ressemble à la vérité, à la prophétie, à la voyance, sans pour autant se confondre avec la conscience ni avec la vue optique. Wilde, à qui la vie devait hélas apprendre plus tard qu’il est de plus poignantes douleurs que celles que nous donnent les livres, disait dans sa première époque : « Le plus grand chagrin de ma vie ? La mort de Lucien de Rubempré », se souvenait Proust. On ne peut s’empêcher de penser que, quelques années plus tard, il devait être Lucien de Rubempré lui-même. Et la fin de Lucien de Rubempré à la Conciergerie, voyant toute sa brillante existence mondaine écroulée sur la preuve qui est faite qu’il vivait dans l’intimité d’un forçat, n’était que l’anticipation — inconnue encore de Wilde, il est vrai — de ce qui devait précisément arriver à Wilde.[16] Et de poser le problème du temps d’une tout autre manière que Bergson.
Je ne suis moi que seul, avouait Proust[17]. Quoi de plus vaniteux ? Encore que la vanité reste aussi difficile à apprécier que la grandeur, et que la solitude le faisait aussi voyager dans le temps, sans lui conférer la vocation d’un télépathe, mais le sens prémonitoire dont il constatait les effets en se relisant. Pour laisser les questions militaires de côté, j’ai dans mes livres noté une série de faits que j’inventais, que je ne pouvais savoir, qui souvent n’avaient pas encore eu lieu, et qui se sont trouvés minutieusement réalisés dans la vie. Je vous en citerai verbalement quelques-uns, assurait-il à Guiche. Mais ce n’est nullement à la télépathie et à la théorie de Bergson que j’attribue cette description de faits que je ne pouvais connaître. Je crois qu’elle est une conséquence logique de prémisses vraies. Est-ce qu’il n’y a pas un théorème qui dit : quand deux triangles semblables, etc., eh bien je crois que cette géométrie est vraie aussi pour l’humanité, et qu’en ne s’écartant pas d’un raisonnement juste on trouve naturellement avec la précision la plus subtile ce que la vie contrôle ensuite.[18]
À requérir la géométrie des triangles isomorphes — de même forme en s’emboîtant les uns dans les autres, du plus grand au plus petit, comme dans un jeu de poupées russes — Proust se rendait bien compte que concevoir un million et un millionième revenait au même.
Que vous multipliez une unité par un million, ou que vous la divisiez par un million, vous obtiendrez une grille avec un million de barreaux. Quelle que soit sa taille, c’est toujours la même grille. Entre un millionième et un, comme entre un et un million, le rapport ne change pas, assimilable aux côtés d’un triangle dont la géométrie définit la même loi causale, que ses dimensions soient astronomiques ou infimes.
Le nombre ne mesure pas qu’une quantité, il effectue un rapport de cause à effet. S’il détient le pouvoir de projeter l’individu sur l’écran imaginaire où se déployer numériquement comme on déplie un éventail, il possède également la faculté de renverser le rapport et de réduire l’individu, de l’écraser, de le rétracter jusqu’à l’état d’une fraction si petite, si négligeable, si peu enviable comparé à l’être tout le monde, que le nombre alors affecte tout autrement la pensée, même s’il procède du même pouvoir.
Aujourd’hui, je me réveille dans une vague apaisante, ramené en douceur à l’actualité. Mon ressort s’est détendu. Il a l’air d’être parfaitement calme. Il s’accorde à la tiédeur du climat de mon lit. Il me suggère la figure la plus stable : celle du triangle dont tous les côtés sont égaux. Rien ne pèse dans ce schéma. Les trois miroirs imaginaires où je m’observe semblent me renvoyer la même image. Image visuelle, image tactile, image musculaire. Chacun de ces angles de vision s’équilibre. Chaque tension trouve sa contrepartie. Édifice indéformable : en pivotant sur son centre il dessinerait un cercle parfait.
Ce triangle moteur, les Anciens lui conféraient déjà la vertu la plus harmonique en rapportant l’unité à l’unité. Il reconstruit la pyramide des Egyptiens. Il symbolise la Tétraktys des Pythagoriciens. Il appelle les peintres de la Renaissance italienne à y inscrire la figure de la Vierge à l’Enfant. La mère prend le nouveau-né contre elle, elle lui tend son sein, elle l’allaite, elle le berce. L’image, à force d’être reproduite, a acquis un goût mielleux, sans perdre pour autant son charme. Le souvenir qu’elle active passe par les muscles, les tendons, les nerfs, la peau, la charpente du corps et son ingénierie. Si j’avais serré le poing au réveil, ce fond géologique et géométrique en moi m’aurait passé un tout autre message.
Les aveugles sont particulièrement habiles à se représenter des figures mathématiques. « J’ai suivi au lycée, au milieu de camarades clairvoyants, tous mes cours de géométrie sans avoir une seule figure en relief sous les doigts », racontait Villey. « Notre professeur traçait au tableau noir, en les annonçant, les triangles, polygones ou cercles dont il avait besoin pour ses démonstrations. Je les reproduisais mentalement, posant sur chaque angle, sur chaque point les lettres destinées à les désigner et je suivais la leçon sur ces images intérieures. »[19] Imaginez maintenant un triangle dont l’un des côtés représente la moitié d’un autre. En métaphorisant le rapport du nombre deux, il suggère un tout autre songe que le triangle équilatéral. Les côtés y ont perdu leur équilibre, un angle se fait plus pointu, il semble porter à faux, comme s’il se soumettait à une poussée interne pour se donner la forme d’un couteau de boucherie ou d’un revolver. Pointez l’index et le majeur pour viser un adversaire imaginaire, vous verrez se dessiner ce triangle-là.
En se penchant sur un miroir d’eau, s’appuyant sur les bras pour se déporter en avant et contempler son reflet dans l’eau, le Narcisse de Caravage se loge dans la même figure mathématique. Figure forcément inquiétante, encore qu’elle n’est pas moins émouvante, elle réveille le réflexe musculaire dont dépend l’acte de me voir, avec le même genre de tension et de charge affective.
Un triangle dont l’un des côtés représente le tiers d’un autre, soit l’opération du nombre trois, aura l’air d’une lame encore plus pointue, et ainsi de suite, de sorte que le triangle qui effectue le rapport de l’unité au plus grand nombre formera une immense aiguille. L’obélisque offrait ainsi son signal au dieu millionnaire. Les anciens Egyptiens l’arrimait réellement comme aujourd’hui une fusée sur son site de lancement. Sur le tremplin, je soulève les bras, je les rassemble, je fuselle mon corps, je m’inscris dans la même géométrie, avant de plonger dans l’eau.
On peut faire se succéder indéfiniment dans une description les objets qui figuraient dans le lieu décrit, la vérité ne commencera qu’au moment où l’écrivain prendra deux objets différents, posera leur rapport, analogue dans le monde de l’art à celui qu’est le rapport unique de la loi causale dans le monde de la science, relevait Proust[20]. Le rapport d’une chose à une autre est conditionné par la manière dont mes mains s’approchent des objets, les touchent, les palpent, les caressent en suscitant le souvenir de mes toutes premières manipulations, de mes appréhensions comme de mon audace à poursuivre l’exploration. « Tout dans la nature se modèle selon la sphère, le cône, le cylindre, Il faut apprendre à peindre sur ces figures simples, expliquait Cézanne. On pourra ensuite faire tout ce qu’on voudra. »[21] La sphère, le cône, le cylindre lui rappelaient qu’il n’y a pas d’autres moyens de se saisir d’un objet que de servir de ses mains, seraient-elles virtuelles.
« Beaucoup d’objets se ramènent à une forme géométrique », constatait Villey. « Les objets aux formes capricieuses, pour être consciencieusement explorés, demanderaient, outre une puissance de synthèse particulière, une grande patience : aussi, à la place d’une représentation exacte, l’aveugle est toujours porté à se contenter d’une image plus ou moins pauvre, plus ou moins fausse, qui lui en tient lieu. Il ramène l’objet à une forme géométrique et le dépouille de tout ornement. »[22] Un aveugle voit comme Cézanne. Si l’on compare ses peintures à des photographies du même motif, la schématisation qu’il opère ne semblera pas très séduisante — c’est ce qui soulevait les rires et les protestations du public devant les toiles d’un peintre si maladroit. Pour autant elles n’inauguraient pas moins un nouvel âge de la peinture.
Peindre ni ce qu’on voit puisqu’on ne voit rien, ni ce qu’on ne voit pas puisqu’on ne doit peindre que ce qu’on voit, suggérait Proust, mais peindre qu’on ne voit pas.[23] Son narrateur se conforme à ce programme laissé en suspend sur l’une des dernières pages de Jean Santeuil : peindre l’état où se sentir aveugle. En se reportant au jour où elle pénétra pour la première fois dans la chambre de Proust, Céleste Albaret se souvenait d’une figure « perdue dans l’ombre et dans le brouillard de la fumigation, complètement invisible, à part les yeux qui me regardaient. Je les sentais plus que je ne les voyais. »[24] L’asthme obligeait Proust à faire quotidiennement, ou presque, l’expérience de la cécité, en prolongeant parfois l’expérience durant des heures, à requérir le fumigène pour mieux respirer.
Voyez comme tout miroite, comme tout est mirage par ce degel, songeait-il devant un paysage de Monet. Vous ne savez plus si c’est de la glace ou du soleil.[25] Enfant, il contemplait déjà des Monet chez les Straus, mais il s’intéressa de plus près à la peinture quand en 1899, abandonnant Jean Santeuil pour passer à la traduction de Ruskin, il commença d’explorer la bibliothèque et la galerie de Charles Ephrussi qui, à la direction de la Gazette des Beaux-Arts, ressemblait dans son hôtel de l’avenue d’Iéna un cercle d’historiens d’art et de théoriciens de l’esthétique.
Devant nous, une allée bordée de capucines montait en plein soleil vers le château. Qu’est-ce qu’un château ? Qu’est-ce qu’un objet dont on ne peut s’approcher, et qui — même si l’on pouvait s’en approcher pour le toucher — est si grand qu’il est impossible de s’en faire une vue d’ensemble ? Un clocher sonne en réverbérant son profil. Le bruit du vent dans les feuillages modèle la silhouette d’un arbre. Le château, lui, ne « parle » pas. Mon grand-père montrait à mon père en quoi l’aspect des lieux était resté le même, et en quoi il avait changé.[26] L’enfant pourrait rapporter ces propos pour permettre à son lecteur de s’en faire une idée. À quoi bon ? — si lui ne peut pas se le représenter. L’odeur des capucines dessine bien une allée. Mais, au-delà, il n’y a plus rien — que du blanc, comme sur une toile vierge.
Entre zéro et un, comme entre un et l’infini, le rapport ne change pas non plus. Zéro désigne le point de saturation où la lumière disparaît : il fait le noir. Vous n’y voyez rien. L’infini, à l’opposé, sature la lumière : il fait le blanc. Quelle différence ? Vous n’y voyez rien non plus. La lumière, quand elle parvient se saturer, produit un blanc auprès duquel l’éclair d’une explosion nucléaire semblera terne. Ce blanc-là, personne ne l’a jamais vu. Mieux vaut s’en tenir au blanc de la toile vierge qui, en somme, restitue le noir comme sur un négatif photographique.
Noir ou blanc ? Devenir infini, ne plus connaître de limites, sortir de soi, s’éprouver dans une solidarité absolue avec tout autre que soi, c’est merveilleux. Devenir zéro, qui peut soutenir que ce n’est pas horrible. Pourtant cela revient au même. Quand elles se referment l’une sur l’autre, les deux branches du compas mesure un écart nul. Ecartez-les l’une de l’autre pour former l’écart infini, l’angle de 360 degrés qu’elles décriront ne les contraindra pas moins à se refermer l’une sur l’autre.
Le blanc restera à jamais blanc sur la toile proustienne. Vous ne saurez jamais à quoi ressemble le château de Tansonville, ni celui de Guermantes — ni même le palace de Balbec vu de l’extérieur. Vous ne lui superposeriez pas si volontiers l’image du Grand Hôtel de Cabourg si cette image, précisément, ne vous manquait pas dans le roman. Le Narrateur, même quand il aura acquis un sens remarquable de la vision, ne peut pas peindre un château. « Ses toiles sont faites de morceaux », constatait Emile Bernard en observant Cézanne au travail. « Il y laisse partout des blancs. »[27]
Le jeune prince amateur de peinture impressionniste et chauffeur, le cousin de Guiche, Alexandre de Wagram que Proust associe à Saint-Loup en transportant son narrateur à Doncières[28], appartenait au faubourg Saint-Germain qu’il observait chez les Straus. Sa mère, Berthe de Rothschild, lui avait laissé les moyens de former la plus importante collection d’œuvres impressionnistes qui ait jamais été réunie. Le prince de Wagram possédait une trentaine de toiles de Cézanne. C’est probablement chez lui que Proust étudia ses paysages et ses visages. Wagram ne collectionnait pas moins les œuvres du XVIIIe siècle, mais comme Swann il appréciait autant les chemins de fer, les automobiles, les aéroplanes, les ascenseurs, la photographie, et la peinture moderne avec un goût qui distinguait dans ce faubourg sa part juive.
Swann avait le toupet de vouloir nous faire acheter une Botte d’Asperges. Elles sont même restées ici quelques jours. Il n’y avait que cela dans le tableau, une botte d’asperges précisément semblables à celles que vous êtes en train d’avaler. Mais moi je me suis refusé à avaler les asperges de M. Elstir. Il en demandait trois cents francs. Trois cents francs une botte d’asperges ! Un louis, voilà ce que ça vaut, même en primeurs ! conçoit le duc de Guermantes[29]. En cela, il se conformait au goût général, encore qu’à la fin du XIXe siècle l’art de Manet (à quoi se réfèrent ses asperges que Proust contempla chez Ephrussi) semblait déjà moins malhabile que celui de Cézanne auquel on ne concédait communément qu’un art dérisoire. Aucune époque ne fut jamais plus contrastée par son refus d’accepter la vision que lui renvoyaient ses grands peintres autant que par leur audace à former cette vision.
Villey signale qu’un aveugle de naissance opéré de la cataracte, quand il découvre la vision optique, s’il distingue une sphère d’un cube, ne peut pas dire, pour autant, lequel des deux objets est la sphère, lequel est le cube. L’aveugle, en manipulant un cube, le comprend à jamais dans la sphéricité de ses mains et les courbures de sa mémoire. « Dans une orange, une pomme, une boule, une tête, il y a un point culminant », faisait observer Cézanne. « Il n’est pas de belle peinture si la surface plane reste plate, il faut que les objets tournent. »[30] Alors caresser la calvitie de Swann, ou aller du côté de Méséglise, c’est toujours la même chose : il s’agit de repérer en un lieu ou en un être sa part la plus douce, et de peindre avec ses mains, quand on n’a pas d’yeux pour voir.
Le monde ne semblerait pas aussi plat, ni aussi sec, si la fonction optique en s’émancipant de la fonction manuelle, lorsque la vision binoculaire se met en place vers l’âge de deux ou trois ans, n’occultait pas le travail de la mémoire musculaire. Maintenant l’objet se présente à soi immédiatement, entrant comme un acteur en scène, sans que j’ai besoin d’aller vers lui ni de tourner autour de lui. Voir se fait tout seul. Pourquoi s’en étonner ? De fait, je ne m’en étonnerais pas si je ne me sentais pas si désemparé en essayant de peindre. Cette vue si mienne, soudain, ne m’appartient plus. Mes mains ne m’obéissent plus. Elles ne dessinent que des cercles, des carrés, des triangles. Qu’est-ce qu’elles veulent dire ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je peux les rapporter à des notions mathématiques, mais qu’est-ce que les mathématiques ont à voir avec la peinture ?
Il me fallut rejoindre en courant mon père et mon grand-père qui m’appelaient, étonnés que je ne les eusse pas suivis dans le petit chemin qui monte vers les champs et où ils s’étaient engagés. Je le trouvai tout bourdonnant de l’odeur des aubépines. La haie formait comme une suite de chapelles qui disparaissaient sous la jonchée de leurs fleurs amoncelées en reposoir ; au-dessous d’elles, le soleil posait à terre un quadrillage de clarté, comme s’il venait de traverser une verrière ; leur parfum s’étendait aussi onctueux, aussi délimité en sa forme que si j’eusse été devant l’autel de la Vierge.[31] Y a-t-il quelque chose de moins mathématique que la langue de Proust ? — Et pourtant l’enfant aveugle arrêté aux aguets comme son lecteur devant cette haie d’aubépines, stupéfait par son parfum, ne doit pas moins recourir à des notions élémentaires pour se la peindre. Cette haie, elle n’est pas droite : elle s’enfle, elle gonfle, elle rétrécie, elle ondule, elle gondole. Se représenter une perspective où deux parallèles se rejoignent est ce qu’il y a de plus difficile à un aveugle. Cette haie, elle a l’air assez bizarre. Mais quelle importance ? Elle sent bon.
« Dites-moi quel parfum s’en dégage », demandait Cézanne à Joachim Gasquet en lui montrant une toile ébauchée. « Quelle odeur dégage-t-elle ? Voyons…
— La senteur des pins.
— Vous dites cela parce que deux grands pins balancent leurs branches au premier plan. Mais c’est une impression visuelle. L’odeur toute bleue des pins, qui est âpre au soleil, doit épouser l’odeur verte des prairies qui fraîchissent là chaque matin, avec l’odeur des pierres, le parfum de marbre lointain de la Sainte-Victoire. Je ne l’ai pas rendu. Il faut le rendre. »[32]
Les mains modèlent la forme ; le flair distingue la couleur. Si les fleurs sentent si bon, c’est qu’elles demandent toujours plus de sexe. En chaleur ou en rut, l’animal, au contraire, ne sent pas bon ; du moins il ne sent pas bon à l’odorat d’un homme, sans doute parce que l’animal alors devient plus susceptible, plus agressif, plus dangereux. Mais quel péril y a-t-il à approcher les fleurs ? Elles vous tendent leurs bras. Elles commandent que vous vous penchiez sur elles.
« Toi qui aimes les aubépines, regarde un peu cette épine rose ; est-elle jolie ! » En effet c’était une épine, mais rose, plus belle encore que les blanches.[33] Sentez-les ces fleurs, elles exhalent comme les daturas l’odeur d’une déesse devenue femme. C’est ce qui rendait si mauvais, du moins si scabreux le parfum qu’on respirait chez Proust, d’autant qu’il n’en supportait pas d’autre et qu’il ne pouvait ni le masquer ni s’en passer. Son narrateur reconnaît le même parfum dans l’aubépine, généreux, opulent, voluptueux quoi qu’on dise. Comment ne le reconnaîtrait-il pas ? Imaginez une haie de datura. Pénétrez-la comme l’enfant aveugle dans le fumigène de Proust.
On part pour Guermantes en famille après la messe, quand il fait beau, comme on va en pèlerinage, encore qu’on n’en atteint jamais le terme. Cela prendrait trop longtemps. Une vie d’homme n’y suffirait pas. Guermantes prolonge naturellement l’église. Méséglise, ce n’est évidemment pas une église — ni même une terre, mais la propriété des Swann, à quoi s’ajoutent la ferme de la tante Léonie, le moulin de M. Vinteuil, la maison de campagne de M. Legrandin, etc. Le voisinage en somme, on n’y risque rien. On n’y va pas qu’en famille, on laisse l’enfant y aller seul, sans se douter qu’il y fera ses premiers pas dans sa vie d’homme. Toutefois, devant ses pas, elle ne s’entrouvre pas moins comme l’ancienne église, la mauvaise église : la synagogue.
L’écriture, quand elle s’inventa en Egypte il y a cinq mille ans, se concevait déjà comme la peinture. « L’artiste égyptien admettait que la longueur totale d’une figure humaine dût être divisée en 18 unités, et savait en outre que la longueur du pied était égale à 3 de ces unités, celle du mollet à 5, etc. ; il savait du même coup quelles grandeurs il devait reporter sur le panneau à peindre ou sur les surfaces du bloc à sculpter », précisait Panofsky[34]. Ce code des proportions prenait l’apparence de grilles où s’inscrivait la silhouette idéale d’un homme, d’un animal, d’une plante. Elles constituaient un catalogue de pochoirs en quelque sorte, adaptés aux exigences de la représentation. Si l’artiste y ajoutait les détails qui singularisaient le modèle, il ne se conformait pas moins à la vision préconçue par le pochoir, ce qui explique que cet art, une fois formé, n’ait guère connu d’évolution (sauf pendant la période akhénatonienne, mais qui dura peu) et qu’il se soit transmis pratiquement inchangé d’une génération à l’autre durant près de trois millénaires.
Pour écrire, le scribe appliquait également un pochoir sur le papyrus en badigeonnant d’encre la forme du hiéroglyphe préalablement découpée dans des plaquettes de bois ou de métal pour la peaufiner ensuite. Il est vrai qu’il ne s’en servait pas toujours. Il lui fallait parfois écrire plus vite, quitte à rendre moins parfaite sa calligraphie. Il n’oubliait pas pour autant ce qu’ordonnaient l’esthétique de l’image et la nécessité liturgique dont elle dépendait. Écrire, c’était exercer un sacerdoce au service de l’Etat et de ses dieux. Le mot, une fois tracé, se chargeait de la surobjectivité qui permettait la codification des procédures de sacralisation, d’archivage, de contrôle, d’injonction, sans quoi la formation d’un empire et son maintien n’eut pas été possible.
Le Nil étendait l’Egypte sur plus de mille kilomètres. À remonter le fleuve, d’une région à l’autre la langue variait forcément, et plus encore quand l’empire s’étendit jusqu’à l’Euphrate. La conquête militaire ne faisait pas tout. Il fallait administrer et soumettre au fisc des populations qui, de Nubie jusqu’à Canaan, parlaient des dialectes qu’on n’eut jamais songé à unifier alors. Le hiéroglyphe restituait une fonction idéale. En sollicitant la chose, l’idée scellée dans l’image commandait un travail. Le hiéroglyphe n’enseignait pas seulement une écriture, il programmait un langage dissociable de la langue parlée et intériorisable en pensée muette, précisément parce qu’il ne réclamait que l’œil.
« Dans l’ancienne Égypte, le taureau figurait la puissance de combat ; la lionne était destruction ; le vautour, si attentif à ses petits, maternité », notait Bergson. « Or, nous ne comprendrions certainement pas que l’animal fût devenu l’objet d’un culte si l’homme avait commencé par croire à des esprits. Mais si ce n’est pas à des êtres, si c’est à des actions bienfaisantes ou malfaisantes, envisagées comme permanentes, qu’on s’est adressé d’abord, il est naturel qu’après avoir capté des actions on ait voulu s’approprier des qualités : ces qualités semblaient se présenter à l’état pur chez l’animal. »[35] Le logogramme réalisait une performance remarquable en réduisant l’énoncé à une figure purement visuelle. C’est cette faculté de transparence immédiate entre l’objet, l’image et l’idée que Bergson admirait dans l’écriture égyptienne.
La logographie rendait l’intériorité visible. Elle cristallisait les choses, mais interdisait d’établir un rapport entre les choses, à les faire défiler indéfiniment comme en les passant en revue. Aucun objet n’était interchangeable ; aucune image, comparable. Le hiéroglyphe étiquetait une valeur. Savoir comment la chose se nommait n’avait guère d’intérêt, l’essentiel c’est ce qu’une chose valait intrinsèquement, comme au premier jour de sa conception, du moins en théorie.
Car, en pratique, les scribes ne parvinrent jamais à façonner une écriture purement visuelle. La langue parlée véhicule des dizaines de milliers de mots ; la pensée, des millions d’idées. Il s’en crée tous les jours. Assigner à chaque concept un logogramme exigerait une police de caractères si étendue et si longue à mémoriser que l’apprentissage du code prendrait plus qu’une vie d’homme comme en allant vers Guermantes — le château des millions d’années, en somme. On n’en finirait plus.
La police des scribes les plus savants n’alignait guère qu’un millier de caractères. C’était déjà beaucoup, mais cela ne suffisait pas à épingler tous les objets à l’état pur. Dans nombre de cas, le scribe recourait une construction en rébus en détournant le sens du logogramme pour n’en conserver que la valeur phonétique afin de signifier par écrit un message oral. Toutefois, comme aujourd’hui en sténographie, s’il disposait d’un signal pour exprimer un concept, le scribe préférait son usage à celui du rébus. Si la logographie permettait d’écrire plus vite, elle suggérait un progrès de la pensée en lui laissant entrevoir un nouvel horizon. Les fêtes du Nouvel An célébraient l’attente d’une nouvelle ère. Elles la célèbrent encore.
La construction en rébus palliait une déficience de la mémoire. Pourquoi ne pourrait-on pas s’en guérir ? Pourquoi ne réussirait-on pas à se doter un jour d’un langage purement visuel et, partant, purement conceptuel et universel où atteindre aussitôt l’objectif ?
Ce que la vue me donne immédiatement, la langue parlée n’est pas capable de l’enregistrer avec la même immédiateté. Elle fragmente sa continuité, elle n’en retient que des morceaux, elle les juxtapose comme Cézanne au lieu de peindre comme Ingres. Quand Ingres parvenait à restituer la qualité idéale de l’objet, Cézanne ne réussissait plus qu’à rendre grossièrement compte de la position de l’objet dans l’espace, du moins au regard de ses contemporains. Si l’idée m’échappe quand je me confronte à une image, n’est-ce pas parce que les mots, et la pensée qu’affectent les mots, me la représentent aussi maladroitement ?
« Nous nous exprimons nécessairement par des mots et nous pensons le plus souvent dans l’espace. En d’autres termes, le langage exige que nous établissions entre nos idées les mêmes distinctions nettes et précises, la même discontinuité qu’entre les objets matériels », observait Bergson. « On pourrait se demander si les difficultés insurmontables que certains problèmes philosophiques soulèvent ne viendraient pas de ce qu’on s’obstine à juxtaposer dans l’espace les phénomènes qui n’occupent point d’espace. »[36] Parler prend du temps. Les mots se succèdent laborieusement quand je cherche à atteindre un savoir, alors qu’un logogramme, si je disposais d’un langage adéquat, me permettrait d’accorder aussitôt ma pensée à mon désir, mais encore de voir ma pensée, en fusionnant vouloir, voir et concevoir. Si l’animal n’a pas besoin de parler pour penser, c’est qu’il disposerait de ce type de langage, activé par la mémoire pure à quoi songeait Bergson, et à quoi songeaient déjà les scribes égyptiens. Elle prévoyait que l’âge de la logographie conduirait inévitablement à l’âge de la télépathie, pour peu qu’on veuille vraiment guérir.
Ne pas voir sa pensée quand on pense, revient à se sentir aveugle. Je cherche à m’en sortir. Et alors ? Je ne sais pas où je vais. Je risque de me casser la figure. Où est-ce que je peux bien être ? Qu’est-ce que c’est que ça ? Si je savais où aller, j’y serais déjà. Mais il n’y aurait pas que moi. Il y aurait, précisément, tout le monde.
Déjà à Combray je fixais avec attention devant mon esprit quelque image qui m’avait forcé à la regarder, un nuage, un triangle, un clocher, une fleur, un caillou, en sentant qu’il y avait peut-être sous ces signes quelque chose de tout autre que je devais tâcher de découvrir, une pensée qu’ils traduisaient à la façon de ces caractères hiéroglyphiques qu’on croirait représenter seulement des objets matériels. Sans doute, ce déchiffrage était difficile, mais seul il donnait quelque vérité à lire.[37] Lorsqu’il se rend compte de son infirmité, l’aveugle de naissance comprend qu’il ne dispose que d’une vue potentiellement hallucinatoire, comme sous l’emprise d’une drogue. Rien ne lui garantit en toute certitude que ce qu’il « voit » est vraiment là. Quelque progrès qu’il fasse pour gagner son autonomie, il restera enfermé dans sa chambre noire. Il ne pourra pas accéder à la vue surobjective, autrement dit à la télépathie où être réellement tout le monde.
Où qu’il aille, l’aveugle se sentira toujours étranger comme dans une ville balisée par des signaux faits pour d’autres que soi, signaux dont il repère la présence, mais dont il ignore la signification — sans quoi le Narrateur ne confondrait pas tout le monde avec l’Egypte, sans quoi non plus les choses ne se chargeraient pas du même pouvoir que les hiéroglyphes. Bergson ne le concevait pas moins, mais d’un tout autre point de vue. Le Narrateur ne peut pas entrer à l’école des scribes. Les aveugles n’y sont pas admis. Y seraient-ils admis qu’ils n’y apprendraient rien. Un langage purement visuel leur est incompréhensible. Ils ne deviendront jamais scribes. Ils ne peuvent pas aller là où être là à l’état pur. Il ne leur reste qu’à trouver le chemin du boulevard des Invalides.
« Le sentier surtout, l’ami de l’aveugle, le sentier sous bois où tout est intime, s’insinue en nous avec une obsédante insistance », écrivait Villey.[38] Le Narrateur suit le même sentier. Il y éprouve les mêmes enjeux que Villey : « Le sentiment de la nature ne vient pas de la nature. Il a sa source en nous. C’est nous qui le projetons en elle. Nous lui donnons notre âme pour pouvoir la remercier ensuite de nous l’avoir rendue. »[39]
L’aveugle se sent étranger dans le monde où la nature fusionne avec la vue. Pour voir, il lui faut apprendre à lire ; mais, pour lire, il ne peut compter que sur soi. Ce que nous n’avons pas eu à déchiffrer, à éclaircir par notre effort personnel, ce qui était clair avant nous, n’est pas à nous. Ne vient de nous-même que ce que nous tirons de l’obscurité qui est en nous et que ne connaissent pas les autres.[40] Proust ne partageait pas moins son expérience de la cécité avec d’autres aveugles.
À la question : « Vos héros dans la vie réelle ? », Proust répondit : « M. Darlu, M. Boutroux ». Alphonse Darlu enseignait la philosophie au lycée Concordet, il se prit d’amitié son élève et le recevait encore volontiers dans son cabinet ; Emile Boutroux enseignait la philosophie à la Sorbonne, il était le maître de Bergson, il devenait celui de Proust. — alors, vers 1890, étudiant à la faculté de Droit, quand il répondait à ce questionnaire.
Élu à l’Académie française en 1912, Boutroux fut longtemps considéré comme un philosophe important avant que son nom et les souvenirs qu’il réveille ne s’enfoncent dans les sables mouvants de l’oubli. Dans son appartement de l’Ecole normale supérieure, puis à la fondation Thiers dont il prit la direction en 1902, Boutroux rassemblait un cercle d’enseignants et d’étudiants dans les matières les plus variées. Il était très lié à Charcot et à Charles Richet, son successeur à la tête de l’école de la Salpêtrière. Ils créèrent conjointement en 1885 la Société de psychologie physiologique, en inaugurant un domaine théorique et expérimental où Théodule Ribot, Pierre Janet, Alfred Binet acquéraient déjà une remarquable audience quand Proust se formait auprès de Boutroux.
À la suite de Charcot, Richet convoquait à des expériences hypnotiques, médiumniques ou télépathiques le public le plus savant. Je dois retourner demain à Paris pour dîner chez la Tour d’Argent ou chez l’Hôtel Meurice. Mon confrère — français — M. Boutroux, doit nous y parler des séances de spiritisme — pardon, des évocations spiritueuses — qu’il a contrôlées, signale à Mme Verdurin un personnage que le Narrateur appelle le philosophe norvégien.[41] Proust ne cite jamais dans son roman des personnes sans se référer à son autobiographie. Sauf quand il s’agit de figures historiques, il évoque toujours des amis ou des relations qui ont compté pour lui — Céleste Albaret, le docteur Dieulafoy, la baronne Alphonse de Rothschild, etc. Proust assista sûrement à des conférences de Boutroux, probablement aussi l’une ou l’autre de ces séances. Il fréquentait les salons les plus fermés. Une séance spirite, c’était au moins aussi intéressant qu’une duchesse.
En léguant à l’Institut de France son hôtel de l’avenue Bugeaud, la veuve d’Adolphe Thiers avait décidé de fonder à Paris l’équivalent universitaire de l’Académie de France à Rome. Aussi monumentale que la villa Médicis, la fondation recevait des boursiers recrutés par Boutroux dans toutes les disciplines enseignées en facultés — Lettres, Sciences, Droit, Médecine, Pharmacie — auxquels il offrait les conditions les plus favorables pour écrire leurs thèses. L’hôtel Thiers disposait d’une galerie-bibliothèque de près de cent vingt mille livres. La salle se prêtait à des conférences autant qu’à des séances spirites. Elle rappelait à la fois le raffinement de l’hôtel de Lauzun sous Moreau et la rigueur de l’amphithéâtre de la Salpêtrière sous Charcot. Richet y présenta peut-être Eusapia Paladino, un médium exceptionnel qui opéra à Paris entre 1905 et 1907. Ne croyez pas pour autant que Richet passait pour un illuminé, il obtint le prix Nobel de médecine en 1913. Les expériences qu’il menait à Paris, si extravagantes qu’elles semblent, procédait de la même volonté de savoir que celles que Freud menait alors à Vienne.
« Les manifestations spirites, expliquait Binet, nous montrent la présence, au même instant, dans le même individu, de deux volontés, de deux actions distinctes, l’une dont il a conscience, l’autre dont il n’a pas conscience et qu’il attribue à des êtres invisibles. »[42] Établi par Charcot à la génération précédente, ce constat définissait les prolégomènes de la métaphysique du XXe siècle. Boutroux fut le premier universitaire à en tirer les conséquences lorsqu’il introduisit la psychologie à la Sorbonne. Si la psychanalyse absorba peu à peu ce domaine de recherches, elle ne dépendait pas moins des mêmes prolégomènes. Richet et Freud s’y initièrent sur les mêmes bancs. Mais, s’il s’appuyait sur le même socle conceptuel, Boutroux anticipait un redéploiement bien plus vaste du savoir en invitant le philosophe à se détourner « de la dialectique abstraite qui ne se donne d’autre fin que l’analyse, la définition et la conciliation logique des concepts, pour se mêler à l’ensemble des activités, scientifique, religieuse, artistique, politique, morale, littéraire, économique, par où l’homme entre directement en contact avec les réalités données. »[43] Sans quoi Boutroux n’aurait pas pu être le maître de Poincaré, de Durkheim, de Mauss, de Binet, etc. Son cercle dessinait déjà une arborescence en sciences humaines où le Collège de France, la Sorbonne, l’Ecole normale supérieure se reconnurent durant près d’un siècle. À la fin des années 1980, l’Institut de France vendit le monument viscontien qui accueillait la fondation Thiers à un groupe hôtelier. C’est aujourd’hui un palace. Le lieu où se conçut ce redéploiement mental n’avait plus de raison d’être. La bibliothèque de Boutroux, récurée, est devenue un bar — encore qu’on peut toujours y retrouver la saveur du Grand Hôtel de Balbec.
Je fus surpris d’apprendre par le philosophe norvégien, qui le tenait de M. Boutroux, « son éminent collègue — pardon, son confrère », — ce que M. Bergson pensait des altérations particulières de la mémoire dues aux hypnotiques. « Bien entendu, aurait dit M. Bergson à M. Boutroux, à en croire le philosophe norvégien, les hypnotiques pris de temps en temps, à doses modérées, n’ont pas d’influence sur cette solide mémoire de notre vie de tous les jours, si bien installée en nous. Mais il est d’autres mémoires, plus hautes, plus instables aussi. Un de mes collègues fait un cours d’histoire ancienne. Il m’a dit que si, la veille, il avait pris un cachet pour dormir, il avait de la peine, pendant son cours, à retrouver les citations grecques dont il avait besoin. Le docteur qui lui avait recommandé ces cachets lui assura qu’ils étaient sans influence sur la mémoire. “C’est peut-être que vous n’avez pas à faire de citations grecques, lui avait répondu l’historien, non sans un orgueil moqueur.” »[44]
À évoquer son maître en philosophie dans son roman, Proust l’associe d’abord aux séances spirites et à l’expérimentation de drogues. Est-ce si étonnant ? La toxicomanie ne dépend-elle pas, elle aussi, des prolégomènes de la métaphysique du XXe siècle ?
Le dialogue avec les esprits et l’abus de stupéfiants rappelait à Proust sa période la plus douloureuse : celle qui débuta à la mort de sa mère en septembre 1905, pour s’achever sur la route de Combray à Caen, deux ans plus tard, quand se produisit l’illumination qui, transposée dans son roman, offrirait à son narrateur la vision des clochers de Martinville. Mais les conférences de Boutroux ne traitaient pas que du spiritisme et de l’usage des hypnotiques. Proust avait bien d’autres raisons de fréquenter la bibliothèque de la fondation Thiers.
Boutroux avait épousé la sœur du mathématicien Henri Poincaré qui, plus encore que Bergson, eut une influence majeure sur la pensée de Proust. Boutroux, qui avait enseigné à l’université d’Heidelberg, maintenait des relations étroites avec Husserl, alors le plus remarquable des philosophes allemands. Malgré les rivalités nationales qui allaient entraîner la guerre, des chercheurs allemands et français mettaient en jeu les mêmes intérêts tant en philosophie qu’en médecine, en chimie, en mathématiques, en physique. D’un côté à l’autre du Rhin, s’édifiait un laboratoire en phénoménologie où se confrontaient des conceptions du temps auquel Proust ne pouvait pas rester indifférent, quand Poincaré, Lorentz et Einstein publiaient les bases de la théorie de la relativité.
Parmi les pensionnaires de la fondation Thiers alors, en 1905, on remarquait un jeune aveugle. Il s’appelait Pierre Villey. Il avait perdu la vue à l’âge de quatre ans. Fils d’un professeur de Droit, il avait passé son enfance à Caen, avant d’entrer à l’Institut du boulevard des Invalides où Maurice de la Sizeranne lui donna une éducation si soignée qu’il fut admis sans difficulté au lycée Louis-le-Grand, puis à l’Ecole normale supérieure. Reçu premier de sa promotion à l’agrégation de lettres classiques, il préparait une thèse sur les Essais de Montaigne. Des lunettes fumées dissimulaient ses yeux morts, mais on oubliait vite sa cécité. Il n’était pas seulement brillant, il était charmant. Louise Boutroux l’aimait. Pour une jeune fille du monde dont le cousin, Raymond Poincaré, serait bientôt élu président de la République, ce n’était pas banal d’être amoureuse d’un aveugle. Émile Boutroux n’avait pas de préjugés. Il lui donna volontiers la main de sa fille. Né en 1879, Villey avait l’âge du Narrateur, issu du même genre de famille, d’une bourgeoisie catholique de province qui offrait à la République ses hauts fonctionnaires, ses savants, ses médecins. Proust trouva le nom de Combray, un village dans la région de Caen, sur la route qui mène à la maison des Villey.
« Le bouton de la sonnette, la poignée de la porte, le bruit du verrou qui s’ouvre de l’intérieur, tout me dit même avant l’entrée que c’est dans la maison de famille quittée depuis dix ans que je reviens. Le vestibule résonne sous mes pas : il y a dix ans que je n’ai pas entendu sa voix sourde. Voilà l’odeur de pomme qui émane du fruitier, là, sur la droite », écrivait Villey dans Le Monde des aveugles, paru en 1914, mais auquel il songeait déjà en 1905. Ce passage renvoie probablement à son retour à Caen en été 1904, après son succès à l’agrégation de Lettres. « Toute la maison s’anime ainsi, tandis que je me penche vers elle pour m’imprégner de sa vie : chaque coin est un nid de souvenirs qui s’éveille et palpite. »[45]
En livrant l’ouvrage le plus complet jamais écrit — aujourd’hui encore — sur les perceptions d’un aveugle, Villey ne poursuivait pas seulement la tâche de Maurice de la Sizeranne, il y impliquait une langue inouïe : « L’aveugle accroche des souvenirs aux angles des tables, aux bras des fauteuils qu’il a bien des fois caressés de sa main ; fidèles dépositaires, les choses touchées et entendues, aussi bien que les choses vues, rendent à l’imagination et au cœur les trésors qu’on leur a confiées, elles les peuplent de leurs joies et de leurs tristesses passées. »[46]
Il n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré, écrivait Proust alors, à l’automne 1905, en publiant Sur la lecture — la préface à sa traduction de Sésame et les Lys de Ruskin. La lecture et la cécité possèdent en commun la faculté d’enfermer le lecteur dans la chambre noire où laisser s’évaporer ses jours, et pourtant, remarquait Proust, la bibliothèque, comme la maison de famille, absorbait même les jours dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l’importunité, elle en gravait au contraire en nous un souvenir tellement doux (tellement plus précieux à notre jugement actuel, que ce que nous lisions alors avec tant d’amour), que, s’il nous arrive encore aujourd’hui de feuilleter ces livres d’autrefois, ce n’est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l’espoir de voir reflétés dans leurs pages les demeures et les étangs qui n’existent plus.[47] Villey partageait avec Proust la même expérience.
Le symbole de l’œil apparaît le plus souvent sur les objets égyptiens. L’objet vous regarde. Vous l’avez sûrement vu. Il constituait le logo de l’industrie égyptienne. De l’objet à l’image, le logogramme transmettait un message en langue divine. Il ne le transmettait pas moins de l’image à l’objet. Savoir écrire dotait le scribe d’un pouvoir magique. Inscrite sur une tombe, sur un sarcophage, sur un récipient, sur un bijou, sur un tissu, l’écriture transférait au support le même pouvoir. Le support changeait de nature. Il devenait une amulette. Il protégeait. Il rassurait. Il détendait. Il soulageait. Il soignait. Le pouvoir de l’écriture, s’il assignait au scribe la tâche d’un prêtre, ne lui confiait pas moins la charge d’un médecin.
L’œil qui labellisait l’amulette signifiait « médecine » en appelant à fêter le Nouvel An et la guérison d’Horus. L’œil allégorisait à soi seul la puissance de l’écriture. Tout le monde répondait à ce signe. Tout le monde y répond encore. Peu importe sa signification, ce qui compte c’est l’action du signe sur soi, qu’on sache le lire ou non. Qu’est-ce que ça peut faire de ne pas savoir lire, pourvu que ce soit écrit ?
Si le hiéroglyphe pouvait apaiser, il pouvait aussi effrayer. Le hiéroglyphe lançait un sort et un ressort. Les partis politiques y ont toujours recours. Ils sont loin d’être les seuls. Le svastika des nazis, la faucille et le marteau de communistes, la fleur de lys des royalistes, la rose des socialistes retiennent en soi la magie du logogramme. Selon ses convictions, ses superstitions, ses hantises, on réagit tout à fait différemment à ces signaux. Mais ce qui est sûr, c’est tout le monde y réagit, même si la plupart des gens sont incapables d’énoncer la signification originelle de l’image.
Bien des égyptologues contestent que l’invention de l’écriture ait été liée aux exigences administratives d’un Etat en formation, puisqu’elle n’apparaît d’abord que sur des objets à vocation magique, et avant même que la civilisation égyptienne ne se structure. Un archéologue du futur pourra conclure que l’usage du svastika ou de la faucille et du marteau n’eut rien à voir avec la formation de l’Allemagne hitlérienne ou de la Russie soviétique, il n’empêche que ces images affectèrent si profondément les esprits que leur force est encore sensible. Il est vrai que les magiciens de l’Egypte ne disposaient pas des mêmes moyens. Le pouvoir de fabriquer des amulettes constituait leur seule arme, du moins la seule qui pût produire un impact massif sur les imaginations. Ce n’est pas grand-chose à qui considère que la formation d’un Etat exige une organisation rationnelle telle que se conçoit la raison aujourd’hui. Le logos n’avait pas encore de verbe. Et alors ? Il détenait déjà le pouvoir de l’icône. Cela suffisait. Il assura la durée des empires durant des millénaires. Les signaux conditionnaient les réflexes de l’Egypte. La discipline militaire ou la discipline administrative réclame toujours le conditionnement de réflexes.
La magie subsiste et résiste au temps comme les panneaux indicateurs du code de la Route. Elle requiert une formation comparable à celle qu’impose l’obtention du permis de conduire. Le conducteur qu’elle forme, le véhicule qu’elle lui offre, le réseau routier virtuel où il circule, lui confèrent le don de voir ce que seuls les scribes, les médiums ou les télépathes peuvent voir.
Après tout, qu’est-ce que ça fait que ce soit la vérité ou non puisque il arrive à me le faire croire, remarque Charlus[48]. Emparez-vous de l’objet le plus désirable, vous ne signifierez pas, vous signalerez, comme le panneau stop ou sens interdit. Signifier et signaler, ce n’est pas du tout la même chose. On peut toujours donner au signal une signification, mais si, au volant d’une voiture, vous attendez que quelqu’un vous traduise en langue orale ce que veut dire stop ou sens interdit, vous aurez vite fait de brûler un stop ou de prendre une voie à contresens. Méfiez-vous. La signification réclame un récit. Cela prend du temps. Le signal active un réflexe. Il ne vous dote pas seulement du pouvoir d’agir au plus vite ; il met en jeu de tout autres circuits cérébraux que la signification — sans quoi, depuis que si longtemps, les aveugles n’auraient pas une réputation aussi effrayante.
« La tradition des siècles était que, sauf des exceptions insignifiantes, l’aveugle né, celui qui avait perdu la vue avant d’avoir creusé son sillon, restait un être faible, mineur, en tutelle, devant se croire heureux lorsqu’il n’était pas opprimé », notait La Sizeranne[49]. Comment un aveugle saurait-il conduire ? Il irait droit dans le mur. Comment voulez-vous qu’il réagisse aux panneaux indicateurs ? Le Narrateur ne se promet pas moins de les décrypter. Quand on ne voit pas avec ses yeux, on peut toujours voir avec sa peau.
Un petit enfant approchera sa main d’une flamme sans crainte. Une fois qu’il se sera brûlé, l’enfant saura que la flamme est mauvaise à toucher, même si elle procure une sensation de chaleur agréable à distance. Ce que la flamme constitue en soi, l’enfant l’ignore. Mais déjà il réagit à son signal. Il ne la touchera plus, il s’éloignera d’elle, il maintiendra la distance entre elle et lui par un mouvement qui lui deviendra vite mécanique, mu par un ressort involontaire.
Tout le monde se soumet à ce réflexe, même si tout le monde n’y obéit pas forcément. Je peux toujours toucher la flamme si je le veux, mais je cesserai alors de laisser agir ma mémoire musculaire. Si le réflexe de retirer mes doigts du brûloir quand j’actionne un briquet me paraît aussi naturel que de m’arrêter au signal stop, c’est que j’oublie l’apprentissage qu’il a réclamé et qui programme toujours la mécanique de mes muscles.
Si une flamme brûle, c’est que toutes les flammes brûlent. L’enfant le sait par induction, expliquait Poincaré. Il me suffit de m’être brûlé une fois, pour prédire que, si je touche une flamme, je me brûlerai une seconde fois. Si la prédiction conditionne mon geste, elle ne conditionne pas moins ma pensée. En éprouvant la brûlure, j’établis une relation de cause à effet entre la flamme et ma peau. D’un cas particulier, je fais une loi générale. Je prévois que les mêmes circonstances produiront inévitablement le même phénomène. Quel intérêt de saisir la flamme à l’état pur ? Ce qui importe, c’est l’impact que la flamme provoque et que provoquera le magicien quand il prétendra détenir le secret de la flamme à l’état pur.
Réveiller mes souvenirs, ce n’est pas grand-chose, mais, à en croire Proust, c’est ma seule chance de comprendre comment chemine une pensée, comment réagit un muscle, comment s’active un réflexe, comment fonctionne une drogue, comment se produit une illumination.
Qui me dit que toutes les flammes brûlent la peau ? Comment l’établir en toute certitude ? Le phénomène que j’ai éprouvé dépend des circonstances où il a eu lieu. « Si toutes ces circonstances pouvaient se reproduire à la fois, ce principe pourrait être appliqué sans crainte : mais cela n’arrivera jamais », présageait Poincaré. « Quelques-unes de ces circonstances feront toujours défaut. Sommes-nous absolument sûrs qu’elles sont sans importance ? Évidemment non. Cela pourra être vraisemblable, cela ne pourra pas être rigoureusement certain. De là le rôle considérable que joue dans les sciences physiques la notion de probabilité. »[50]
Poincaré remarquait qu’on ne peut pas déduire mathématiquement que un et un font deux — qu’on peut seulement l’induire d’une expérience et le démontrer par récurrence. Voilà une pomme. Voilà une autre pomme. Je vois aussitôt deux pommes. Je n’ai pas besoin de les décompter. Ma vue fait le calcul automatiquement. Toutefois, en voyant deux pommes, je ne les pose pas moins comme sur les deux plateaux d’une balance. Leur poids, en s’équilibrant à peu près, fait réagir comme un fléau sensible. Il effectue le rapport d’une pomme à l’autre. L’objet que je vois, je le pèse ; du moins, je ramène en moi l’expérience que je faisais dans ma petite enfance lorsque je prenais une pomme en la caressant et en sentant sa pesanteur dans ma main. L’équilibre que produisait une autre pomme quand je la prenais dans mon autre main, cet équilibre, je l’ai d’abord éprouvé avec l’ossature de mon corps, la symétrie de mes mains, l’élasticité de mes muscles, en découvrant que mon corps me fournit un instrument de mesure.
Occulté, le souvenir de cette expérience ne continue pas moins d’agir sur soi, sans quoi il ne me suffirait pas de voir deux pommes d’à peu près la même taille pour prévoir qu’elles pèsent à peu près le même poids. Cette prédiction, vous pouvez la faire aussi bien que moi. N’importe qui pourra la vérifier. Elle nous confère un pouvoir considérable, mais qui n’a rien de télépathique, assurait Proust.
« Les mathématiciens n’étudient pas des objets, mais des relations entre les objets ; il leur est donc indifférent de remplacer ces objets par d’autres, pourvu que les relations ne changent pas », constatait Poincaré en livrant La Science et l’Hypothèse en 1902[51]. Souvenez-vous : On peut faire se succéder indéfiniment dans une description les objets qui figuraient dans le lieu décrit, la vérité ne commencera qu’au moment où l’écrivain prendra deux objets différents, posera leur rapport, analogue dans le monde de l’art à celui qu’est le rapport unique de la loi causale dans le monde de la science. Cette prédiction au Temps retrouvé, qui permet au Narrateur de projeter son œuvre, de concevoir ce que c’est qu’écrire et de se donner un travail, cette prédiction, je ne pouvais pas en mesurer la portée tant que je ne l’avais pas mise en relation avec le constat de Poincaré et ce qu’il induit, comme en pesant à mon tour ces deux phrases.
À l’automne 1897, Proust put rencontrer chez Charles Ephrussi un historien d’art du même âge que lui, bergsonien et opiomane, orienté vers le même genre de recherches. Il s’appelait Aby Warburg. Proust aurait pu également le rencontrer chez les Straus. Warburg était lié aux Rothschild et aux Ephrussi par des attaches familiales et des intérêts d’affaires. Cependant alors, quand il séjournait à Paris, Warburg songeait à tout autre chose qu’à des affaires financières. Il revenait de Florence où il avait formé sa thèse sur La Naissance de Venus et Le Printemps de Botticelli, Comme Swann, Warburg ne consacrait qu’à l’étude. Il avait cédé à ses frères ses actions dans la banque familiale avec le pouvoir de la diriger. En échange, ses frères lui promirent qu’il pourrait acheter tous les livres qu’il voudrait. Maintenant il projetait de créer à Hambourg une bibliothèque sur le modèle que lui offrait Ephrussi, une bibliothèque à mettre à la disposition des « aventuriers scientifiques », précisait-il.
Warburg faisait le même constat que Boutroux : le cloisonnement du savoir faussait, quand il ne l’empêchait pas, l’aventure scientifique. Mais à l’usage des drogues, aux séances spirites, aux conférences qui rassemblaient des chercheurs venus de tout horizon, Warburg ajoutait une nouvelle pratique du décloisonnement, laquelle bouleversait le classement de sa bibliothèque.
À l’ordre alphabétique par nom d’auteur pour ranger les livres, Warburg préférait ce qu’il appelait la « loi de bon voisinage ». Un livre rend compte d’une recherche forcément singulière, puisque les conditions où elle s’effectua ne se reproduiront jamais tout à fait à l’identique. L’expérience d’un chercheur, le récit qu’il en tire, les interrogations qu’il formule, les conclusions qu’il avance, ne requièrent pas moins l’expérience d’autres chercheurs par un foisonnement d’échos, de résonances, de miroitements. Warburg se proposait d’accorder le classement de sa bibliothèque au sentiment que d’un livre à l’autre s’établissaient des liens harmoniques comme dans un paysage. Au bibliothécaire alors de procéder comme un peintre dont les livres seraient les formes et les couleurs, quitte à confronter le chercheur à l’épreuve nécessaire du labyrinthe.[52] La référence du Narrateur au rapport unique de la loi causale me demeurait assez obscure jusqu’à ce que je retrouve comme sa trace et sa source dans La Science et l’Hypothèse. Jamais je n’aurais lu un livre au titre aussi rébarbatif que La Science et l’Hypothèse, si la lecture de Proust ne m’y avait pas poussé.
« Avez-vous jamais cru à l’existence des choses ? Est-ce que tout n’est pas une illusion ? Il n’y a de vrais que les rapports, c’est-à-dire la façon dont nous percevons les objets », enseignait Flaubert à Maupassant[53]. Sur le rayon de ma bibliothèque, à la ranger mentalement selon la méthode de Warburg, je classais Proust à côté de Flaubert. Son influence fut si déterminante que Proust comparait la force de Flaubert à celle d’une drogue capable de provoquer des éclairs prodigieux autant qu’une dépendance des plus douloureuses. Le constater, c’était déjà parler la langue mathématique. Si un toxicomane la parle sans le savoir, il la comprendra peut-être mieux que personne pour peu qu’il fasse l’effort de la pénétrer. Flaubert et Proust se liaient l’un à l’autre sur un plan auquel Poincaré offre une profondeur tout à fait inattendue, tant elle diffère que celle qu’on éprouve à lire une œuvre romanesque, mais elle ne construit pas moins, à associer avec eux, le même espace de recherche. Toutefois la linéarité d’une étagère ne suffit pas à en rendre compte : il faudrait à la bibliothèque une dimension supplémentaire pour pouvoir glisser entre Flaubert et Proust non seulement La Science et l’Hypothèse, mais un laboratoire en sciences humaines, une espèce de salle de sport comme celle que concevait Sade où étudier les reflets et les réflexes.
« Ce sont des sensations musculaires tout à fait différentes des sensations visuelles qui nous ont donné la notion des deux premières dimensions », observait Poincaré. « La troisième dimension ne nous apparaîtra donc pas comme jouant le même rôle que les deux autres. »[54] Ce laboratoire, Proust l’abordait à peine en 1902. La théorie musculaire que développait Poincaré pouvait bien découler de l’éducation sentimentale que Flaubert conçut à la suite de Sade, pour autant la théorie n’était pas facile à appréhender. Poincaré y laissait entrevoir des prolongements que personne n’avait encore soupçonnés. À Berne, Albert Einstein constitua un cercle de lecture pour l’aborder avec la même synchronie que Proust, quoique d’un tout autre côté. Einstein allait alors souvent à Prague pour donner des conférences sur le même sujet d’étude — chez Berta Fanta en particulier, où se retrouvaient Kafka et ses amis, Max Brod et Oskar Baum, un romancier aveugle avec qui Villey était en relation.
Un cercle comme une bibliothèque trouve sa vocation à provoquer la rencontre de gens qui, a priori, n’ont rien à voir les uns avec les autres. En cela, Berta Fanta à Prague agissait comme Aby Warburg à Hambourg ou Emile Boutroux à Paris. Oui mais, quand un mathématicien entendra sans peine la langue d’un romancier, le romancier, lui, éprouvera bien plus de difficultés à entendre la langue d’un mathématicien. Lire un roman, même s’il semble obscur, n’exige pas d’autre formation que celle des lettres et de la vie. Un monde mathématique, à qui veut le pénétrer, réclame un apprentissage spécifique. Il restera inaccessible au romancier, tant qu’il ne se trouvera pas un professeur.
Proust croisait depuis longtemps le duc de Guiche dans le salon de Mme Straus, mais il s’intéressa à lui en mars 1903, à l’occasion d’un dîner chez Anna de Noailles. Dès lors, ils ne cessèrent plus de se lier. Élève de Poincaré à la faculté de Sciences, Guiche se consacrait à des recherches en aérodynamique et en physique optique. Seul Proust pouvait avoir un duc pour professeur de mathématiques. Et alors ? Le duc mathématicien, c’était intéressant, d’autant que ce duc-là, en qui s’associaient la mémoire des Rothschild et celle des Gramont, prouvait la justesse des prédictions de Stendhal.
Que j’aimerais vous parler d’Einstein ! lui assurait Proust. On a beau m’écrire que je dérive de lui, ou lui de moi, je ne comprends pas un seul mot à ses théories, ne sachant pas l’algèbre.[55] Nous sommes en décembre 1921. Camille Vettard travaille à un essai intitulé Proust et Einstein, dont la parution bientôt dans la NRF réjouit Proust autant qu’elle semble absurde à Guiche. Swann ne peut pas croire Vinteuil, le professeur de piano des paroissiennes de Combray, soit l’auteur de la sonate qui bouleverse sa vie. Comment pourrait-il s’agir du même homme ? Mme de Villeparisis ne peut pas croire que Stendhal, ce brave type qu’elle a si bien connu jadis, soit un génie. Un familier du salon de sa mère ne peut pas être un génie. Proust racontait à Céleste que Poincaré était si distrait qu’un jour, en contemplant des oiseaux dans une boutique du quai de la Messagerie tout en se laissant absorber par un raisonnement, il avait pris une cage et était parti sans se soucier de la régler, poursuivi par une vendeuse. Comment ce vieux fou, que Proust croisait depuis des années dans l’entourage de Boutroux, pouvait-il produire la théorie musculaire qui changeait son appréhension de l’espace et du temps ? Le sentiment qu’éprouvait Guiche en 1921 quand il songeait à Proust — à Proust qui faisait les « bouts de table » chez sa tante Straus, comparé maintenant à Einstein, même si le grand public l’ignorait —, Proust l’avait probablement éprouvé en 1902, quand Poincaré publia La Science et l’Hypothèse.
Je ne vous demande pas de m’écrire comme le président de l’Académie de Suède : « Vous accélérez et ralentissez à votre gré la rotation de la Terre ; vous êtes plus que Dieu », ce qui me semble tout de même beaucoup !! Mais pourtant votre jugement sur moi ne me semble plus favorable, confiait-il à Guiche[56]. Proust ne lui laissait pas moins entendre que les académiciens suédois envisageaient de lui attribuer le prix Nobel. La théorie de la relativité, Proust ne pouvait sûrement pas la comprendre en scientifique (sauf à prendre le mot dans l’acception que lui donnait Warburg), mais il en ressentait les enjeux mieux que personne.
« Je suis absolument incapable de faire une addition sans faute », avouait Poincaré. « Je serais également un fort mauvais joueur d’échecs. »[57] La puissance qu’on admire dans le calcul mental comme dans la stratégie déployée aux échecs, cette puissance tient à la faculté d’enregistrer des combinaisons numériques et de les garder en mémoire. On y exerce seulement un pouvoir. Si puissant qu’il soit, ce pouvoir se limite à un cadre imposé à soi a priori, impossible à remettre en cause, ni même à questionner. Un joueur d’échecs, qui ne peut que soustraire les pièces de son adversaire, ne fera jamais autre chose que ce pour quoi il est programmé. Si un ordinateur aujourd’hui réussit à gagner la partie, c’est qu’elle mobilise toujours la même procédure. La mémoire humaine s’y compare à la mémoire d’une machine. Je réactive indéfiniment les mêmes réflexes à ce jeu. J’y applique au mieux des fonctions comme au volant d’une voiture. J’y éprouve mon intelligence. Je n’y apprends rien.
« Ma mémoire n’est pas mauvaise, mais elle serait insuffisante pour faire de moi un joueur d’échecs », reconnaissait Poincaré. « Pourquoi donc ne me fait-elle pas défaut dans un raisonnement mathématique difficile où la plupart des joueurs d’échecs se perdraient ? C’est évidemment parce qu’elle est guidée par la marche générale du raisonnement. Une démonstration mathématique n’est pas une simple juxtaposition de syllogismes, ce sont des syllogismes placés dans un certain ordre, et l’ordre dans lequel ces éléments sont placés est beaucoup plus important que ne le sont ces éléments eux-mêmes. »[58]
Admettez que un soustrait de un fasse zéro. Vous constaterez que un égale un. Vous concevrez que un et un font deux. Ce raisonnement est à la portée d’un enfant. Il ne met pas moins en jeu un axiome indémontrable. C’est ce que faisait valoir Bergson. Pourquoi dites-vous que un soustrait de un fait zéro ? — Parce que vous assimilez un à une chose matérielle, définie dans l’espace. Un, c’est comme une pomme. Elle n’est plus là. Il n’en reste rien. — D’accord, mais si vous assimiliez un à tout le monde, alors vous ne pourriez plus soustraire tout le monde à tout le monde. Tout le monde n’est pas une pomme, sauf à confondre le monde avec l’espace. Soustrayez l’espace à l’espace, il restera toujours le temps.
Ce que signifie « rien », c’est ce qu’on ne sait pas. Quand je remarque qu’une pomme a disparu, je me sens obligé de dire que j’ignore où elle est. Si, en disparaissant, elle donne zéro, zéro ne signale que la limite du savoir. Il se peut que la pomme soit toujours là, déposée quelque part ; il se peut aussi qu’elle ait absolument disparu, anéantie, consumée, dissoute d’une manière ou d’autre. Je n’en sais rien. Voilà seulement ce qu’indique zéro : rien de plus, rien de moins.
Ce n’est déjà pas mal. Maintenant, si le temps constitue le savoir à l’état pur, comment se fait-il que tout le monde ne le sache pas ? — Eh bien, c’est que l’espèce humaine suit une pente dégénérescente. Si vous n’apparteniez pas à une lignée animale dégénérée, vous redeviendriez aussitôt télépathe et vous verriez tout ce que vous savez, objectait Bergson. D’où l’intérêt d’une séance spirite ou hypnotique pour le prouver.
L’absence n’est-elle pas pour qui aime la plus certaine, la plus efficace, la plus vivace, la plus indestructible, la plus fidèle des présences ? se demandait Proust[59]. Un toxicomane demande à la drogue de pouvoir trouver ce qu’il cherche à savoir. Bergson conférait le même pouvoir au temps. Poincaré conseillait plutôt de se retourner vers les mathématiques.
Je repars à zéro comme dans la chanson d’Edith Piaf. Sans dimension, le lieu m’oppresse. Il exerce sur soi une pression de plus en plus douloureuse. J’en ai le souffle coupé. Précisément, à force de resserrement, d’accablement, d’écrasement, il induit un signal. Si ce que je cherche à savoir n’est pas là, il ne s’associe pas moins à une sensation musculaire. Il produit un effet sensible. En revenant à zéro, je revis une épreuve. Elle me rappelle ce qui m’est nécessaire.
A-t-il jamais été là ? Je l’ignore. Peu m’importe, c’est sa faculté de se soustraire à soi qui me le rend nécessaire. L’épreuve me rend malade, mais elle n’est pas si mauvaise, puisqu’en rapportant un effet à une cause elle me fournit un remède. Maintenant, il me suffit de renverser la relation de cause à effet pour l’entrevoir. Si la soustraction de soi par soi donne zéro, alors c’est soi que je cherche. Voilà l’inconnu à déterminer. Je ne sais rien de plus en soi. Non mais, soudain, à définir soi comme un objet, je vais beaucoup mieux. Je respire, je m’apaise, je me détends. Je ne saisis pas pour autant l’objet. J’éprouve seulement sa présence. Hallucinatoire ou pas, je n’en sais rien. Seulement, de soi à soi, s’établit un équilibre, encore qu’il implique un dédoublement : c’est comme si je prenais soi dans la main droite et soi dans la main gauche. Même s’il ne pèse rien, d’un côté à l’autre de soi se crée une identité, avec l’intuition d’une direction où aller, direction toujours hasardeuse, mais sans elle je ne pourrais pas comprendre que un et un font deux, comme en apercevant mon reflet dans un miroir.
Si l’être n’avait pas la faculté de se soustraire absolument à l’être, il n’aurait pas non plus celle de susciter tout aussi absolument sa présence. Mais je ne le « tiens » pas. Je ne réveille, là encore, qu’un souvenir musculaire, sauf qu’au lieu de requérir ce que j’ai vécu de plus douloureux, il requiert ce que j’ai vécu de plus agréable.
Le point, dimension zéro ; la ligne, dimension un ; la surface, dimension deux ; le volume, dimension trois, etc. Si ces métamorphoses successives me projettent dans des dimensions de plus en plus extensives, ces dimensions ne signifient rien sans les souvenirs musculaires qui s’associent à la recherche de l’objet soustrait. La soustraction de soi par soi, son identité, son dédoublement, sa projection, son déplacement, etc., ces sensations, je ne les perçois jamais a priori, il me faut les expérimenter. Mais je ne peux le faire sans suivre un certain ordre : avant d’apprendre à marcher, il a bien fallu que j’apprenne à ramper ; avant de compter deux, il a bien fallu que je compte un ; avant d’éprouver la présence paradoxale de soi, il a bien fallu que j’éprouve son absence, sinon je ne serais jamais parti à sa quête.
À partir de zéro, l’objet où se définir ne cesse de se dédoubler. Il programme mes habitudes de consommation. Il me soumet aux lois de la toxicomanie. Il me fait passer d’un hypnotique à un autre. Si je ne peux guère y échapper, la langue mathématique me signifie comment fonctionne l’addiction à un objet nécessaire. Faut-il encore ne plus se soucier de l’objet, mais de la sensation qu’il provoque, des réflexes qu’il conditionne, de la vision qu’il détermine, de l’apprentissage qu’il exige, de l’ordre qu’il met en jeu.
« Si j’ai le sentiment, l’intuition pour ainsi dire de cet ordre, de façon à apercevoir d’un coup d’œil l’ensemble du raisonnement, je ne dois plus craindre d’oublier l’un des éléments, chacun d’eux viendra se placer de lui-même dans le cadre qui lui est préparé, et sans que j’aie à faire aucun effort de mémoire », remarquait Poincaré[60], précisément parce qu’il se laissait guider par la nécessité autant qu’un toxicomane, sauf qu’il assignait au besoin, non la prise d’un stupéfiant, mais l’analyse d’une fonction mathématique. Poincaré n’observait pas moins qu’elle produisait le même genre d’illumination mentale. Autant qu’un coureur de fond, le mathématicien réclame le travail de la morphine endogène.
Définir l’objet, ce n’est pas y adhérer, c’est s’y brûler ; c’est aussi le mettre à distance comme une flamme, et étudier ses effets sur soi. Bergson soulignait justement que ce n’était possible que dans l’espace.
Dans le temps, tous les objets s’enchaîneraient et se fonderaient les uns aux autres comme dans les dissolving views de Turner. Zéro, un, deux, trois, c’est bien joli, mais tout cela ne se conçoit que dans un monde de particules, de morceaux, de marchandises. Dans le temps, selon Bergson, les objets s’exposeraient continûment en soi, comme sur un tapis roulant, sans dimensions, sans matière, sans mesures, sans vide, sans espace. Défilant sans arrêt, voilà des objets en pensée, autrement dit des qualités intrinsèques, indétachables de soi, à apprécier en philosophe ou en poète, sans partage entre l’objet et la sensation.
Quand la matière suscite l’être pour le ramener à zéro aussitôt qu’il se soustrait à soi, la mémoire, elle, ne cesse de le démultiplier. Faut-il encore ne pas confondre la mémoire avec mes souvenirs autobiographiques. La mémoire tout court retient la vie tout court. Elle naît perpétuellement de sa source. Au lieu de se soustraire, la mémoire ne finit plus de s’extraire comme un excavateur de sa propre mine. Elle s’accouche. Elle se régénère. Elle se maintient en forme. Elle reste neuve quoi qu’il advienne. Elle garantit sa résistance absolue à l’usure grâce à des images — des images d’un genre tout à fait particulier que Bergson préférait appeler des « objets virtuels », des icônes superposables à toutes choses, des surobjets en quelque sorte, où saisir le cristal du temps.
Les surobjets véhiculent un vouloir pur et simple, sinon ils ne commanderaient pas mes habitudes de consommation. « Les centres où naissent les sensations élémentaires peuvent être actionnés par deux côtés différents », expliquait Bergson. « Par devant ils reçoivent les impressions des organes des sens et par conséquent d’un objet réel ; par derrière ils subissent, d’intermédiaire en intermédiaire, l’influence d’un objet virtuel ».[61] L’objet virtuel restitue le pouvoir du panneau indicateur du code de la Route, en superposant au paysage la vertu de l’image codée — autrement dit du souvenir pur en langue bergsonienne. Une mouche ne se brûlera jamais à une flamme. Le souvenir pur, comme le signal stop ou sens interdit, lui ferait immédiatement savoir qu’il ne faut pas la toucher. La mémoire façonne le code de la Route universel sans quoi l’animal ne pourrait pas durer. L’homme, seul, l’aurait oublié.
Pourquoi parler d’images ? Pourquoi se servir de mots ? Les mots, nécessairement comptables, trahiraient toujours la pensée. En excavant la qualité de la vie, l’œil virtuel que Bergson assimilait au temps, cet œil me fournirait tout ce dont j’aurais besoin en laissant agir les puissances mémorielles qui, en constituant les objets en soi, ne secrèteraient pas moins les sujets, les génies, les anges qui me rendraient les choses cristallines, transparentes, pures, comme en levant le voile de ma cécité. Là encore, la différence entre le sujet (la mémoire) et l’objet (le réel) ne se concevrait que dans l’espace. Dans le temps, il ne resterait que soi, devenu télépathiquement tout le monde, déplié autant de sujets qu’il y aurait de d’objets à spécifier pour établir la sympathie universelle et l’harmonie écologique. Eh oui, la mémoire que j’aurais oubliée, à en croire Bergson, c’est tout simplement la vue — la vue à l’état pur.
En se rendant chez elle ce jour-là, comme chaque fois qu’il devait la voir, d’avance il se la représentait ; et la nécessité où il était, pour trouver jolie sa figure, de limiter aux seules pommettes roses et fraîches, les joues qu’elle avait si souvent jaunes, languissantes, parfois piquées de petits points rouges, l’affligeait comme une preuve que l’idéal est inaccessible et le bonheur médiocre.[62] Odette, pour peu qu’on la détaille sous une lumière crue, réveille des souvenirs rebutants, quand ils ne sont pas écœurants. N’empêche, Odette l’émeut. Swann se reconnaît en elle. Il ne ressent pas moins l’envie d’accorder son émotion à l’image produite par l’esthétique qui lui procure le même genre de sentiment : la charité, au sens exaltant du mot ; la charité qu’allégorisait Giotto en Italie, en inaugurant la Renaissance, lorsqu’il peignait Les Vices et les Vertus.
Comment faire pour effacer les traces de l’addiction à l’opium ou à la morphine sur le visage d’une courtisane comme sur son propre visage ? L’usage des cosmétiques, des postiches, des fards, des parfums ne remédie pas à tout. Il faut bien se démaquiller parfois, et laisser apercevoir ses misères. Il ne reste plus qu’à lui superposer la vue à l’état pur. En inclinant la tête, de ses grands yeux, si fatigués et maussades quand elle ne s’animait pas, elle frappa Swann par sa ressemblance avec cette figure de Zéphora, la fille de Jéthro, qu’on voit dans une fresque de la chapelle Sixtine.[63] En enclenchant cette procédure, Swann agit en scribe comme Bergson et en historien d’art comme Warburg, encore qu’il permet d’analyser une fonction mathématique comme Poincaré.
J’aimais beaucoup un film de Wim Wenders qui s’appelait L’Ami américain. Il n’y avait pas encore de magnétoscopes alors. J’ai revu le film en salle au moins cinq ou six fois. J’aurais voulu le revoir indéfiniment. Une émotion esthétique n’entraîne pas qu’une montée d’endorphine, elle implique une chimie sûrement plus complexe et durable, avec la sensation de devenir meilleur, de découvrir un horizon jamais entrevu jusque-là, d’accomplir un mouvement dont on ne se serait jamais cru capable. Dans l’école de cinéma où je fus bientôt admis, je rencontrai un garçon, étudiant comme moi, que j’ai aimé autant que Swann aima Odette. Appelons-le Roland. Des années plus tard, lors d’une conversation de table, un de nos anciens condisciples fit remarquer combien Roland ressemblait à Bruno Ganz dans L’Ami américain. Remarque en passant, celui qui la formulait n’y attachait guère d’importance.
Je n’y avais jamais songé. Roland ne ressemblait pas à l’acteur, mais au personnage du film, un artisan encadreur où observer l’allégorie du cinéaste selon Winders, avec son emblème, sa signature, et éprouver le charme de son esthétique.
En contemplant l’allégorie de la Charité par Giotto, Proust admirait qu’aucune idée de charité ne soit exprimée par « son visage énergique et vulgaire » : Par une belle invention du peintre elle foule aux pieds les trésors de la terre, mais absolument comme si elle piétinait des raisins pour en extraire le jus ou plutôt comme elle aurait monté sur des sacs pour se hausser ; et elle tend à Dieu son coeur enflammé, disons mieux, elle le lui « passe », comme une cuisinière passe un tire-bouchon par le soupirail de son sous-sol à quelqu’un qui le lui demande à la fenêtre du rez-de- chaussée.[64] Se dire qu’on a aimé un être que parce qu’il réactivait le travail d’une esthétique, en rappelant un personnage de film ou une icône, et que personne n’échappe à cette loi, ne réjouit pas. J’admets volontiers que la séduction qu’exerce un lieu, un meuble, un vêtement, un livre, un aliment, tient à des suggestions de toutes sortes, et que pour être validées, et produire leurs effets sur moi, elles exigent que je les intègre à ma vision et que je les fasse intimement miennes, comme si elles émanaient de ma propre agence de publicité. Bien, mais cette procédure ne conditionne que mon rapport aux objets de consommation. Comment assimiler l’être aimé à un objet de consommation ?
Je ne remets jamais en cause l’utilité et la nécessité du panneau indicateur du code la Route. Mais je ne peux pas croire qu’il fonctionne comme un panneau publicitaire. La publicité ne m’indique pas moins une route à suivre. J’y obéis de la même manière. Mes réflexes ne commandent pas mon comportement sans lui laisser une part d’autonomie. L’influence de la publicité, je peux toujours y échapper. Toutefois, en règle générale, je préfère ne pas brûler un stop, ni prendre une voie à contresens. En apprenant à conduire, je me conforme aux lois qui régissent la circulation. En apprenant à voir, je ne me conforme pas moins aux lois qui régissent la vision, comme tout le monde.
Une image ne me séduirait pas si elle ne me dirigeait pas vers l’objet soustrait. Une image ne me rebuterait pas si elle ne constituait pas comme un signal stop. Le sucre, l’alcool, les stupéfiants, le sexe, le sport, les produits de luxe, etc., ne se substitueraient tour à tour à l’objet que je cherche, s’ils ne suscitaient pas l’iconographie où retrouver le temps et sa qualité hypnotique.
Quand j’étais petit, j’appréciais le chocolat plus que tout, jusqu’à me rendre malade. Et puis, en grandissant, j’ai découvert le champagne. Je n’y goûtais pas la même saveur. Le chocolat s’associait à la fête enfantine. Le champagne m’ouvrait la perspective de rites dont un enfant se sent exclu, avec le gain d’une ivresse dont j’ignorais l’existence. Pourtant, c’est à Noël que j’ai bu ma première gorgée de champagne. Les images festives que me renvoyait le chocolat fusionnaient avec celles que me suggérait le champagne, comme dans un fondu enchaîné cinématographique. La qualité que j’y éprouvais, si elle changeait de nature, ne dépendait pas moins de l’action du même ressort sensible.
Les fabricants de chocolat ou de champagne consacrent des fonds considérables à la publicité de leur produit. Soumis à la concurrence, chacun vante sa propre marque. Mais le produit, lui, se passe de cette publicité-là. Elle ne rend que l’écho de la réputation que le chocolat ou le champagne se sont acquis depuis des siècles. Les dealers de haschisch ou de cocaïne laissent opérer le produit. Aussitôt testé par soi, il génère une vision double en quelque sorte, en superposant à sa forme objective une imagerie suggestive bien plus efficace sur soi que celle que programmerait une véritable agence de publicité.
À côté de mon assiette je trouvai un oeillet dont la tige était enveloppée dans du papier d’argent, note le Narrateur en s’initiant à son premier dîner en ville — chez les Swann, mais les Swann tels qu’ils lui apparaissent à Paris, loin de Méséglise, loin de l’enfant aveugle qu’il laisse cheminer sur son sentier. Il suffit qu’on le convie à ce rite pour qu’aussitôt le Narrateur se dédouble en devenant clairvoyant. Je vis tous les convives masculins s’emparer d’un oeillet semblable qui accompagnait leur couvert et l’introduire dans la boutonnière de leur redingote. Je fis comme eux avec cet air naturel d’un libre penseur dans une église, lequel ne connaît pas la messe, mais se lève quand tout le monde se lève et se met à genoux un peu après que tout le monde s’est mis à genoux. Un autre usage inconnu et moins éphémère me déplut davantage. De l’autre côté de mon assiette il y en avait une plus petite remplie d’une matière noirâtre que je ne savais pas être du caviar. J’étais ignorant de ce qu’il fallait en faire, mais résolu à n’en pas manger.[65] Bientôt, dès qu’il saura ce que c’est, le Narrateur appréciera le caviar. Tout le monde l’apprécie. Pourquoi ne l’apprécierait-il pas ?
La vue optique, une fois construite au sortir de la petite enfance, ne me restitue pas que les dimensions mesurables des objets ; elle promeut leurs vertus affectives, compactées dans des icônes plus ou moins attirantes, plus ou moins stimulantes, sur lesquelles mon attention se fixe en permanence pour peu qu’un environnement ne me soit pas familier. Sinon, voyager ne serait pas si captivant. Dans une ville étrangère que j’explore, je ne cesse de me laisser affecter par des images où l’objet manquant, l’objet toujours soustrait à soi, s’investit potentiellement, en offrant à la séduction sa dynamique et à la vie sa puissance stupéfiante.
Si je n’avais pas besoin de me nourrir, si je n’éprouvais pas la faim, cette fonction, je ne l’aurais sûrement pas développée. Il faut bien que je trouve de quoi manger. Encore qu’avant même de m’en soucier, il a fallu que je fasse l’expérience de la jouissance et qu’elle ait disparu, pour que j’accomplisse mon premier mouvement. De cette expérience vécue quand j’étais aveugle, je n’ai aucun souvenir visuel — comment pourrais-je en avoir ? — mais mes muscles, eux, me la rappellent de loin en loin.
« En dehors des données de la vue et du toucher, il y a d’autres sensations qui contribuent autant et plus qu’elles à la genèse de la notion d’espace », supposait Poincaré. « Ce sont celles que tout le monde connaît, qui accompagnent tous nos mouvements et que l’on appelle ordinairement musculaires. Le cadre correspondant constitue ce que l’on peut appeler l’espace moteur. Chaque muscle donne naissance à une sensation spéciale susceptible d’augmenter ou de diminuer, de sorte que l’ensemble de nos sensations musculaires dépendra d’autant de variables que nous avons de muscles. »[66]
Proust s’intéressait tout autrement qu’Einstein à la théorie de Poincaré, mais à étudier l’allégorie de Giotto, et à remarquer que la charité exposait forcément une gestuelle — qu’elle forçait à un geste — il se demandait comme Einstein : comment fonctionne cette force ?
Se dire que l’amour met inévitablement en jeu un rapport de forces, ne réjouit pas non plus. Les rapports de forces, je les éprouve dans le monde du travail, soumis aux lois de la concurrence, à l’exigence de gagner ma vie, à la comptabilité de la matière, dirait Bergson, à la pollution industrielle des valeurs intrinsèques, bref à la dénaturation du temps par l’espace. Où pourrais-je retrouver le temps, le restaurer, le dépolluer, le purifier, et le tenir enfin, sinon en aimant ?
Le saisissement par l’amour ne met pas moins en jeu une nécessité à laquelle je ne peux résister, une nécessité bien plus vitale que celle qu’induit l’objet de consommation courant. Je m’aimante en aimant. J’entre dans un champ gravitationnel. J’adhère à l’amour, j’en ressens aussitôt le retentissement, avec le réveil d’un mouvement salutaire. Je progresse, je monte, je grandis, comme en passant mon cœur à Dieu.
À superposer au visage d’Odette celui de Zéphora, la femme de Moïse, et à son propre visage celui du fondateur du judaïsme, ce que Swann cherche à quitter c’est précisément l’Egypte, au sens biblique : l’empire de l’esclavage, de l’idolâtrie, de la consommation insatiable.
Bergson n’y songeait pas moins : le temps qu’il concevait, là où cesser d’être un dégénéré, pour vivre vraiment, c’était la Terre promise. Fallait-il encore qu’elle fût peinte par Botticelli sur une fresque de la chapelle Sixtine. « Que le christianisme ait été une transformation profonde du judaïsme, on l’a dit bien des fois : à une religion qui était encore essentiellement nationale se substitua une religion capable de devenir universelle », concluait Bergson. « À un Dieu qui tranchait sans doute sur tous les autres par sa justice en même temps que par sa puissance, mais dont la puissance s’exerçait en faveur de son peuple et dont la justice concernait avant tout ses sujets, succéda un Dieu d’amour et qui aimait l’humanité entière. »[67] La différence entre le judaïsme et le christianisme ne tient qu’à la faculté de voir l’icône et de l’adorer — sinon la synagogue ne serait pas aveugle, ni l’Eglise le véritable Israël. Sur le chemin de Damas, Jésus rend justement à Paul la vue à l’état pur. En exaltant la religion dynamique et télépathique à quoi tout le monde adhèrerait pour peu qu’on consente à se débarrasser de la pesanteur morbide de son autobiographie, la mission universelle que Bergson se donnait, les questions qu’il soulevait, les réponses qu’il suggérait, appartenaient elles aussi aux prolégomènes de la métaphysique du XXe siècle.
« Né à Hambourg, Juif de sang, Florentin dans l’âme. Au fond de mon âme, je suis chrétien ! » confiait Warburg à Carl Georg Heise. Confidence délivrée à voix basse ; cependant Heise se souvenait qu’après qu’il lui eut fait jurer de garder le secret sur un tel aveu, Warburg ouvrit une fenêtre de sa bibliothèque et qu’il hurla la phrase afin de l’apprendre à tout le monde.[68] Lorsqu’il assista à Rome le 11 février 1929 aux fêtes où Mussolini et Pie XII se réconcilièrent, Warburg précisa l’acception qu’il donnait à son christianisme, laquelle s’accordait à son éducation bergsonienne et nietzschéenne : « Tout au long de mon existence je me suis intéressé à la renaissance du paganisme et aux fêtes païennes. Aujourd’hui j’ai eu la chance unique d’assister à la repaganisation de Rome. »[69] Ce qui n’empêchait pas Warburg d’étudier les icônes en talmudiste.
Ma mémoire ne cesse jamais de travailler. Elle exerce toujours une tension. Elle contrôle en permanence, jusque dans mon sommeil le plus profond, les muscles de mon sphincter pour m’empêcher de me souiller. Le vieillard, le malade, le fou laissent aussitôt entrevoir le symptôme de la mort quand ce réflexe ne s’active plus en eux. L’anneau du signum exposait le symbole de l’infirmité la plus répugnante. Au regard de l’esthétique qui commandait le port d’un tel insigne, les Juifs « faisaient » sur eux, virtuellement, encore qu’ils ne puaient pas moins. Lorsqu’une suggestion le détériore, l’objet perd la qualité qui le constitue à l’état pur. Il sent mauvais. Dégradé par le travail visuel qui l’assimile à zéro, l’objet « fait » sur soi, en quelque sorte. Qui pourrait l’aimer ? Qui voudrait être ce que personne ne voudrait être ? Seul un fou peut parier sur zéro, quand le million est là, à portée de main. Bergson le savait mieux que personne : le million, par nature, anime une vocation universelle. Tout le monde voit le million — pas la masse monétaire, matérielle, vulgaire, excrémentielle qui ramènerait immédiatement à l’être à zéro, non — le million en soi, la puissance, la grandeur, le multiplicateur à l’état pur. Mais qui le verrait, qui le distinguerait, qui le désirerait sans construction iconologique ? Si elle varie considérablement au cours des âges, elle repose toujours sur une vision préconçue par un œil idéal, selon la procédure qui s’inventa jadis avec la logographie et que l’enfant restitue quand il apprend à voir. Warburg étudiait précisément sa persistance à travers le temps. Qu’est-ce que vous croyez ? On ne quitte pas l’Egypte si facilement que ça. Swann n’en a pas fini avec l’Egypte, c’est peu de le dire. Mais, en souffrant, il découvre sa mémoire musculaire, pas moins que sa solitude, avec la part de soi où se sentir aveugle. Comment ne serait-elle pas involontaire ?
1. Fernand Braudel, Les Mémoires de la Méditerranée, Fallois, p. 227.
2. Stendhal, Le Rouge et le Noir, Panthéon, p. 202.
3. Ibid., pp. 401-402.
4. Honoré de Balzac, Le Cabinet des Antiques, Pléiade, p. 966.
5. Ibid., pp. 1095-1096.
6. Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe — Le livre sur Venise, Pléiade, t.II, p. 1030.
7. Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, Pléiade, t. II, p. 1022.
8. Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, Pléiade, t. I, p. 566.
9. Chateaubriand, Les Martyrs, Pléiade, p. 367.
10. Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, Pléiade, t. II, p. 506.
11. Ibid., t. II, p. 76.
12. Marcel Proust, Correspondance, Plon, t. XX, p. 348.
13. Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des courtisannes, Pléiade, pp. 793-794.
14. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 247-248.
15. Jean Cocteau, Le Passé défini, Gallimard, t. I, p. 308.
16. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 273.
17. Marcel Proust, Lettres, Plon, p. 750.
18. Marcel Proust, Correspondance, Plon, t. XX, pp. 348-349.
19. Pierre Villey, Le Monde des aveugles, Flammarion, p. 191.
20. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Pléiade, t. IV, p. 468.
21. Paul Cézanne, cité par Emile Bernard, Conversations avec Cézanne, Macula, p. 63.
22. Pierre Villey, Le Monde des aveugles, Flammarion, p. 217.
23. Marcel Proust, Jean Santeuil, Pléiade, p. 896.
24. Céleste Albaret, Monsieur Proust, Robert Laffont, p. 30.
25. Marcel Proust, Jean Santeuil, Pléiade, p. 896.
26. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Pléiade, t. I, p. 134.
27. Paul Cézanne, cité par Emile Bernard, Conversations avec Cézanne, Macula, p. 24.
28. Marcel Proust, Le Côté de Guermantes, Pléiade, t. II, p. 435.
29. Ibid., t. II, pp. 790-791.
30. Paul Cézanne, cité par Emile Bernard, Conversations avec Cézanne, Macula, p. 43 et p. 65.
31. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Pléiade, t. I, p. 136.
32. Paul Cézanne, cité par Joachim Gasquet, Conversations avec Cézanne, Macula, p. 110.
33. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Pléiade, t. I, p. 137.
34. Erwin Panofsky, L’Œuvre d’art et ses significations, Gallimard, p. 61.
35. Henri Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, PUF, pp. 97-98.
36. Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, PUF, p. 7.
37. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Pléiade, t. IV, p. 457.
38. Pierre Villey, Le Monde des aveugles, Flammarion, p. 251.
39. Ibid., p. 253.
40. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Pléiade, t. IV, p. 459.
41. Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Pléiade, t. III, p. 322.
42. Alfred Binet, Les Altérations de la personnalité, Alcan, p. 63.
43. Emile Boutroux, La philosophie en France depuis 1867 — cité par Laurent Rolet, Henri Poincaré sur la scène philosophique française, in Annales de l’Est, Presse universaire de Nancy, pp. 147-148.
44. Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Pléiade, t. III, p. 373.
45. Pierre Villey, Le Monde des aveugles, Flammarion, p. 246.
46. Ibid., p. 247.
47. Marcel Proust, Sur la lecture, Actes Sud, pp. 9-10.
48. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Pléiade, t. IV, p. 404.
49. Maurice de la Sizeranne, Les Aveugles par un aveugle, Flammarion, p. 148.
50. Henri Poincaré, La Science et l’Hypothèse, publié en ligne, abu.cnam.fr
51. Ibid.
52. Aby Warburg, cité par Maud Hagelstein, Mémoire et Denkraum. Réflexions épistémologiques sur la Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, publié en ligne, cm.revues.org
53. Gustave Flaubert, lettre à Guy de Maupassant du 15 août 1878.
54. Henri Poincaré, La Science et l’Hypothèse, publié en ligne, abu.cnam.fr
55. Marcel Proust, Correspondance, Plon, T. XX, p. 578.
56. Ibid., t. XX, p. 578.
57. Henri Poincaré, L’Invention mathématique, publié en ligne, univ-nancy2.fr
58. Ibid.
59. Marcel Proust, La confession d’une jeune fille, in Les Plaisirs et Les Jours, Pléiade, p. 85.
60. Henri Poincaré, L’Invention mathématique, publié en ligne, univ-nancy2.fr
61. Henri Bergson, Matière et Mémoire, PUF, p. 79.
62. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Pléiade, t.I, p. 219.
63. Ibid., t. I, p. 219.
64. Ibid., t. I, p. 80.
65. Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, Pléiade, t. I, pp. 539-540.
66. Henri Poincaré, La Science et l’Hypothèse, publié en ligne, abu.cnam.fr
67. Henri Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, PUF, p. 128.
68. C. G. Heise, cité par Joseph Koerner, préface à Aby Warburg, Le Rituel du serpent, Macula, pp. 9-10 et p. 39.
69. Aby Warburg, cité par Philippe-Alain Michaud, Aby Warburg et l’image en mouvement, Macula, p. 138.