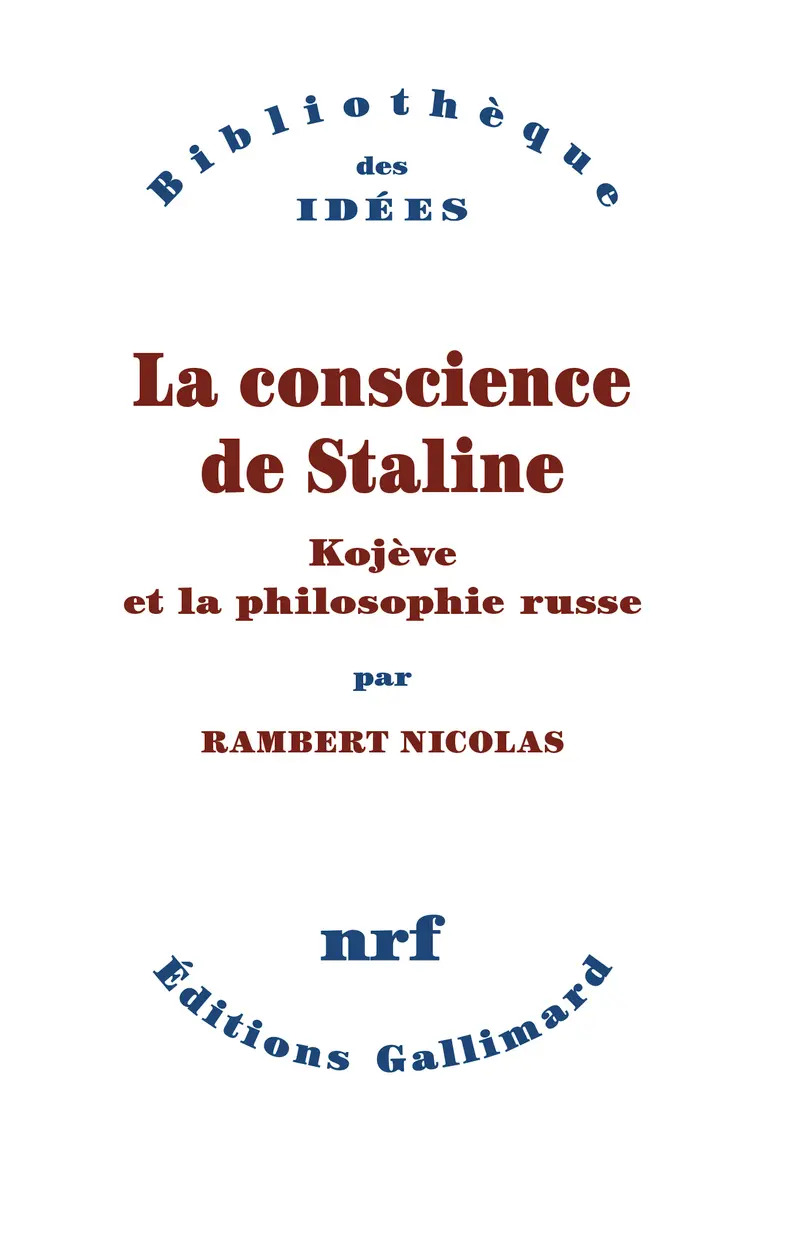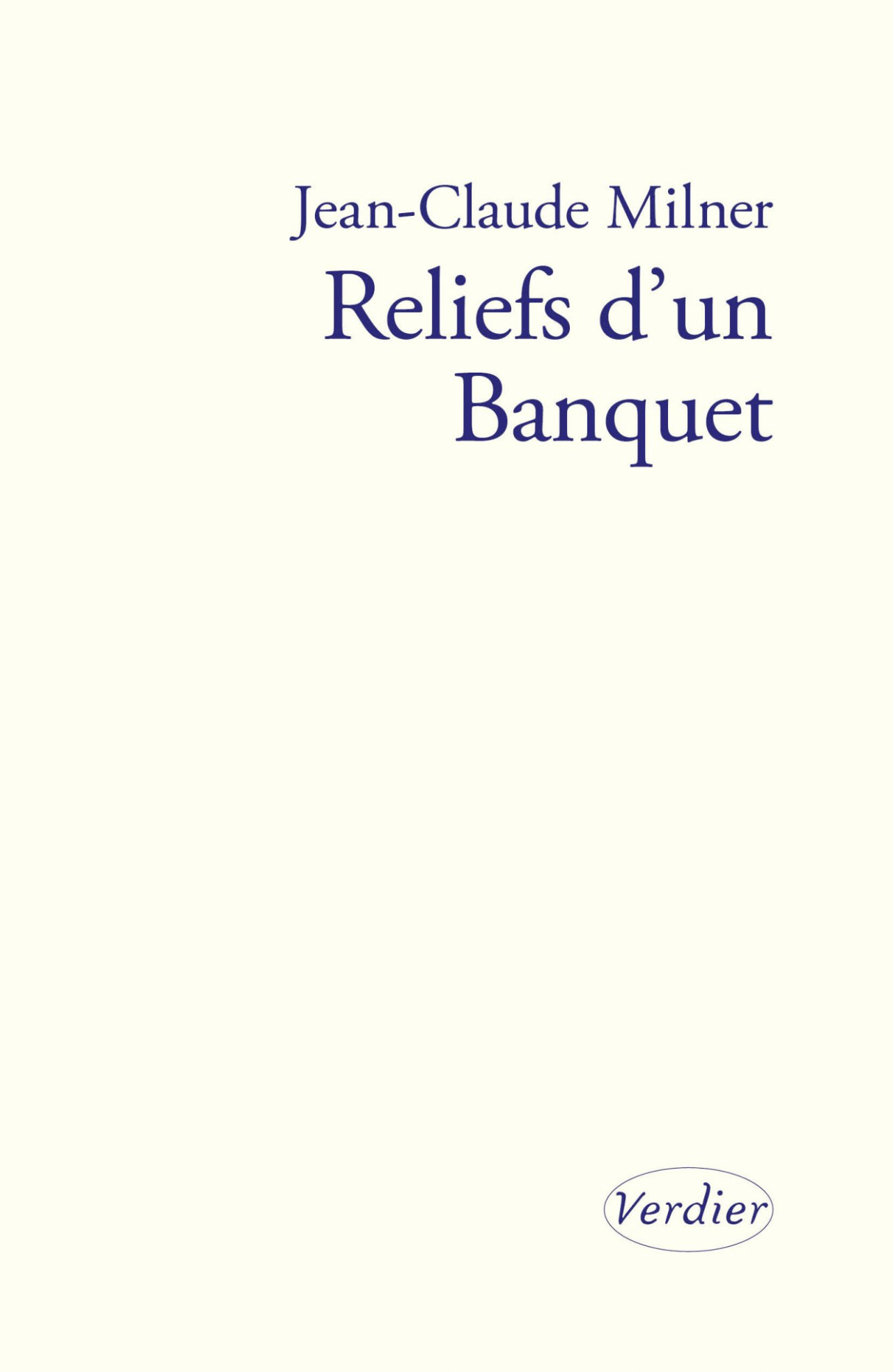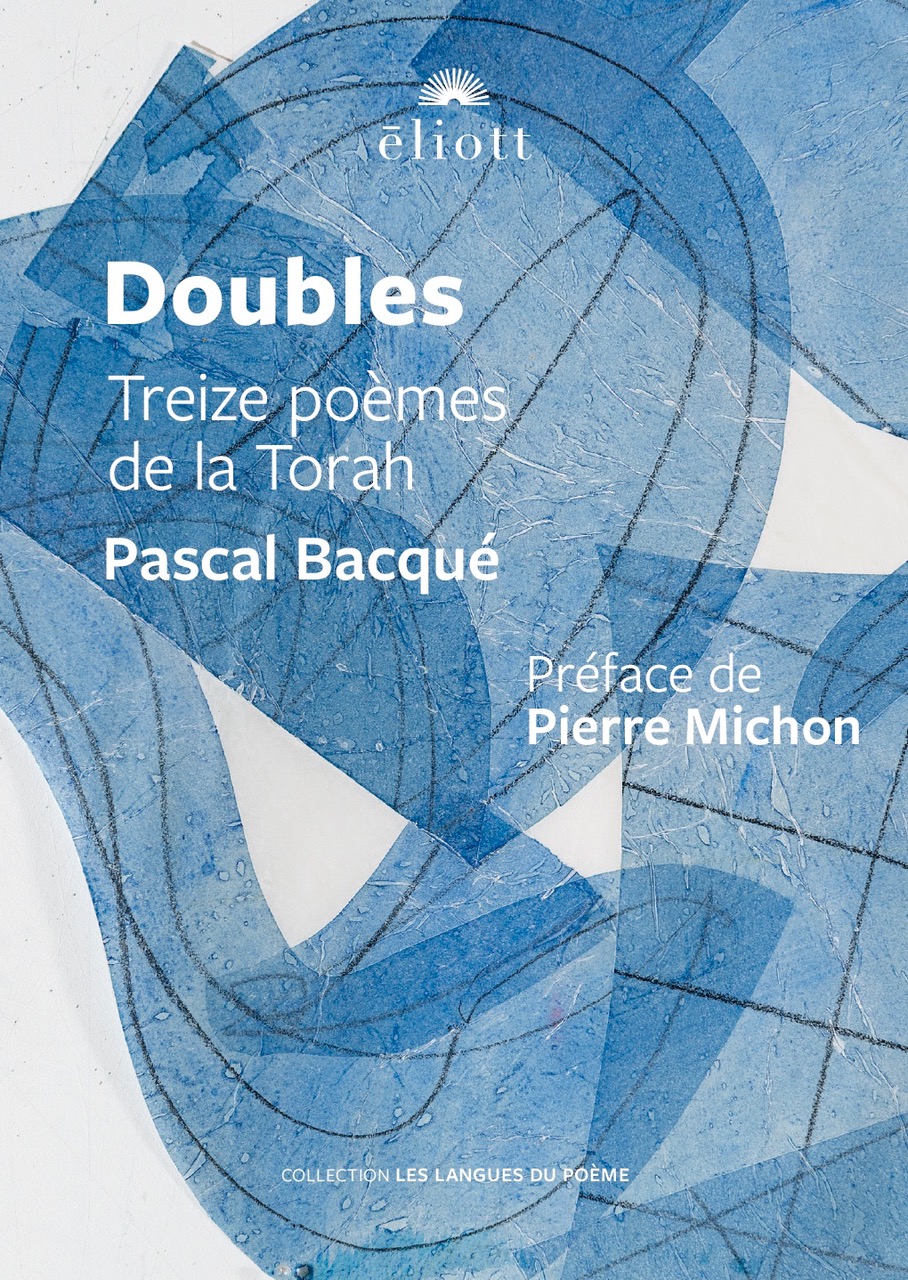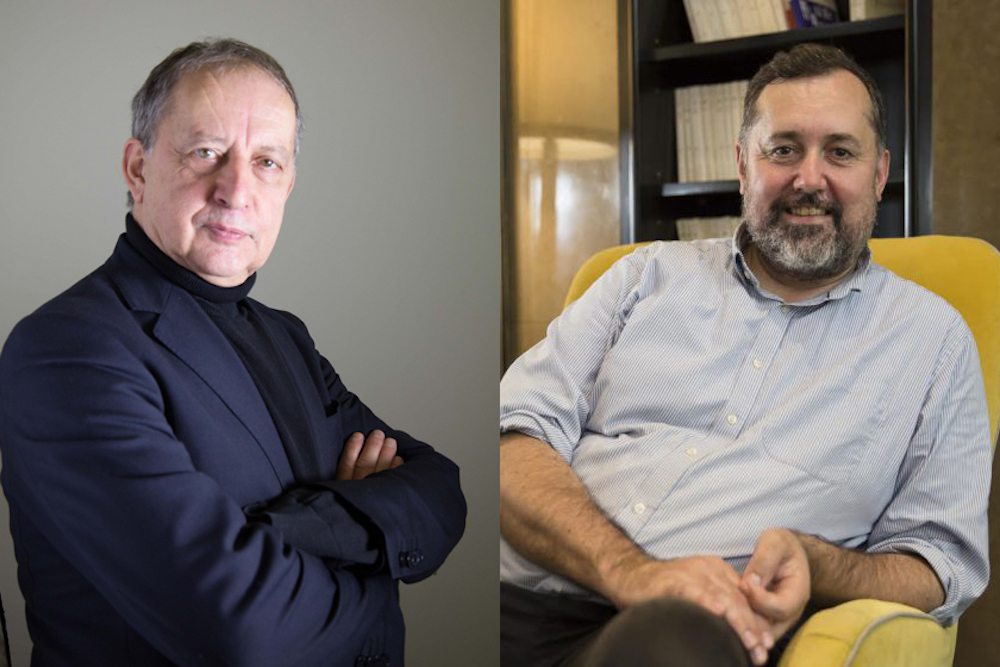Dans un excellent petit livre que publie un nouvel éditeur, À l’est de Brest-Litovsk, et qui s’intitule Dire non à la violence russe, cette définition de « l’actualité » : le temps, non de l’écume, mais du remous ; non du journalisme, mais de l’esprit du monde ; l’actualité, en un mot, et comme son nom, au fond, l’indique, c’est l’action. Ainsi pensait Karl Jaspers qui est, avec Hannah Arendt, Edmund Husserl et quelques autres, l’une des figures du livre. Ainsi parlait Sartre, intellectuel engagé s’il en est, dont les livres devaient se lire, disait-il, comme on mange une banane, au pied de l’arbre. Ainsi parlait Alexandre Koyré avec sa théorie des « conspirations à ciel ouvert ». Et ainsi raisonne Olga Medvedkova, l’autrice de ce manuel de résistance au fascisme russe, quand elle exalte Alexeï Navalny, héros et martyr d’une dissidence dont le programme était de « vivre selon la vérité ». Ce livre est une bonne action.
Paraît, au même moment, un moins bon livre et une très mauvaise surprise : La Conscience de Staline, de Rambert Nicolas (Gallimard). Qui dit Koyré dit Kojève. Parce que ces Alexandre sont, tous deux, d’origine russe. Parce qu’ils sont contemporains. Parce que c’est le premier qui cède au second la fameuse chaire d’études hégéliennes qui va, directement ou à distance, à travers un commentaire génial de la Phénoménologie de l’esprit, former trois générations de normaliens : celle de Sartre ; celle d’Althusser ou de Foucault ; celle de Jean-Claude Milner ou de moi-même. Or qu’apprend-on dans ce livre ? Non que l’énigmatique Kojève a été un stalinien conséquent – on le savait plus ou moins. Mais qu’il fut nourri au lait de Vladimir Soloviev, père de la philosophie religieuse russe, de son anti-occidentalisme messianique et de sa volonté de proposer (d’imposer ?) une version eurasienne de l’Universel. Non plus Aliocha, mais Ivan Karamazov. Non plus Staline, mais Poutine. Non le crépuscule d’une idole, mais sa nuit définitive.
De Jean-Claude Milner j’ai déjà dit, ici, qu’il est l’un des rares philosophes dont la parole, aujourd’hui, importe. Voici une occasion de le vérifier. Cela s’appelle Reliefs d’un Banquet. C’est une anthologie de ses interventions au Banquet du livre de Lagrasse, qui rassemble, chaque été, à l’ombre de l’abbaye du même nom, des amoureux des mots et des savants austères. Trace de Gérard Bobillier, son inventeur… Présence de Benny Lévy, son inspirateur… Et lui, Milner, y déployant sa pensée comme on ouvre un éventail… Il y parle de Koyré et des multiples métronomes qui, en chaque corps, battent la mesure. De l’exode selon Husserl. De l’adieu de Foucault à Kant et de sa relation obscure aux Lumières. Des liens attelant Descartes et Corneille à la Révolution française. De la rivalité, sur fond de comédie humaine, entre Metternich et Talleyrand. Il y explique comment la vérité ne divise pas ceux qui en doutent mais ceux qui y croient. Ou pourquoi c’est quand on ne décide de rien qu’on doit vouloir et pouvoir. Goût et rigueur de pensée retrouvés : les éditions Verdier, qui le publient, n’ont-elles pas construit leur bibliothèque autour d’une traduction du Guide des égarés ?
Faire entendre en langue grecque le souffle de l’hébreu et, en hébreu, le son du logos grec… Ainsi parlait Emmanuel Levinas. Ou, mieux, tel était le projet lévinassien tel que le comprenait notre ami Benny Lévy. Eh bien je n’ai jamais si bien compris cela qu’à la lecture du livre – Doubles, Eliott Éditions – que publie Pascal Bacqué. Ce sont treize poèmes de la Torah. Précisément treize. À condition de trouver de la poésie dans une rime, non pas seulement de mot, mais d’idée. Ces treize poèmes, Bacqué les transcrit. Les traduit. En propose un commentaire qui s’appuie tantôt sur Victor Hugo, tantôt sur un glossateur midrachique ou médiéval. Il en fait une traduction, une vraie, c’est-à-dire une extrapolation où parle, soudain, le poète français en lui. Et un double miracle, alors, se produit : l’hébreu tel qu’on avait fini par ne plus l’entendre tant pesaient sur ses aspérités les couches de vernis déposées, au fil des siècles, par les langues de passage vers l’Occident gréco-latin ; et notre français laminé, appauvri, exténué par la banalité de ses usages qui s’éveille, revit et exulte. Génie du judaïsme ? esprit de la France ? les deux ?
Elle s’appelle Monique Lévi-Strauss. Elle aurait pu croiser Kojève et Koyré. Elle a dîné chez Lacan. Discuté avec Aron. Entendu Roman Jakobson, inventeur, avec une poignée d’autres, de la linguistique structurale, réciter « Les Chats » de Baudelaire. Croisé Jean Pouillon à l’époque où il était une sorte d’agent de liaison entre Sartre et Claude Lévi-Strauss, son époux. Elle a éconduit René Char. Vécu le suicide d’Alfred Métraux. Vu naître Tristes Tropiques et mourir le malentendu structuraliste. Elle est presque centenaire mais garde sa liberté d’allure du temps – 1945 – où elle habitait rue Chardon-Lagache, près du journal Combat. Ses souvenirs, recueillis par Marc Lambron (J’ai choisi la vie, Plon), sont un régal de temps perdu et retrouvé. Ils bouclent, loin des fureurs du jour, mes lectures de la semaine.