Il y a des livres dont le destin est de ne jamais dormir sur des étagères, des livres qui empêchent les autres livres de dormir, des livres auxquels on pourrait appliquer la formule de Joseph Beuys : la mort me tient en éveil. Ces livres sont comme Le livre de sable de Borges : intranquilles, vivants, inépuisables – et certains leur promettraient volontiers le destin funeste que le narrateur réserve à son Livre de sable dans cette nouvelle : « L’été déclinait quand je compris que ce livre était monstrueux. (…) Je sentis que c’était un objet de cauchemar, une chose obscène qui diffamait et corrompait la réalité. Je pensai au feu, mais je craignis que la combustion d’un livre infini ne soit pareillement infinie et n’asphyxie la planète par sa fumée. Je me souvins d’avoir lu quelque part que le meilleur endroit où cacher une feuille, c’est une forêt. Avant d’avoir pris ma retraite, je travaillais à la Bibliothèque nationale, qui abrite neuf cent mille livres ; je sais qu’à droite du vestibule, un escalier en colimaçon descend dans les profondeurs d’un sous-sol où sont gardés les périodiques et les cartes. (…) Je profitai d’une inattention des employés pour oublier le livre de sable sur l’un des rayons humides. »
Mais non. Ces livres resteront. Non qu’ils s’offriraient, tels des œuvres ouvertes, au jeu sans fin des lectures et des interprétations qui se renouvellent au fur et à mesure que changent les époques et se renouvellent les générations, mais plutôt parce qu’ils laissent fuser un chant qui s’inviterait au plus profond de leur lecture, et dont on entend qu’il atteint les couches rythmiques les plus profondes de notre respiration : ce genre de livres, même s’il nous fait respirer l’air du temps, libère à chaque pas des mots qui se succèdent, une dose d’oxygène supplémentaire et salutaire, et que l’on n’imaginait pas pouvoir sentir encore dans l’air raréfié de la langue, un air aussi rare que les passants dans les rues de nos villes confinées.
Du coup, même s’ils nous disent l’effondrement de notre monde, l’étouffement de la culture, l’abaissement général de l’humanité au niveau de la tourbe, le triomphe de l’homme quelconque, et le cimetière des mots, ils le font avec cette langue qui est aussi la nôtre, et qui se remet alors à respirer en nous, comme le cœur d’un malade se remet à battre et la terre à tourner après un accident.
Ils opèrent en ce sens comme certaines expositions qui nous donnent à voir le monde, quand on sort du musée, mais sous un jour différent, comme filtré par les couleurs, les angles d’attaque et de vue, les perceptions et les interrogations de l’artiste que l’on vient de découvrir.
Ces livres sont pour les artistes des réserves inépuisables de formes et de significations, d’images et d’actions, de réponses et de questions, et l’énergie qui circule entre leurs lignes est comme une langue étrangère (tant il est vrai que l’on n’avait jamais lu cela), qu’ils savent aussitôt comprendre comme si elle habitait depuis toujours leur pensée.
La guerre, troisième tome de ce vaste poème épique et énigmatique intitulé La guerre de la terre et des hommes qu’écrit Pascal Bacqué sans discontinuer, est l’un de ces très rares livres.
« Cet homme, peut-on lire sur la quatrième de couverture, dont il faut dire le fait est le vrai maître du cosmos.
C’est à lui que sont redevables tout ce qu’on appela jadis les constellations, puis le monde, enfin ce qu’on appelle aujourd’hui, pour le peu de temps qu’il lui reste, la culture. Il est l’alpha et l’oméga, c’est-à-dire l’alphabet des choses, de leur ordre, l’ordonnateur de la vérité. Il est le vrai principe. Cet homme, c’est l’homme quelconque.
On va dire son histoire. Qu’il n’y ait pas de méprise sur son compte : derrière son nom indétectable, il est le plus redoutable des êtres qui aient hanté la terre. »
Norbert Hillaire
Norbert Hillaire : Je voudrais commencer par une anecdote. Il y a quelques jours, j’ai été invité à participer à un séminaire (un webinaire organisé par des collègues universitaires rennais), sur le thème de la modernité, sujet qui m’intéresse toujours au plus haut point. Je venais de relire cette formidable « cosmologie », par laquelle s’ouvre le tome 3 de votre Guerre de la Terre et des hommes, intitulé La Guerre. Et encore habité par cette joie de vivre et d’écrire qui s’entend et s’éprouve dès les premiers mots de votre livre, j’ai dû déchanter quand j’ai écouté d’abord un sociologue, puis un artiste venu étayer le propos du premier intervenant par la présentation d’une œuvre contributive. Car après avoir rappelé ce long chemin qui va de la Renaissance jusqu’à la postmodernité en passant par l’Art Moderne, ce sociologue, Yves Bony, a voulu nous conduire jusqu’en ce point de rupture auquel les artistes se trouvent aujourd’hui assignés : partagés entre, d’un côté, cette singularité ou cette « originalité », qui définissaient l’artiste de l’art moderne (singularité perçueaujourd’hui comme une pure convention sociale – c’est le mot employé par l’organisateur de cette rencontre – qui se serait perpétuée jusqu’à nous) et, d’un autre côté, l’exigence de retrouver le sens d’un monde commun, qui ferait obligation à l’artiste de s’engager dans une démarche contributive.
C’est là le sens de l’œuvre de l’artiste invité à l’appui de cette sociologie de la postmodernité, Thomas Tudoux – l’artiste n’étant jamais qu’un participant parmi d’autres participants au service des « communs », ou de cette unité qui fait aujourd’hui défaut, mais qui a existé, rappelait le sociologue, à la Renaissance, et qui se chercherait aujourd’hui dans une « postmodernité alternative », ou une « post-tradition » (ce sont là les mots employés par les intervenants).
En les écoutant, je me disais que l’Histoire tournait en rond, et que toutes ces tentatives ne faisaient que consacrer l’épuisement de la culture et la victoire de l’homme quelconque, qui est au cœur de votre livre.
Pascal Bacqué : Oui, il y a comme une pesanteur… Je pense que l’extrême longueur des chemins à parcourir pour justifier les fameuses postures contemporaines (je parle de la longueur, ou de la sinuosité si vous préférez, des appareillages intellectuels) témoigne d’une sorte d’étouffement de la culture par elle-même, de la même façon que l’extraordinaire intelligence qu’elle est censée afficher (car tout cela procède par verrous qu’on déverrouille et chevillettes qui cherront), toute la conscience qu’il faut pour parler à ce niveau de concept révèle, dans son évidente bêtise, le fait que le discours de la culture se tient (désormais ? Ou bien n’a-t-elle pas toujours fait ainsi ?) dans cette zone mi-morte, mi-vivante, que j’appelle la tourbière. Quant à oser qualifier de « pure convention sociale » la singularité, autrement dit le non-quelconque – de même que de chercher ce que vous appelez la démarche « contributive », ce sont effectivement des signaux d’un épuisement extrême des ressources humaines, au moment où elles croient s’être perfectionnées, professionnalisées. Il faut bien qu’il y ait une justice ! Justice, parce que, sous tous les jargons divers dont végètent et prolifèrent les discours, la même haine de la langue, je veux dire la Langue (dont la France n’a connu que le reflet, sur une vitre, ou sur une pierre d’opale, en concevant ce qu’on nomma et tua sous le nom de belle langue) l’opprime et la dessèche.
NH : Cela nous plonge au cœur de votre livre. Ce livre agit à mes yeux comme une mise en suspens de cette culture, et de cette langue assiégée par la haine d’elle-même dans laquelle elle s’est réifiée, cette tourbe dont vous parlez, et qui est au cœur du premier tome de La guerre de la terre et des hommes. Mais, pourtant, il ne s’agit en rien, avec ce tome 3, de retrouver le temps béni d’une prose du monde qui se serait évaporée dans l’air vicié de la tourbière. Il ne s’agit pas non plus d’une révolte, et pas non plus d’un roman. Peut-être s’agit-il du poème d’une voix : quelle est cette voix ? Et où se tient-elle, cette voix qui semble traverser les mots, les temps, les espaces et l’ordre des choses, avec ce troisième volume, par rapport aux deux livres précédents ?
PB : C’est la voix de la Langue, plus que la voix du Poète, que certains, encore animés par quelques souvenirs, appellent de leurs vœux. Le fameux « Poète », celui qui est nécessaire en amont de la pensée (même Platon citait Pindare et Homère), il est tout bonnement absent aujourd’hui. Ce n’est pas René Char, dernier « poète de la république » en remplacement de Paul Valéry, qui va faire l’affaire. Une fois pour toutes, il faudrait déjà entendre que derrière le « poète », plutôt qu’à se lamenter sur la désaffection des éditions poétiques, il faut entendre une tâche, radicalement impersonnelle, du poète, à l’égard de la Langue. Par lui, la langue vit. Il n’est « Le Poète » qu’en tant qu’il donne à la Langue une vie, qui dépasse, enfin, les horreurs de la « communication » dans laquelle toute la prose du monde, littéraire, journalistique, est empêtrée.
Voix du poète qui est donc la voix de la Langue : La langue française, en l’occurrence, au moment où il est possible qu’elle ait été achevée (comme on achève un cheval blessé, ou un chien galeux).
Je ne dis pas là ce que je fais, mais ce que je veux faire. Qu’ensuite, il soit dit que je l’ai fait ou non, ne m’appartient pas.
Dans le premier tome, il était question de repartir de l’Histoire et de ses lambeaux de mythes, tantôt fictifs (le Seigneur des anneaux), tantôt réels (les trois grandes nations maîtresses de l’idée d’Europe – Angleterre, France et Germanie – et son effondrement dans la deuxième guerre mondiale). Et de montrer – enfin, non, pas de montrer, de chanter que cela était de toutes façons joué depuis toujours, depuis que le paradigme du monde était cette tourbe, soit cette mort, ou cette satisfaction, ou cet arrêt, ou cette institution, appelez-le comme vous voulez. Dans le fond, jusque dans son culte ancien des créateurs (remisé par les espèces de professeurs que vous évoquez), la haine de la Création, laquelle ne signifie rien d’autre que cet impossible (mais vrai) : l’advenue du pur nouveau. La sainte horreur du nouveau, déguisée dans toutes les ruses que la culture sache sécréter. Cela, dans le tome 1, se racontait par le vol du bâton d’Elias (l’homme du nouveau, l’homme de l’effraction d’un dehors dans la tourbière) par son frère Hermann, l’homme de l’institution, l’homme de l’Empire.
Ici, dans le tome 3, il s’agit de saisir le mouvement de négation de la Création à son point maximal, à son moment d’hybris. C’est-à-dire que la massification de l’homme est totale, que son enfermement dans le réseau est absolu, qu’Internet n’est en cette matière qu’une cerise sur le gâteau parce que le World Wide Web est aussi vieux que l’Occident – souvenez-vous du surnom de Louis XI, l’Universelle aragne – mais que désormais, toute sortie hors de la tourbière est interdite. C’est le règne de « nous tous ». (Je dois dire que je l’expérimente sur moi-même, y compris avec la façon dont mon livre est reçu par l’institution littéraire. Le grand peintre Bonnefoi résume cela de façon plaisante : « la censure social-démocrate procède par étouffement. »)
Reste la sortie toujours possible, l’effraction. Il n’est pas d’autre définition de la beauté. Cette sortie, je la tente avec deux séries de personnages, dans mon tome 3 : avec le quatuor, qui sont quatre grands esprits « occidentaux », qui appartiennent à cet Occident dont tout mon cycle raconte l’éternelle malédiction ; pour prendre la mesure de cette Histoire, ils sont invités dans un « monde à l’envers » ; et avec « Léa B., fille de Pascal B. », qui écrit une sorte de journal intime (un journal de jeune fille comme on disait jadis) de nos terrifiantes mutations en forme d’arraisonnement généralisé. Reste que la Langue, c’est-à-dire la terre, peut toujours, doit toujours rejeter cette gangue. C’est le poème qui monte tout au long du livre, et qui s’appelle, par dérision, Collapsologie. 70 « versets », soit une forme d’écriture poétique que j’invente, fondée non sur une régularité des syllabes mais des mots, 70 mots par verset divisés en deux – parce que, à l’instar des rimes d’idées bibliques, le rythme est moins celui des syllabes que celui de la pensée. Il ne faut pas moins qu’un art poétique pour conjurer cette malédiction.
NH : Entre le tome 1 et le tome 3, il y a le tome 2, que vous n’évoquez pas, peut-être parce que c’est le plus personnel – Étranger parmi les Vifs – qui explore cette étrangéité qui est au centre de votre aventure poétique, laquelle commence très tôt, mais trouve dans l’étude de la Tora et du Talmud, une résonance, une amplitude comparables à celle que le Christianisme a pu représenter pour un Claudel, mais d’une manière toute différente et peut-être même opposée. L’étude juive n’est pas pour vous une source d’inspiration, mais le lieu d’un renversement : ce renversement de la religion juive elle-même en invention, qui définit selon vous cette religion, et qui se manifeste à travers l’énigme du verset, cette unité qui admet plusieurs niveaux de sens, et qui semble condenser dans son énoncé des possibilités infinies d’extension de ce sens – verset qui, de ce point de vue, consonne avec l’expérience poétique, mais qu’il faut soigneusement distinguer du vers, et même de ce vers « déversifié » qui vient après la « crise de vers » mallarméenne et se répand peu ou prou sur tout le 20ème siècle, des calligrammes d’Apollinaire et des premières avant-gardes jusqu’à nous.
C’est en ce point que l’inventivité poétique, la Langue et la terre (au sens acosmique où vous l’entendez, nous y reviendrons) se rencontrent : car le verset, dans son énoncé littéral qui peut faire parfois l’objet d’une lecture naïve ou d’une attention flottante est en réalité en dehors de l’Histoire (y compris de ces bégaiements ou de ces prophéties autour de la fin de l’histoire de l’art, qui viennent après les avant-gardes du haut modernisme) – une source inépuisable d’invention, non seulement dans la langue, mais aussi dans la vie (l’étude du Talmud est cette fraîcheur du sens qui intensifie le présent, et fait de chaque jour un jour nouveau) : du coup, l’Histoire contemporaine n’est pas absente de cette aventure poétique, et on la croise à tous les carrefours de votre livre, mais il faut la comprendre comme une Histoire qui marche à l’envers, ou une Histoire que l’on rencontre sous la forme de ces chocs, de ces éclairs de vérité, ou de ces « instantanés », comme on disait avant le numérique et l’iPhone, qui altèrent l’idée d’une continuité de la mémoire ou de la narration romanesque (comme fait Breton dans Nadja), et qui faisaient dire à Walter Benjamin que la photographie était la formule nouvelle de la connaissance historique. Quand on sait l’importance prise par les thèmes de l’expérimentation et le culte du nouveau dans les arts modernes et contemporains, on ne peut qu’être intéressé, et même frappé, par une telle approche de l’invention du sens, en ces temps difficiles pour la création.
PB : Pas seulement le verset. Il en va de même exactement dans une ligne de Talmud que dans un verset. Ce qui est troublant, et même sans doute effarant, c’est que les thématiques de la création, et du Nouveau – qu’il soit baudelairien, ou rimbaldien – sont pour l’étude juive de toute époque une espèce de truisme, d’évidence inutile à formuler – et cela, sans qu’elle ait besoin d’arborer ni posture, ni conscience de soi, ni radicalité, sinon celle qui consiste, justement, à faire une confiance intégrale à la source primitive où puisent tous les renouvellements ultérieurs. Mais brisons-la sur cette matière : elle a quelque chose de proprement impossible au mélange avec la culture. Non que la culture ne puisse croire qu’elle s’en empare : c’est seulement que sitôt qu’elle est prise (au sens de capturée), l’étude n’est plus l’étude. Elle radote, comme l’université. Ce n’est donc plus l’étude. À vous faire enrager.
En revanche, comme je suis beaucoup plus saisissable qu’elle, je ne puis nier que j’ai tenté de faire lieu, dans mon écriture, à mes faibles et lointaines perceptions de l’étude juive. Faire lieu à ces perceptions, où je m’essaye au plus d’art avec la langue française – plus d’art, plus de langue, au lieu même où, dans mon esprit, la langue française est le plus désinvestie de son rôle de structure originelle, et donc de réservoir de toutes les pensées. Si vous me suivez, la langue est première pour tout être parlant : or, l’étranger parmi les vifs, titre du tome 2 et fonction définitoire du narrateur, c’est celui qui vient inscrire, au fond de lui-même, cette irradiation de l’intelligence vive – par vive, entendez juive en tant que ce renversement, dont vous parlez, y opère – et donc destituer, fragiliser, voire mettre en danger la leçon, en lui, de sa langue. Je ne vous cacherai pas que cette irradiation pourra sembler, littérairement, un suicide ; il n’est que de frôler la langue contemporaine, écrite ou orale (comme on dit « enfer ou ciel, n’importe ! ») pour s’en persuader. L’étranger, autrement dit, c’est le crétin de français en moi – je ne dirais pas que c’est une bonne leçon pour la satisfaction hexagonale, parce que je ne donne là nulle leçon, n’étant pas professeur. Du même coup, la langue irradiée qui est la mienne est en danger de n’être pas partagée par nombre de ceux de la tribu, pour paraphraser Stéphane Mallarmé, le gréviste de la société. Mais du même coup, je peux encore être poète, enfin, le vouloir si je puis dire, « sérieusement », sans justement me mettre en grève de la société, sans écrire le coup de dés ou l’aboli bibelot d’inanité sonore (si parfaitement compris par Jean-Claude Milner) – car le bibelot est, si je puis dire, étrangéisé avant que d’être aboli.
NH : Ce faisant, vous déplacez toutes les lignes, qui forment l’arrière-plan sur lequel se déploie l’horizon d’attente – morne plaine – des relations coutumières de l’art et de la culture : et c’est un autre paysage qui se dessine alors entre la langue source et la langue cible, entre cette langue irradiée par l’étude et la langue française.
Votre art n’est pas (ou pas seulement) « l’autre » de la culture, au sens où les artistes, écrivains ou poètes des premières avant-gardes jusqu’à nous, ont voulu le manifester (et le XXe siècle aura été le siècle des manifestes en tout genre), selon les formules et les postures les plus diverses.
Et c’est en ce sens que votre entreprise est à nulle autre comparable. Car cette étrangéité est double – étrangéité à sa langue et étrangéité à la langue de l’étude.
C’est sur cette arête fuyante que se déploie alors, comme dans un hors-champ de la république des arts et des lettres, cette écriture qui échappe à toutes les catégories (des plus académiques ou plus transgressives, des plus formalistes aux plus « pures ») : mais, curieusement, depuis ce hors-champ, quelque chose surgit, là, devant nous (de non médié – mot affreux – par les pesanteurs du roman), comme un tableau, un poème, ou un chant qui nous place directement dans le champ : anthropocène, cafés, écologie, triomphe du Mac, écrivain célèbre, Gaïa, monde de l’édition, CélinetProust : tout est là, mais comme irradié par une autre lumière, qui viendrait percuter notre culture contemporaine de plein fouet, au point de la rendre méconnaissable à force d’avoir cédé si complaisamment aux injonctions du reconnaissable. Comme si le jet continu de la doxa digitale qui nappe le monde de cette fine pellicule mi-vivante, mi-morte que vous nommez la tourbe ou l’homme quelconque, avait fini par produire en retour, terre et écriture mêlées, et comme indiscernables, un sursaut, une révolte tectonique des mots, le choc violent de la terre qui vomirait son passé. Si bien que nous ne sommes pas, avec ce livre, du côté de Gaïa, de la crise climatique, ou de la seule responsabilité envers les générations futures. Ou plutôt, nous y sommes aussi, puisque c’est la petite Léa qui sauve le monde, mais grâce à son cahier qui aurait surnagé par-dessus le temps et porterait, avec les traces de ce passé qu’il contient, les chances de son renouveau. En somme, votre intention sotériologique procède aussi bien d’une responsabilité envers les générations futures qu’envers les générations passées. Toujours la question du nom. Le salut de la planète est indissociable du salut de la langue.
PB : Permettez-moi de dire ici que vous avez tout dit. C’est parfaitement compris. Je vous remercie.
NH : Du coup, votre livre est peut-être un suicide littéraire, mais certainement pas un suicide poétique. Tout y passe (c’est votre côté Pollock, All over), mais pas comme passent les jours et passent les semaines sous le pont Mirabeau, car, dans ce fleuve, des éclairs de sens se déposent ça et là, engrammés dans une profondeur qui échappe au narrateur, comme à l’auteur ou à ses personnages, un sens dont la lumière vacille et scintille au présent de la lecture, mais un sens qui se tient aussi en réserve dans son excès même : c’est donc un livre plein d’avenir, car son énigme est généreuse. Et c’est pourquoi, sans doute, votre œuvre intrigue. Comme cette énigme qui viendrait perturber le lent et sûr épuisement de la langue à travers une littérature qui se contente de célébrer ses morts annoncées, par exemple dans le mariage de l’autofiction et du care ordonné par le marketing, ou alors l’éternel ressassement de ses monstres sacrés, comme Céline et Proust. Sans parler de la prose entendue et contenue dans les strictes limites de l’attendu d’un Houellebecq, dont la rencontre avec le narrateur nous vaut l’une des scènes les plus incroyables de votre Guerre. Comme le dit une journaliste, on vous connaît, même si on feint de vous ignorer…
PB : Cela pose la question, encore une fois, du « on », soit de l’homme quelconque. Cette question va largement au-delà de mon petit problème personnel. C’est toute la question du lent remplacement (comme, vous savez, on dit que l’eau très pure contenue par les tourbières est progressivement, si je puis dire, « dévorée » par la végétation, de sorte qu’il n’en reste plus ; je vous propose de tenir pour essentiel, par opposition au « Grand Remplacement » des amateurs d’anecdotes et d’eschatologie narcissiques, le « Lent Remplacement » de l’Intelligence par la bêtise – saint Flaubert, priez pour nous !), dans la parole, de toutes ces traces scintillantes de l’esprit poétique, jetées en poussière de fée (pour ceux qui ignorent cette métaphore, merci de se reporter à Peter Pan de James M. Barrie), parfois, sur les romanciers (sans les Rimbaudellarmé, pas de Célinéproust), par la nullité si satisfaite de la langue que je peinerai à dire de la doxa culturelle, tant elle est partagée, dans une égalité parfaite, entre les écrivains, les journalistes, les sociologues et les politiques. Un même goût absolument mortel pour le déjà pensé, le déjà dit ; ces révoltes qui singent les révolutions comme les Badioux singent les Sartre, comme les damnés de la terre singent les juifs, comme les écrivains germanopratins singent les banlieusards, croyant trouver dans cette conscience, si satisfaite, de leur « posture », une espèce de gage de salubrité publique bientôt estampillé par Télérama ou France Culture, délégués au rôle du curé confesseur en l’absence d’un clergé retenu au tribunal… Cela appartient en effet à une vision du monde où tout est d’ores et déjà donné, où le ressassement du même est le fait d’un monde dont on sait tout, parce qu’il est entièrement clos… sur son infini, lequel infini ne se conçoit jamais que comme dilatation sans fin des data (comme tout big bang, mythologique). Extraordinaire aventure que celle qui se sténographie du nom de Spinoza (je me moque de l’œuvre, c’est son image qui m’importe, ici), et qui s’est rêvée ou mythifiée, à travers cette immanence qui nous débarrassait enfin de l’irruption d’un dehors dans nos esprits – immanentisme dont Spinoza fit son baiser de mort à la philosophie qui l’avait bien cherché. Au fond, le juif (ou sa figure) servirent, mis au service de la culture qui le lui rendit en persécutions diverses quoique séculaires, à l’empêcher de devenir complètement spinoziste, en la bousculant dans son système clos (infini ou non, cela ne change rien ; la même bêtise de mille kilomètres carrés ou de mille infinis carrés reste la même bêtise), en giflant le monde de son étrangéité. Il semblerait moins disponible pour cette tâche, ces derniers temps – requis ou investi par sa medina.
En revanche, pour la culture, c’est-à-dire pour la culture comme affirmation positive, voire conquérante – et pas seulement comme visage de la réalité – c’est-à-dire pour l’Europe (je ne parle ni du territoire, ni des institutions, mais de la foire d’empoigne qui a résulté de son exposition au juif sous forme de Christianisme, autre synonyme), la conséquence évidente est celle-ci : embarrassés désormais de nos langues antagoniques (qui, je le répète, sont ou font, ou plutôt furent ou firent la vraie Europe, car disons-le : l’anglais, l’italien, « l’allemand », le russe », le français , etc. autrement dit les langues à leur maximum d’intensité et donc de rivalité, furent la seule existence réelle de l’Europe), nous, Européens, sommes condamnés à vomirnos souvenirs de gloire intellectuelle, artistique ou politique, sans pouvoir remplir nos estomacs lassés de quelque autre nutriment. Tout au plus pouvons-nous, la tête baissée, écouter Elon Musk, en guise de prophète de maître Xi et Donald Biden ici conjurés, nous promettre pour 2030 (vous avez remarqué que tout le monde s’acharne sur 2030, du prince d’Arabie à tous les start-upers de Frisco ?) que la fin du langage est pour tout bientôt, mais voui mais voui, les implants cérébraux étant beaucoup moins coûteux que l’effort de bien dire !
NH : Adieu au langage, donc – comme le titre de l’un des derniers films de Godard ! Un dernier mot, quand même : j ’ai fait tout à l’heure référence aux manifestes. Dans leur manifeste, le tout dernier sans doute des dernières avant-gardes, Les Nouveaux Réalistes prennent acte de leur singularité collective. Je cite cet extrait du manifeste, rédigé par Pierre Restany : « Le jeudi 27 octobre 1960, les Nouveaux Réalistes ont pris conscience de leur singularité collective. Nouveau Réalisme = nouvelles approches perceptives du réel. » Les signataires de ce manifeste sont Arman, Dufrêne, Hains, Klein, Raysse, Spoerri, Tinguely, Villeglé et Restany. Plus tard, César, Rotella, Niki de Saint-Phalle et Christo se joignent au mouvement.
Il est intéressant de souligner que ce soit à Yves Klein – chez lequel eut lieu d’ailleurs cet acte fondateur du mouvement autour de cette idée de singularité collective – que l’on doive Le Saut de l’Ange, performance risquée dans laquelle on peut voir comme un dernier acte du programme avant-gardiste.
Et qu’après, ce que l’on appellera alors l’art contemporain, entrera dans une nouvelle phase, dans ce que j’appelle un duchampisme généralisé, soit cet éternel grand écart, dont nous parlions au début de cet entretien, entre l’aspiration à la plus profonde singularité et cette aspiration contraire à se fondre dans le Commun, à défaut de l’Un.
Pourquoi ce saut de l’Ange ? Que viennent faire les anges là-dedans ?
Lors d’une récente séance d’étude avec Gilles Hanus, nous relevions, dans un verset du Lévitique, que Moïse voit YHVH avec des séraphins, comme pour lui dévoiler à lui, Moïse, avec ce signe, les conditions d’un rapprochement (Korban) avec lui, YHVH. Et le verset nous dit que ces anges s’appellent l’un l’autre pour former un chœur, ce chœur s’entendant dès lors, comme relève ou condition de leur singularité dans une unité supérieure, une singularité collective en somme. Il faut être absolument singulier, à condition que ce singulier soit tout le contraire d’une fermeture sur soi, si c’est encore possible.
PB : Oui, l’idole ultime tapie au cœur de la pensée du singulier, c’est le singulier lui-même, ou tout au moins (car le singulier ne l’est jamais qu’à vif, exactement au vif du sujet, c’est-à-dire au vivant que le sujet fait advenir en soi, par l’exposition, justement, à la nouveauté) le sujet qui portait, l’instant d’avant, l’heure d’avant, la décennie d’avant, en hypokhâgne (alors qu’il est maintenant caïman), enfant (alors qu’il est maintenant un peintre célèbre) le fin trait de lumière qui l’allumait, l’animait, le vivifiait. Ensuite, « il », le sujet, l’individu, l’invité de France Cu, s’est exploité, a cédé, comme on dit, à ses « obsessions », et a construit son « discours ». Cette pitoyable idolâtrie de soi, sans aucun doute, est une punition du Romantisme – et croyant en sortir, puisque l’art contemporain s’est cru déromanticisé, elle y enferme sans espoir de retour. De Retour du vif, de Retour du nouveau, de Retour de la surprise… de Retour de l’Ange. C’est sans doute trop demander à un artiste, que de lui demander ce qu’on demande à d’autres, d’exister si je puis dire en singuliers collectifs. La preuve, c’est que sitôt fait, dans l’art, et voilà en lieu et place du singulier, le dogmatisme qui est sa négation même. Surréalisme, etc. Du même coup, le corps social est travaillé par son irrémédiable échec, à moins d’une société d’anges, ce qui, vous en conviendrez, n’est pas tout à fait à l’ordre du jour (nous n’allons pas confondre, avec la meilleure volonté du monde, l’humanité augmentée avec des anges ; d’ailleurs, les génies sino-américains qui croisent les gênes chimpanzés avec les gênes humains pour le meilleur des mondes possibles ont le bon goût de les nommer des chimères ; voilà qu’en s’emballant dans le dernier refuge de la volonté de puissance, ils redeviennent lyriques). Mais je dirais que cet échec est une ouverture à une sortie, à un déconfinement toujours demandé, toujours espéré, et que cet espoir, maintenant, est la condition de toute grande aventure humaine possible. Voilà exactement ce que nous interdit notre gigantesque bulle close, notre société infinie ou illimitée, ou, comme l’avait bien dit Jean-Claude Milner dans les Penchants criminels de l’Europe démocratique, Judenrein. Vide de juifs – vide de vifs. Ce ne sera pas cet extraordinaire vase clos, si petit, si gigantesque et si petit en même temps, si consanguin (maintenant que nous sommes mondialisés), si radoteur, si gâteux, qui s’étale de mot d’ordre en mot d’ordre, de lieu commun en lieu commun, de révolte en révolte, d’outrage en outrage et d’installation en installation, ce ne sera pas cette immense paresse collective et obligatoire qui nous donnera le sentiment de vivre, ni même, hélas, de mourir. Semblables à la Charogne de Baudelaire « qui vit en se multipliant », notre corps social demeurera le piège horrible qui s’est mieux révélé que jamais, avec ce virus. Même la contestation et la radicalité sont digérées, désormais, et c’est pourquoi elles crient d’une voix assourdissante. Alors un saut hors de la tourbière. Cadeau pour quelques-uns. Cadeau pour celui qui l’invente. Et le reste est littérature, c’est-à-dire, dans le fond, recherche du temps perdu.

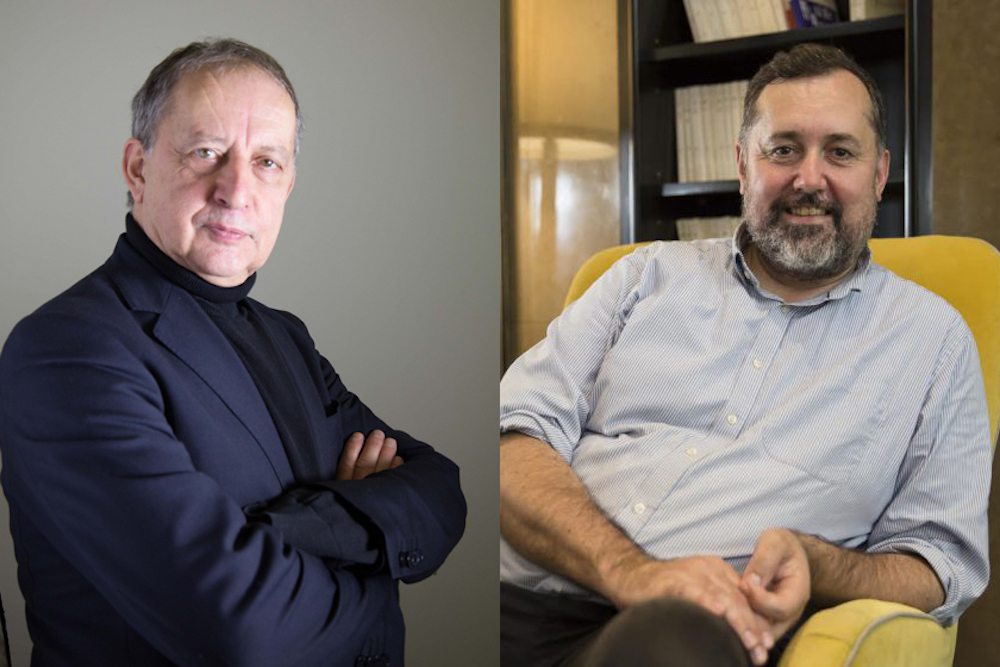
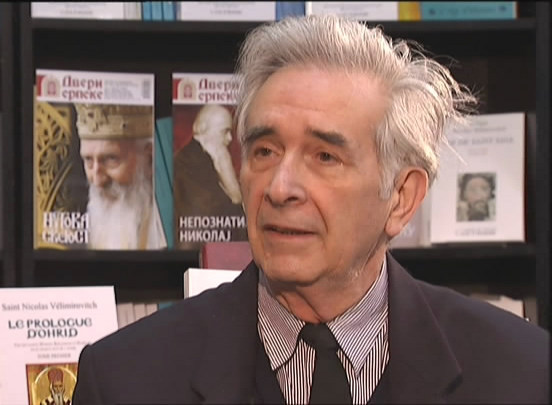




Ce que vous déplorez, c’est le « Age of Entitlement » qui, comme nous pouvons espérer parce qu’il semble assez logique, précède le « Age of Enlightenment ». Oui, les textes spirituelles éternelles nous donnent un répit au dehors des « âges » en nous réflétant notre propre nature éternelle – une certitude qui me console et m’assure face à l’effondrement de notre culture …