Personne, dans la littérature contemporaine, ne se sera aussi diversement créé que Philippe Sollers, européen d’origine Française, vénitien de Bordeaux, aérien maritime, fumeur de grande santé, catholique-libertin… Personne, surtout, n’aura autant de fois recommencé son œuvre : adopté tant de formes, épousé des styles aussi variés, repris les choses à zéro avec une telle constance, cherché à fonder l’écrit depuis des sources si hétérogènes. Depuis Une Curieuse solitude, roman de la complétude du plaisir, au Graal de la fin, en passant par la ponctuation omni-absente de Paradis sur fond de prophétie réinventée, le vrai-faux célinisme métaphysique de Femmes, le panthéon athée de la Guerre du goût, les mille et une Venises, les Chines incorporées, le calme plein d’attentes, le Nouveau plein d’histoire, les langues mêlées de Nombres, les écoles sans maîtres de Mozart et de Casanova, peu d’œuvres se seront à ce point efforcées d’exprimer le même depuis la différence.
Et pourtant, d’où nous vient cette impression flottante, pulsatile et volage, d’entrer en sollersie quand nous lisons Sollers ? Je ne saurais le dire, sinon par hypothèses.
1) Une histoire de quête. C’est le mot de Barthes, dans Sollers écrivain : « Sollers refuse d’hériter, sinon de l’inhéritable ». Drôle de bénédiction : voilà un homme qui goûte à l’odeur d’idée d’avant-garde, qui entreprend d’en finir avec le verbe-représentation, voilà quelqu’un qui sait ce que le mot Cézanne veut dire, voilà un jeune d’ailleurs et de demain – et pourtant empreint d’une histoire qui l’engage, suffisamment pour qu’il se confronte au don d’inhériter.
Sollers en révolutionnaire permanent de sa propre écriture : un auteur en fusion, qui aurait passé sa vie à questionner le point absent de la littérature. Qui aurait poussé jusqu’au bout la logique de Gracq : refuser le prêt à porter d’un style pré-donné, partir sans fin à l’assaut d’un rythme où respirât son souffle. Pour ce faire, tels ces explorateurs assoiffés d’horizons, comme ces forestiers qui n’aiment les chemins qu’à condition de les improviser, il aurait embrassé le rêve d’une écriture qui voyage à l’intérieur d’elle-même. On trouve, dans son œuvre, à peu près tous les genres : des textes expérimentaux, debout dans l’oralité et retrouvant la langue dans ses brisures mêmes, des textes donc sans ponctuation, mathématico-lyriques, puis hyper-ponctués, puis politiquement engagés par la littérature, renouant ici ou là avec un semblant de classicisme, celui des plaisirs et des formes, des biographies mêlées de rêves, d’autres livres encore, musicaux silencieux, picturaux par les ombres, méta-méta-∞-littéraires, libertins, religieux. Il s’agirait d’une totalisation par fragments cumulatifs, avalanche toujours recommencée et toujours en mémoire.
Sollers comme un auteur pour qui chaque livre suscitait l’occasion d’une nouvelle vie, début autant qu’adieu, naissance et mort mêlées, dans une hauturière aventure où l’écriture, travaillée par sa propre négativité, s’engagerait en haute mer contre les vagues de la répétition. N’est-ce pas le sens même des propos qu’il tient dans Une Conversation infinie, ce livre empli de densité où se cristallisent tant d’intenses conversations avec Josyane Savigneau : « Je n’ai aucune peur de la mort. La mort ce n’est pas le mourir. Le mourir c’est ce qui infecte la pensée depuis très tôt, ça dépend des dons qu’on a pour comprendre qu’on est un animal mortel. » ? N’est-il pas là, le mystère – dans ce refus de mentir, dans cette conscience accordée à la mort plutôt qu’à l’esprit du mourir ?
2) Sollers en lui-même. Je veux dire l’auteur dans sa cohérence et sa continuité. Car il y a malgré tout, dans son œuvre, des intuitions maîtresses, des échos directeurs. L’amour intransigeant de la liberté. L’athéisme de tout et poussé jusqu’à son estuaire : aimer le Dieu qui aime. La catholicité de sa culture, donc, mais réconciliée avec les élans de la chair. La croyance inexorable en la singularité et ses déclinaisons politiques, musicales, physiques : 68, Mozart, Tiepolo. Une esthétique de l’amour, aussi, exprimée dans Du Mariage considéré comme un des beaux-arts, le livre qu’il coécrivit avec Julia Kristeva, et dans ses Lettres à Dominique Rolin. Le magnétisme des lieux qui flottent en leur formule, des villes-mers, des sols-cieux : Venise, Bordeaux, New York, Ré, sans compter l’Angleterre. Une légèreté qui vole avec le poids. Une mémoire pleine de muscles. Un auteur de l’instinct caché derrière un érudit caché derrière un gai lecteur caché derrière un éditeur caché derrière un écrivain caché derrière un personnage caché derrière un auteur de l’instinct caché derrière… – et ainsi de suite dans un impénétrable jeu de diallèles, de miroirs et de masques.
3) Sollers, auteur de l’éternel recommencement ou bien d’une même et longue phrase prolongée de livre en livre – voire, comme il l’écrivait à propos de Joyce, d’un unique mot, « un seul et immense mot », « un mot bourré de mots, et à vrai dire un nom plein de noms mais ‘‘ouvert’’, en spirales » ?
Et si la sollersie échappait à cette alternative ? S’il s’agissait d’autre chose ? Précisément, de déplacer le temps ?
Car Sollers et le temps…
J’ai rencontré Sollers à l’occasion d’un entretien qu’il accordait à La Règle du jeu, dans le petit bureau, Nautilus enfumé disait-il, qu’il occupait chez Gallimard. C’était par une belle journée de printemps, avec Florent Zemmouche et Avery Colobert. La première image qui me revient de lui, c’est que Sollers riait à peu près autant qu’il parlait. Il riait entre deux remarques, deux citations, deux questions, comme en aposiopèses, d’un rire comme je les aime, sans motif rigide, un rire non mécanisé, non figé, qui refuse de se cristalliser en blagues.
Je crois donc qu’il riait lorsqu’il nous dit ceci : « Il n’y a qu’un seul écrivain, parfois contradictoire, parfois en lutte avec lui-même, qui agit au rythme du défilé des siècles, et écrit à travers les écrivains contingents, ponctuels. Écrire, ce n’est pas raconter sa petite vie, ajouter un livre de plus au marché des marchandises culturelles, livrer ses souffrances, mais c’est s’inscrire dans le flux de parole de l’unique écrivain, à la fois identique et différent (c’est le même, et ce n’est pas du tout le même), qui traverse le temps. Il faudrait peut-être écrire cet écrivain archi-originel avec une majuscule : l’Écrivain. (…) Voilà le mystère fondamental de la littérature. »
La sollersie, ou la volonté d’écrire à partir de soi, mais en direction de cet éternel Écrivain. L’expérience, autrement dit, d’une unité de la littérature. L’invention d’une durée autre, sans avant ni après, sans futur ni passé, où les paroles se mêlent. L’idée que les auteurs ne sont rien que des phares, qui se relaient une lumière unique. Le recueil de la lumière des autres – et puis la transmission vers de nouvelles altérités.
Ce thème, dira-t-on, vient de Baudelaire. Et puis surtout de Proust. Oui mais… Proust le trouve chez Schopenhauer, autrement dit chez le penseur par excellence de l’annihilation, de l’effacement, du refus de soi-même. Proust l’horrifié du nombril, effrayé à l’idée que les fleurs puissent s’aimer. Proust dont Sollers a bien dit quel était son organe princeps : la jalousie – le plaisir de désirer souffrir.
Or Sollers, c’est l’inverse. « Nietzsche » contre Schopenhauer. Exaltation de l’idiosyncrasie, art vibrant, transduction permanente, plaisir du plaisir éprouvé, sensation contre la perception, écriture par le grand soi du corps.
Comment un auteur de l’irréductible singularité peut-il adhérer à l’idée que les auteurs communient ?
La plus belle page, à mon sens, écrite par Sollers se trouve au début de la Théorie des exceptions. Je la cite entière :
« J’ai toujours rêvé d’un espace mouvant et contradictoire où l’on verrait apparaître, de l’intérieur, au moment même où il a lieu, le geste de la création.
Là, pas de temps, j’imagine, ou alors le temps vraiment retrouvé : Montaigne est contemporain de Proust, Sade de Faulkner, Saint-Simon de Joyce, Watteau de Picasso, Webern de Bach. L’ancien et le moderne se confirment, s’éclairent, se multiplient l’un par l’autre. Homère et Freud sont simultanément nécessaires. Mais aussi la Bible et Les Demoiselles d’Avignon.
Ce rêve est possible. Il suffit de se situer d’un coup dans le système nerveux de la parole en acte, du trait et de la couleur, de la mélodie et du rythme. C’est chaque fois le même corps qui se révolte contre l’évacuation hypocritement silencieuse des corps. C’est l’individu extrême, l’élément indivisible, qui affirme être la seule réalité vraie, la pointe ultime du réel. Loin de justifier le flux biologique d’où il sort, il le cerne du dehors, le marque, le juge, l’anéantit, l’oublie. Exception : telle est la règle en art et en littérature, d’où, périodiquement, les scandales moraux, les embarras légaux, les remous sociaux. »
Récapitulons : l’auteur de ces lignes, nommé Joyaux (ce qui étincelle seul) par la naissance, a voulu s’appeler Sollers. Tout entier art, certes, mais aussi l’entièreté de l’art. La volonté d’héberger en son œuvre l’écho universel de la littérature, celui de Dante, de Bataille, de Céline, de Proust, de Rimbaud de Nietzsche, de Freud, de Joyce, de Heidegger, de Saint Thomas, de la Bible, de Voltaire et de Sade, d’Homère et de Casanova – leur accorder, non l’asile, mais l’irradiation d’être lus et d’avoir transmis.
Sollers reprochait souvent aux écrivains du jour de ne pas lire assez. Lui aura poussé jusqu’à son paroxysme l’intuition d’Oscar Wilde : the critic as an artist, the artist as a critic. Write-reader et read-writer à la fois.
Sollers aurait-il dépassé le thème, cher à Roland Barthes, de la mort de l’auteur pour penser et pratiquer sa transcendance ?
Telle est, me semble-t-il, la grâce profonde de ses derniers livres. On ne sait jamais, au juste, qui s’exprime en l’auteur : est-ce Sollers lui-même ? Un « je » voisin, hétéronyme aux semblables réflexes, un essaim d’Identités Rapprochées Multiples ? Mais pourquoi, en ce cas, cette impression que des revenants se glissent dans la conscience du narrateur, s’insinuent dans sa voix ? Pourquoi a-t-on le sentiment de lire une œuvre magnétique, semblable à cette chaîne d’inspiration qu’évoque l’Ion de Platon – à ceci près que, contrairement au rhapsode, la voix des écrivains exprime celle des autres sans cesser d’être elle-même ?
A ce titre, l’un des livres les plus novateurs de Philippe Sollers est peut-être Désir. Ce roman commence comme une biographie de Louis-Claude Saint-Martin, penseur illuministe du XVIIIe siècle. Mais très vite, le récit traverse les générations, les siècles, les époques, jusqu’à atteindre la nôtre. Le Philosophe cesse d’un personnage. Sa biographie bave, son histoire devient contemporaine, sa voix déteint sur celle du narrateur : il est devenu une instance saturée, à la fois source et objet du récit, partout là et jamais ici. Ce jeu de lumière n’a rien à voir avec l’idée naïve de l’immortalité. C’est un roman de réverbération : la volonté, expansive et pourtant décentrée, de voyager le temps.
Sollersie, ou la possibilité d’un continent dont le sol est mobile.




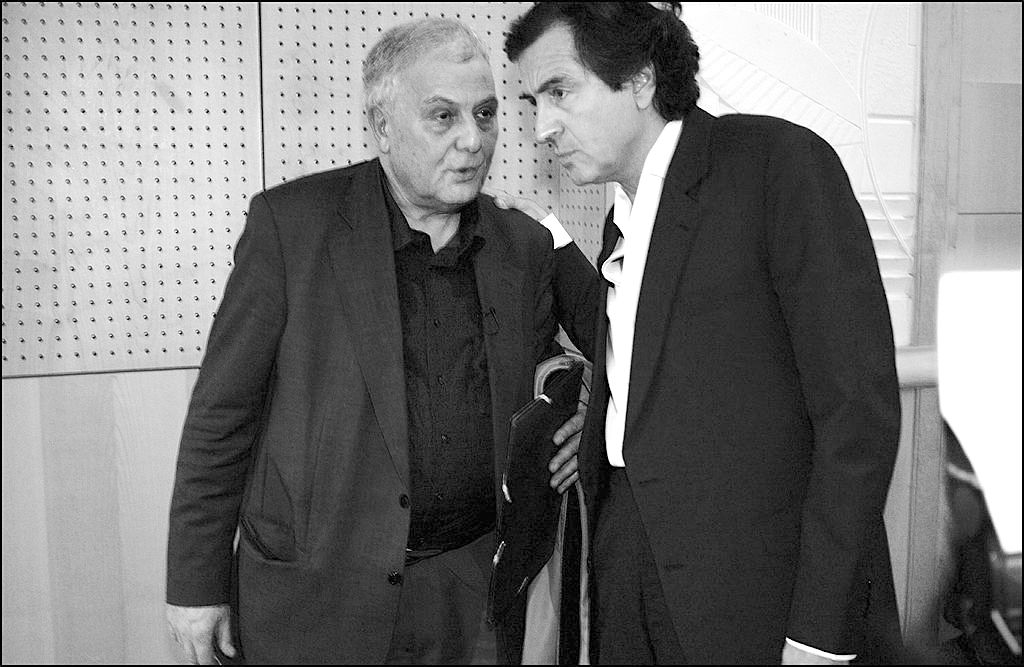



Magnifique hommage.