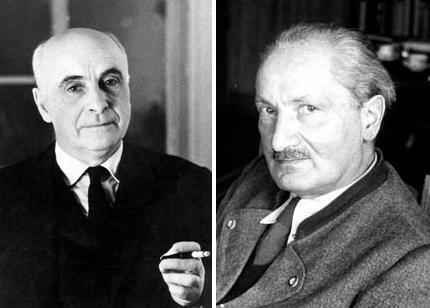Il y a une énigme Celan.
Non pas celle, assez rebattue, de son suicide, à 50 ans, dans les eaux grisâtres de la Seine.
Mais celle, à la fois plus opaque et plus glorieuse, de son inaltérable aura.
L’énigme, si l’on préfère, de la coexistence, sous un même nom, d’une poésie réputée difficile, sanctuaire cryptique pour initiés, et d’une célébrité de légende.
Logique, sans doute.
Car le XXè siècle, et ses abîmes d’épouvante, se sont incrustés dans la Lyrik de ce natif de Bucovine, qui ripostait par une «contre-lyrique » à tous les embrigadements de l’enthousiasme.
Ceux qui lisent sans relâche sa poésie reconnaissent sa signature, comme on identifie sans peine la voix d’un proche qui passe à la radio. Le rythme singulier de cette poésie, sa résonance, la précision troublante de son jeu d’images, et cette « respiration octroyée par la grâce de l’irrespirable » analysée par l’écrivain et critique Jean Starobinski, forment autant d’exceptions dans la littérature de langue allemande. Des exceptions qui ont fait de leur auteur le plus grand poète germanophone depuis Rilke.
Où réside l’énigme de sa puissance de commotion, sinon dans le pressentiment et le souvenir de l’horreur nazie ? Survivant de la Catastrophe, Paul Celan, né en 1920 à Czernowitz en Bucovine, s’est efforcé d’arracher l’allemand, sa langue maternelle, à sa part de noirceur ; il s’est mis en quête d’une Allemagne soustraite aux vertiges qui l’ont jetée dans le désastre ; il a cultivé, en somme, l’utopie d’une germanité alternative, affranchie de l’ « idéologie allemande » et de ses spectres völkisch – l’utopie, plus précisément encore, d’une germanité capable de fusionner en un creuset réparateur les sonorités de la langue allemande avec l’hébreu et le yiddish, langues plus aptes que celle de Goethe et de Novalis à dire l’exil et l’inappartenance.
Mais cette recherche d’une autre Allemagne s’est avérée inséparable, pour le poète, d’une rupture philosophique et poétique avec l’essentialisme qui a pavé le chemin des camps d’extermination. Qu’entendait Celan par cet impératif ? Quel était ce règne de l’essence, cette hégémonie de l’antique et mutique Seyn, dont il cherchait à ébranler le joug ?
« Je ne vois pas de différence entre une poignée de main et un poème », avouait-il dans une lettre à son ami Hans Bender, en 1960. Et pour cause : plus on scrute cette trajectoire hantée par le deuil et la culpabilité, plus la question de l’Autre se dévoile comme une obsession récurrente, comme un fil rouge.
Cap sur l’utopie
Lors d’une circonstance officielle, le fameux discours de Brême, prononcé en janvier 1958, Celan a complété l’image de la « poignée de main ». Cette fois-ci, c’est une autre métaphore qu’il convoquait, en l’empruntant à deux de ses devanciers, Alfred de Vigny et Ossip Mandelstam. Cette image, c’était celle de la bouteille à la mer : « Le poème peut, puisqu’il est un mode d’apparition du langage et, comme tel, dialogique par essence, être une bouteille à la mer, mise à l’eau dans la croyance, pas toujours forte d’espérances, certes – qu’elle pourrait être en quelque lieu et quelque temps entraînée vers une terre, Terre-cœur peut-être. »
En parlant ici de Terre-cœur (le mot allemand est Herzland), Celan relance le questionnement : où se trouve la contrée espérée et élective du poète ? et quelles personnes peuvent être les destinataires de son message aventureux ? Maigre certitude : ce lieu n’est pas topographique ; il relève d’une géographie mentale – c’est un lieu de l’Être.
Dépaysement inaugural : les latitudes et longitudes du planisphère échouent à assigner cette « Terre-cœur » qui flotte, comme Celan l’écrit, dans la « clarté de l’utopie » (1)
La clarté de l’utopie ? C’est cette zone franche, accessible à tout lecteur pourvu qu’il soit disposé à laisser entamer sa part la plus intime. Tant il est vrai, comme le rappelait son maître, l’auteur de Tristia, que « le poète est seulement lié à un interlocuteur providentiel ». La clarté de l’utopie : cette expérience d’un « pour-autrui » antérieur à toute expérience, que Mandelstam a pressentie, et qu’Emmanuel Levinas a thématisée. Dans son commentaire éclairant, l’auteur de Totalité et infini évoque cette préséance de l’Autre sur moi, ce « transport » qui ravit le Sujet à lui-même, qui le désenchaîne de son enchaînement à soi.
Cette haute teneur en dialogisme de la poésie de Celan rend, justement, problématique son inclusion à une métaphysique de l’anonyme. Voir dans son écriture l’expression d’une philosophie du neutre, célébrant le primordial « être-au-monde », est une position tentante, mais intenable. Giorgio Agamben s’y est récemment essayé. Certes, comme l’a souligné le philosophe italien, lecteur assidu de Heidegger, «après avoir transformé l’œuvre en marchandise, voici que l’artiste se fait à son tour de celle-ci un masque inhumain et renonce à l’image traditionnelle de l’humanité ». C’est d’ailleurs ce que négligeraient selon lui les critiques réactionnaires de l’art moderne. A en croire Agamben, ceux-ci oublieraient que l’antihumanisme de Baudelaire, le projet rimbaldien de « se faire l’âme monstrueuse », ou encore la marionette de Kleist, trahissent la recherche interminable de la poésie contemporaine – sa tension vers la région troublante où n’existent plus ni hommes ni dieux et où «seule se lève inconcevablement, comme une idole primitive, une présence à la fois misérable et sacrée, qui possède à la fois l’immobile matérialité du cadavre et la fantomatique évanescence du vivant » (2). Certes… Nous savons tout cela, nous n’ignorons ni la fascination des « idoles primitives » et nous avons appris, aussi, que l’extase médusée où elles ont plongé Heidegger devait lui inspirer quelques-uns des philosophèmes les plus robustes du XXè siècle. On ne comprend, pourtant, rien à Celan, si on annule la tension qui innerve son « contre-lyrisme », si on omet sa persévérance à acheminer le « bavardage bariolé de la lyrique » vers ce qu’il a nommé « la nudité de la glace » (3) . On méconnaît, enfin, l’urgence qui animait son aventure poétique quand on nie la blessure narcissique que Celan a infligée à la fière présence « misérable et sacrée » de l’étant.
Car ce poète fut, d’abord, un détracteur acharné du « national-essentialisme » de la métaphysique allemande. Il aurait pu reprendre à son compte ce jugement implacable de Leo Strauss, dans Pourquoi nous restons juifs : « Il sautait aux yeux que la pensée nouvelle de Heidegger conduisait fort loin de toute charité et de toute humanité ».
Un humanisme hébraïque ?
Bien sûr, comme l’écrit le Dante de la Solution finale, dans Renverse du souffle, « il reste encore des chants à chanter au-delà des hommes ». En d’autres termes : il reste une voix à faire entendre qui ne serait plus l’articulation lyrique d’un sujet, un « reste chantable » dont la poésie même s’attache à préciser la nature ou les conditions. Ce reste-là échappe justement à l’anonymat de l’ontologie, il ne se donne pas sous les traits d’un étant indistinct mais d’une silhouette humaine mutique, que l’écrivain a reçu mandat de libérer de son manteau de neige.
Plus proche de Martin Buber et de son humanisme dialogique que de la marionette kleistéenne, Celan ne prolonge pas, ce faisant, l’antihumanisme, il le dérange, il l’inquiète, il en détraque les radars ontologiques.
Comme Levinas aussi, Celan professe un humanisme de l’Autre homme : à la contemplation des réelles présences qui subjugue les « riverains de l’Être-là » (4), sa poéthique substitue la surprise d’un vis-à-vis. Epipahanie d’un visage, dans la clarté de l’utopie.
La « deconstruction » de Kleist, Hölderlin et Rilke
Ne pas se tromper, dès lors, sur son duel et sa rixe de mots avec la poésie dont son enfance bucovinienne fut bercée : à l’endroit de Rilke, de Kleist comme de Hölderlin, ces compagnons de ses premières lectures, Celan se comporte en interlocuteur hypercritique. La tradition doit être concassée et ramenée, justement, à la « nudité de la glace » (5). Ce que Celan traque, dans leur beau phrasé, dans le balancement de leurs vers, c’est, non une source d’inspiration, mais la complicité avec les « fausses positivités » qui menèrent les Allemands à l’abîme hitlérien.
Son programme est, encore une fois, poéthique : il consiste à opposer au vacarme sans sujets de l’enracinement une langue de la proximité pour la proximité, plus ancienne que celle de la vérité de l’Être. Celan ranime le « premier des langages », cet idiome dont Levinas a écrit qu’il était « réponse précédant la question, responsabilité pour le prochain, rendant possible, par son pour l’autre, toute la merveille du donner » (6).
Ainsi, ajoute Celan, les poèmes, dans la mesure où ils réactivent ce langage qui n’est pas celui de l’origine et qui est pourtant premier, «sont aussi de cette façon en chemin : ils mettent un cap. Sur quoi ? Sur quelque chose qui se tient ouvert, disponible, sur un Tu, peut-être, un Tu à qui parler, une réalité à qui parler » (7).
Dans la parole poétique est contenue, à l’état de virtualité, toute la force du pour-autrui. «C’est depuis toujours une espérance du poème, note Celan, lors de la réception du prix Georg Büchner, à Darmstadt, qu’en parlant justement de cette façon qui lui est propre, il parle aussi au nom de l’Etranger – non, je ne peux plus utiliser ce mot désormais, qu’en parlant ainsi en son nom propre, il parle au nom d’un Autre, – qui sait, peut-être au nom d’un tout Autre ».
Alors, Celan avec Levinas ?
Ou plutôt : Celan, avant Levinas ?
Sûrement…
Mais tout aussi légitime paraît, à ce stade, la tentative d’évoquer, à l’instar de la « génération Levinas » (8), une « génération Celan ».
Il ne s’agit évidemment pas d’un héritage organisé ni d’une obédience structurée, ni même d’une école.
En sa solitude glacée, Celan ne se prête à aucune opération de transmission : il est sans émules. Nulle cohorte de disciples – mais le legs d’une série de questions et de commandements qui dessinent, aujourd’hui, comme le transcendantal de l’Europe démocratique. Nous y reviendrons.
(1) Voir Emmanuel Lévinas, Noms propres, Fata Morgana.
(2) Stanze, Giorgio Agamben, Christian Bourgois, 1977, p. 99
(3) Poésie contre Poésie, Jean Bollack, PUF, p.4
(4) Bollack, op. cit.
(5) Discours de Brême, op.cit
(6) Lévinas, op. cit.
(7) Le Méridien et autres proses, Seuil, 2002, p. 73-74
(8) Bernard-Henri Lévy, Le Monde, 5 janvier 2006.