Max Mills, suffisamment scénariste de métier pour se prêter un confort de vie, est une sorte d’épicurien en fin de stage. Un savant dosage des plaisirs lui empêche les excès nocifs du corps et de l’âme, lui assure une marche équilibrée dans l’existence et le met à l’abri des passions du cœur.
Lever de rideau, le livre commence à l’Hôtel de Russie à Rome : «Ce matin-là devait, comme tant d’autres, promettre mille bonheurs mobiles». Il suffira d’une malencontreuse erreur du concierge pour que notre héros reparte avec une valise semblable à la sienne, mais qui ne lui appartient pas, pour que la ronde des rituels et des réflexes s’estompe, que les façades du décor se fissurent avec malice et ouvrent une valse des possibles. À l’intérieur de la valise, Max Mills découvre des somnifères, un journal intime, un portrait d’Audrey Hepburn, de la soie. Pour qui a fréquenté les précédents livres de Jean-Paul Enthoven, il y a des indices qui ne trompent pas. L’auteur du magnifique “Aurore” n’a pas son pareil pour aller sonder la psyché de ces femmes dont les parures et les accessoires ne sont bien souvent que le signe d’une fêlure où s’engouffrera le désir de l’homme. Il restera à en observer les effets, les pousser à leur limite par diverses hypothèses, ne se priver d’aucun artifice (notes de bas de pages, journal intime, dialogues de théâtre) et déployer les couleurs des sentiments par un style allegro et un sens du tragique dont seule une conversation imaginaire entre Stendhal et Dino Risi attablés au restaurant d’un grand hôtel de Monte Carlo pourrait rendre compte.
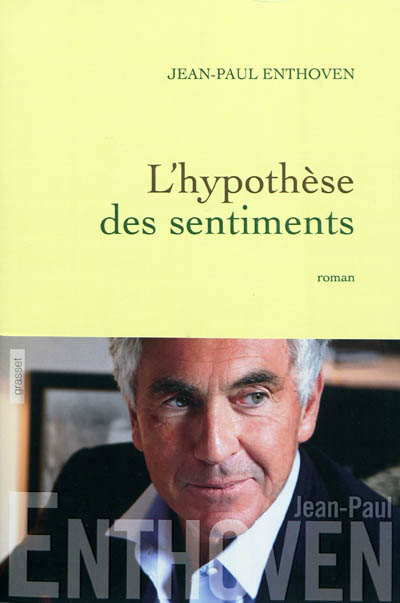
Elle s’appelle donc Marion et vit dans un bel hôtel de Monaco avec le baron d’Angus qui a un château de cartes dans la tête. Nous en suivons la déchéance en même temps que les jeux de l’amour naissant entre nos deux prétendants. «Ce qui se passe en vérité : on choisit, on croit choisir, on recrute un désir ou un sentiment, mais des lois obscures précèdent l’éclosion de ce que l’on va éprouver, en décident comme un relief décide du cours d’un fleuve, et agissent enfin selon leur seule logique de nature.» Il faudra un regista pour en rendre compte, ne pas avoir peur du film qui se construit, avec tous ses personnages : agent secret, mac, putes, grands hôtels, hommes d’affaires et voyante, etc. Il faudra ne pas avoir peur de frotter le grand style au toc de l’époque, s’intoxiquer, si l’on veut suivre le caprice, par endroit, qui servira d’antidote à la mélancolie, déjouer le kitsch et renouer avec le sublime. S’est-on déjà demandé ce que donnerait une rencontre entre Anna Karenine et Gatsby sur une terrasse à Rome au couchant? Ce livre vous y convie en passant par des brillants détours. Car on sent également que le romanesque, chez Jean-Paul Enthoven, passe par la quête de cette zone miraculeuse où le roman toucherait à la force de certaines séquences que seul le cinéma pourrait fournir et se nourrit par l’amour de certains films scénarisés par des écrivains hors pairs. L’Italie a pu connaître cette alliance, et ce n’est pas pour rien que l’on songe souvent à Dino Buzzati, à Mario Soldati ou encore à Ennio Flaiano tout au long de la lecture de “L’hypothèse des sentiments”.
Mais si l’on devine que Jean-Paul Enthoven a mis beaucoup de lui dans la construction de cette fresque tour à tour douloureuse et enchantée, il nous appartient de citer Baudelaire parlant de Delacroix pour tenter d’en saisir l’âme : «Sceptique et aristocrate, il ne connaissait la passion et le sentiment que par sa fréquentation forcée avec le rêve.»






