Notre capitale rend hommage à la chanteuse Barbara (1930-1997) où elle vécut et y grava les étapes majeures de sa carrière.
Installée au 6, rue Brochant (17ème arrondissement), la famille Serf fuit Paris dès le début de la guerre et des premières persécutions. Son père Jacques est juif alsacien et sa mère est née Esther Brodsky, russe originaire d’Odessa.
1944. Depuis deux ans, Monique, ses trois frères et soeurs se cachent à Saint Marcellin, un village au pied du Vercors.
La future Barbara a quatorze ans et déjà un timbre de voix remarquable.
La belle adolescente, grande, souriante, élégante, joue du piano chez Madame Bossan. Elle en jette : une vraie Parisienne. Dans la salle de restaurant où la famille prend ses repas, on lui demande de chanter et elle s’exécute. Chez les Serf, au milieu de ce bonheur fragile, les valises sont prêtes. La menace n’est jamais loin. Patrouille, rafle, dénonciation. Le père a d’ailleurs prévenu :
– Demain, si les allemands se pointent, on devra partir.
Quand ils reviennent dans les Yvelines, au Vésinet en 1945, Monique continue d’étudier le chant et le piano au Conservatoire de Paris. Son père disparaît sans donner d’explications. Monique change de prénom pour celui de Barbara. Sa mère s’adonne aux jeux et vend le piano de sa fille pour payer ses dettes. Quand Barbara découvre le grand vide dans le salon, elle s’enfuit.
1954 : Barbara devient la chanteuse de Minuit, Quai des Grands Augustins sur la petite scène de l’Ecluse. Répertoire rive gauche. Elle n’écrit pas encore ses textes, se contentant d’interpréter ceux des autres : Brassens, Mouloudji, Brel…
Il lui faudra du temps pour trouver les mots. Les ajuster à sa tessiture, à son tempo, à sa sensibilité de faïence. Et quand – enfin libre et inspirée – la plume de Barbara crissera sur le papier, elle fera beaucoup de brouillons et de chiffonnades jetés dans la poubelle, se souvenant d’un adage de Serge Gainsbourg : – Ce qui est gravé est grave.
Dis quand reviendras-tu ? Sa première chanson originale sort en 1962 et allume enfin sa carrière après un long anonymat doré, puisqu’on la connaît et qu’on l’encourage.
On vit l’époque des yéyés avec Sheila et Sylvie Vartan : les filles en jupes et en bas zibeline, dansent le Hully Gully en twistant de la croupe afin de narguer les garçons.
1964. Barbara a 35 ans et enregistre son premier album où figure Nantes, dédié à son père disparu, qui un soir de 1959, désirait la revoir :
– Madame, soyez au rendez-vous, 25, rue de La Grange-aux-Loups.
Juste une voix au téléphone. Elle se précipite à Nantes mais arrive trop tard. Il vient de mourir. Cette maudite échéance la fâchera à jamais avec les horloges et le sablier du temps. Désormais, elle estime que seuls, les rendez-vous avec son public, méritent d’être ponctuel.

Et puis, il y a le piano. Son instrument, son confident, son supplice, son boulet. Et ce tabouret sur mesure qu’elle trimballe partout et qu’elle ajuste avant chaque récital, les cuisses bien calées sous le bois.
Pauvre Barbie. Ses tournées mettent à l’épreuve ses nerfs. Quand elle se présente dans la salle de concert, on lui présente souvent en guise de piano une vieille casserole au clavier édenté ou un crapaud géant qui émet des couacs dès qu’on frôle une note.
Aujourd’hui, quand un pianiste se produit en spectacle, l’organisateur a loué un Steinway, un Bosendorffer ou un Yamaha : l’instrument est accordé, lustré, vérifié, éclairé.
Vous imaginez Elton John, en concert solo obligé de jouer sur l’harmonium centenaire de la chapelle polyvalente de Buckingham ?… De quoi arracher son postiche.
Un jour de 1966, au théâtre de Fontainebleau, le directeur de la salle accueille La grande Barbara en frétillant du fessier :
– Vous allez voir ! Notre piano est une œuvre unique…
Le genre de phrase qui fait grimper dans le rouge le stress d’un artiste expérimenté.
– Aïe aïe aïe ! se dit Barbara, ça commence mal.
Dans le grand escalier qui conduit à la scène, le type se plie en deux, mielleux tel un japonais, expliquant que l’instrument date du 18ème (Aïe !), que le coffre de volume est vaste et qu’il est donc inutile de le sonoriser (Aïe !), que sa marqueterie de bois rare est ornée de peintures représentant des créatures divines (Aïe !).
Barbara découvre un piano imaginé par Aslan ou Hugh Heffner.
Le peintre a couvert la surface de l’instrument de femmes nues et d’angelots bouclés qui virevoltent dans le ciel, le zizi à l’air.
– Dites ?… Vous me voyez, assise là, en train d’interpréter Nantes, avec le sein de la fille qui me saute à la figure ? demande Barbara au directeur déconfit.
Ce dernier appela les pompes funèbres Borniol et se fit livrer un drap mortuaire taille XXL afin d’envelopper l’objet du délit.
En mai 1970, Barbara emporte les suffrages et le succès public avec l’Aigle Noir : un titre qui ne devait pas exister.
Né par hasard, quelques mois avant. Il manquait une chanson pour terminer l’album. En fouillant ses tiroirs, elle retrouve une cassette d’une chanson presque inachevée. Une mélodie au piano qui résonne comme la Sonate Au Clair de Lune de Beethoven.
Elle confie la cassette à son chauffeur, Pierre, pour qu’il l’apporte au célèbre arrangeur Michel Colombier.
– S’il vous plaît, vous devez en faire un tube !… La patronne en a vraiment besoin, confie Pierre en livrant la maquette. Colombier écrit une orchestration puissante.
Savent-ils ces deux hommes ce qui se cache sous les ailes déployées de la chanteuse ?
Lorsqu’elle lève les bras au ciel et porte sa voix vacillante vers quelqu’un tapi dans l’ombre : … Mais, QUI est l’Aigle Noir ?
D’ailleurs, à bien y réfléchir. Donner ce titre à une chanson ? Un aigle noir. Allusion à l’occupation, au sigle nazi, au drapeau de la vieille Germanie ?
Avec Nantes et Au Cœur de la Nuit, l’Aigle Noir achève en fait, une trilogie confidentielle. Un drame intime. Familial.
Plus tard, Barbara livrera en demi-murmure son secret :
– Parmi tous les souvenirs, ceux de l’enfance sont les pires. Ceux de l’enfance, nous déchirent…
Voilà enfin, le visage de l’Aigle Noir. Un père incestueux. Jacques Serf. Disparu depuis si longtemps, puis échoué à Nantes où dans un sursaut de remords déboussolé, il avait supplié – mourant – la présence de sa fille à son chevet.
Barbara était arrivée trop tard.
– Mourir ou s’endormir, ce n’est pas du tout la même chose, pourtant, c’est pareillement se coucher les paupières closes.
Barbara s’est éteinte à 67 ans, à Neuilly-sur-Seine, un 24 novembre 1997.
– Paris, mon Paris… Au revoir et merci… Si on téléphone… Je n’y suis pour personne…
A Voir : Au Théâtre de Gymnase Marie Bell (38 Bd de Bonne Nouvelle)
Barbara, de l’Ecluse au Châtelet, interprété par Marie Hélène Féry.



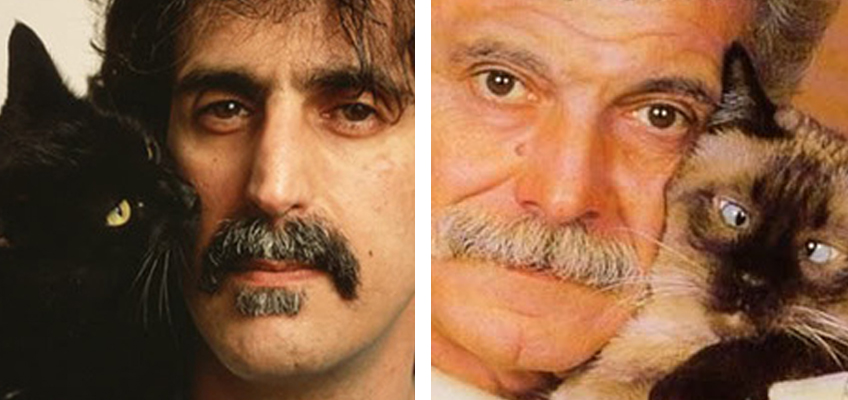



J’aime les chansons de Barbará, sa voix si douce et melancolique. C’est domage et on deplore que elle n’est plus ici. J’avais toutes ses disques mais je ne trouve pas des compacts d’elle, au moins dans Buenos Aires. Peut etre ils existent.