2
Manger du papier
À l’époque où il tente de sevrer Proust, le docteur Sollier dénombre, sur 300 toxicomanes guéris dans sa clinique de Boulogne, 50 médecins, 3 dentistes, 4 pharmaciens, soit près de 20 % du total[1]. S’il s’épargne d’y ajouter les membres de leur famille, et s’il reste aussi discret sur le cas du fils du docteur Proust, il permet d’entrevoir combien le corps médical payait sa rançon à la drogue. Pour autant, ce même corps n’admettait pas moins que la toxicomanie n’était pas inhérente à la qualité des produits stupéfiants, mais à la faiblesse constitutionnelle des sujets stupéfiés. Sujets « dont la volonté affaiblie et le besoin de stupéfiants auraient fait et faisaient mauvais usage de n’importe quel stimulant mis à leur disposition », notait Freud[2] qui de fait, durant des années, prit régulièrement de la cocaïne sans guère se causer de dommages. Ainsi la psychiatrie (du moins celle qui émanait de l’école de la Salpêtrière) établissait une différence essentielle entre le toxicomane livré à son démon et le consommateur raisonnable, capable d’ajuster son dosage et d’en tirer bénéfice. Au regard de ce savoir, l’intoxication relevait en somme de la sélection naturelle ; elle n’atteignait que les sujets tarés pour laisser les sujets sains profiter des avantages de la drogue, non seulement sur le plan thérapeutique, mais à un niveau qui le dépassait de loin ; un niveau où le stupéfiant se dotait d’une vertu éminemment positive, rationnelle et noble, à livrer non plus un médicament, mais la ration d’un dopant.
La vague de morphinomanie qui s’amorce vers 1850, la cocaïnomanie que les années 1880 soulèvent à leur tour, la vague plus puissante encore d’héroïnomanie qui commence à déferler au tournant du XIXe et du XXe siècles, se conjuguent en un flux continu, rejeté jusqu’aux rives du présent, dont la lame de fond tient tout autant à l’invention de la seringue hypodermique qu’au souci de doter l’humanité d’une nouvelle arme biologique propre à améliorer sa santé et à pousser toujours plus loin ses performances physiques et intellectuelles. S’y crée un maniement original du psychotrope qui ignore ce que Baudelaire appelait le « rêveur », et sollicite en premier lieu le militaire, le sportif, le dirigeant politique, mais également l’homme de science, en particulier le chercheur, pour qui il n’est plus question de se soigner, encore moins de s’abandonner à la volupté et à la paresse de l’hallucination, mais de se surpasser, d’accomplir des exploits, de désinhiber ses forces vitales, de déchaîner ses facultés créatrices. Devenir dieu, prédisait Baudelaire, en notant que cette ironie ne mordrait pas sur le cerveau du rêveur, pour peu qu’il se considère comme un homme en bonne santé. Là encore, les travaux du jeune Freud sur la coca en portent témoignage, eux parmi tant d’autres, mais ceux-là plus éloquents à la mesure de son génie ; non qu’il n’entrevoie pas ses périls, mais qu’au sang imaginaire de l’ancienne noblesse, le dopant — à passer outre ses dangers — substitue en soi un outil infiniment plus efficace.
« Le “sang” de la bourgeoisie, ce fut le sexe », expliquait Foucault. « Elle a converti le sang bleu des nobles en un organisme bien portant et en une sexualité saine. »[3] Foucault, si expert en pharmacologie et si grand lecteur de Baudelaire, savait pourtant mieux que personne que s’il fut un sang au XIXe siècle, et plus encore au XXe, un sang propre à fortifier, à tonifier, à dynamiser, à revitaliser, à régénérer, ce fut la drogue ; non pas une drogue en particulier, mais l’objet virtuel que son expérience laisse percevoir. Car, si inéluctablement l’usage répété d’un dopant finit par dégrader sa vertu, cette même vertu n’oblige pas moins le sujet dopé à rechercher un stupéfiant toujours plus performant, et à configurer à cette fin un domaine d’expérimentation et de savoir. Zola y installait son Docteur Pascal. Freud s’y profilait et partageait la même ambition clinique. « Un immense espoir s’ouvrait, observait Zola, il croyait avoir découvert la panacée universelle, la liqueur de vie destinée à combattre la débilité humaine, seule cause réelle de tous les maux, une véritable et scientifique fontaine de Jouvence, qui, en donnant de la force, de la santé et de la volonté, referait une humanité toute neuve et supérieure. »[4]
Si, durant son stage à la Salpêtrière, Freud préféra renoncer à la cocaïne comme objet d’étude (sans pour autant cesser d’en consommer) pour lui substituer la sexualité, il rappelle toujours la même ambition. Et de démontrer qu’elle se loge au cœur de l’inconscient et qu’elle noue le lien fondamental aux sociétés humaines. Ambition qui traversait déjà les traités d’hygiène du docteur Proust et permettait au sexe de devenir un objet de laboratoire et de recherche — non seulement comme agent de reproduction génétique, outil d’amélioration de la race, arme de repeuplement, mais comme dispensateur, stimulateur et régulateur de l’élan vital —, ambition qui offre inévitablement au sexe la vertu du dopant et les mêmes enjeux stratégiques. « Prends garde, ma princesse ! », écrivait Freud à sa fiancée. « Si tu te montres indocile, tu verras bien qui de nous deux est le plus fort : la douce petite fille qui ne mange pas suffisamment, ou le grand monsieur fougueux qui a de la cocaïne dans le corps. »[5] Or, en stratège, à son tour, à analyser si longuement les procédures qui encadrent la sexualité dans son tableau du XIXe siècle, Foucault oublie curieusement de s’intéresser aux procédures symétriques, en quelque sorte, qui gèrent la production pharmaceutique et son commerce, et qui, plus encore que l’économie proprement sexuelle, dépendent de la configuration de la santé publique et de sa gestion concrète par les services de l’Etat. Proust s’y confronta d’autant plus que cette gestion, au plus haut niveau administratif comme sur le plan le plus intime, relevait de l’autorité et de l’expertise de son propre père entre les années 1880 et 1900.
La police sanitaire n’imposait pas seulement à chacun d’avoir à régler des taxes fiscales pour obtenir des stupéfiants, mais de passer par un contrôle médical et bureaucratique plus lourd encore à supporter. S’y ajoutaient, dans le cas de Proust, la contrainte familiale et l’inspection méticuleuse à quoi il se soumettait en échange de drogues. Car le revenu de 1000 francs par mois que ses parents lui octroyaient pour subvenir à ses dépenses courantes, revenu pourtant considérable, ne suffisait pas à entretenir sa pharmacomanie, en l’obligeant à se justifier indéfiniment et à en appeler à la pitié des siens. Étant donné que je paye mes poudres (ce que tout le monde trouve fantastique et que je trouve naturel) peut-être il me faudrait aussi payer mon loyer. Je me résigne donc à la vie telle qu’elle est, écrivait-il à sa mère en mars 1903. Et de regretter ne pas pouvoir mener une existence dans une maison distincte.[6] Ses parents ne l’empêchaient pourtant pas de recevoir ses amis dans l’appartement familial ; ils permettaient même à leur fils d’y donner ce que Mme Proust appelait sarcastiquement des « dîners de cocottes » — Oscar Wilde y serait invité, l’année qui précéda son procès en sodomie — et, en somme, ses parents l’y laissaient mener une vie de célibataire qui ne devait guère leur laisser de doutes quant ses goûts sexuels. Cependant remarquez qu’étrangement, quand il y est si souvent question de sa pharmacomanie, les allusions à sa sexualité et à son célibat ne traversent jamais sa correspondance avec ses siens, à quelques exceptions près où, sans doute, le fil d’une persécution intime se laisse deviner, mais en dessinant un serpent de mer qui, s’il suscite les soupçons en pédérastie, oblige la famille inquisitrice à jouer un rôle à la fois ridicule et odieux, dans quoi l’ironie du jeune Proust la fige.
Je ne te cache pas, confie-t-il à sa mère dans une lettre qu’il lui adresse d’Evian en septembre 1899, que le docteur Cottet me paraît tout à fait emballé sur mon compte. Habite-t-il Paris l’hiver ? Bien entendu (et je n’ajoute cette remarque stupide qu’à cause de l’imagination de ma mère) je dis emballé dans un bon sens et ne va pas imaginer que c’est une mauvaise relation, grand dieu !!![7] Une ironie dont le parfum imprégnait déjà la fameuse lettre à son grand-père Weil en mai 1888 : J’avais si besoin de voir une femme pour cesser mes mauvaises habitudes de masturbation que papa m’a donné 10 francs pour aller au bordel. Mais 1° dans mon émotion j’ai cassé un vase de nuit, 3 francs ; 2° dans cette même émotion je n’ai pas pu baiser. Me voilà donc comme devant, attendant à chaque heure davantage 10 francs pour me vider et en plus ces 3 francs de vase. Mais je n’ose pas demander sitôt de l’argent à papa, et j’ai espéré que tu voudrais bien venir à mon secours dans cette circonstance qui, tu le sais, est non seulement exceptionnelle mais encore unique : il n’arrive pas deux fois dans la vie d’être trop troublé pour pouvoir baiser…[8] Prose destinée à être lue en famille, écrite par un garçon de seize ans déjà passé maître dans l’art de dérégler à son profit la mécanique de la bonne hygiène sexuelle — et qui, plus tard, confierait à Gide « n’avoir jamais aimé les femmes que spirituellement et n’avoir jamais connu l’amour qu’avec des hommes »[9] encore que cette confidence, livrée si volontiers et si stratégiquement, épaississe encore le rideau de fumée proustien et qu’il faille l’entendre, sans doute, avec au moins autant d’ironie qu’à son adolescence —, un garçon sur qui pèse surtout, déjà, le besoin de stupéfiant comme le besoin d’argent. Et ne peut-il échapper aussi facilement à cette autre mécanique de l’hygiène intime.
Le journal de santé où Proust rend compte à sa mère du détail de ses fumigations et de ses prises d’amyle comme du menu de ses embarras intestinaux ou de ses insomnies, ce journal de santé, s’il laisse passer son ironie, ne construit pas moins les murs de sa prison à l’âge d’Albertine, en défiant l’autorité maternelle d’exercer sur soi, tant sur sa sexualité que sur son usage de drogues, un contrôle réellement efficace, même si le défi implique parfois le sordide de la dissimulation ou du chantage. Elle conditionne la vie d’un adolescent qui doit à son asthme comme à son audace de goûter au meilleur et au pire. Son cas, pour être particulier, ne laisse pas moins entrevoir les perspectives dont Foucault ignore les tenants et les aboutissants en centrant son tableau du XIXe siècle sur le sexe, et visent-elles un tout autre point de fuite qui, s’il absorbe la sexualité, la dépasse de loin.
La drogue ne soulageait pas que les souffrances inhérentes au commerce du plaisir ; elle l’animait en profondeur, initiait à l’ars erotica et à ses voluptés, mais servait aussi d’outil de séduction et d’instrument de pouvoir. Or une visite à l’hôpital ne tentait guère les courtisanes et les garçons de location que fréquentait Proust. Le diagnostic de la maladie vénérienne, pour leur valoir l’ordonnance de la morphine, leur fermait aussitôt les portes des maisons de passe et les condamnait à la misère en leur ôtant le moyen de s’en procurer. Voilà pourquoi, entre le remords et le remède, Baudelaire scellait un pacte qui exigeait moins le secours du médecin que celui du partenaire de plaisir. Créait-il déjà un vaste trafic de contrebande et des laboratoires clandestins où, précisément, l’auteur des Fleurs du mal reconnaissait le visage de Satan, mais un Satan qu’il déleste de son attirail traditionnel, un Satan d’une nature nouvelle, un Satan d’un « sexe ambigu », ami des putains et des poètes, fournisseur de bordels et d’ateliers de peinture, qui révèle de « beaux yeux languissants », des lèvres d’où s’exhale « la bonne odeur de parfumerie », et une fiole « dont le contenu était d’un rouge lumineux, et qui portait pour étiquette ces mots bizarres : “Buvez, ceci est mon sang, un parfait cordial.” »[10]
Accrocher un client en recourrant à une drogue sert d’arme à la prostitution, au proxénétisme et au truquage depuis toujours. « Nous vous donnerons des somnifères et des poisons, que vous emploierez au besoin, en partant toujours d’un principe ; c’est que la santé… la fortune du prochain n’est rien, toutes les fois qu’il s’agit de s’enrichir. En excitant la pitié dans les autres, souvenez-vous que vos devoirs vous font une loi de n’en jamais éprouver aucune : votre cœur doit être comme de l’acier », apprend Justine à l’école de Sade[11]. Une éducation qui oblige courtisane, gigolo ou truqueur à se doter d’un œil clinique ; à considérer son client comme un patient et à établir un diagnostic. Empoisonner méthodiquement la vie d’un partenaire amoureux réclame, sinon l’entière compétence d’un médecin, du moins le même savoir fondamental, la même technologie rationnelle, la même médicalisation de la pensée spéculative, en exigeant les mêmes sortes d’attentions, de soins, de raffinements. Mais une telle arme, et ce qu’elle suggère, offrent aussi une autre acception à la formule « en être ». Acception si mystérieuse qu’elle sidère le baron de Charlus quand, en ouvrant une lettre écrite par Léa à Morel, il remarque que Léa ne lui parlait qu’au féminin en lui disant : « grande sale, va ! », « ma belle chérie, toi tu en es au moins. » Confidence d’une courtisane à un gigolo, mais plus encore signal de reconnaissance, aveu d’appartenance au même corps social, collégial et confraternel, fût-il clandestin. Et Proust d’expliquer : Le baron était surtout troublé par ces mots « en être ». Après l’avoir d’abord ignoré, il avait enfin, depuis un temps bien long déjà, appris que lui-même « en était ». Or voici que cette notion qu’il avait acquise se trouvait remise en question.[12] S’y profile une pratique de soi dont la perspective ontologique, sans ignorer l’objectif sexuel, n’en fait pas moins un leurre, là encore, sur une route où s’envisage un tout autre but. Cependant, au regard de cette éthique maligne, Odette « en est » autant que Léa ou Morel. Si elle ne semble pas user de drogue avec Swann, il n’en ressent pas moins les mêmes effets toxiques. Et qui sait si, véritablement, elle n’en use pas ?
L’affaire des Poisons faisait déjà peser le poids du même soupçon sur Mme de Montespan à dessein d’envoûter son royal amant et d’en profiter en dépassant toute mesure. Il est vrai que la morphine surgissait au même moment en Europe sous la forme d’une poudre dont le médecin de l’électeur de Saxe livra en 1688 la première description savante, poudre appelée alors « magistère d’opium ». Son procédé de fabrication ne resta pas moins hautement confidentiel — il valait son pesant d’or — et dut attendre le progrès de la révolution industrielle, et l’horizon des années 1820, pour être pleinement divulgué. N’oubliez pas que, sous l’Ancien Régime, la définition du toxique dépendait moins de la qualité de sa substance que de la vertu de son fournisseur (c’est d’ailleurs encore largement le cas). L’opium, voire la morphine, à supposer qu’elle apparût en France durant l’affaire des Poisons, n’étaient condamnables, et effectivement condamnés, que parce que des sorciers en faisaient commerce, et que des criminels ou des libertins en usaient. Pour le reste, avant de le concéder à la Compagnie française des Indes, le Roi réservait le privilège de la ferme de l’opium aux ordres religieux. Et le dotaient-ils d’une odeur de sainteté. Le couvent des Célestins du Louvre produisait en particulier deux remèdes opiacés — le laudanum du père Rousseau et le baume du père Tranquille — dont Mme de Sévigné, entre autres, témoigne de la remarquable efficacité. Mais les Capucins distillaient également un parfum qui ne faisait pas moins fureur alors : l’Eau de la reine de Hongrie, dont la recette provenait, disait-on, de la cour de Naples. « Elle est divine, je vous en remercie encore ; je m’en enivre tous les jours : j’en ai dans ma poche. C’est une folie comme le tabac : quand on y est accoutumée, on ne peut plus s’en passer », racontait Mme de Sévigné à sa fille[13]. Et de s’amuser que son gendre l’utilise pour soulager les douleurs de ses piqûres, c’est-à-dire de ses saignées. Étrange usage d’un parfum, du moins à un regard actuel, encore que Proust rappelait à lui, en leur comparant l’art de Gustave Moreau, les parfums qui facilitent les apparitions[14]. Parfums qui le ramenaient dans sa chambre à fumigations du boulevard Haussmann, mais également quai Malaquais dans le salon de la princesse Marie de Chimay, en qui Gustave Moreau trouva la plus fervente des protectrices ; vocation de mécène que la princesse transmit à sa fille, Elizabeth Greffulhe, à son neveu Robert de Montesquiou et à son amie, Geneviève Straus, trio auquel reviendrait d’organiser en 1906 la première rétrospective des œuvres du peintre comme de composer le cœur du faubourg proustien. Parfums qui ne ressuscitaient pas moins le cabinet du docteur Charcot en ce même hôtel de Chimay.
« Beaucoup de femmes demandent à la morphine un mordant de l’esprit, un coup de fouet de la causerie », remarque Goncourt dans son Journal de 1882. Qui sait si cette habitude ne remontait pas déjà loin dans le temps, au moins jusqu’au XVIIe siècle ? Il est vrai qu’alors l’habitude s’acquerrait à son corps défendant, puisqu’en consommant des stupéfiants on en ignorait encore le concept et qu’il affleure à peine la langue de Goncourt. « On voit, poursuit-il, des maîtresses de maison disparaître une minute, avant leur dîner, et reparaître avec, dans les yeux, de l’ivresse spirituelle. Dieulafoy cite comme la plus extraordinaire des morphinomanes la comtesse de Lichtenberg, qui se fait vingt ou trente piqûres par jour. »[15] Voilà peut-être aussi pourquoi Foucault esquive un tel objet archéologique comme s’il lui glissait comme du sable entre les doigts. Objet si précieux, et si délicat à manipuler, qu’il exige un écrin à la fois protecteur et publicitaire, où la poudre se laisse deviner sans pour autant se dévoiler. Se révélerait-elle par mégarde ou par sottise qu’elle changerait aussitôt de nature. Car, à se délester de son indispensable énigme, la drogue se rend dérisoire et dégoûtante ; et, en cela, bien plus que la sexualité lorsqu’elle passe les limites de la pudeur ; quoique le plaisir de dénoncer leurs rites clandestins à l’une et à l’autre procède de la même nécessité scabreuse. Suffit-il, pour l’éprouver, de se mettre dans la peau du baron de Charlus, indigné si on le citait pour ses goûts, mais toujours amusé de faire connaître ceux des autres.[16]
« Ne pas vouloir reconnaître, c’est encore une péripétie de la vérité. Que la Salpêtrière de Charcot serve ici d’exemple, expliquait Foucault. C’était un immense appareil d’observation, avec ses examens, ses interrogatoires, ses expériences, mais c’était aussi une machinerie d’incitation […]. Or, c’est sur fond de cette incitation permanente au discours et à la vérité, que viennent jouer les mécanismes propres de la méconnaissance : ainsi le geste de Charcot où il commençait à être trop manifestement question de “ça”. »[17] Ça ? — Mais ça quoi ? — Or, précisément, ça disait tout court. L’arrière-petite-fille de l’auteur de Justine, la comtesse de Chevigné, née Laure de Sade, l’apprit peut-être à Proust. Ça disait précisément ce que chacun taisait, mais qui, à être énoncé, se flétrissait en se chargeant d’obscénité, comme en faisant reculer indéfiniment l’horizon du savoir et sa promesse de jouissance. « Ça : la débauche ? la sodomie ? la morphine ? Satan ? Ça quoi ? — Ça… et le reste ! » Lui revenait nécessairement le dernier mot. Ce à quoi vous n’auriez pas songé, ni goûté, mais qui, précisément, doit se taire pour mieux se savourer. Il permettait toujours au baron de Charlus — dont le nom se prononce Charlû au faubourg Saint-Germain — de passer incognito auprès des gigolos du bordel de Jupien, qui disaient eux Charluze en entendant probablement « Ça… l’use ». Beaucoup seulement croyaient que c’était un surnom et le prononçant mal l’avaient déformé de sorte que la sauvegarde du baron avait été leur propre bêtise et non la discrétion de Jupien, indique Proust[18] sans en dire plus, en posant à son lecteur le même genre de devinettes qui affolait déjà la langue et les mœurs de la cour de France au XVIIe siècle.
L’hôtel de Condé, où naquit Sade, rassemblait la parentèle d’une branche de la maison royale à qui la duchesse de Bourbon avait transmis cet art du mot et de la chose — ce que Saint-Simon appelait « l’esprit Mortemart » — qu’elle tenait de Mme de Montespan, sa mère. Princes et princesses y prenaient des noms de terre si spirituels quand on leur associait celui de Bourbon — Condé, Conti, Sens, Clermont, Charolais, etc. — qu’ils leur valaient une réputation de libertinage sans pareille en Europe. Réputation qu’ils n’usurpaient pas. Illustraient-ils encore la devise du premier des Bourbon : « Suivez mon panache blanc ! » Ces princes y gagnaient toujours plus d’audace, et ce fut chez le comte de Charolais que s’organisa, sous la Régence, la boucherie dont sortit le premier scandale sadique de la maison de France — sadique, avant la lettre. Tiendrait-il au hasard que Sade ait épousé Mlle de Montreuil, qu’il ne se vouait pas moins au même affolement de la langue. « Mapoulie, Magrue, Monlevier ? Non, Montreuil », remarque Philippe Sollers[19]. Voire « Montre œil ». Il est vrai qu’à injecter « ça » dans la langue, toutes choses se dotent bientôt de la même teinte, pour peu qu’on vous conduise à détecter son infrarouge. Et il n’est pas sûr que Freud ait si bien compris « ça » dans sa traduction française, puisqu’en allemand « ça » et « cela » reviennent au même. Du moins, la nuance engagea Jacques Lacan à revisiter le signifiant freudien et à imposer à « ça de dire tout court », en remployant à sa manière un jeu de mots déjà si usuel et si efficace jadis sur les divans sadiens.
La géniale trouvaille de « ça » crée sa phénoménologie au libertin, et tenait-elle — du moins au regard de Proust — à l’esprit de Mme de Montespan. Son frère, le duc de Mortemart, qui n’était pas moins spirituel, portait également le titre d’amiral de Vivonne. Est-ce si étonnant que son eau vive baigne à présent le paysage d’A la recherche du temps perdu ? Mais si son narrateur, en progressant du côté de Guermantes, remonte jusqu’aux sources de la Vivonne, où il n’imagine rien moins que l’entrée des Enfers, il n’y découvre qu’un pauvre lavoir d’où montent des bulles. Car ça n’a aucune importance en tant que tel : seul compte l’esprit qui le conçoit, du moins encore au regard de Proust. Les gens du monde sont si bêtes — expliquait-il à Paul Souday — qu’il m’est arrivé ceci : agacé de voir Saint-Simon parler toujours du langage si particulier aux Mortemart sans jamais nous dire en quoi il consistait, j’ai voulu tenir le coup et essayer de faire un « esprit des Guermantes ». Or, je n’ai pu trouver mon modèle que chez une femme non « née », Mme Straus, veuve de Bizet.[20]
Mme Straus disait : « Ma fleuriste est si convenable qu’elle s’appelle Cambron. » Mot que Proust appréciait spécialement ; il retenait pourtant cette étrangeté que son propre patronyme suscitait (et suscite toujours) le même genre de plaisanteries — « Prout ! » voire « Prout-Prout ! » — plaisanteries qu’on ne lui épargna sûrement pas, au moins durant sa période lycéenne. Prière de ne pas m’appeler Proust quand vous parlez de moi. Quand on a un nom si peu harmonieux, on se réfugie dans son prénom.[21] Or, précisément, à partir du même motif, dans une variation plus complexe, mais qui rappelle la même figure scabreuse, si cruelle qu’elle paraisse à ses propres yeux, Proust crée entre Oriane et Swann une complicité, une passe à laquelle il attache une plus-value particulière, initiée précisément par ce mot de la duchesse de Guermantes :
Enfin ces Cambremer ont un nom bien étonnant. Il finit juste à temps, mais il finit mal ! dit-elle en riant.
— Il ne commence pas mieux, répondit Swann.
— En effet cette double abréviation !…
— C’est quelqu’un de très en colère et de très convenable qui n’a pas osé aller jusqu’au bout du premier mot.
— Mais puisqu’il ne devait pas pouvoir s’empêcher de commencer le second, il aurait mieux fait d’achever le premier pour en finir une bonne fois. Nous sommes en train de faire des plaisanteries d’un goût charmant, mon petit Charles, mais comme c’est ennuyeux de ne plus vous voir, ajouta-t-elle d’un ton câlin, j’aime tant causer avec vous. Pensez que je n’aurais même pas pu faire comprendre à cet idiot de Froberville que le nom de Cambremer était étonnant.[22]
Saisir le trait d’esprit oblige à se laisser aspirer comme par l’entrebâillement d’une porte et à épouser une gestuelle conspiratrice qui semble à la fois d’un factice de théâtre et d’un nécessaire de civilisation ; d’un théâtre et d’une civilisation propres à l’ancienne cour de France, mais que Proust anime maintenant à sa manière et qui n’est plus comprise que par lui. Cependant, dans le passage de cette entrée, Proust ne se donne qu’une présence théorique, à la fois conceptuelle et mystérieuse : n’est-il encore que mon hôte en puissance, compris dans une promesse lointaine, qui exige une épreuve préalable, à laquelle je sens qu’il faut me soumettre et où sa langue — mon hôtesse en acte — me jaugera et me jugera. C’est que, depuis le port où j’ai embarqué dans la Recherche jusqu’à ce seuil, je n’ai été conduit que par un passeur : passeur mythologique ; mais aussi, réellement, passeur de douanes, à qui je dois d’explorer la civilisation française et d’y être admis.
L’épaisseur des murs de la chambre proustienne, la porte qu’en l’abordant je referme aussitôt comme pour faire un sort à mon actualité installent un silence fantastique, à la lettre. Ce silence qui m’accueille et me cueille comme une fleur qu’on coupe, ce silence crée dans ce dispositif rituel un moment crucial : celui où Proust vient vous observer au premier regard que vous posez sur lui et sur le contraste qu’il offre, sur la découpe qu’il opère, sur son tranchant longuement aiguisé, mais qui ne trahit rien encore de ce qu’il tranche au-delà de ce tranchant. Solliciter à présent le mot de Cambronne et l’objet qu’il tait — qu’il tait maladroitement toutefois comme en bégayant — ne suffit pas à articuler la fonction qu’évoque le nom de Cambremer, et à percevoir en quoi, précisément, elle constitue un mot de passe, comme si Proust voulait me signifier que pénétrer l’esprit des Guermantes n’est pas un acte anodin, me faire mesurer le privilège qu’il confère, et surtout ce qu’un tel acte implique de complice, de décisif, de risqué, tant pour l’invité que pour l’hôte. Délivrer le mot de passe, c’est pénétrer, en quelque sorte, le nom de Proust, c’est en assumer la cruauté et partager un secret dont le prix se négocie et se paie. Faut-il croire que mon passeur y tenait spécialement puisqu’en s’introduisant dans la salle à manger des Guermantes, et en rapportant une conversion de table, il revient à nouveau sur le même motif pour composer une nouvelle variation tout aussi scabreuse :
« Zola un poète !
— Mais oui », répondit en riant la duchesse, ravie par cet effet de suffocation. « Que Votre Altesse remarque comme il grandit tout ce qu’il touche. Vous me direz qu’il ne touche justement qu’à ce qui… porte bonheur ! Mais il en fait quelque chose d’immense ; il a le fumier épique ! C’est l’Homère de la vidange ! Il n’a pas assez de majuscules pour écrire le mot de Cambronne. » […]
« Il l’écrit avec un grand C, s’écria Mme d’Arpajon.
— Plutôt avec un grand M, je pense, ma petite », répondit Mme de Guermantes, non sans avoir échangé avec son mari un regard gai qui voulait dire : « Est-elle assez idiote ! »[23]
Voilà l’esprit des Guermantes. Il ne dira jamais ce qu’il cache, encore moins ce à quoi qu’il touche, voire ce dont il se délecte, pas tant parce que l’objet qu’il élude est répugnant, que pour mettre en jeu la fonction rhapsodique de la langue ; fonction qui tient toujours aux parfums qui suscitent les apparitions, et au ça des libertins. Mais ça quoi encore ? — Ça, la merde ? — Ça… et le reste.
Longtemps après la Leçon d’anatomie du docteur Tulp, Rembrandt peignit un autre cadavre quand, en 1656, il livra la Leçon d’anatomie du docteur Deyman. Un cadavre qui épousait maintenant les traits du Christ mort représenté par Mantegna au début de la Renaissance : même effet de perspective, même « raccourci », même visage, même pose, si ce n’est que le ventre ouvert et éviscéré du corps de Dieu laisse deviner une béance à peine préservée par un linge pudique, et que le chirurgien lui a découpé la calotte crânienne afin de procéder à la dissection du cerveau. En revenant dans sa vieillesse sur le même motif, Rembrandt songeait-il que sa gloire n’empêchait pas qu’il dût se déclarer en faillite, se laisser dépecer lui-même et vivre de charité ? Sade atteint le même âge et le seuil de la même misère quand il prend la direction du théâtre de l’hôpital de Charenton. Seulement le savoir anatomique changeait de nature : il n’exigeait plus la collaboration du plus grand peintre de son temps, mais du plus scandaleux des pornographes.
« Je commençais à désirer l’usage du vin et des liqueurs », raconte Sade dans Juliette, en mettant ces mots sur les lèvres de son héroïne, « et lorsqu’une fois que ma tête était prise, il n’était plus d’excès où je me portasse ; j’employais aussi l’opium et les autres stimulants d’amour dont j’avais reçu les indications chez la Durand, et qui, dans l’Italie, se vendent ouvertement et à profusion. On ne doit jamais craindre d’irriter ses appétits lascifs par de tels moyens ; l’art sert toujours mieux que la nature, et le seul inconvénient qui résulte d’en avoir essayé une fois, est l’obligation de continuer toute sa vie. »[24] Les allusions à l’opium restent cependant exceptionnelles dans le roman sadien, comme dans la littérature du XVIIIe siècle, hormis les traités proprement savants et quelques correspondances intimes. Sade ne laisse pas moins entendre qu’il y eut largement accès lors de ses aventures en Italie, mais sûrement aussi en France.
Le médecin observe le toxicomane d’un œil objectif et d’un regard de glace : excitation, euphorie, contractions de la pupille, hallucinations, extase, somnolence, baisse de l’amplitude respiratoire, ralentissement du rythme cardiaque, hypothermie, démangeaisons, difficulté à uriner, constipation, hypersudation, lésions cutanées, insomnie, apathie, anémie, etc. Symptômes que le Narrateur détecte en Swann, mais qui, pour dépendre de l’observation clinique, n’articulent pas moins une langue infernale, cependant muette ; et, si elle parle de soi, dit-elle peu de chose à qui n’a pas éprouvé l’intoxication personnellement. Elle exige du rêveur de se créer une langue, à son tour ; une langue qui imposait déjà à Sade de requérir la fonction qui lie le mal dos-à-dos au bien, ou ventre contre ventre comme dans un agencement obscène ; fonction rhapsodique encore, dont Jacques Derrida remarque qu’elle « ne se laisse pas manier en toute sécurité, ni dans son être, puisqu’elle n’en a pas, ni dans ses effets, qui peuvent sans cesse virer de sens. »[25]
Derrida rappelle encore que, déjà en ancienne Grèce, le pharmakon possédait le double don de signifier « remède » pourvu qu’il fût prescrit par le pharmaceus, le médecin, et « poison » lorsqu’on s’en procurait chez le pharmacos, le sorcier, quand bien même il eût recouvert exactement le même objet. Le statut de la drogue se comprend toujours dans le jeu de cette double identité au XVIIIe siècle. Cependant, à revenir sur l’affaire des Poisons, et à entrevoir qu’elle permet moins au Roi d’organiser le dernier grand procès en sorcellerie de l’Europe chrétienne, qu’à sa police de démanteler le premier réseau de narcotrafiquants de l’âge moderne, Sade bouleverse ces données millénaires en introduisant entre le remède et le poison une toute nouvelle notion. Il est vrai qu’en ancienne Grèce le pharmakon possédait encore un troisième sens : « parfum ». Suscitait-il déjà des apparitions, mais rejetés dans le jeu de la sophistique, de la vanité, des chimères ou du délire par la logique classique ; là où Sade conçoit non seulement le stimulant, le dopant, la dope, mais l’économie qui conditionne sa production et son commerce méthodiques, le pouvoir qu’il octroie, le savoir phénoménologique qui en procède, et le cogito, le sujet stratégique auquel il renvoie.
Remarquez que les deux affaires — celles d’Arcueil et de Marseille — qui valurent à Sade de passer onze ans dans les prisons de l’Ancien Régime mettaient déjà en jeu un dopage, somme toute, assez courant alors, sans attendre que l’auteur de Juliette eût formé leur concept. L’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche, pourtant si prude, songeait à faire prescrire des aphrodisiaques à Louis XVI pour honorer Marie-Antoinette[26], quand Joseph II d’Autriche, de passage à Versailles, à observer l’impuissance de son beau-frère, estimait qu’« il faudrait le fouetter pour lui faire décharger son foutre comme les ânes. »[27] Et suffit-il de parcourir la correspondance de Madame Palatine ou les Mémoires de Saint-Simon pour constater combien la sodomie était banale, ou presque, alors à la cour de France. Sade ne fut pas moins jugé et condamné à mort pour les mêmes motifs : usage d’aphrodisiaques, fustigations, sodomie. Sa vocation y trouva une pression toujours plus accrue, mais elle lui ouvrait un devenir qui, s’il l’avait envisagé à la lecture de Candide, n’était pas toujours plaisant à explorer et à expérimenter. A lui de devenir philosophe ; à lui, surtout, de concevoir une tout autre réponse que celle de Voltaire à Leibniz, et de se donner pleinement, désormais, pour l’avocat du mal. Faut-il encore qu’il dénie à la sorcellerie son pouvoir, et qu’il laisse loin derrière soi Satan pour rencontrer et observer le mal à un degré de souveraineté infiniment supérieur, degré où se comprend sa vocation d’avocat, et où s’opère la création sadienne de l’univers et sa révolution. Ainsi conçoit-il la toxicologie pas moins que la toxicomanie.
À force d’être administré régulièrement depuis le XVIIe siècle, en particulier dans les hautes classes, l’opium n’avait pas révolutionné la médecine sans bouleverser les « tempéraments ». Delfau, l’un des premiers médecins à s’intéresser aux rapports de la drogue et de la sexualité, notait : « Les effets excitants de l’opium cesse après 15 à 20 pipes ; après 20 ou 30 les érections deviennent incomplètes, et au-delà de 40 cessent totalement. »[28] 40 pipes, c’est-à-dire une semaine, tout au plus, dans la vie d’un fumeur. Si l’usage de la pipe thébaïque, répandu dans les colonies hollandaises, restait exceptionnel sous l’Ancien Régime en Occident, où l’on préférait encore se droguer par ingestion ou par inhalation, l’accoutumance à l’opium n’entraînait pas moins à long terme les mêmes effets, complexes et variables selon les individus, mais observables en règle générale dans la société qui y avait accès, celle que Balzac rencontrerait chez les Mortsauf, mais qui créaient déjà, au temps de Sade, une donnée statistique à qui étudait les mœurs de l’aristocratie française. Sade en souffrait lui-même : « J’ai parfaitement pris mon parti sur l’opiniâtreté de cette flèche à ne point vouloir partir », admettait-il[29]. Elle n’obligeait pas seulement à substituer le coup de fouet à la caresse ; elle exigeait des drogues de plus en plus fortement dosées, en cantharide pour accélérer la circulation sanguine et aider à l’érection, ou en opium sous forme de pilules ou de baume pour panser les plaies après le plaisir. Elle ancrait surtout dans le sexe un objectif toujours plus cérébral dont la pression ne cessait de s’accentuer à mesure que se produisait la révolution des Lumières ; pression obsessionnelle qui conditionnait le « ça » des libertins, faisait naître leur littérature et la nécessité de sa stimulation ; pression qui, bientôt, élirait Sade tout court.
« Celui qui vit aujourd’hui à Saint-Germain-des-Prés doit se rappeler qu’il habite dans un espace sadien dégénéré », remarque Barthes[30] en revenant en pensée à l’hôtel de Condé (à l’emplacement de l’actuel quartier de l’Odéon). Lieu qui offrait déjà à l’adolescent Sade le théâtre où le caprice se mêlait à la nécessité, et où sa vocation se forma, encore qu’elle ne tînt peut-être qu’au fil d’un jeu de mots dans l’esprit Mortemart et à l’audace qu’il supposait. « Voici la chaîne étymologique : Sade, Sado, Sadone, Sazo, Sauza », souligne Barthes en reconnaissant cette pression dans le nom même de Sade, et dans son antériorité en Sauza, la terre, le fief auquel il devait ce nom, aujourd’hui le village de Saze. « Z’est za… Z’au za… » soupirerait Charlus sous les coups du plaisir, car Proust ne l’entrevoit pas moins. « Ce qui s’est perdu dans cette filiation, conclut Barthes, c’est encore une fois la lettre mauvaise. Pour aboutir au nom maudit, d’une éblouissante formule (puisqu’il a pu engendrer un nom commun), le Z qui zèbre et fustige s’est perdu en route, il a fait place à la plus douce des dentales. »[31] Ça quoi maintenant : Ça Dieu ?
Sous la poussée de la même pression, et du même mouvement rhapsodique, Sade releva toujours le même défi, dut-il le lancer du fond de sa prison : mettre en place son propre trafic de dopant, sans disposer pourtant d’aucun produit sauf le fruit de sa littérature ; ni d’aucun complice sauf à se trouver des lecteurs. Trafic qui déchaîna en vain contre lui toutes les polices criminelles et médicales de l’Europe, il éleva le dopant à la dignité conceptuelle du mal, en lui présentant non seulement son tableau clinique et son programme, mais l’expérience intérieure où se construit méticuleusement son enfer et sa graduation ; moyennant quoi Sade donne un nouveau sens au mot de voyage pour y déterminer le contrat qu’il passe avec son lecteur, à qui il présente à la fois le résultat et le guide d’une performance — autant que le gage d’un pari et son prix en nature.
« Le lieu sadien est unique : on ne voyage tant que pour s’enfermer », reconnaissait Barthes[32]. Et pour s’oublier — là où se constitue le défi qui fait du roman sadien un véhicule de transport en jouissance, en imposant toutefois à son lecteur de devenir, à son tour, une créature sadienne. Et, s’il lui concède le droit de juger son œuvre, Sade n’impose pas moins à son œuvre le devoir de juger son lecteur.
Les aristocrates anglais qui fondaient le Jockey Club dans les années 1750, ou ceux qui organisaient les premiers matchs de boxe, offraient également à des performances d’être l’enjeu d’un pari. Ainsi naissait le sport, au sens actuel. Au moment où l’artillerie devenait l’arme déterminante de la guerre, l’exploit physique de l’homme, comme celui du cheval, n’avait plus guère d’intérêt militaire, mais gagnait à se déplacer sur le terrain sportif une plus-value d’autant plus jouissive qu’elle ne prenait plus en compte que la prouesse en soi et sa mesure. Voilà précisément le terrain qu’investit Sade. Voilà aussi pourquoi son lieu anticipe le plan et le conditionnement de la salle de sport. Si elles se vouent au mal, ses créatures ne doivent pas moins à se conformer à une règle du jeu, à un emploi de temps, à une hygiène (serait-elle répugnante), à un strict régime alimentaire, à des exercices quotidiens d’échauffement, d’entraînement, d’endurance — à une ascèse, en somme. Sans ce réglage lancinant et monotone, impossible de se dépasser et de battre des records.
« Comment, c’est déjà fini ? ça n’a pas été long », dit-il en apercevant Maurice qu’il croyait en train de frapper celui qu’on avait surnommé, par allusion à un journal qui paraissait à cette époque : L’Homme enchaîné. « Ce n’est pas long pour toi qui est allé prendre l’air », répondit Maurice, froissé qu’on vît qu’il avait déplu là-haut. « Mais si tu étais obligé de taper à tour de bras comme moi par cette chaleur ! » écrit Proust[33] en investissant à son tour le bordel pour devenir par nécessité, autant que par vocation littéraire, une créature sadienne. Et remarque-t-il que le dopage y crée aussi une règle. Ils disent qu’ils sont malades. Malades je t’en fiche, c’est des gens à prendre de la coco, ils ont l’air à moitié piqués.[34] Ou plutôt remarque-t-il que le dopage y crée la règle. Car, si sa langue recourt à la jalousie plus souvent qu’à la drogue, elle ne porte pas moins la même promesse. Et elle enveloppe le même objet, nécessairement tu pour être désiré. « Je crois que nous ferions bien par pudeur de le tenir toujours sous le voile », convient Sade[35] — puisque sa fonction relève de la poussée et qu’exposé en détail pour être expérimenté, il perdrait bientôt sa force impulsive, sauf à laisser entrevoir un autre versant du secret où s’envisagerait le même être insaisissable, sans quoi précisément il n’est pas de voyage ; sans quoi surtout il n’est pas de progression.
« Il est onze heures du soir. On fume depuis cinq minutes ; on consulte sa montre : il est cinq heures du matin », note Cocteau[36]. Cependant le regard sur la montre annonce le besoin d’une nouvelle pipe. Ainsi le dopage exige-t-il son dosage et le cadrage méticuleux de son temps, avec le paradoxe que la ruine du temps — que la perte de la notion du temps sous l’emprise du dopant — ne laisse pas moins subsister en soi une mécanique horlogère d’une admirable régularité, dont les axes, les roues, les crans composent le fond de l’anatomie du champion. Anatomie artificielle, sans doute, mais qui épouse sa nature intime, du moins celle qui ressort de sa vocation, comme en adhérant à son système nerveux et à la chimie organique produite par le travail et le souci en soi de la performance.
Dans les années 1870, ce fut la « maladie du soldat » qui amena les psychiatres à reconsidérer l’usage de la morphine et à songer à mettre au point une méthode de sevrage. La « maladie du sportif » ne les conduit pas moins aujourd’hui à reconfigurer les paramètres de ce même domaine de recherche. La « maladie du sportif » n’est pourtant pas si récente. Le premier cas répertorié de dopage remonte à 1865 lors d’une compétition de natation à Amsterdam. Le mot apparaît en 1903 dans le dictionnaire Larousse, prélevé dans le monde des courses hippiques. Mais les archives du cyclisme, pour être moins élégantes, témoignent combien déjà, à la même époque, l’usage du « pot des fous » ou du « pot belge », administré par injection, était répandu chez les coureurs. Mélange de caféine, de cocaïne, de morphine et d’héroïne, il rappelle la pharmacie de Proust. Cocktail auquel on adjoindrait ensuite des amphétamines. Avant que ne se multiplient les contrôles d’urine sur le Tour de France, les soigneurs le dispensaient jusque dans les années 1990. L’emploi des corticoïdes, des anabolisants, de bêtabloquants, et de toute une nouvelle cuisine d’hormones et de transfusions sanguines, mais également de produits masquants, lui crée une sophistication qui ne date pas non plus d’hier, quoiqu’elle ne cesse de se perfectionner et qu’elle défie toutes les tactiques de prévention, de prohibition, de répression — comme déjà Sade en son temps.
« Ton corps est à toi, à toi seule, il n’y a donc que toi seule au monde qui aies le droit d’en jouir et d’en faire jouir qui bon te semble », assure Dolancé à l’Eugénie de La Philosophie dans le boudoir[37]. Parole d’entraîneur sadien. Et lui faut-il non seulement flairer, repérer, sélectionner, flatter, célébrer l’athlète en puissance, mais le rendre dépendant d’un conditionnement qui le force à gagner sous peine d’être rejeté hors du clan ; un clan qui mobilise tout le temps du futur champion et le coupe de sa famille, de ses amitiés, de ses loisirs ; un clan qui, hormis les compétitions, se limite à l’entraîneur, au club et à l’équipe. Voilà qui organise le conservatoire de musique comme l’école de danse ; l’agence de mannequins comme l’écurie de course ; la maison close comme la « boîte ». Tous ces lieux, pourtant si hétérogènes, ne pourraient pas échanger leur nom sans se conformer au schéma sadien de la salle de sport, et à la nécessité de mécaniser le corps de l’adolescent, en employant une méthode qui doit à l’auteur de Juliette, non sa pratique car on l’expérimentait depuis toujours, mais sa théorie en philosophie, là où elle n’a guère d’antécédent, ne serait-ce que parce qu’elle ne vise plus la vérité ni l’essence, mais l’efficacité du discours sur soi, l’exploit que crée sa radicalité et la saturation jouissive de son objectif.
« Toi, c’est dégoûtant, je t’ai aperçu devant l’Olympia avec deux cartons. C’est pour te faire donner du pèze. Voilà comme tu me trompes. » Heureusement pour celui à qui s’adressait cette phrase il n’eut pas le temps de déclarer qu’il n’eût jamais accepté de « pèze » d’une femme, ce qui eût diminué l’excitation de M. de Charlus et réserva sa protestation pour la fin de la phrase en disant : « Oh non ! je ne vous trompe pas. » Cette parole causa à M. de Charlus un vif plaisir et comme malgré lui le genre d’intelligence qui était naturellement le sien ressortait d’à travers celui qu’il affectait, il se retourna vers Jupien : « Il est gentil de me dire ça. Et comme il le dit bien. On dirait que c’est la vérité. Après tout, qu’est-ce que ça fait que ce soit la vérité ou non puisque il arrive à me le faire croire. »[38] Ainsi se construit la méthode pour peu qu’elle parvienne à réunir des affiliés, à les soumettre à sa règle du jeu, à les convaincre de ses prouesses. Or, en cela, le philosophe sadien se détache de ses créatures, par la force des choses, en se dotant d’une double vue et d’une double langue. C’est justement ce qui lui confère sa supériorité d’entraîneur, avec le don d’anticiper, de prévoir, de programmer la jouissance ; et de la doser comme de la fournir. Mais, en cela aussi, le philosophe sadien conçoit nécessairement le roman — le roman tout court, là encore.
S’il pousse son lecteur à accomplir un voyage stupéfiant et à y progresser, ce roman en soi n’est pas moins conceptuel en vous offrant la faculté hallucinatoire de diriger à mesure que Sade vous enseigne l’algèbre du pouvoir et l’arithmétique du mal. Seulement voilà une clause du contrat que vous n’aviez peut-être pas prévue en vous y engageant : le voyage sadien produit le bad trip le plus épouvantable qui puisse s’entrevoir et s’éprouver, toujours selon la même nécessité, sans quoi l’opération de chimie naturelle à sa littérature perdrait sa qualité dopante, en vous empêchant d’avoir pitié de soi et de remonter jusqu’à votre gisement d’endomorphine pour l’extraire à volonté. « Ceci tient à l’histoire du cœur humain, et c’est à cela particulièrement que nous travaillons », explique Sade[39]. Remarquez qu’il évite de dire « ça », pour donner un sens nouveau à « cela ». Remarquez aussi qu’il y construit un lieu romanesque qui, pour être hallucinogène, ne fonctionne plus seulement comme une salle d’entraînement, mais comme un laboratoire en sciences humaines et sociales. De fait, s’il passa les treize dernières années de sa vie à Charenton, et si le régime impérial l’y priva de liberté, Sade dut à la conception de ce contrat, et à son don prophétique, d’y être admis comme partenaire privilégié ; interné, contrôlé, surveillé, épié nuit et jour, auquel l’Empire ne livrait pas moins un théâtre, une troupe d’acteurs, un financement et une extraordinaire publicité. Il n’est guère de metteurs en scène actuels qui n’envient, au fond, de passer un tel pacte avec le Prince
Pacte que Sade passe également avec son lecteur, pacte conclu sous le sceau du secret par la même force des choses et la même double vue qui tiennent à sa vocation d’entraîneur et requièrent de son partenaire qu’il désapprenne la différence entre philosophie et littérature : vieille leçon socratique, mais sur quoi il s’appuie à sa manière pour fonder ou refonder l’école du roman dont Proust sera l’héritier.
C’est que Bergotte, notait Proust, si moderne par d’autres côtés, était le dernier représentant — le dernier pour le moment — car cette forme d’art peut renaître — d’un art intellectuel qui s’ingéniait à taire beaucoup de ce qu’il voulait dire, à laisser signifier beaucoup par la composition, par la signification, par l’ironie.[40] Contrat du remède avec le poison, de la vertu avec le vice, du bien avec le mal, contrat implicite et insinuant dont émane un parfum sans pareil, mais qui n’est si proustien que parce qu’il dépend d’une filiation, d’une filière dont Sainte-Beuve fut le premier à reconnaître le laboratoire, à flairer la farine, à dénoncer le trafic : « J’oserai affirmer, sans crainte d’être démenti », assurait Sainte-Beuve « que Byron et Sade (je demande pardon du rapprochement) ont peut-être été les deux plus grands inspirateurs de nos modernes, l’un affiché et visible, l’autre clandestin. […] En lisant certains de nos romanciers en vogue, si vous voulez le fond du coffre, l’escalier secret de l’alcôve, ne perdez jamais cette dernière clé. »[41] Révélation publiée en 1843 dans La Revue des Deux Mondes, qui visait l’auteur des Illusions perdues en premier lieu.
Livrer les épisodes d’un roman « comme dans le journal » ; faire éprouver à son lecteur le même souci d’information, la même accoutumance, la même dépendance, la même urgence au savoir : l’art de Balzac ne tient pas qu’à cela, mais lui doit sûrement sa portée et son impact. Non seulement parce qu’il exploite mieux que personne l’idée du saucissonnage d’un roman en feuilleton dans les journaux parisiens, mais qu’il ne craint pas de faire épouser à sa langue le même code ; du moins de jouer constamment avec ce code, ses suspensions, ses respirations, son rythme, son souffle. Ressuscite-t-il le maître sadien en arithmétique pour qui le calcul secret, contenu, retenu dans l’énoncé romanesque, articule et actionne la fonction stratégique de la langue : sa rhapsodie entraînante, endurante, jouissive — avec la différence que Balzac substitue le génie du journaliste à celui du pornographe, encore que l’un et l’autre envisagent les mêmes contraintes, le même deal, et comprennent, au fond, la même réclame. Seulement pour décrypter les figures insufflées dans La Comédie humaine, et se laisser soulever par leur puissance hallucinatoire, faut-il savoir y repérer l’intrication d’un tout autre code. Diffère-t-il radicalement de celui du quotidien à grand tirage, lequel ne sert, en somme, qu’à recruter le disciple. Et si Proust regrettait parfois les vulgarités, les niaiseries, les hâbleries de Balzac, il n’admirait pas moins sa langue souterraine et l’expérience intérieure qu’elle induit : Chaque mot, chaque geste, note-t-il, a ainsi des dessous dont Balzac n’avertit pas le lecteur et qui sont d’une profondeur admirable. Ils relèvent d’une psychologie si spéciale et qui, sauf par Balzac, n’a jamais été faite par personne, qu’il est assez délicat de les indiquer.[42]
En abordant l’homosexualité dans Contre Sainte-Beuve, Proust prend bien des précautions avant d’en venir au fait, en donnant la mesure de la superstition qui affectait alors le mot (d’ailleurs tout récent) quand il n’était pas employé à des fins de prophylaxie médicale ou de réprobation morale, mais plus encore du raffinement de savoir, du privilège de lecture, des lettres de noblesse qu’il confère à qui parvient à pénétrer son univers. Du moins Proust feint-il d’user de ces précautions en créant un embryon à l’essai sur la Pédérastie qu’il projetait de publier malgré les mises en garde de ses amis — essai qui, après bien de remaniements, deviendrait Sodome et Gomorrhe.
Tout, depuis la manière dont Vautrin arrête sur la route Lucien qu’il ne connaît pas et dont le physique seul a donc pu l’intéresser, jusqu’à ces gestes involontaires par lesquels il lui prend le bras, etc., ne trahit-il pas le sens très différent et très précis des théories de domination, d’alliance à deux dans la vie, etc., dont le faux chanoine colore aux yeux de Lucien, et peut-être aux siens mêmes, une pensée inavouée. La parenthèse à propos de l’homme qui a la passion de manger du papier n’est-elle pas aussi un trait de caractère admirable de Vautrin et de tous ses pareils, une de leurs théories favorites, le peu qu’il laisse échapper de leur secret ? Mais le plus beau sans conteste est le merveilleux passage où les deux voyageurs passent devant les ruines du château de Rastignac. J’appelle cela, dit Proust, la Tristesse d’Olympio de l’Homosexualité.[43]
Avoir la passion de « manger du papier » — en termes clairs, en termes d’aujourd’hui (car les mots aussi sont affaire de temps) : avoir la passion de la fellation. À l’image de la pâte à papier, associez la consistance du sperme pour entrevoir l’acte que voile l’expression. Le besoin de suggérer par une métaphore un régime alimentaire, mais pas moins sentimental, que les codes sociaux interdisaient d’énoncer produit dans l’œuvre de Balzac cette langue dans la langue, cette langue en la langue, qui n’est pas seulement celle de la « tante » et de sa dissimulation forcée dans la société de son temps, mais la langue sensuelle du complot, d’un complot qui mêle à la fois l’ordre du besoin, de l’argent, du pouvoir, de la jouissance, de l’absolu, du complot en soi en langue balzacienne.
Ce double intérieur que Balzac se crée en Vautrin, précisément parce qu’il gère le nœud sans quoi le roman n’existerait pas — sans quoi, non plus, il ne disposerait pas du révélateur des passions humaines —, ce double scabreux ne lui impose pas seulement de laisser se profiler le phallus, et d’installer l’ars erotica au centre du processus initiatique qui le lie à son lecteur, mais d’organiser une zone tourbillonnaire et hallucinatoire au cœur de sa littérature. « Il se mit à rire superbement. “Et, se dit-il, ils me croient, ils obéissent à mes révélations, et ils me laisseront à ma place. Je régnerai toujours sur ce monde, qui, depuis vingt-cinq ans, m’obéit…” » écrit-il[44] à la fin de Splendeurs et misères des courtisanes en se logeant plus que jamais dans la pensée de Vautrin. Mais lui, Balzac, mangeait-il réellement du papier ? Qui sait ? Secret extraordinairement rétracté ; secret qu’il faut déduire de sa comptabilité romanesque, comme on déduit une loi de l’observation, mais qui constitue sa plus-value, autant par contrainte que par délicatesse, par jalousie que par mélancolie, par malice que par délice, avec le projet d’échapper à la plupart des lecteurs, en les invitant néanmoins à faire d’eux-mêmes cette déduction et d’en manger à leur tour. D’où l’analyse qu’en tirait Proust — que le point de vue de Vautrin est le point de vue de Balzac.[45] Manger du papier, au sens balzacien, tient essentiellement en cela ; et, si cette drogue est effectivement géniale, c’est qu’elle permet de les révéler toutes rien qu’à en taire une seule.
« Je me trouve dans la situation où fut le baron de Goërtz, le fameux ministre de Charles XII, qui arriva sans secrétaire dans une petite ville en allant en Suède, comme moi je vais à Paris. Le baron rencontra le fils d’un orfèvre, remarquable par une beauté qui ne pouvait certes pas valoir la vôtre », avoue Vautrin sous le masque du faux abbé Herrera à Lucien. « Le baron de Goërtz trouve à ce jeune homme de l’intelligence, comme moi je vous trouve de la poésie au front ; il le prend dans sa voiture, comme moi je vais vous prendre dans la mienne ; et, de cet enfant condamné à brunir des couverts et à fabriquer des bijoux dans une petite ville de province comme Angoulême, il fait son favori, comme vous serez le mien. Arrivé à Stockholm, il installe son secrétaire et l’accable de travaux. Le jeune secrétaire passe les nuits à écrire ; et, comme tous les grands travailleurs, il contracte une habitude, il se met à mâcher du papier. […] Notre beau jeune homme commence par du papier blanc, mais il s’y accoutume et passe aux papiers écrits qu’il trouve plus savoureux… »[46]
Même constat sadien, même programme que dans Juliette : accoutumance fulgurante, dépendance à vie. Balzac, selon la leçon de Sade, crée au dopant un objet romanesque qui, s’il produit l’hallucination et reste insaisissable, ne nourrit pas moins la langue qui le lèche. Faut-il encore que Balzac retrouve le secret de sa fabrication et que son génie l’améliore, mais qu’il remonte aussi sa filière et reconçoive la chaîne de sa production, de sa distribution, de sa publicité, de son commerce de détail. Le romancier s’y accroche autant que le journaliste, le libraire, l’éditeur, l’imprimeur, l’inventeur de la pâte. Reconnaissez les personnages des Illusions perdues comme ceux de l’industrie de la littérature — en quoi consiste, là au sens le plus concret, manger du papier.
Les créatures sadiennes avalaient toutes sortes d’horreurs, proprement innommables sauf en langue pornographique, mais elles appréciaient par-dessus tout la matière fécale. Initier méticuleusement son lecteur aux rites de ce régime et à sa gastronomie offre l’une de ses signatures à Sade, là où se reconnaît son parti pris à la fois le plus répugnant et le plus métaphorique. Car la coprophagie n’était sûrement pas aussi répandue chez les libertins qu’on le croirait à le lire à la lettre — sauf à entrevoir que le chocolat pouvait fournir les mêmes crottes en apparence, d’autant que les chocolatiers y fourraient toutes sortes de liqueurs ou d’épices, de la coca en particulier, en offrant un motif à des farces aussi comiques au regard de l’initié qu’immondes pour le novice. Si impressionnant qu’il soit sur la scène du théâtre sadien, et quel qu’il soit en réalité, un tel aliment prenait déjà en compte la valeur de ce que les lycéens actuels appellent gaiement le shit. Aliment primaire, mais au fond aussi initiatique, aussi conceptuel, aussi romanesque que le papier balzacien, il envisage la même figure symbolique, les mêmes enjeux phénoménologiques, les mêmes rites maniaques, et s’il s’est banalisé aujourd’hui, il peut toujours valoir à un adolescent des ennuis considérables.
« Si vous croyiez que ce joli homme, condamné à mort pour avoir mangé le traité relatif à la Finlande, se corrige de son goût dépravé, vous ne connaîtriez pas l’empire du vice sur l’homme ; la peine de mort ne l’arrête pas quand il s’agit d’une jouissance qu’il s’est créée ! »[47] confie Vautrin à Rubempré. Observez cependant que la Finlande et la Suède tracent sur la carte de l’Europe la figure phallique qui offre à la confidence son mordant obscène et sa qualité spirituelle, sans quoi le traité diplomatique perdrait toute saveur. Au lecteur desIllusions perdues, maintenant, de prendre le risque de l’avaler et de renouer avec Balzac le contrat sadien — seulement, désormais, il ne passe plus entre libertins mais entre tantes.
Là se mesure l’écart entre Ancien et Nouveau Régime. « Aller déposer ses “bijoux” chez sa tante » définissait à l’époque de Sade, dans l’argot de la prostitution masculine, l’acte même de se vendre. Entendez alors par la tante : la tentation ; la bouche, l’anus, la matrice, la visée, mais également le trottoir, l’attente ; fonction spéculative, cause d’une rente régulière et clandestine ; le « mont-de-piété » en langue du blasphème. En langue balzacienne, le mot désigne à présent un personnage, à quoi Vautrin, Rubempré ou Rastignac, chacun à leur manière, prêtent leurs propres traits, sinon leur auteur ; et si intéressants, si captivants, si hallucinants que Proust songea d’abord à appeler La Race des tantes l’étude qui deviendraitSodome et Gomorrhe. Car Balzac n’introduit pas seulement le personnage dans la littérature française, mais son effet de stupéfaction dont des expressions — « lion », « fashionable », « dandy » —, expressions encore récentes en son temps, issues du tourisme des aristocrates anglais à Paris, et passées dans le milieu de la presse, diffusaient l’écho élégant sur les boulevards, pourtant en investissant le même souterrain et en envisageant le même nœud, le même « vice ». Lucien de Rubempré, note Proust, même dans ses apartés, a juste la gaieté vulgaire, le relent de jeunesse inculte qui doit plaire à Vautrin : « Allons, pensa Lucien, il connaît la bouillotte. »[48] « Connaître la bouillotte » — là encore, l’expression, également argotique et parisienne, se serait à jamais perdue sans Balzac, et si la bouillotte désigne un jeu de cartes ne joue-t-elle pas moins double jeu, voire triple, en sollicitant une bourse ne parle pas moins que manger du papier à l’oreille d’un gigolo.
Remarquez surtout qu’à présent sexe, drogue et littérature parlent la même langue chiffrée en anticipant la même délectation. Tient-elle autant à la jouissance du déchiffrage en soi qu’à l’acte secret qui s’y profile ; acte cependant irréductible à sa seule qualité érotique, ou stupéfiante, ou romanesque, mais qui les confond toutes trois par nécessité de solidarité initiatique, trangressive et subversive. En cela, précisément, fait-elle naître la tante et sa triple identité : producteur de plaisir, agent d’individuation et de subjectivation, monstre grammatical ni masculin, ni féminin, ni neutre.
« Pour donner une vague idée du personnage que les reclus, les argousins et les surveillants appellent une tante, il suffira — conclut Balzac — de rapporter ce mot magnifique du directeur d’une des maisons centrales au feu lord Durham, qui visita toutes les prisons durant son séjour à Paris. […] “Je ne mène pas là Votre Seigneurie, dit-il, car c’est le quartier destantes…
— Hao ! fit lord Durham, et qu’est-ce ?
— Le troisième sexe, milord.” »[49]
Appréciez le trait d’esprit lancé par ce Hao ! Entrevoyez et entendez, dans sa réverbération comme dans sa réversibilité, que Sa Seigneurie n’est pas moins tante que les prisonniers qui excitent sa curiosité. Notez surtout que ce mot de passe ne met pas seulement en jeu entre Balzac et son lecteur la connivence qui exige, suivant la leçon socratique, que vous deveniez à votre tour une tante — ne serait-ce qu’au sens conceptuel, selon sa triple identité, mais dans sa retenue la plus clandestine, la plus intéressante, peut-être, sans perdre de vue toutefois le risque éthique que vous ne prenez pas moins, même là, à en être —, car par là, entre soi, Balzac met d’abord en jeu l’objectif qui permet de reconsidérer la Comédie humaine et sa profondeur de champ, toujours en suivant Socrate.
« J’ai de la peine à comprendre que ce petit garçon, si gentil, que j’ai tant vu vers 1885 et 1886, assis sur un tabouret auprès de Mme Straus, soit devenu l’auteur de tant de volumes indigestes ou nauséabonds comme le dernier : Sodome et Gomorrhe », déplorait Gustave Schlumberger. Et de conclure : « Le sang sémite qui coule dans ses veines est la seule explication possible. »[50]
En 1885, Proust n’a que treize ou quatorze ans : âge précoce pour débuter dans un salon — encore que voilà l’âge où jadis, à Athènes, l’éphèbe s’émancipait et se déniaisait. Salon hautement littéraire, mais également aristocratique, qui devait ce prestige à un cercle de dandies emblématiques du faubourg Saint-Germain : Boson de Sagan, Louis de Turenne, Henri de Breteuil, Antoine de Mouchy, Charles Haas, etc. Déjà âgés au moment où l’adolescent Proust les approche, ils avaient animé la dernière cour de France, et n’avaient cessé depuis lors de se retrouver dans les mêmes clubs, sur les mêmes champs de course, dans les mêmes théâtres, chez les mêmes hôtesses. La rubrique mondaine en livrait de tels échos que les princes en visite à Paris leur reconnaissaient d’évidence des rugissements balzaciens et trouvaient en eux les meilleurs guides pour s’initier au libertinage de la capitale, si bien que cette même presse prit l’habitude de les désigner sous le nom de « coterie du prince de Galles ». Remarquez que les princes russes s’y impliquaient tout autant, en engendrant l’expression, moins élégante mais plus parlante, de « tournée des grands-ducs ».
Entre les années 1840 et 1880, le souci des bonnes mœurs et le poids des ligues de vertu avaient poussé l’Angleterre, l’Allemagne, l’Autriche, les Etats-Unis et la plupart de pays de l’Europe du Nord, à réformer la législation du crime de sodomie. Il relevait depuis l’époque médiévale de la peine de mort et d’un supplice si barbare qu’il rendait pratiquement, au regard du Progrès, sa sanction inapplicable. L’emprisonnement, parfois les travaux forcés, lui furent substitués ; cependant on reconçut également les qualificatifs juridiques qui définissaient le crime. Ce qu’on entendait jusqu’alors par sodomie définissait un acte érotique et diabolique, voire de contraception. L’identité sexuelle des partenaires sodomites n’entrait nullement en jeu, du moins en théorie. Le droit en Europe du Nord considéra désormais que seules les relations entre hommes — ce qu’on appelait au temps de Sade la « bougrerie » ou la « pédérastie » — constituaient le délit, en faisant naître des craintes qui poussèrent les libertins anglais, en particulier, à franchir la Manche et à profiter à Paris de plaisirs auxquels il était risqué maintenant de se livrer à Londres. Vagues de panique, suivant les secousses de l’actualité judicaire, elles n’anticipaient pas moins des jouissances si alléchantes qu’elles rendraient vite suranné le « libertin » en langue française, pour lui faire goûter, apprécier, préférer le « dandy ».
Lord Lytton, ambassadeur d’Angleterre en France, assidu aux soirées de Mme Straus, renouvelait ce tourisme où s’arbitraient les élégances et y entraînait un mouvement qui conférait à ce lieu le privilège rare — qu’il ne partageait guère qu’avec le salon de la comtesse Greffulhe ou celui de Mme de Chevigné — d’accueillir la coterie du prince de Galles toute entière. « J’ai aperçu parfois chez Mme Straus, Oscar Wilde à l’apogée de sa renommée. C’était peu avant sa chute retentissante. Ce gros homme rasé me faisait horreur », assurait Schlumberger[51]. Car si, depuis les réformes de la Révolution et de l’Empire, le droit français avait exclu du code pénal la sanction de pratiques sexuelles (quelles qu’elles fussent, quand elles n’impliquaient pas de violence ni d’atteinte aux mineurs), les tantes ne souffraient pas moins, de ce côté de la Manche, d’une réputation ignoble. Wilde, mieux que personne, mesura le douloureux glissement sémantique de dandy à tante : celui que prévoyaient les Illusions perdues. Et Proust d’observer que Balzac, qui passe pour un grand peintre de la société, la peignit dans sa chambre, mais la génération suivante éprise de ses livres se peupla brusquement de Rastignac, de Rubempré qu’il avait inventés, mais qui existèrent.[52]
« À voir ses pieds, un homme aurait été d’autant plus tenté de le prendre pour une jeune fille déguisée, que, semblable à la plupart des hommes fins, pour ne pas dire astucieux, il avait les hanches conformées à celle d’une femme. Cet indice, rarement trompeur, était vrai chez Lucien, que la pente de son esprit remuant amenait souvent, quand il analysait l’état actuel de la société, sur le terrain de la dépravation particulière aux diplomates », écrit Balzac[53] comme s’il rédigeait une expertise médicale. Seulement il y dessine un profil psychosexuel que la médecine de son époque ignorait encore délibérément. Le cas même de Sade n’intéressait pas les aliénistes du Ier Empire — pourtant, quel cas ! — si ce n’est que les représentations théâtrales, les bals, les feux d’artifice que la direction de l’asile l’autorisait à y donner, les scandalisaient. « Cet homme n’est point aliéné. Son seul délire est celui du vice, et ce n’est point dans une maison consacrée au traitement médical de l’aliénation que cette espèce de délire peut être réprimée. Il faut que l’individu qui en est atteint soit soumis à la séquestration la plus sévère », réclamait Royer-Collard[54], le médecin-chef de Charenton. Et de dénoncer la cruauté des traitements auxquels l’abbé de Coulmier, le directeur de l’asile, soumettait les fous autant que les privilèges qu’il conférait à un monstre ; et de mener campagne pour obtenir la révocation de l’abbé et le placement de Sade en forteresse. Sade n’assurait pas moins que l’effet causé par ses représentations avait « guéri près de cinquante malades. »[55]
Il est vrai qu’Esquirol, à qui le ministère de l’Intérieur confia ensuite la direction de Charenton, se décida à élaborer un tableau clinique des troubles maniacosexuels. Il reprenait des concepts fort anciens, issus des traités médicaux de l’antiquité gréco-romaine — l’érotomanie, le satyriasis, la nymphomanie — mais, en déterrant ce savoir que la théologie chrétienne avait si longtemps banni, il n’ignorait pas moins ce que Balzac appelait le troisième sexe. Esquirol appréciait pourtant la Comédie humaine et la compagnie de son auteur ; il lui organisait volontiers des visites de Charenton, lui présentait les fous les plus intéressants, le gardait souvent à dîner, les théories balzaciennes l’amusaient sûrement. Néanmoins en refusant d’accorder un crédit scientifique au troisième sexe, le médecin se conformait aux principes de la culture hellénistique comme aux fondements du code Napoléon. Et la tante patienterait jusqu’aux années 1880 pour devenir le sujet de laboratoire que Balzac pressentait lorsqu’il suivait lord Durham dans les prisons de Paris.
Fallait-il que l’expert en dégénérescence envisage de disséquer, au-delà du corps de l’individu, le corps social en son entier, et qu’il y repère des pathologies qui, jusqu’alors, relevaient des atteintes aux personnes, aux biens ou à l’ordre public : criminalité, délinquance, prostitution, ivrognerie, etc. La mise en jeu d’une tare héréditaire, d’origine vénérienne, dans une conduite perverse, violente ou criminelle, stimule alors les études en psychiatrie et les thèses en hygiène publique en même temps que la littérature de Zola. Si la nécessité de requalifier le tableau des troubles maniacosexuels se fit sentir plus tôt en Allemagne qu’en France, c’est que la législation du IIe Reich sanctionnait un délit auquel le droit français restait indifférent. Cependant le regard des bonnes mœurs ne le condamnait pas moins, et la psychiatrie allemande — à travers les travaux de Casper et de Krafft-Ebing — fit admettre sans peine, de ce côté du Rhin, la validité scientifique de ses thèses, et l’urgence qu’il y avait, maintenant, à encadrer conceptuellement et cliniquement l’homosexuel, aux titres de névropathe, de malade mental et de dégénéré, selon les degrés de son efféminement — degrés dont l’analyse découle des critères psychologiques et anthropomorphiques qu’avaient déterminés Balzac quand il observait le jeu de ses dandies.
Sous l’Ancien Régime en France, mais bien au-delà, dans la plupart des sociétés historiques en Occident comme en Orient, le personnage qu’on appelait à Rome l’impudicus, et en Grèce le diathemenos, soulevait déjà sur son passage une réprobation unanime, et prenait-il des risques où parfois il jouait sa vie. Paul Veyne souligne que les anciens Romains prêtaient « une attention démesurée à d’infimes détails de toilette, de prononciation, de geste, de démarche, pour poursuivre de leur mépris ceux qui trahissaient un manque de virilité. »[56] Les anciens Grecs également. Au fond, il n’est pas de société qui échappe à la même règle intestine ; mais dépend-elle d’une modulation subjective, mystérieuse, aléatoire, parfois extravagante, selon le caprice des habitudes morales et mentales. Un ecclésiastique travesti publiquement en femme du monde se présenterait aujourd’hui à l’Académie française et y serait élu qu’il provoquerait un scandale que la France d’Ancien Régime tolérait volontiers. Pourtant, alors, cette même France disposait d’une législation des plus répressives tant en matière de travestissement que de sodomie. Si elle ne s’appliquait guère, la loi ne sévissait pas moins le cas échéant — Sade en fit assez les frais. Cependant, à se réduire à une stricte affaire de sexualité, ce dispositif si complexe, si déroutant, si paradoxal, échappe encore à ses enjeux conceptuels.
Ce que les anciens Romains sanctionnaient quand ils réprouvaient l’impudeur tenait d’ailleurs moins au manque de virilité qu’au défaut d’ambition. Foucault note qu’« il est très difficile pour un Grec ou un Romain d’accepter l’idée qu’un garçon, qui sera amené — de par sa condition d’homme libre né dans une grande famille — à exercer des responsabilités familiales et sociales, et un pouvoir sur les autres — sénateur à Rome, homme politique orateur en Grèce — d’accepter l’idée que ce garçon ait été passif dans son rapport avec un homme. C’est une sorte d’impensable dans le jeu des valeurs morales, mais qu’on ne peut pas assimiler, non plus, à un interdit. Qu’un homme poursuive un garçon, il n’y a rien à redire à cela, et que ce garçon soit un esclave, à Rome surtout, ça ne peut être que naturel. Comme disait le dicton : “Se faire baiser : pour un esclave, c’est une nécessité ; pour un homme libre, c’est une honte ; et, pour un affranchi, c’est un service rendu.” »[57]
Ce qui rendait une réputation infâmante ou honorable ne tenait pas à la nature d’un rapport sexuel, mais au statut social et symbolique du partenaire avec lequel on s’affichait en public, ou avec qui on était surpris par mégarde, et au jeu des rôles qu’il impliquait. Baisé ou baiseur ? Passif ou actil ? Questions de comptabilité, il en allait de l’économie de soi et son bilan. À Rome ou à Athènes, elles débordaient largement le cadre légal et renvoyaient au code d’un savoir-vivre sous-jacent aux relations sociales comme aux spéculations théoriques, code dont les principes s’établissaient et se modulaient en fonction des circonstances, selon le statut des étants en cause. « Principes d’appréciation », explique Foucault, « non pas à partir de l’acte considéré dans sa forme plus ou moins régulière, mais à partir de l’acteur, de sa manière d’être, de sa situation propre, de son rapport aux autres et de la position qu’il occupe vis-à-vis d’eux. »[58] Principes de maintien avantageux qui me conseillent d’adopter telle tenue, tel langage, tel comportement, tel régime, telle posture sexuelle, au besoin, selon les opportunités. Principes subjectifs, soumis aux aléas de la vie autant qu’à l’assujettissement par plus grand que soi et au respect dû à sa grandeur. Principes qui me recommandent de pas hésiter, surtout, à changer de mode d’adaptation et de conformer constamment mon attitude à mon environnement, sans oublier les droits et les devoirs que me confèrent ma naissance, ma fortune, mes mérites, mes intérêts particuliers, encore qu’il importe par-dessus tout de ne jamais perdre la face, de tenir à ma réputation, de défendre mon honneur. Cultiver son ambition, tirer sa carte, lancer son atout, oui mais s’armer de prudence, de méfiance, de patience, de tempérance. Ne pas en faire trop, ni trop peu, juste assez. Principes de mesure rationnelle, autant que de pudeur éthique, qui offrent à une société le pouvoir de se regarder, de se raisonner, de se rationner, de réguler la constitution de sa hiérarchie, de contempler l’esthétique de sa civilisation, d’admirer ses performances, d’évaluer sa puissance, de jouir de son activité.
M. de Charlus m’eût sans doute pardonné mon manque de reconnaissance. Mais ce qui le rendait furieux, c’est que ma présence ce soir chez la princesse de Guermantes, comme depuis quelque temps chez sa cousine, paraissait narguer la déclaration solennelle : « On n’entre dans ces salons-là que par moi. » Faute grave, crime peut-être inexpiable, je n’avais pas suivi la voie hiérarchique[59], note le Narrateur en s’affrontant à ces mêmes principes, vieux comme le monde, et qui construisent le monde. Charlus en prend compte tous les enjeux spéculatifs et tous les paradoxes. Car l’estime de soi se jauge nécessairement dans l’impudeur — dans la chambre noire où s’apprécie le négatif intime qui la révèle — autant qu’en exposant son cliché positif, public et pudique. Procédure essentielle, confession à soi, voire aux autorités sanitaires — médicales, familiales, morales, religieuses, etc., — pour peu qu’on y soit obligé par malchance, souci ou repentir.
Blanche Boyer, sous le pseudonyme de baronne Staffe, connut de grands succès de librairie dans les années 1880 en publiant Les Usages du monde, et en multipliant ses Carnets du savoir-vivre. Elle n’empruntait pas moins sa méthodologie au docteur Proust et à son Traité d’hygiène publique et privée. Mais remontez jusqu’en Grèce, en Egypte, en Mésopotamie, en Inde, en Chine, au temps des toutes premières civilisations, vous y reconnaîtrez déjà des barons de Charlus, des baronnes Staff, des docteurs Proust, arbitres des élégances, prescripteurs des bonnes manières, fournisseurs de drogues compassionnelles, agents de rites maniaques, préfets de police sanitaire, portés par la lame de fond qui, à travers les âges, véhicule et développe cette technique de la vie en société dont l’objectif vise à assurer son meilleur maintien, au sens le plus large, coûte que coûte. Savoir vivre : savoir s’adapter — par nécessité. S’adapter à une nature forcément transitoire, parfois catastrophique, toujours menaçante, pourtant généreuse et ontologique, en investissant un champ qui ne cesse de s’élargir à mesure que l’histoire avance. Et, sans doute, cette méthode assure-t-elle réellement sa durée à l’être. « Modèle hellénistique », concevait Foucault : pratique de soi qui découle d’une école de la pensée dont les stoïciens sont les représentants les plus emblématiques, quoique y convergent la plupart des courants de la philosophie et de la sagesse.
Démocrite comparait déjà, au Ve siècle avant le Christ, « la sagesse qui libère les âmes à la médecine qui soigne les maladies du corps. »[60] Enjeu dont l’exigence et la grandeur apparaissent plus nettement encore chez Platon, quand, dans Gorgias, il enjoint au « jugement de justice d’être le traitement médical de la méchanceté. »[61] Ainsi s’accomplit la médicalisation de la conscience, et progresse-t-elle en même temps que les Grecs se vouent au culte d’Hygie, la déesse de la santé ; elle-même fille d’Esculape, le dieu de la médecine, et petite-fille d’Apollon, le médecin des dieux. Elle répandait les foules sur les marches des asclépeia des temples d’Epidaure, de Cos ou de Pergame. Cependant, gravée sur la porte du sanctuaire, une inscription prévenait : « Entrée interdite à la mort ». On y prenait des bains, on y purgeait son corps, on s’y lavait la tête. Soins qui réclamaient des latrines, des thermes, des salles de massage, des pharmacies, des pistes de danse, des chambres de repos, mais surtout un théâtre. Sade se donnait la même ambition quand il restaurait à l’hôpital de Charenton l’art de la tragédie, compris maintenant par sa pornographie. Aristote y concevait le principe même de la cure, de la purgation, de la catharsis, en assignant au philosophe autant qu’au poète la tâche de provoquer le choc salutaire qui viendrait à bout de la passivité en soi, origine de tous les maux. Mais les malades les plus atteints, ceux qui sentaient, ceux qui puaient la mort, étaient confiés à d’autres mains, à d’autres médecins, experts en chirurgie et pourvoyeurs de drogues autrement puissantes, qui relevaient, eux, de Panacée, la déesse de la science curative, sœur d’Hygie. S’y crée le partage entre la médecine spectaculaire de soi et la médecine intériorisée en soi.
Les guérisseurs ouabou-sekhmet, prêtres voués au culte de Sekhmet — la déesse égyptienne de la santé dont Hygie serait l’avatar — et les sounou, les médecins du pharaon, placés sous la tutelle de Thot, le dieu de la connaissance, opéraient déjà le même partage, des siècles auparavant, sur les bords du Nil. Mais à sélectionner les remèdes les plus efficaces, à distinguer les pratiques qui assurent au mieux la vie, à définir les principes qui allongent son activité, ils travaillaient de concert au même effort rationnel dont dépendrait le développement de la philosophie. En atteignant le seuil et la perspective que s’ouvrait la méthodologie stoïcienne, Diogène Laërce associait naturellement maintenant les impudiques, « les hommes de mauvaise vie, voire ceux qui font profession d’être leurs disciples, à des malades dont les philosophes sont les médecins »[62], en requérant une nouvelle discipline, une nouvellepraxis : l’hygiène, qui participe autant de l’étude que du conditionnement de soi.
Si l’hygiéniste vise alors à former une élite, et à lui offrir un éthos qui la sépare du vulgaire, il n’élabore pas moins des remèdes, des régimes, des ascèses, des stratégies de vie qui prennent en compte toutes les relations sociales et travaillent en profondeur la civilisation gréco-romaine. Le nombre considérable de relais et d’échos de cette pensée dans la littérature et dans l’administration de l’Empire anticipe la médicalisation de l’Etat que Foucault repère en Allemagne au XVIIIe siècle — avec la différence qu’au lieu de solliciter, comme Frédéric II de Prusse, les médecins du corps, le Sénat de Rome puis ses empereurs requièrent les médecins de l’âme, mais en leur confiant la même expertise stratégique. Elle vaut à l’Etat romain d’organiser, de raisonner, de planifier l’intendance de son armée comme la gestion de ses cités. Elle le dote de sa carte routière, de son réseau d’égouts et d’aqueducs, mais plus largement des règles de son esthétique urbaine et de son élégance aristocratique. Ses thermes, ses gymnases, ses valetudinaria lui constituent déjà un système de santé publique et gratuite. Le nom même de curia — le « centre de soins » —, qui désignait à Rome le lieu symbolique du pouvoir, en porte l’emblème, tout comme le titre de curio — « soigneur » — offert au patricien romain quand il était éligible à des fonctions législatives ou administratives. Dans toutes les cités de l’Empire, le culte de Salus — avatar latin d’Hygie — célébrait cette conception à la fois sanitaire et salutaire du gouvernement.
En réalité, la réorganisation du corps médical au XVIIIe siècle fit basculer dans le domaine clinique des logisticiens qui, jusqu’alors, sous des noms divers, avaient relevé de la philosophie antique, puis de la théologie chrétienne — de la curie apostolique. Proust, à observer son propre père, n’admirait pas seulement le travail d’une ambition personnelle, mais celui du savoir de l’adaptation humaine au monde — savoir porté par l’histoire et qui conditionnait concrètement son présent.
Que vous alliez faire pipi chez la comtesse Caca, ou caca chez la baronne Pipi, c’est la même chose, vous aurez compromis votre réputation et pris un torchon breneux comme papier hygiénique. Ce qui est malpropre,[63] enseigne Charlus à Morel en recourrant à la même langue stratégique. Et sollicite-t-elle une conception intestinale de l’univers qui prévoit que toute substance, tout objet, tout sujet est destiné à être avalé, dégluti, digéré, décomposé et recomposé, sans fin ni finalité dans le temps, avaleur suprême, en quoi il offre son âme au monde. « La vie de chaque homme n’est pas autre chose que l’exhalaison du sang, la respiration de l’air. La nutrition n’est pas d’un autre ordre que l’acte qui excrète le superflu de l’alimentation », écrivait l’empereur Marc-Aurèle[64]. Considérer que tout corps se forme à partir de quatre substances graduelles — la terre, l’eau, l’air, le feu — produit le spectacle d’une macération atroce où fermente l’humanité, pas moins que la valorisation de la sécheresse, du souffle, de la flamme qui échappe au magma fécal. Si cette vision, quelque peu écœurante, fournit un motif de plaisanteries aux Guermantes, elle ne constitue pas moins l’un de ses principes actifs de l’assemblage d’une coterie ou d’une cour. Se doter d’égouts où se soulager, comme d’étuves où se purifier, façonnait les signaux essentiels qui permettaient au Grec de se différencier du barbare. D’où son inépuisable vertu métaphorique que Charlus, là encore, comprend mieux que personne : Croyez-vous que cet impertinent jeune homme, dit-il en me désignant à Mme de Surgis, vient de me demander, sans le moindre souci qu’on doit avoir de cacher ces sortes de besoins, si j’allais chez Mme de Saint-Euverte, c’est-à-dire, je pense, si j’avais la colique.[65]
La loi du sale et du propre, du noble et de l’ignoble, du pur et de l’impur, impose ses sentences aux sociétés humaines depuis la nuit des temps. Elle relève précisément de l’arbitrage des élégances — du « snobisme » où Lévi-Strauss décelait l’un des caractères les plus archaïques de l’humanité. Elle doit maintenant à la philosophie hygiéniste de pouvoir s’appuyer, avec le renfort de la raison, sur la rhétorique du malade et du sain, du passif et de l’actif, du pathos et du logos, mais de pouvoir surtout sacraliser et médicaliser, par le même acte thérapeutique, l’idéal de sa civilisation.
La diététique y joue un rôle majeur en lui imposant une économie fondée sur la recherche du tonus, mais plus encore sur le besoin du parfum. Épices, aromates, stupéfiants y servent autant à la cuisine qu’aux soins du corps et au culte des dieux, et s’échangent-ils sous forme de baumes, d’huiles essentielles, de poudres. Depuis des siècles, leur commerce passe par le royaume de Saba et trace la route initiatique que les Rois mages emprunteront à leur tour pour aller livrer l’or, l’encens, la myrrhe à Bethléem, en l’honneur du Messie nouveau-né. Mais déjà, bien avant la nativité, Diogène Laërce concevait dans le parfum le principe générateur de la vie : la vapeur pénétrante où se respire, s’inhale et s’absorbe l’âme universelle en requérant tous les sens.[66]
La lutte contre l’asthme obligeait Proust à porter une attention obsessionnelle à sa respiration, pas moins qu’à restaurer l’économie de l’encens et l’hygiène du pneuma. Prenait-il probablement de l’opium en procédant de la même manière qu’avec le datura, et peut-être les mélangeait-il, en s’enfumant comme les anciens Grecs ou les anciens Romains — l’effluve pénétrant l’âme autant que l’âme pénètre l’effluve. « Le premier caractère auquel on reconnaît la bonne qualité de l’opium est l’odeur ; on ne peut résister à celle de l’opium pur », relevait Pline l’Ancien dans son Histoire naturelle. « Le second caractère, c’est que, allumé à une lampe, il donne une flamme brillante, et que, après avoir été éteint, il répande de l’odeur ; ce qui n’arrive pas dans l’opium falsifié, qui s’allume plus difficilement et s’éteint souvent. »[67] « Picasso me disait : “L’odeur de l’opium est la moins bête du monde” », note Cocteau deux millénaires plus tard. Mais de mettre en garde : « Si vous ne l’enfermez pas dans une caisse de métal, et que vous vous contentez d’une boîte, le serpent noir aurait vite fait de ramper dehors. Soyez prévenu ! Il longe les murs, descend les marches, tourne, traverse le vestibule, la cour, la voûte, et bientôt il s’enroulera autour du cou du sergent de ville. »[68] Rien n’est plus volatil et entêtant que l’odeur de l’opium. Suffit-il d’un pot-pourri pour la diffuser dans un sanctuaire ou dans une chambre. Elle imprégnera vos meubles, vos étoffes, votre peau, avant que vous ne laissiez consumer sa macération sur un peu de braise pour accroître sa puissance et vous étuver. Ne craignez pas d’y gaspiller un produit si précieux. En réalité un fumeur passif, pour peu qu’il s’y soumette durablement, fixe une quantité aussi importante d’agent stupéfiant qu’un fumeur actif. Seulement s’évite-t-il de brûler ses voies respiratoires, et de s’affronter sans préparation ni initiation à la rencontre de l’âme universelle.
Pline précise : « Ce sont les seuls Arabes qui voient l’arbre de l’encens, et encore ne le voient-ils pas tous ; on dit que c’est le privilège de trois mille familles seulement, qui le possèdent par droit héréditaire ; que pour cela ces individus sont sacrés ; que lorsqu’ils taillent ces arbres ou font la récolte ils ne se souillent ni par le commerce avec les femmes ni en assistant à des funérailles, et que ces observances religieuses augmentent la quantité de la marchandise. »[69] Remarquez que Pline, le plus grand expert en botanique de son temps, n’est jamais parvenu à identifier la composition de l’encens : « On n’est pas même d’accord sur la forme de l’arbre. Nous avons fait des expéditions dans l’Arabie, les armées romaines ont pénétré dans une grande partie de ce pays, et même Caïus César, fils d’Auguste, lui a donné du renom. Cependant aucun Latin, que je sache, n’a décrit l’apparence de cet arbre. »[70]
Et d’indiquer : « On recueille en automne ce que l’été a produit ; c’est l’encens le plus pur, il est blanc. La seconde vendange se fait au printemps ; les écorces ont été incisées en hiver ; l’encens sort roux, il n’est pas comparable au premier. »[71] À transformer l’opium en morphine-base, les narcotrafiquants actuels obtiennent une matière visqueuse et rougeâtre, issue de la cuisson du suc de pavot dans une solution basique et acide : le brown sugar. Suffit-il d’y mélanger du jus de citron pour le rendre consommable. Il relève de la méthode la plus traditionnelle pour obtenir ensuite de la morphine blanche et il réclame des moyens que possédaient déjà la culture hellénistique. Pousser plus loin le raffinement du brown sugarexige du natron formé dans des eaux très salines. On extrayait sur les rives de la Mer Morte. Ce qui permettait peut-être aux laboratoires d’encens d’Alexandrie de le purifier et de le raffiner, avec d’extraordinaires précautions. Ces laboratoires d’encens, note Pline, « ne sont jamais suffisamment gardés ; on appose un cachet sur le caleçon des ouvriers ; on leur met un masque sur la tête, ou un réseau à mailles serrées ; on ne les laisse sortir que nus. »[72]
Dans les Mémoires de la Méditerranée, Fernand Braudel admire l’ingéniosité remarquable, déjà — au IIe siècle avant l’ère chrétienne —, d’Héron d’Alexandrie « inventeur de cent stratagèmes, de mécanismes compliqués, d’une carafe assortie d’un siphon qui verse ou ne verse pas, à volonté, l’eau qu’elle contient, d’engrenages, de roues dentées, de vis sans fin, etc. », mais surtout « d’un tourniquet qui utilise pour son mouvement la pression de la vapeur d’eau issue d’une chaudière miniature »[73]. Et Braudel de se demander par quel mystère la révolution industrielle ne s’est pas produite à Alexandrie ou à Rome, alors que les prouesses techniques de ses ingénieurs dotaient déjà leur civilisation de machines d’une puissance considérable, comme si leur science se limitait étrangement à réaliser des outils sans se soucier de leur usage, sauf à fournir des jouets à des enfants. Les siphons et les chaudières d’Héron n’offrent pas moins à un laboratoire de chimie la sophistication d’alambics dont auraient pu sortir les alcools indispensables au raffinement de la morphine. Qui sait si ce laboratoire n’a pas construit la chambre d’écho de la rationalité universelle, et les conditions historiques qui permettront à la civilisation gréco-romaine de s’étendre comme une flaque d’huile parfumée sur le monde, en s’appuyant déjà sur l’économie d’une véritable industrie chimique, maintenue toutefois sous le sceau du secret ?
L’habitude d’encenser les temples — c’est-à-dire de déposer une goutte d’encens sur un brûloir en l’honneur d’un dieu et de l’inhaler —, cette habitude se répand jusqu’en Perse, jusqu’en Inde, jusqu’en Chine, durant le Ier millénaire avant l’ère chrétienne, entretenue au long des siècles, et s’impose-t-elle à toutes formes de culte, en se normalisant et en requérant bientôt la même substance blanche, vendue à un prix exorbitant sous forme de baume ou de poudre compactée. Pline signale que son commerce donnait lieu à toutes sortes de falsifications. L’encens vendu couramment aujourd’hui, tiré du Boswellia, un arbuste odoriférant originaire du Yémen, n’en restitue peut-être qu’une espèce, ou l’un des excipients qui entraient dans sa composition. Quoi qu’il en soit, l’usage de l’opium médicinal se généralise selon le même processus historique. Hippocrate en définit les vertus thérapeutiques et prescrit une méthode d’enfumage pour calmer les hystériques. Héraclite de Tarente, le médecin de Philippe de Macédoine, diffuse une recette d’infusion de pavots bientôt célébrée jusqu’en Inde. Dioscoride, le médecin des armées romaines sous Néron, met au point le sirop diacode, un anti-tussif nettement plus opiacé. Gallien, le médecin de Marc-Aurèle, invente la thériaque, une boisson analgésique plus opiacée encore. En 312, sous Constantin, on répertorie à Rome près de 800 magasins vendant de l’opium, à un prix, modique, fixé par décret impérial. Pourtant le récit des rites et des effets de l’opium n’intégrait guère la littérature latine, ni celle des philosophes païens ni celle des Pères de l’Eglise. Cette pratique de soi se répercutait autrement. Investissait-elle la scène du théâtre tragique ; sûrement aussi le discours de l’âme stoïcienne, de son souffle ensemenceur, de son logos spermatikos ; bientôt l’hygiène rédemptrice de l’encensoir requis par la liturgie chrétienne et sa mystique, avec le même besoin de parfum céleste. Se sentir bon, s’il est inhérent à toute société humaine, ne constitue-t-il pas le besoin, parmi tous les besoins, dont on peut le moins se passer ?
La route de l’encens ne dessine-t-elle pas sur le carte du monde, entre Mer Rouge et Océan indien, le centre où se décide l’histoire ? Mais le parfum, au sens où nous l’entendons aujourd’hui, en vise-t-il seulement l’enjeu ? Ou faut-il encore convoquer dans ce mot de parfum, entre remède et poison, le sens phénoménologique que lui prêtait Proust : celui qui facilite les apparitions ? « Alexandre le Grand, dans son enfance, chargeant d’encens les autels avec prodigalité, son précepteur Léonides lui avait dit d’attendre, pour implorer les dieux de cette manière, qu’il eût subjugué les pays produisant l’encens », relève Pline[74]. Mais tous les grands conquérants n’ont-ils pas agi sous la même pression ? Grecs, Romains, Byzantins, Arabes, Croisés, Turcs, Chinois, Portugais, Espagnols, Français, Anglais, etc., n’ont-ils chacun leur tour formé des flottes et massé des armées pour s’emparer de cette route aussi commerciale que céleste ? Remarquez que la consignation de la formule de la morphine — à l’Académie des sciences de Paris en 1803 — suit de près l’expédition française en Egypte, avec pour visée l’Inde et le contrôle de cette même route, expédition où 150 savants accompagnaient Bonaparte, parmi lesquels nombre de médecins, de pharmaciens, de chimistes. Formé par Lavoisier, Armand Seguin qui cumulait les fonctions de banquier du Premier Consul, de fournisseur général de l’armée française et de médecin-chimiste, effectua lui-même le dépôt de la formule, encore qu’il réclamait de l’Académie des sciences de ne pas la publier. Cependant, moins de deux ans après le retour de l’expédition, de la morphine industrielle sortait du laboratoire Seguin, dans l’île qui porte toujours son nom près du pont du Sèvres, concurrencé déjà par le laboratoire Derosne sur le quai de Grenelle, et alimentaient-ils Paris en pilules et en poudre.
« Oh ! La douceur de la morphine ! Son froid délicieux sur la peau ! On dirait de la perle fine. Coulant liquide sur la peau », chantait Yvette Guibert au Divan japonais, un cabaret parisien célèbre alors, au début des années 1890. Refrain : « Je suis le dieu des morphinées. En quête de frissons nouveaux. Je suis le dieu des raffinées. Dont je détraque le cerveau. » Paroles de Jean Lorrain[75]. Notez qu’il emploie « morphinée » exclusivement au féminin — par facétie de tante, peut-être, mais pas seulement. Jules Claretie signalait, en 1881, dans sa chronique au Temps : « Les femmes, dont quelques-unes, par exemple, réclament tous leurs droits, ont conquis, depuis un certain nombre d’années, un droit bien singulier, tout nouveau, que je j’appellerai le droit à la morphine. »[76] Le docteur Notta constatait : « Il n’est pas d’ouvrière qui ne puisse se payer une seringue de Pravaz et “se piquer à la morphine” comme la plus riche hystérique. »[77] Et le docteur Gérard de livrer des statistiques : « 100 femmes morphinomanes pour 1 homme ».[78] Chiffres invérifiables. Cependant, dès les années 1860, les joailliers de Paris présentaient en vitrine d’admirables petites seringues en cristal taillé dans des étuis d’or, assorties à la préciosité de poudriers et de nécessaires du soir, dont les aiguilles visaient d’abord une clientèle féminine. Les magasins de jouets en livraient des copies miniatures, à peine moins luxueuses, mais d’un style plus rigoureux et médical, pour les petites filles. S’initiaient-elles à un nouveau jeu. Leur éducation prévoyait nécessairement maintenant des leçons dans une école d’infirmières. L’obtention d’un diplôme constituait une manière de dot. Il en allait de l’honneur des familles. Aux épouses, aux mères, aux sœurs de se préparer à soutenir un effort de guerre. Elle menaçait toujours avec l’Allemagne. Question de savoir-vivre, là encore : une débutante dans la bonne société s’inscrivait à la Croix-Rouge et y prenait des cours. La piqûre ne relevait-elle pas d’un geste couturier, propre aux femmes ?
La morphinomanie exigeait seulement des moyens considérables. Elle entraîna une vague de prostitution d’un ampleur sans précédent au faubourg Saint-Germain. La duchesse de Clermont-Tonnerre, qui fut la première biographe de Proust, relève le fait, encore qu’à ses yeux sa responsabilité revienne étrangement au prince de Galles : « Il instaura en Angleterre — et la France copia — la vie cynique. Renversant la valeur de la phrase grecque : “Et tout ce qui est heureux vient après…” — après l’Or, bien entendu — les dames commencèrent en douce à monnayer couramment leurs charmes, à Londres d’abord, puis à Paris. »[79] Il est vrai que la coterie du prince se formait en même temps que se répandait l’usage de la seringue de joaillerie. Le fait pourrait aussi expliquer le manège de Mlle de Stermaria, si troublant au regard du Narrateur : Il [Saint-Loup] m’avertissait, pour me montrer qu’il avait pensé à moi, qu’il avait rencontré à Tanger Mlle ou plutôt Mme de Stermaria, car elle avait divorcé après trois mois de mariage. Et Robert, se souvenant de ce que je lui avais dit à Balbec, avait demandé de ma part un rendez-vous à la jeune femme. Elle dînerait très volontiers avec moi […]. J’en pouvais croire la lettre de Saint–Loup. Mme de Stermaria se donnerait dès le premier soir.[80]
Pourtant, durant longtemps, jusqu’au bal de têtes du Temps retrouvé et à l’apparition de la vicomtesse de Saint-Fiacre, le Narrateur ne s’intéresse guère aux morphinomanes, sauf pour les comparer aux Juifs et aux invertis : « races maudites » dont les données construisent le profil pathologique de Marcel Proust en langue de théoricien de la dégénérescence. Faut-il croire que son Narrateur n’avait pas lu l’ouvrage du docteur Paul Rodet, Morphinisme et Morphinomanie, paru en 1897. « Toute la phalange de Cythère et de Lesbos, femmes du monde, artistes, filles de joie de toutes classes, toutes les névrosées, toutes les déséquilibrées, tout cela sacrifie sur l’autel de la déesse Morphine. Le nombre en est incalculable, elles sont légion », assurait Rodet[81]. Proust, lui, en revanche, l’avait sûrement lu. On croirait presque entendre son docteur Cottard : « Tenez, regardez », ajouta-t-il en me montrant Albertine et Andrée qui valsaient lentement, serrées l’une contre l’autre, « j’ai oublié mon lorgnon et je ne vois pas bien, mais elles sont certainement au comble de la jouissance. »[82] Et si Cottard s’abstient d’évoquer le morphinisme, la chronique de l’époque ne l’associe pas moins au saphisme. Il est étrange que l’enquête méticuleuse qui conduit le Narrateur sur les traces d’Albertine ne lui permette jamais d’envisager cette hypothèse, relayée si souvent alors par la presse et la littérature ; plus étrange encore que Swann n’y songe pas.
« Voilà qu’apparaissait une transformation nouvelle de cet éternel feminin, un être raffiné, de sensibilité indécise, d’âme inquiète, agitée, irrésolue, qui semblait avoir passé déjà par tous les narcotiques dont on apaise et on affole les nerfs, par le chloroforme qui assomme, par l’éther et par la morphine qui fouillent le rêve, éteignent les sens et endorment les émotions »[83], écrivait Maupassant en livrant Notre Cœur, en 1890. Tout Paris reconnaissait le portrait de Geneviève Straus dans son héroïne, Mme de Burne, rumeur qui ravissait le romancier. Proust lisait Maupassant depuis longtemps. Leur hôtesse lui offrait maintenant de l’étudier de plus près. Vous étiez dans votre lit, belle comme un ange qui aurait mauvaise mine, c’est-à-dire à rendre fous les mortels. Et n’ayant pas osé, pour ne pas vous faire mal à la tête le faire vraiment, ici, par fiction je vous embrasse tendrement. Votre petit Marcel, lui écrivait-il alors[84]. À dix-huit ans, toujours en alerte, mais persuadé au fond qu’elle préférait son adolescence et son audace aux valeurs littéraires ou aristocratiques affichées dans son salon, Proust observait Maupassant s’éprendre de Mme Straus comme on s’accroche à une drogue : même volupté, même déchirement, même cruauté. En quoi consiste la trame deNotre Cœur. Et s’agrège-t-il à un genre romanesque qui convoque à la fois Les Paradis artificiels et L’Education sentimentale. « L’amusant, c’est l’éloge que la femme portraiturée prodigue au livre : “Non, Maupassant n’a jamais si bien fait”, se tue-t-elle de répéter à tout le monde », signale Goncourt. « “Il y a tant de femmes comme ça !” Et comme Mme Sichel hasardait timidement : “Mais vraiment, si peu, si peu de tendresse pour un homme l’aimant si complètement ?…” elle lui jetait durement : “C’est bien ce que les hommes méritent !” » Et de conclure : « Oui, Geneviève est bien l’allumeuse sans cœur, sans tendresse, sans sens qu’est Mme de Burne. »[85]
Curieusement, plus encore que les lesbiennes et les prostituées, ce sont les femme du monde qui alarmaient la médecine française à la fin du XIXe siècle. Alors que leurs collègues allemands mettaient en place une barrière sanitaire pour circonscrire l’abcès de l’homosexualité masculine, les psychiatres français se préoccupaient surtout des « riches hystériques » — ce qui ne les empêchait pas de fréquenter leur salon, mais les rendait peut-être d’autant plus inquiets. Mme Straus connaissait si bien le docteur Sollier que, lorsqu’elle convainc Proust de subir une cure de désintoxication dans sa clinique, il lui suggère d’abord de demander à M. Sollier s’il ne voudrait pas beaucoup plus simplement, sans isolement, sans me faire entrer chez lui, rien qu’en changeant mes heures, mes repas, etc., me rendre un peu plus capable d’une vie normale.[86] Balzac le prévoyait encore : « Si les femmes des autres pays savaient ce qu’est à Paris une femme à la mode, riche et titrée, elles penseraient toutes à venir jouir de cette royauté magnifique. Les femmes vouées aux seuls liens de leur bienséance, à cette collection de petites lois déjà nommées assez souvent dans La Comédie humaine le Code Femelle, se moquent des lois que les hommes ont faites. »[87]
Veuve de Georges Bizet à qui, dit-on, elle inspira le personnage de Carmen, Mme Straus avait épousé un fils de James de Rothschild, fils naturel, néanmoins intégré et apprécié par les siens. Ils n’en faisaient guère de mystère. Le « monde » n’ignoraient pas ce secret. Avocat de la banque familiale, également amateur d’art à la manière de Swann, il participait — quoique sous le nom obscur d’Emile Straus — à la création de ce que les historiens du goût appellent le style Rothschild. Sa femme, alors, l’incarnait en soi. Cependant son salon devait à la filiation adultérine de son mari, à son romanesque et à l’espèce d’incognito qu’il lui créait, une part de son charme, mais d’autant plus de prestige, car il ne reprenait pas moins la succession du salon de la baronne James de Rothschild où fréquentaient Balzac et Ingres. Et Degas, maintenant, aimait voir Mme Straus se peigner des cheveux.
C’était le temps, se souvenait la duchesse de Clermont-Tonnerre « où les snobs disaient : “Demain, nous dînons chez Geneviève. — Geneviève… qui ? — Geneviève Straus, voyons !” »[88] En suivant amoureusement Jacques Bizet (le fis du compositeur de Carmen, son camarade alors au lycée Condorcet) comme le Narrateur piste Sain-Loup — encore que la réciproque ne soit pas moins vraie — le lycéen Proust prit tôt l’habitude de remonter et de redescendre les quelques centaines de mètres qui séparaient les deux univers : le cabinet du grand médecin hygiéniste, boulevard Malesherbes ; et si prés, pourtant à une distance fantastique en pensée, le salon de « Geneviève ». À l’angle de l’avenue de Messine et du boulevard Haussmann, face à la statue de Shakespeare, les Straus habitaient un immeuble tout récent, bardé de pilastres et de ferronneries, dont la rotonde écrasait sous le socle de son deuxième étage les fenêtres entresolées qui voilaient et sanctifiaient leur appartement. Vaste, admirablement décoré de peintures de Degas, de Monet, de Moreau, mais dans un espace banalement haussmannien, à plafond bas, le lieu ne laissait guère deviner qu’il animait le mythe du faubourg Saint-Germain, ce qui le rendait encore plus plaisant à explorer au regard d’un enfant. « Ce que l’on nomme en France le faubourg Saint-Germain n’est ni un quartier, ni une secte, ni une institution, ni rien qui se puisse nettement exprimer », expliquait Balzac[89]. Un bahut bourguignon ayant appartenu à la duchesse de Berry, un lit où aurait dormi la Pompadour, un cabinet incrusté de nacre provenant de Marie de Médicis… — l’inventaire du mobilier de Balzac, en anticipant le style Rothschild, animait déjà ce mythe, encore qu’il réservât d’autres surprises aux huissiers qui venaient régulièrement le saisir : Rembrandt, Véronèse, Rubens… seulement des noms inscrits sur les murs qui, en comblant des manques, lui laissaient la joie de profiter d’une telle collection, insaisissable celle-là, sauf à organiser sa propre salle des ventes, à y officier en commissaire-priseur, à y faire passer son temps. Le faubourg Saint-Germain y trouva son expertise et son estimation. Balzac sut lancer un tel objet sur le marché de l’antiquité et le faire hautement apprécier. À Proust de prendre son relais.
« Etonnée, je demandai qui était ce jeune homme singulier, se penchant avec tant d’exagération sur le dossier de la chaise dorée de Belloir où Mme Straus était assise. “C’est le petit Proust”, me répondit-on », racontait la duchesse de Clermont-Tonnerre[90]. Ne prenait-il pas prise alors chez les Rothschild, en suivant un dessein suscité par la charge symbolique de leur nom, comme son narrateur prend prise chez les Guermantes ? « Aucun ambitieux de Balzac n’a plus ardemment rêvé de cette mystérieuse contrée et de cette terre de Canaan. Y pénétrer est l’unique objet des vœux de ce novice, qui se figure un instant qu’il est amoureux de Mme de Guermantes elle-même, mais ne l’est en réalité que de cette Olympe où planent les grands dieux de la suprême mondanité et de l’inimitable élégance », commentait Paul Souday en rendant compte du Côté de Guermantes. Et de préciser, en livrant, à son tour, une sorte d’expertise médicale : « Esthète nerveux, un peu morbide, presque féminin… »[91]
Au moment où je vais publier Sodome et Gomorrhe, et où, parce que je parlerai de Sodome, personne n’aura le courage de prendre ma défense, d’avance vous frayez (sans méchanceté, j’en suis sûr) le chemin à tous les méchants, en me traitant de « féminin ». De féminin à efféminé, il n’y a qu’un pas. Ceux qui m’ont servi de témoins en duel vous diront si j’ai la mollesse des efféminés, lui répond aussitôt Proust, en formulant une autre objection : Comment, sachant probablement que j’ai toute ma vie connu des duchesses de Guermantes, n’avez-vous pas compris l’effort qu’il m’avait fallu faire pour me mettre à la place de quelqu’un qui n’en connaîtrait pas et souhaiterait d’en connaître ?— Là, comme pour le rêve, etc., etc., j’ai tâché de voir les choses du dedans, d’étudier l’imagination. Les romanciers snobs, ce sont ceux qui, du dehors, peignent ironiquement le snobisme qu’ils pratiquent.[92]
Le snobisme relève de l’hygiène la plus archaïque : celle qui fusionne en soi la parure et la propreté, l’élégance et la santé, le trait d’esprit et la raison, la justesse et la justice, l’arbitraire et l’arbitrage. Et d’agir par décret, par sentence, par ordonnance, en initiant à la médicalisation de la vie, mais par l’enseignement d’un savoir-vivre où le prêtre, le prescripteur de bonnes manières, le médecin, le fournisseur de drogues ne différencient pas encore leur rôle, et se confondent en un même acteur ou une même actrice, à qui le baron de Charlus, la duchesse de Guermantes, Swann ou les jeunes filles de Balbec offrent précisément leurs traits, superposés dans le flou voluptueux et séduisant d’une coterie, d’une petite bande. La drogue qu’elle suggère ne consisterait qu’en un objet purement virtuel que sa puissance n’en serait pas moins irrésistible, l’objet restant insaisissable, la petite bande opérant comme par prise d’otage de soi à distance, en créant le besoin d’en être.
Quant à Swann, pour tâcher de lui ressembler, je passais tout mon temps à table, à me tirer sur le nez et à me frotter les yeux. Mon père disait : « Cet enfant est idiot, il deviendra affreux. » J’aurais surtout voulu être aussi chauve que Swann.[93] Jeu puéril, il conditionne pourtant la vie du Narrateur. Là se mesurent son impact et sa portée ontologiques. Faut-il passer par là ! Là où le snob se rend odieux : snobant et snobé, actif et passif, sujet et assujetti — étant et ayant été. Il implique nécessairement le jeu de deux sens en soi s’annihilant l’un l’autre : nobilitate et sine nobilitate ; noble et ignoble ; remède et poison. Seulement produit-il la phénoménologie des parfums qui suscitent les apparitions : non plus soi, mais l’écran hallucinatoire d’une pensée séparée de son être, réfractée, projetée comme dans une chambre noire. Là où le roman s’invente : en mangeant du papier.
1. Paul Sollier, Méthode physiologique de démorphinisation, in Bulletin et mémoires de la Société Médicale de l’Elysée — cité par Alain Morel, in Le Traitement des toxicomanies à Boulogne, Le Trait d’Union, p.2.
2. Sigmund Freud, Remarques sur la cocaïnomanie et la la cocaïnophobie, in Un peu de cocaïne pour me délier la langue, Milo, p. 90.
3. Michel Foucault, La Volonté de savoir, Gallimard, pp. 164 et 166.
4. Emile Zola, Docteur Pascal, Livre de poche, p. 97.
5. Sigmund Freud, lettre du 2 juin 1884 à Martha Bernays.
6. Marcel Proust, Lettres, Plon, p. 235.
7. Marcel Proust, Correspondance, Plon, t.II, pp. 340-341.
8. Marcel Proust, Lettres, Plon, p.71.
9. André Gide, Journal, Pléiade, p. 692.
10. Charles Baudelaire. Les Tentations — le Spleen de Paris, XXI, Pléiade, t.I, p. 308
11. Sade, La Nouvelle Justine, Pléade, t.II, p. 981.
12. Marcel Proust, La Prisonnière, Pléiade, t. III, p. 720.
13. Mme de Sévigné, lettre du 16 octobre 1675, à Mme de Grignan.
14. Marcel Proust, Gustave Moreau, in Contre Sainte-Beuve (version Fallois), Gallimard, p. 392.
15. Edmond de Goncourt, Journal, Laffont, t. II, p. 940.
16. Marcel Proust, Somode et Gomorrhe, Pléiade, t. III, p. 64.
17. Michel Foucault, La Volonté de savoir, Gallimard, pp. 74-75.
18. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Pléiade, t. IV, p. 396.
19. Philippe Sollers, Théorie des Exceptions, Folio, p. 52.
20. Marcel Proust, Correspondance, t. XIX, p. 574.
21. Marcel Proust, Correspondance, t. III, p. 128.
22. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Pléiade, t. I, pp. 335-336.
23. Marcel Proust, Le Côté de Guermantes, Pléiade, t. II, p 789.
24. Sade, Juliette ou les Prospérités du vice, Pléiade, t. III, p. 770.
25. Jacques Derrida, La pharmacie de Platon, in La Dissémination, Seuil, p. 157.
26. Cité par Philippe Huisman et Marguerite Jallut, Marie-Antoinette, Vilo, p. 111.
27. Lettre du 9 juin 1777, à Léopold de Toscane, citée par Claude Manceron, Les Vingts ans du roi, Lafont, p. 442.
28. Gérard Delfau, Manuel complet des maladies des voies urinaires et des organes génitaux, Doin (1880), p. 145.
29. Sade, lettre à la marquise de Sade, fin 1784 — citée par Michel Delon, Notes, in Œuvres de Sade, Pléiade, t. II, p. 1372.
30. Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Seuil, p. 177.
31. Ibid., p. 177.
32. Ibid., p. 21.
33. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Pléiade, t. IV, p. 400.
34. Ibid., p. 393.
35. Sade, Les 120 Journées de Sodome, Pléiade, t. I, p. 236.
36. Jean Cocteau, Opium, Stock, p. 105.
37. Sade, La philosophie dans le boudoir, Pléiade, t. III, p. 38-39.
38. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Pléiade, t. IV, p. 404.
39. Sade, Les 120 Journées de Sodome, Pléiade, t. I, p. 102.
40. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Esquisse XXXIII, Pléiade, t. IV, p. 855.
41. Sainte-Beuve, in La Revue des Deux Monde, 1843 — cité à l’article Sade dans wikipédia.
42. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 273.
43. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Pléiade, pp. 273-274.
44. Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes, Pléiade, t. VI, p. 934.
45. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 273.
46. Honoré de Balzac, Illusions perdues, Pléiade, t. V, p. 692.
47. Ibid., p. 693.
48. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 272-273.
49. Honoré de Balzac, Splendeurs et Misères des courtisanes, Pléiade, t. VI, p. 840.
50. Gustave Schlumberger, Mes Souvenirs, Plon, t. II, p. 357 et p.190.
51. Ibid.,p. 226.
52. Marcel Proust, Correspondance, Plon, T. XIX, page 224.
53. Honoré de Balzac, Illusions perdues, p. 145.
54. Royer-Collard, Lettre du 2 août 1808 à Fouché — cité par Maurice Lever, Sade, Fayard, p. 629.
55. Sade, Lettre du 4 mai 1811 à Mme de Bimard — cité par Maurice Lever, Sade, Fayard, p. 646.
56. Paul Veyne, Sexe et pouvoir à Rome, Tallandier, p. 67.
57. Michel Foucault, Entretien, in Dits et Ecrits, Gallimard, t. II, p. 1106.
58. Michel Foucault, Le Souci de soi, Gallimard, p. 49.
59. Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Pléiade, t. III, p. 40.
60. Démocrite, Fragments, II, B 31.
61. Platon, Gorgias, 477 e.
62. Diogène Laërce, Vies, VI, 4 et 6
63. Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Pléiade, t. III, pp. 475-476.
64. Marc-Aurèle, Pensées, VI, 15 et 16.
65. Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Pléiade, t. III, p. 99.
66. Diogène Laërce, Vies, VII, 147.
67. Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XX, 76, 5.
68. Jean Cocteau, Opium, Stock, p. 106.
69. Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XII, 30, 2 et 3.
70. Ibid., XII, 31, 1.
71. Ibid., XII, 32, 2.
72. Ibid., XII, 32, 2.
73. Fernand Braudel, Les Mémoires de la Méditerranée, Fallois, pp. 298-299.
74. Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XII, 32, 4.
75. Pierre Kyria, Jean Lorrain, Paris 1973, p. 55 — cité par Jean-Jacques Yvorel, La morphinée : une femme dominée par son corps, Persée, en ligne, p. 108.
76. Jules Clarerie, Le Temps du 4 octobre 1881 — cité par Jean-Jacques Yvorel, ibid, p. 106.
77. Maurice Notta, La morphine et la morphinomanie, in Archives générales de médecine, 1884, vol. 2, p. 581 — cité par Jean-Jacques Yvorel, ibid, p. 106.
78. Cité par Jean-Jacques Yvorel, ibid, p. 107.
79. Elizabeth de Clermont-Tonnerre, Mémoires, Grasset, t. II, p. 19.
80. Marcel Proust, Le Côté de Guermantes, Pléiade, t. II, p. 643.
81. Paul Rodet, Morphinisme et Morphinomanie, Paris, 1897 — cité par Jean-Jacques Yvorel, La morphinée : une femme dominée par son corps, Persée, en ligne, p. 108.
82. Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Pléiade, t. III, p. 191.
83. Guy de Maupassant, Notre Cœur, in Romans, Pléiade, p. 1059.
84. Marcel Proust, Correspondance avec Mme Straus, Livre de poche, pp. 15-16.
85. Edmond de Goncourt, Journal, Laffont, t. III, p. 443.
86. Marcel Proust, Correspondance avec Mme Straus, Livre de poche, p. 55.
87. Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes, Pléiade, t. VI, p. 781.
88. Elizabeth de Clermont-Tonnerre, Mémoires, Grasset, t. I, p. 203.
89. Honoré de Balzac, La Duchesse de Langeais, Flammarion, p. 63.
90. Elizabeth de Clermont-Tonnerre, Robert de Montesquiou et Marcel Proust, Flammarion, p. 9.
91. Paul Souday, Le Temps du 4 novembre 1920 — cité notes 4 et 12, in Marcel Proust, Correspondance, t. XIX, Plon, pp. 576-577.
92. Marcel Proust, Correspondance, t. XIX, Plon, pp. 574-575.
93. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Pléiade, t. I, p. 406.






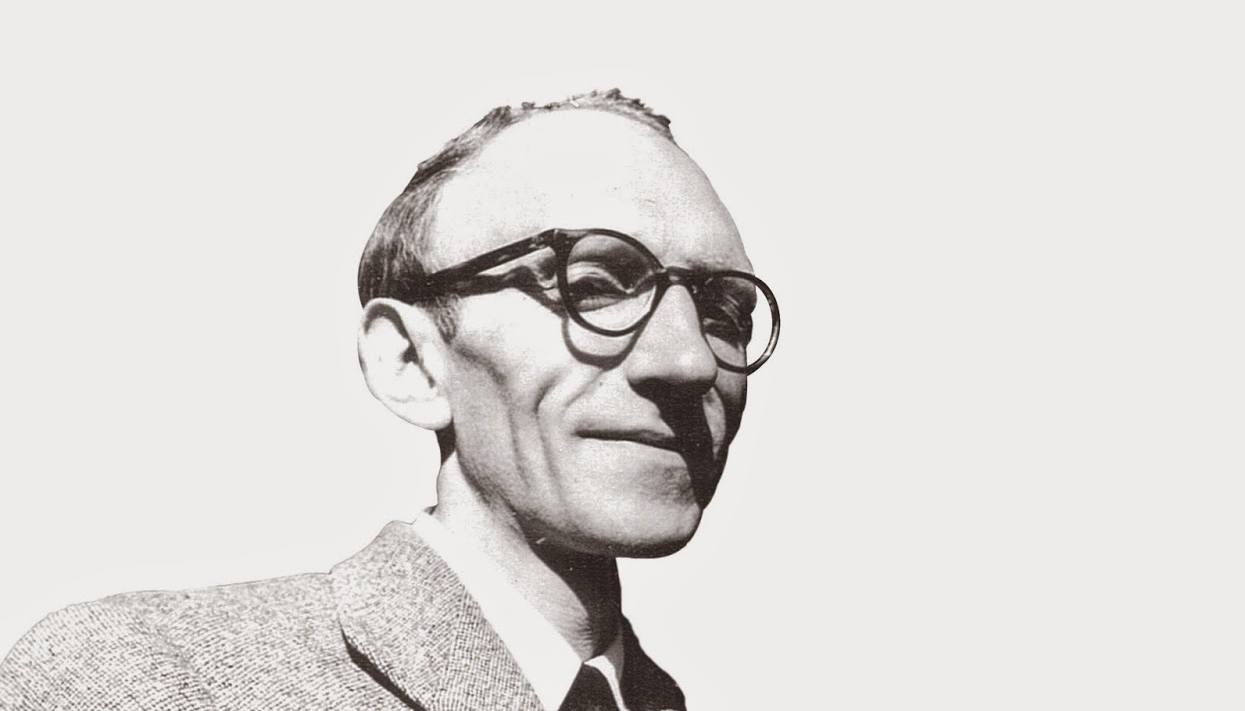

Lecture passionnante. Je suis si impressionné par votre culture littéraire et scientifique, ainsi que par le style de votre prose que je pourrais vous lire ou vous écouter pendant des heures.
Donnez-vous des conférences, participez vous a des salons litteraires?
Je suis un ancien étudiant de Philippe Jaworsky, son nom devrait vous évoquer quelque chose.
J’ai 38 ans, une bonne situation, en couple, heureux mais en manque de stimulation intellectuelle…
Ah! J’allais oublier… J’ai la passion de manger du papier, et un certain intérêt pour mes semblables.
Au plaisir…
Salutations
Marco.