… Drôle de jeu de mots français – qu’un traducteur avisé de Brontë avait substitué au plus terne wuthering – hurlevent. Jeu de mots qui nous semble appartenir à un français d’autrefois, ou même, à un français qui aurait pu être mais n’a pas été, trop retenu, trop bienséant dans sa gangue malherbienne… Mais voilà, les langues sont ce qu’elles sont, « vivantes », disent les linguistes – qu’ils disent…
Le français est peut-être en train de devenir, quelque goût on ait donc pour ces néologismesbeaux qui auraient pu en naître, une hurlangue ; lui qui s’est cru la langue d’élection, la langue faite atone pour respecter le pas feutré des idées, lui gueule aujourd’hui, dans la bouche de Nicolas Sarkozy, d’Eric Zemmour, de François Bégeaudeau et de l’immense individu disparate, clamant si violemment sa différence d’avec les trois premiers, mais les unissant justement et s’unissant à eux de son nom propre toujours exhibé toujours pour rien – le réacteur, quel qu’il soit, où qu’il parle ; – et laissez-moi vous dire ce qu’est un réacteur : ayant comme avalé le d qui le séparait du professionnel, il réagit, donc, à la prose du professionnel ; il réagit, toujours furieux, mais non pas comme ces vieux cons qu’on conspue pour leur gloussement nostalgique – « Ah ! la viande en sauce ! ah ! l’école ! ah ! la littérature ! »
Le réacteur ne réagit pas comme un réac : il part, il s’embrase ; il réagit comme un moteur, comme une turbine, et fait de la scène nationale de la parole un gigantesque hurlement, un cri aussi avorté qu’il se répète, aussi vain qu’il s’impose, volatil, fugitif, itératif ; c’est cela, aujourd’hui, que parler.
Je veux répéter que le président de la république ne parle pas le français mais la hurlangue ; qu’Eric Zemmour ne parle pas le français mais la hurlangue ; que François Bégaudeau ne parle pas le français mais la hurlangue, et que ces trois personnes hautement négligeables ne sont ici d’importance que pour la fonction qu’ils accomplissent, avec tous, en même temps que tous (et juste un peu plus fort que tous.)
Faut-il des citations ? Allez, il suffit, pour le président, de : « nous on ». Mieux encore que : « casse-toi etc. », « nous on » dit tout du rapport du président à la langue, à peu près comme : « je crois pas que ». Vous direz que tout le monde dit : « nous on », et que tout le monde dit : « je crois pas ». Nous on répondra qu’un président ne dit pas : « nous on ». On dira que c’est cela, qu’il n’est pas présidentiel. Nous on répondra qu’il l’est hautement, présidentiel ; et que c’estcomme président qu’il impose, tyrannique, absolutiste comme le sont toujours nos souverains, le nous on.
François Bégaudeau ? Allez, l’imparfait du subjonctif. Qu’est-ce qui est remarquable, dans sa présentation, à sa classe incrédule, de la valeur de l’imparfait du subjonctif ? C’est que de toute sa langue, il s’offre au parler adolescent, comme une courtisane, comme une Laure Heyman, comme une Odette de Crécy à son bourgeois ; mieux, au parler de la hurlangue ; et qu’alors, ilbrandisse soudain son imparfait du subjonctif : quel que soit l’avantage subjectif qu’il en acquière sous les caméras toujours aussi bêtes, puisqu’elles fixent des images et non des mots, qu’est-ce qui en résulte ? Il en résulte objectivement qu’il vient d’avérer la nécessité, toujours politique (malédiction du français) d’abolir, une fois le bonbon narcissique offert au futur ex-professeur, l’imparfait du subjonctif.
Eric Zemmour ? Oh, c’est si simple. Eric Zemmour, c’est plus encore quand il ne parle pas qu’il parle la hurlangue ; oui : quand il rit. Vous savez, on rit, sur le plateau de M. Ruquier ; on rit d’un rire à gorge déployée, d’un rire frénétique, d’un rire… mortel. Eh bien lui, lui qui, certes sur un mode un peu canaille, pose à l’intellectuel, lui rit exactement de ce rire hystérique, mécanique, lancé par la vedette blonde, et non pas cascadant, mais embrayant dans les gorges des autres. Un rire de réacteur ; patience, M. Zemmour, à vous aussi on retirera bientôt le fameux « d ».
Quid, alors, de la hurlangue, de sa fonction, par-delà ses exemples ? La hurlangue, c’est cette parole qui n’a plus en son fond, ou plutôt en sa surface l’extraordinaire amortisseur de la belle langue, obligée pour certains – même monsieur Giscard d’Estaing faisait des efforts, de quelque énarque exprimât-il, dans sa miraculeuse impersonnalité, l’essence… La parole à vif, constamment ; l’argutie dite dans les mots de l’invective ; l’injure, dans ceux de l’assassinat ; l’affirmation de soi, dans celui de l’anéantissement de l’autre ; la violence ; la raréfaction des mots ; l’atténuation de l’effort de dire, au nom de la sincérité et de la vérité ; au nom du tempo d’une discussion toujours plus rapide, car le temps de la communication doit être réduit à cette marche furieuse non de l’action (car nul n’en fait) ; non du corps (car ils ne bougent, tous ces corps, que sur place) ; mais du cri qui se répète, toujours identique ; du cri qui structure la hurlangue – langue, aujourd’hui, du politique, et donc, puisque le politique est plus que jamais tout puissant, du journaliste, de l’artiste (rassurez-vous, c’est la même chose), et du particulier. Langue du réacteur.
Deux questions, toujours inlassables, reviennent : pourquoi mon premier, et à qui mon tout ressemble-t-il ?
Le tout, c’est facile : bien sûr, aux années trente. Oh ! Gide et Valéry, et Aragon et tant d’autres savaient parler la belle langue, et ils s’y employaient sans trêve ! L’imparfait du subjonctif fleurissait encore ! Mais la langue politique : ce qu’elle a de commun avec la nôtre, c’est la fureur, l’à-vif, la volonté criminelle du dire. L’insondable différence, c’est que tuer au nom de la race, ou du prolétariat, ou de quelqu’une de ces « idéologies » radicales, prophétiques, et millénaires, ce n’est pas tuer comme aujourd’hui au nom de… soi. Mais dans les deux cas l’on tue ; et peut-être qu’un esprit plus profond, oui, saurait voir, dans la fureur idéologique des années 30, et dans la fureur narcissique d’aujourd’hui, exactement le même visage.
Mais peu importe.
Ce qui importe, c’est pourquoi. Je voudrais suggérer quelque chose, et puis me taire – c’est-à-dire, essayer de parler à côté de la hurlangue ; autant que je peux, en français, en espérant que d’autres s’y essayent aussi ; tentative donc qui emprunte à la hurlangue sa vitesse. Dure nécessité, que celle d’adopter le rythme de ce qu’on déteste le plus, pour essayer de lui porter l’estocade. Servitude du combat ; servilité, même ? Esclavage ?
Pourquoi qu’il est pas poli, le président ? Pourquoi qu’y cause comme ça, l’écrivain ? Pourquoi qu’y rigole, « l’intellectuel » ?
Pourquoi qu’il hurle, le réacteur ?
La politesse, c’est un commandement religieux qui s’est sécularisé. La sécularisation prend du temps. Donc, pour que la politesse s’impose, il faut du temps ; beaucoup plus de temps pourfaire une politesse (ou la politesse) que pour n’en faire pas, ou plus ; disons même que la politesse a pour essence le temps, comme feu l’aristocratie. Mais le temps, par définition, excède celui qui s’y trouve. Et quand il n’est pas question que chacun ne soit, à soi tout seul, la totalité du réel ; quand l’ordre universel, dicté à tous et à chacun, est que chacun soit l’alpha et l’oméga (à concurrence de l’autre, bien sûr, à entendre dans tous les sens) de sa durée, alors plus de place pour la durée, et donc plus de place pour la politesse.
Vous savez quoi ? Ce n’est pas grave. Nous ne serons pas réacs ; nous ne pleurerons pas la politesse défunte. Vous savez pourquoi ? Parce qu’elle est morte par justice (elle était mensongère), et parce qu’une autre, probablement mensongère elle aussi, apparaîtra à son tour. Plus tard. Quand le temps aura reparu. Quand la baudruche narcissique aura éclaté bruyamment, faisant taire la hurlangue pour un tour. Cela viendra. Le problème n’est pas la politesse (souci de réac, qui ne sait jamais vraiment se soucier de soi – telle est sa vraie faute : le réac ne sait jamais que ce qu’il défend n’a de prix que parce qu’il doit en rendre sa vie plus précieuse ; le réac est incapable de penser à soi ; inverse donc du narcissique, ou bien son double, l’extrême du cercle où son identité se boucle.)
Le problème, donc, c’est nous ; dans la mesure où il nous est demandé, au moins par nous, de prendre la vie au sérieux ; et dans la vie, rien n’est plus sérieux que la langue.
D’abord, je voudrais proposer ceci : ce sont les artistes qui ont inventé la hurlangue ; ou plutôt, les écrivains, c’est-à-dire ceux qui, se nommant tels (prenant acte de la prose du monde), en mirent à mort la langue comme art. Résumons : Proust écrivit, mieux que tous (osant les barbarismes, inventant un rythme, et gonflant comme des ballons qu’on enchaîne ses petits poèmes en prose réussis, ceux-là), en belle langue ; il était poli, au demeurant. Qu’il fût moderne, qu’il décapât, nul doute ! Qu’il mît fin à la langue, cela est déjà idolâtrique. Mais qu’il inventât la hurlangue, alors là non ; et si tous les écrivains se réclament de Proust, eh bien s’ils écrivent en hurlangue, ils le trahissent – au moins, qu’ils assument cela.
Duras, dit-on, pratique l’épure. Duras dit vrai. Duras écrit des phrases qui disent ce que ça est, la vie. Elle s’est autorisée à faire ça. Ça, mes cocos, c’est déjà la hurlangue. Très vite, regardonsquelques lieux communs. Mettre l’homme à nu, dénuder la parole : mais la parole étant faite de mots, si on la dénude, si on la dépouille, si on la raréfie, alors il n’en reste pas beaucoup, de parole ; et donc, pas beaucoup d’homme ; et donc, pas beaucoup de vie ! Un homme qu’on a épuré, dépouillé, qu’est-ce que c’est, finalement ? Ben… rien. Oh, un paquet de chair, si vous voulez. Mais oui, on le sait bien : ça fascine, les paquets de chair. On en redemande (c’est même ce qui fait de la littérature un marché.)
Elle le fit, tout cela, l’épure, le dépouillement, etc. parce que Rimbaud, avant elle, avait craché sur la littérature. Tout ce qui était génial et/ou se disait génial savait, à la fin du dix-neuvième siècle, cracher, invectiver. Les Surréalistes crachèrent. Duras cracha. Aujourd’hui, Zemmour et Naulleau crachent. Or, à l’époque où Rimbaud crachait, on en était choqué. Car la politesse commandait qu’on ne crachât pas ; mais la politesse avait toujours dû ménager une place pour le génie, qui tire la langue, ça se fait, on le sait bien. Donc la politesse laissa cracher Rimbaud, et se tut. Mais qu’elle se tût, le crachat tua la politesse, et, au passage, Duras, puis Zemmour, puis Bégaudeau, puis Sarkozy, puis le réacteur, tout le monde, vous, moi, ta sœur et ton voisin, tous se prirent pour Rimbaud. Ils oublièrent tous, pauvres enfants, que Rimbaud, outre ses crachats, avait écrit, justement, Enfance ; « bijoux debout sur le sol gras des bosquets et des jardinets dégelés. » Cela, ce n’est même pas de la belle langue. C’est du chant, du chant des é et des è dans le plus atone des instruments.
Ce que je veux dire, c’est que cet assassinat de la langue, et donc de l’homme, qu’on est en train, sur la scène française, de perpétrer, d’une volonté uniment politique, et culturelle, est en son fond lié à cette énorme comédie d’orgueil dont chacun joue, sagement, le rôle : « je suis comme je suis », disait l’antipoète par excellence ; disent Sarkozy, Bégaudeau, et Zemmour ; disent les réacteurs.
Il faut savoir une fois pour toutes qu’on ne parle pas pour être sincère. Il suffit, je ne sais pas, de roter pour l’être, pour être sincère. Roter son être, effectivement, c’est être ce qu’on est. On parle, on doit parler, et nous nous foutrons pas mal, pour l’occasion, des professeurs de linguistique, pour aller par-delà soi. La belle langue, c’est la réquisition d’être, non pas autre que soi, mais soi plus que soi. Autrement dit, la parole est le contraire du narcissisme ; et donc, le narcissisme est le contraire de la parole ; donc le narcissisme est le contraire de l’art, de la création, et précisément, le narcissisme est l’autorité devant quoi tous, ici et maintenant, cèdent ; autorité qui se dit en nouvelle langue : en hurlangue.
Il n’y a qu’une chose à faire, aujourd’hui : bien dire. Bien dire, ce n’est pas encore le beau. Le beau est une haute tâche, celle des poètes. Oh ! Elle n’est pas non plus la plus haute. On sait bien que le beau ne dit pas tout ; on sait bien que le beau ne sauve pas du mal ; tel est le fiasco, justement, du XIXe siècle. Seul le vrai sauve du mal. Mais le vrai, par pitié, ce n’est pas moi. Le vrai, ce n’est pas « pour moi j’veux dire » ! Le vrai nous attend, souriant et lointain, et si proche, dans le surplomb de la montagne…
Bien dire, cela nous suffira. Mais pour cela, il est une condition : se déprendre de soi. Croire que la parole n’est pas mon invention, savoir que la langue est un instrument, et qu’effectivement, les poètes, ceux qui la parlent le mieux, y ont une responsabilité considérable, puisque, façonnant la parole, ils façonnent l’homme. Mais pour être tel, poète, et façonnant, il faut savoir que la matière est à la fois difficile, rétive, et mystérieusement étrangère à moi ; que ma langue m’est étrangère. C’est tout ; cela donne : un tout petit peu de hauteur ; oui, c’est tout ce qu’on demande ! Rendre la hauteur, aider la hauteur à reprendre ses droits sur les hommes ; car c’est ainsi qu’un homme se libère de la pire, la plus vociférante, la plus hurlante des prisons qu’il ait jamais hanté : soi.





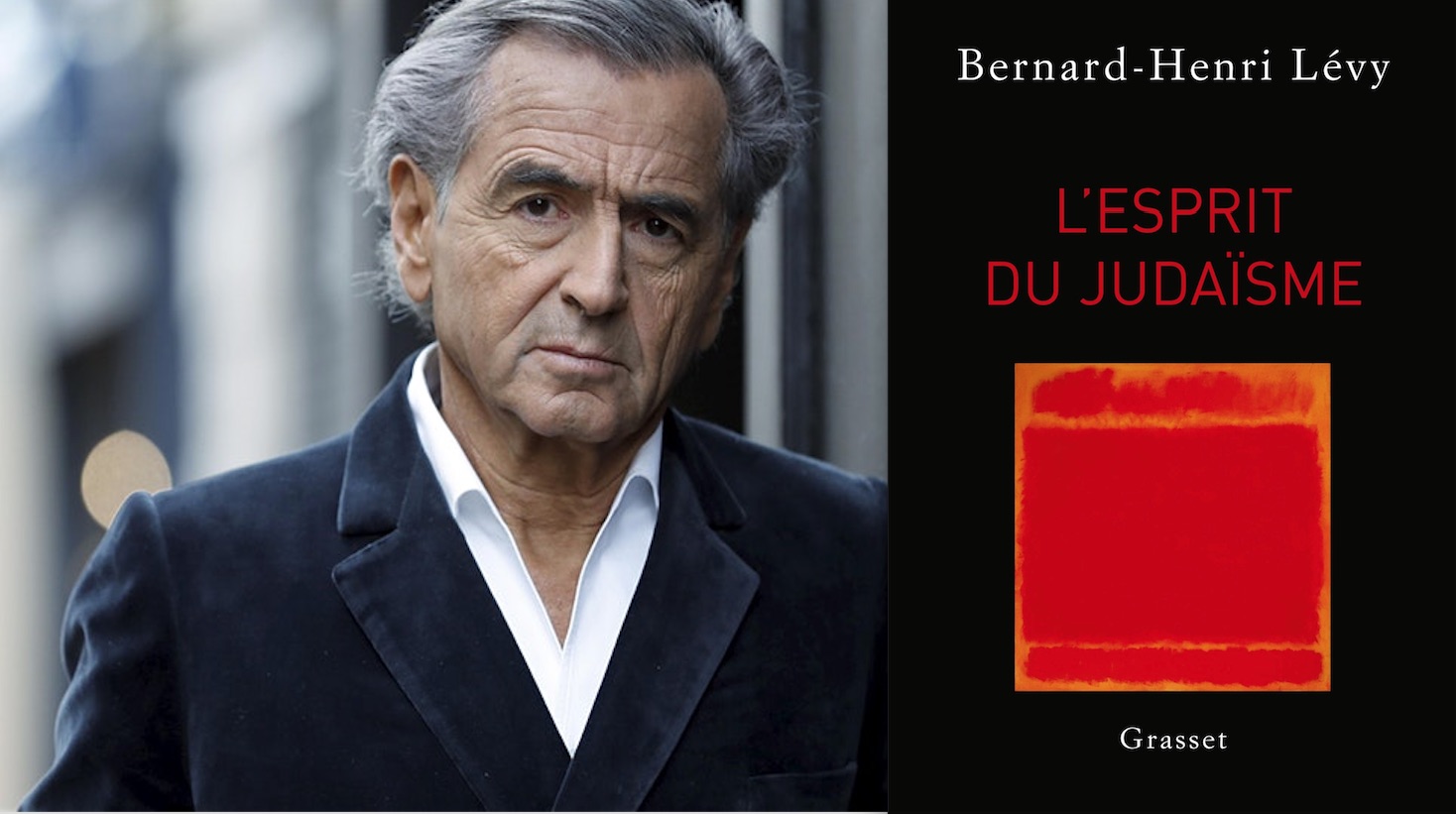


Si on évoque parfois la lecture comme un plaisir solitaire, appréhender votre article s’est d’avantage apparenté à un jeu solitaire.
Comme la crise économique du XIX ième a donné naissance au Monopoly, la crise culturelle au Trivial, la crise militaire à Risk, doit-on voir au retour du casse-tête une quelconque symptomatologie de notre époque, où le moi profond serait en souffrance. C’est ce que semble suggérer votre conclusion.
En guise de transition, je fais juste ici une petite digression pour évoquer Kohlanta : doit-on le considérer comme le signe d’une crise sociétale ? Un essai clinique ? Je m’étonne seulement du choix des scénarii où l’on fait arriver quelques jours après la constitution de l’équipe un représentant des populations d’immigration récente.
Alors, la vie, dans tout ça? Pas celle des pays mais la vie des gens, est-elle une corrida, un jeu de petits chevaux ou un joli combat de boxe?
J’ai parfaitement ressenti que votre article recèle d’innombrables références, que je n’ai pas pu identifier. Ma réaction de réacteur ne sera donc pas celle d’une intellectuelle mais d’une lectrice en qui vos mots ont résonné…comme des dissonances.
La première fausse note fut la référence au romantisme d’Emily Brontë évoquant, pour la lectrice amatrice que je suis, des amours impossibles et des blessures profondes. Nous voilà bien loin de notre société, non ? Pour rester dans la littérature anglaise et féminine, le fric, le bling-bling, l’hypocrisie, l’intempérance jusqu’à l’inconvenance du langage, l’éducation et la discrimination pour rester entre soi m’évoquent un autre auteur qui ne signait pas plus que la première : Jane Austen et son livre « Orgueil et préjugés ».
La deuxième note disharmonieuse fut votre choix des symboles de la société française. 3 hommes…il ne manquait plus que le couffin pour que ça devienne drôle. Simplement, dans un souci de parité, je souhaiterais y ajouter une femme, juste une, mais qui peut aisément hurler au moins trois fois plus fort que les trois hommes que vous avez réunis. Une femme qui ne signe pas de son nom mais use d’un pseudonyme ou de son prénom : Diam’s et sa chanson « L’honneur d’un peuple ». Vous parlez d’impolitesse… Son « Je vous emmerde » rappelle-t-il le « Je vous emmerde » de Tristan Bernard ? Un brin réac, je regrette Brassens et ses contemporains qui la maniaient avec tant de subversion que cela en devenait révolution. Pour évoquer les financiers aux commandes de l’état, nous devrons nous contenter aujourd’hui d’une subtile allusion à Perrette qui ne savait pas battre son beurre et voulait tout sans contre-partie.
Les mères de famille tentant de militer contre l’intolérance, gentiment, tranquillement, sereinement, avec le sourire, plagieront-elles Cabrel pour demander qui est ce pantin, ce minus qui s’agite pour mettre à mort les forces vives du pays qui poursuivent le combat comme un dernier baroud d’honneur.
Autre désaccord : votre dénigrement du subjonctif. La maîtrise de la langue est le reflet de l’ascenseur social. L’utilisation parentale du présent du subjonctif fut le symbole de leur ascension. Juste un petit pas « conjuguaire », mais un grand pas familial.
Un espoir, une espérance concernant Eric Zemmour ? Il y a encore plus d’hommes en lui que dans votre article et si une part de féminité se révèle c’est une garce. Ca ne manquerait pas de piquant de voir se glisser discrètement à ses côtés une féministe socialiste, pro-polyculture et sympathisante musulmane. Cela pourrait donner un joli duel Montillac-Gélidon. Quel parcours de Petits Chevaux ne faudrait-il pas faire ?
Dernière reprise, puisque j’ai évité jusque là le KO. Pour un psy à 2 sous du temps de Freud, dépendre de soi-même était considéré comme la pire dépendance. Alors, c’est quoi se déprendre ? Et si les blessures d’un âge où l’on n’aurait pas dû être sérieux étaient après tout le treillage du jasmin, sa cohérence, sa structure indépendante de son essence. Et si construire ses indépendances n’était pas paradoxale avec le fait de reconnaître, d’avouer, de dire, de vouloir avoir besoin de l’autre.
Au final, ressenti d’un concert de musique atonale qui prône émancipation et rejet de toute hiérarchie.
Peu éduquée et encore moins avertie, j’espère que ces mots ne fussent pas totalement hors-propos…
Zemmour ne fait pas que hurler et ricaner, car l’ordre est donné que chez Ruquier, on rit, mais aussi, il ment avec la régularité du métronome. Et le Paf est debout presque entier pour le soutenir, lorsqu’il « démasque » ses adversaires en flagrant délit de mensonge, d’hypocrisie, de bienpensance, de démagogie – non Zemmour, lui n’est pas un démagogue. Bien sür. Bien sûr.