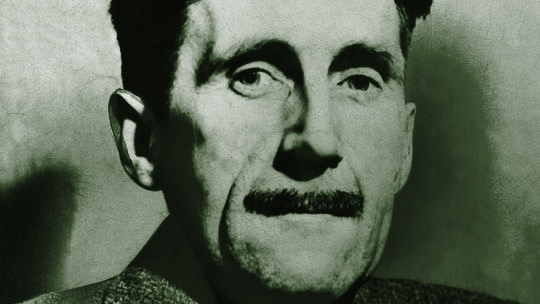I. Derrida tel qu’en lui-même
Il ne suffit pas d’avoir été un élève de Derrida pour entrer dans sa philosophie ou plutôt dans son écriture. J’ai eu la chance, au cours de mes années d’étude, de l’écouter longuement, d’abord avec scepticisme, ensuite avec une franche admiration lors du Colloque de Cerisy-la-Salle en septembre 1981, Les Fins de l’homme. Il a prononcé alors, en conclusion, un très grand texte procédant de Kant, mais profondément derridien dans son intention et sa formulation : D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie. On se souvient du titre de l’opuscule de Kant rédigé en 1796 contre l’illuministe Swedenborg : D’un ton grand seigneur adopté naguère en philosophie. Derrida le réécrivait à sa façon.
Derrida soutenait devant une assistance nombreuse que toute phénoménologie de l’apparaître devait reconnaître un lien fondateur avec le thème de l’Apocalypse présent dans les traditions religieuses. Pour Derrida après Heidegger, l’être est dévoilement, mais le dévoilement est aussi bien apocalyptique, c’est-à-dire soumis au jugement de Dieu revenant, à la fin des temps, partager les mérites et les torts de l’humanité. Il voulait dire alors qu’en grec, pour finir, la vérité n’est pas seulement « a-letheia », elle est « apo-kalupsis », non pas seulement « non-dissimulation », mais procédant à partir de la fin du temps.
Mais Derrida faisait plus, il annonçait, devant une assistance médusée, que l’avenir de la philosophie passerait désormais par un nouveau débat avec le religieux et il annonçait un temps qui devait se préparer à des épreuves « apocalyptiques ». Même s’il avait été précédé à cette époque par les prémonitions d’Emmanuel Levinas, et qu’il fut largement suivi après lui par Marcel Gauchet dans son Désenchantement du monde, ce propos était nouveau alors, dans une époque entièrement dévouée à la lutte politique et au matérialisme dialectique. Ce mouvement allait être dénoncé plus tard par un philosophe disciple de Heidegger, Dominique Janicaud, dans un livre d’une grande importance publié en 1992 : Le tournant théologique de la phénoménologie française.
Mais ce tournant supposé de tout un pan de la philosophie française ne pouvait signifier un retour fidéiste à la théologie chez Derrida, ni une résolution des conflits humains par un retour à la divinité. Il marquait plutôt combien Derrida était sensible aux mouvements intellectuels de son temps et a bien pressenti les changements qui ont décidé la forme du monde actuel. Il le répètera encore dans un livre de la dernière période, Foi et savoir, de 2001 : la vérité a changé de visage, elle est devenue ambigüe et exige une traversée de tous les savoirs pour faire valoir son droit. C’est pourquoi Derrida est un homme hanté, hanté par tous les fantômes dont il a voulu reconnaître l’effet sur Marx. Le vrai titre de cette conférence ne peut être qu’une reprise du livre sur Marx et doit s’intituler : « Spectres de Derrida ».
Car il n’y a pas que Marx qui a marqué de façon spectrale Derrida et cette remarque permet d’éclairer le profil si étrange de son œuvre. Le premier spectre de Derrida est son pays de naissance, l’Algérie, sa mère, son oncle, le judaïsme familial avec ses rites, parmi lesquels la circoncision a joué le rôle qu’on sait. Derrida, à l’époque « Jackie » Derrida, partage cette enfance avec un autre grand rapatrié d’Algérie de la littérature française, Albert Camus, y compris jusqu’à la passion commune pour le football. Mais si Camus a tenté de parler à la France métropolitaine en évoquant les souvenirs de la Résistance et de la lutte anti-fasciste, Derrida a préféré parler à la France à travers la pensée allemande, et, Hegel naturellement, mais aussi le philosophe controversé Martin Heidegger. Derrida a subi des pressions considérables, dont j’ai moi-même été le témoin, pour renoncer au débat avec Heidegger, il n’a jamais cédé. Pour lui Heidegger était le philosophe « incontournable » de son siècle.
Derrida était un philosophe de profession et il ne pouvait se contenter d’attitudes militantes ou journalistiques. Il avait identifié en Heidegger le seul penseur capable de reprendre le legs de Hegel et le conduire au-delà de la dialectique. À cet instant, le vrai enjeu de Derrida apparaît : il n’a pas cherché, après Marx, à poursuivre la réalisation pratique de la dialectique des contradictions que Hegel avait maintenue sur le terrain des idées ; il s’est risqué au-delà du rythme obligatoire qu’une telle dialectique en mouvement impose aux événements dont elle construit l’intelligibilité. Il a voulu, en dernière analyse, penser au-delà d’un certain pouvoir de détruire et de construire.
La fameuse « déconstruction » derridienne porte exactement sur ce point : non plus construire dialectiquement l’événement (comme un moment de l’Esprit absolu ou de la conquête du pouvoir par le prolétariat), mais porter l’attention de la pensée vers ce qui n’est pas thématisable par la phénoménalité telle que Husserl avait pu la définir à partir de l’objet de la science. Désormais, l’apparaître s’attache à l’invisible, au secret, au différent, à tout ce qui encourt le risque d’une irréversible abolition. Le « derridisme » s’intéresse au non-dit de la réalité et cherche à en fixer la phénoménalité détournée : il déconstruit le monde fait pour laisser paraître un monde défait. Il revendique un moment de vérité pour les vaincus de l’histoire.
En intense union avec la mémoire de la Shoah, Derrida a placé cette nouvelle orientation de la philosophie sous le signe de la cendre : il faut déconstruire le monde apparent pour manifester une hospitalité « sans condition » pour les pauvres, les délaissés, les êtres qui n’ont pas achevé leur visibilité dans le monde. Il y a bien une charité derridienne et elle fait partie des moments les moins bien perçus de son œuvre. Mais elle ne saurait s’identifier à aucune charité instituée, dans la mesure où tout don, aussi généreux soit-il, est déjà une « Fausse monnaie » dès qu’il entre dans la relation d’échange. J’ai assisté pour ma part, dans les années 80, au séminaire sur ce texte tiré du Spleen de Paris de Baudelaire, La fausse monnaie. Ce fut un exemple de la finesse des analyses morales de Derrida. Il est un des rares lecteurs à avoir poussé à ce niveau de profondeur la lecture du poème de Baudelaire et à avoir affronté sans cession les pièges du don dans les relations humaines.
Pour Derrida le monde vrai n’est pas celui de la présence, mais celui de la trace. Toute insistance indue ou prétentieuse sur l’être de la présence masque le vrai jeu d’aveu et de dissimulation qui travaille le réel. Contemporain de Derrida, Jacques Lacan avait déclaré sans nuance, mais avec une force extrême, que le « réel, c’est l’impossible ». Plus sophistiqué, Derrida tâche de suivre les traces d’un réel qui ne cesse d’échapper à toute assignation que lui imposent les institutions, les pouvoirs, les représentations dominantes. On comprend que par cette voie, il ait donné l’élan à la contestation qui s’est développée aux USA. À Paris en revanche, Derrida est resté plus marginal, souvent détesté face au « nouveau réalisme » en cours, et le plus souvent méconnu dans sa complexité.
II. Derrida et le marxisme spectral : le parti de la Différance
Il nous appartient maintenant de mettre en perspective comment Derrida, penseur de gauche, a pu entretenir des relations ambigües avec la politique, et d’abord avec son collègue Louis Althusser.
Derrida a participé à tous les combats de la gauche et il a signé des pétitions innombrables pour lutter contre les politiques de l’éducation des gouvernements de droite comme soutenir les dissidents de tous bords, de la lutte contre l’Apartheid de Nelson Mandela à la candidature de Lionel Jospin aux élections présidentielles, manifestant toujours son adhésion de fond au mouvement d’émancipation qui a suivi les événements de Mai 68.
Mais Derrida n’a pas une lecture sociale de la réalité et, comme Michel Foucault, il ne veut pas limiter à la lutte des classes les formes de la domination. C’est précisément ce que signifie le motif conceptuel de la différence, devenue, en une faute d’orthographe voulue, la différance : il s’agissait alors de souligner le caractère constamment dynamique de chaque chose en train de différer d’elle-même, précisément : « différant » (participe présent du verbe différer). Derrida appelle « écriture » le jeu de signification qui précède tout sens établi et se refuse à s’unifier sous l’autorité d’un sujet, d’une conscience, d’une identité manifestée par une voix qui méconnaîtrait son écriture. C’est pourquoi la pensée de Derrida peut se nommer une lutte déterminée contre ce qu’il a fini par appeler le « phallo-logocentrisme », associant dans une même lutte la domination masculine et la domination métaphysique sur la dissémination originaire du sens.
On ne trouve pas chez Derrida, issu d’une communauté opprimée en Algérie, de fraternisation directe avec le monde ouvrier et les masses laborieuses. Ce n’est pas le travail, ni la production qui l’intéressent ; pour lui, ce sont des forces élémentaires qui semblent appartenir sans remède au monde de la présence et en comporter tous les risques d’effacement de la différence. Le « derridisme » est une philosophie des communautés opprimées, ou qui se considèrent comme telles. Il est fondamentalement « alter-mondialiste » car il cherche des alternatives plus qu’une victoire et une dictature des opprimés. Conformément à sa génération, il ne cherche plus à maîtriser le sens de l’histoire, mais à en libérer les possibilités latentes.
On lui a reproché d’être sinueux et de perdre dans les différences de l’écriture la force des concepts. Mais ces défauts réels n’ont jamais exclu le courage. Je rappelais en commençant comment il avait relevé à Cerisy le défi de l’Apocalypse biblique. Il a été présent au milieu des événements de Prague et il a cherché aux États Unis à se tenir au plus près de la lutte pour l’égalité des droits. Mais il n’était pas habité par une conscience de classe, ni par le désir d’appartenir en quelque manière à l’Avant-garde du prolétariat.
Son attitude à l’égard de la philosophie dialectique de Marx dépend en profondeur de son attitude générale à l’égard de Hegel. Son grand livre sur la dialectique est un livre sur Hegel, Glas, qui date de 1974. C’est un livre complexe, qui joue sur la disposition de l’écriture sur les pages, un peu à la façon du des Calligrammes d’Apollinaire. L’idée générale tend à montrer que la dialectique est un événement plus paradoxal que véridique : d’abord mobilisée par Platon pour l’approfondissement de sa théorie des idées et placée au cœur de la recherche métaphysique par Aristote, la dialectique est, pour Derrida, une image fantastique du pouvoir de l’esprit humain. Mais comme tout ce qui est total, la dialectique n’est porteuse de vérité que par ses articulations, qui sont autant de points de faiblesse : c’est en ces points que travaille le « Pharmakon » de la médecine grecque, c’est-à-dire le venin du savoir, qui ensemble sauve et tue. Il en est ainsi de cet « Aufhebung » chez Hegel qui constitue le point central de sa dialectique, et que Derrida a examinée avec une particulière acuité.
Pour Hegel, dans une contradiction, il y a un moment fini et un moment infini. Le moment fini est le moment où une position de la conscience se croît sûre d’elle-même et par là se condamne. Vient l’infini, sous la forme d’une position plus profonde et plus intégrative, et le moment fini est aboli. Il n’est pas pour autant détruit, il est repris par le moment plus fort, dans un moment qui le transcende en le traduisant dans le langage de l’autre. Ce passage est l’Aufhebung, littéralement le dépassement qui conserve, et dans la langue de Derrida : la « relève ».
La dialectique pour Derrida vaut par ce moment de suspens de la relève. À la différence de Marx, Derrida ne cherche pas le pouvoir « révolutionnaire » de la dialectique hégélienne, mais le pouvoir d’engendrer des aléas dans les pensées constituées. L’Aufhebung n’est pas l’effet d’une lutte, c’est un suspens qui engendre des effets parasitaires, des réalisations seulement « à la marge » et, finalement, une forme d’égarement au sein des systèmes établis.
On comprend qu’avec une pareille approche la publication de Spectres de Marx en 1993 ait été considérée comme un événement pour la gauche française, qui fut aussitôt déçue ! Elle attendait le grand aveu de Derrida faisant ses comptes avec les concepts fondamentaux du mouvement ouvrier, tel que Marx les avait établis. Si Althusser est devenu célèbre en écrivant son Lire le capital, qui date de 1965, Derrida en 1993 ne s’est confronté que de façon très marginale avec le Capital et n’a pas discuté du taux d’augmentation de la Plus-Value. Il a cherché au contraire à découvrir des « Aufhebung » non comblées par le récit historique et théorique de Marx, ce qu’il appelle des… fantômes ! Spectre de Marx n’est pas un livre de théorie économique, mais un essai de vérifier que la vérité n’est pas une, mais disséminée dans des fragments innombrables, qui ont tendance à se transformer en fausseté et en oppression dès qu’ils sont mis en œuvre.
III. Un humanisme libertaire
À sa façon, le livre de Derrida, quoique très fidèle à une lecture précise de Marx, est une forme de dépolitisation du discours philosophique qui annonce plus les mouvements alternatifs des années 2010 que les grands mouvements démocratiques pour la conquête du pouvoir. Derrida, mort en 2004, n’a pas eu le temps de formuler un jugement sur ces attitudes, même si sa dernière œuvre publiée a porté sur le « Concept » du 11 septembre, qui a ouvert un temps irréversiblement nouveau. Il reste que l’auteur se révèle en toute occasion fidèle à la tradition humaniste par son exceptionnelle maîtrise de la mémoire occidentale, aussi bien en philosophie qu’en littérature. Il est le philosophe généalogique capable de retracer la vie d’un concept sans manquer de le replacer dans son contexte métaphysique ou disséminé. On le voit enfin toujours exact dans ses lectures innombrables, celles de ses amis comme Jean-Luc Nancy, comme celles de ses rivaux dans le domaine de la linguistique ou du calcul logique.
On pourrait parler dans ce cas d’une politique de l’amitié. Mais ce n’est pas assez car il faut compter avec la vigueur des concepts de Derrida. Malgré ses jeux de mots parfois lassants et des anecdotes sans nombre liées à son extravagante notoriété (qui a réussi même à éclipser le souvenir de Sartre ou la magie de Lacan), Derrida a travaillé en profondeur et a proposé des concepts qui gouvernent l’avenir et d’abord ceux d’écriture, de trace, d’indécidable, de différ(a)nce, de simulacre ou de spectre. Derrida passait parfois pour un magicien ou un occultiste que seules ses appartenances déclarées de gauche ont protégé de la dénonciation. Mais dans le fond, il a proposé un nouveau rebond à la philosophie occidentale, certes dans la suite de Martin Heidegger, mais en se détachant de la philosophie de l’être avant qu’elle ne devienne immaîtrisable dans ses conséquences politiques. En ce sens, il n’est pas excessif de dire que ce grand contempteur de la Métaphysique traditionnelle a sauvé la métaphysique, en la libérant de ses compromissions et en lui offrant des ouvertures inédites.
Mais c’est peut-être son insistance sur l’idée inconditionnelle de justice qui hausse une philosophie souvent joueuse à une forme d’universalité. Dans Spectre de Marx, il montre que le fantôme de Marx doit hanter la conscience des justes, non pas tant par le système de droit et de pouvoir qu’il a inspiré, que par un appel à la justice que Marx a toujours identifié au travail de la critique. La critique devient ainsi la mise en œuvre pratique de la justice. Derrida ne se fixe pas pour autant sur les faiblesses de l’adversaire, mais sur les points par lesquels il se métamorphose, dès lors qu’il s’expose au caractère infini de la responsabilité qu’impose la transcendance de la justice. Cet impératif de justice ne peut être simplement satisfait par des « cours de justice » et le jeu des institutions internationales. Il se présente au sujet affecté comme une dette incommensurable que toute l’écriture du monde ne saurait épuiser. Si le sujet est en différ(a)nce, c’est précisément parce qu’il est déporté par la justice hors de son lieu natal pour atteindre à la circonfession de sa substance.
On le sait, « circonfession », c’est à la fois, pour Derrida, circoncision et confession : d’un côté, la reprise pour le citoyen d’Alger qu’était Derrida du chef-d’œuvre de l’évêque d’Hippone saint Augustin, les Confessions, de l’autre, pour le juif assigné à sa judéité, le sacrifice de la circoncision. On peut dire que la justice m’oblige à une confession qui ne peut être assumée que par l’entaille du sujet en son être phallique. La justice aura eu précisément ce pouvoir de me faire parler et de me marquer à vif par un trait décisif comme un rasoir. Sous cette double autorité de la justice, le « derridisme » vérifie sa longue mémoire culturelle et la cicatrice ineffaçable de sa dette. Derrida aura ainsi imposé une transformation « circonfessionnelle » à l’humanisme : il aura scellé cette alliance entre humanisme et liberté qu’on pourrait nommer, pour finir, un humanisme libertaire dont, au temps de la Renaissance, Rabelais fut un symbole, comme plus tard Péguy ou Lacan, qui ne peut qu’agrandir l’idée de la culture française et l’horizon de ses responsabilités.