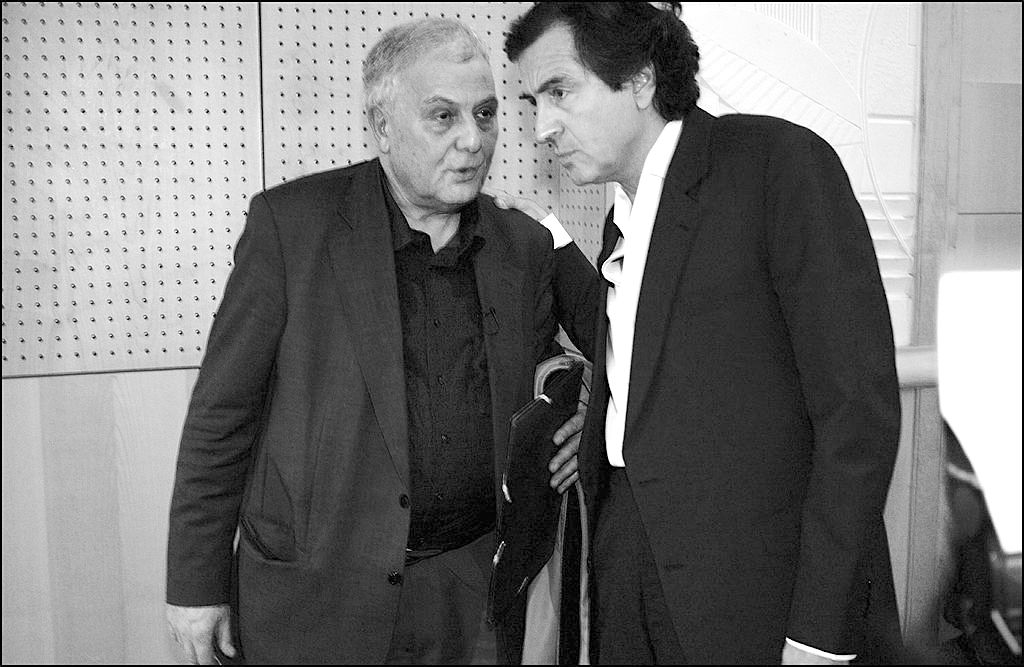Associer son nom et la mort ! Saugrenu. Je ne l’avais jamais vu que joyeux, moqueur, mordant, preste, paradoxal, ignorant le repos, toujours d’attaque. La maussaderie, la dépression, la nostalgie, la souffrance morale, lui étaient étrangères et éveillaient ses brocards.
Il se présentait volontiers comme le détenteur d’un savoir secret sur les doubles-fonds de l’actualité, les turpitudes de l’époque et les manœuvres de puissances occultes. Certainement, vous, si entendu du vrai des choses, vous ne pouviez, ce savoir, le méconnaître. Vous partagiez avec le décrypteur ces vérités cachées au commun. Il n’avait donc pas à les dire, il lui suffisait de cligner de l’œil. Il s’établissait aussitôt avec lui une connivence silencieuse, une complicité de cognoscenti. Si vous faisiez mine de ne pas comprendre, il levait les sourcils, il n’en croyait pas ses oreilles, il était déçu, et vous déchu, il devenait caustique. Vous vous le teniez pour dit, et la fois suivante, vous ne rechigniez plus. Alors, quelques minutes avec lui vous étaient une fête, une fontaine de jouvence.
N’allez pas croire pour autant que ses mystères n’étaient que des mystifications. Lisez plutôt Littérature et politique, qui réunit ses chroniques du Journal du dimanche : c’est une sorte d’Envers de l’histoire contemporaine, il s’adonnait avec alacrité à l’art de dévoiler le dessous des cartes.
Comment ce persifleur de génie était-il tombé des années durant sous la coupe d’un mentor triste, qui se voulait son directeur de conscience dans la chose littéraire ? Il se libéra de ce lien maléfique quand il laissa derrière lui le Seuil pour rallier Gallimard. Alors Femmes fusa, Te Deum de son émancipation. « Il est temps pour moi de faire une œuvre », me dit-il au moment où il m’invitait à le suivre, avec les séminaires de Lacan dont j’avais la charge.
On le disait opportuniste, inconstant, caméléon, sans foi ni loi, et sans doute prêtait-il le flanc à ces diffamations. Cependant, qui était plus fidèle que lui ? Ne parlons pas de ses femmes, qui étaient deux. Mais Heidegger, malgré tout. Mais Lacan, justement. Rien ne le détournait d’eux. Il tenait surtout un fil qu’il ne lâchait pas, c’était celui de la littérature. A cinq ans, rapportait-il, il s’était écrié dans un éblouissement : « Je sais lire ! ». Sa vocation s’était alors déclarée : il donnerait à lire, il saurait écrire, il en avait le don, qui lui fut d’emblée reconnu. Après des années à le dissimuler, ce don, à jouer les Flaubert peinant sur la phrase, il s’était décidé à laisser libre cours à sa prodigieuse facilité et à devenir lui-même, un cavalier menant son affaire à bride abattue. « Vite et bien », il empruntait sa devise à Gracián. Il pouvait se reconnaître dans la phrase de Saint-Simon qu’il citait : « Je ne fus jamais un sujet académique, je n’ai pu me défaire d’écrire rapidement. » À la surprise générale, il caracolait désormais et, servi par ses innombrables lectures d’autodidacte, qui, ne devant rien à l’Université, gardaient sous son regard inaltéré une fraîcheur sans égale, il parlait de tout – hormis des sciences, qu’il ignorait, et peu des spectacles, qu’il méprisait.
Dans la Chartreuse, Stendhal avait plongé un héros du XVIème siècle dans le sombre XIXème. Lui se voyait en homme du XVIIIème tombé dans « le pire des mondes possibles », disait-il, monde sans mémoire, tantôt « moisi » (adjectif auquel il imprima un lustre paradoxal), tantôt mangé par le présent, balançant entre frénésie et neurasthénie, et finalement ridicule. Dernier avatar de Cagliostro, lui avait vécu « dans les années voisines de 1780 » évoquées par Talleyrand, et connaissait « le plaisir de vivre. »
Comme il venait d’ailleurs, les xénophobes se liguaient contre lui. N’étant d’aucune Académie, il n’avait à leur opposer que lui-même et ses ruses. Il était donc perpétuellement sur ses gardes. Pas un frémissement du milieu littéraire qu’il n’observât à la loupe. Toujours en éveil, rien n’échappait à sa vigilance, il compulsait les traités des stratèges chinois et tirait ses plans. Force intrigues et stratagèmes. C’est qu’il faisait la guerre, celle du goût, comme il l’appelait si justement. À ses commencements, il avait réuni autour de lui une brigade, mais celle-ci s’était vite débandée. La vérité est qu’il n’avait pas de troupes. « Aussi seul que je l’ai toujours été dans ma relation à la cause analytique… » avait écrit Lacan. Le mot était vrai de lui : il menait seul son esquif.
Cependant, il aimait être aimé. Et la fausse modestie n’étant pas son genre (comme Lacan, encore), il était le premier de ses admirateurs. Il s’était persuadé que Lacan l’aimait, et Jean-Paul II, et les fées, comme le lui avait susurré André Breton. Nul n’était pourtant moins infatué que lui, il était trop malicieux et bouffon pour ça, mais il se plaçait avec simplicité au plus haut. Je ne le voyais s’amertumer que quand il évoquait le dédain de l’Université à son endroit, et le défaut de la notoriété internationale que s’étaient acquise Derrida et Kristeva. Mais qui l’égalait la plume à la main ? Replié sur son pré carré, le français, « langue royale » disait Céline, il faisait fi des « foutus baragouins tout autour. » De fait, il se suffisait à lui-même : « Moi : moi, dis-je, et c’est assez. »
Il n’était pas de ces romanciers dont les personnages pullulent. De personnages, il n’en avait qu’un : lui-même. Ce Fregoli changeait la couleur de ses yeux, celle de ses cheveux, son âge, son métier, sa nationalité, sa maison, son amoureuse, ses us, et tel Graal, prétexte de l’histoire, mais c’était invariablement du même que se racontait la fable. La formule était surtout sensible dans les petits romans que depuis L’Étoile des amants, de 2002, il livrait au public au début de chaque année. Quand il donna ses mémoires, ce fut sous le titre Un vrai roman. En vérité, c’étaient ses romans qui étaient ses mémoires. Il s’y esbaudissait de ses prouesses et facéties, et trompetait ses triomphes. Pas de larmes, pas de regrets, encore moins de reniements : rires et sourires.
Je tiens qu’il était romancier véritable dans ses essais et ses critiques – bien mal nommées, car il n’écrivait que des éloges. Là, les personnages foisonnaient, jaillis de son immense culture, et formant une glorieuse comédie humaine. Quand il avait à peindre un portrait, il ne s’embarrassait d’aucune circonlocution, il sautait à pieds joints in medias res, il était comme chez lui, farfouillant de tous côtés, multipliant les aperçus insolites, choisissant des citations avec un tact exquis, qui vous faisait lire avec des yeux nouveaux. De métamorphose en métamorphose, le sujet ne se perdait que pour renaître, enfin autre que celui qu’on vous avait enseigné. C’était à chaque fois une pêche miraculeuse. J’avais une dilection particulière pour ses chroniques du Monde où, semaine après semaine, il renouvelait la figure des classiques. À tu et à toi avec les plus sévères et les plus usés, il les rendait passionnants, il les ressuscitait.
Il s’épancha ainsi dans pas moins de quatre chefs d’œuvre, La Guerre du goût, Éloge de l’infini, Discours parfait, Fugues, soit un massif de 4 000 pages (j’ai compté). J’avais presque tout lu, je relisais tel morceau quand j’avais à me mettre en train, comme, disait-il, il lisait quelques pages de Voltaire ou écoutait du Mozart avant de prendre la plume (il n’écrivait qu’à l’encre).
Coda : toujours vert, il n’écrivit jamais une ligne qui fût d’outre-tombe.
Le 12 mai 2023