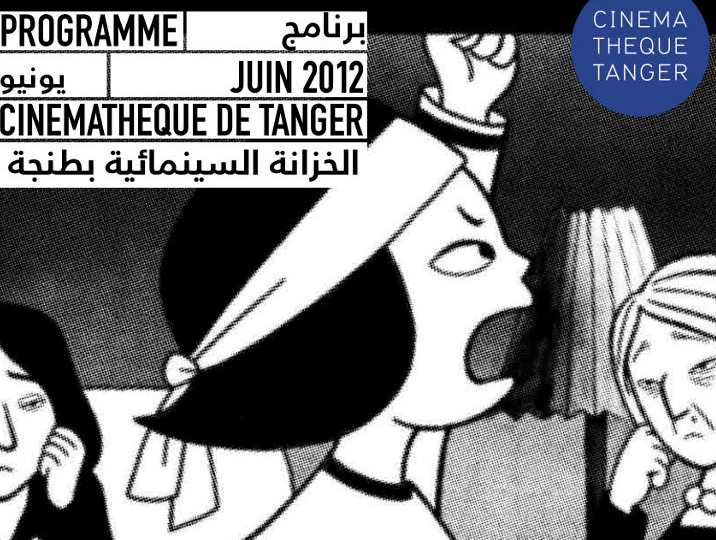La semaine dernière, une grande nouvelle a retenti. Salafistes, le film de François Margolin qui montre, avec la violence nécessaire à son objet, l’intrication de la parole et de la mort, a enfin été autorisé par le Conseil d’Etat. Après trois ans de procédure et la liberté d’expression, le courage physique d’un homme, systématiquement piétinés au nom d’on ne sait quel impératif de décence, nous pouvons nous réjouir de ce que la souveraineté de l’artiste ait finalement eu le dernier mot.
Toutes les censures se ressemblent, quelles que soient les raisons arguées pour les justifier : la censure, c’est toujours la peur.
Oui, le djihad fait peur. Oui, la radicalité salafiste, ce puritanisme – au sens propre – de l’islam – fait peur. Et fait peur, manifestement, le geste du cinéaste, par lequel le sérieux de cette radicalité (bibliothèques chargées d’ouvrages de fiqh, de droit musulman, au second plan, discours articulés, logiques, des fanatiques…) est désigné au public.
Le film de François Margolin fut présenté il y a quelques semaines à New York, ce qui m’a donné l’occasion d’y prolonger nos entretiens parisiens. Je dois dire qu’à mon grand regret, c’est sous un titre altéré, Jihadists, qu’il fut proposé à la presse très pusillanime de ce pays : censure mineure, certes, mais censure encore. Quoiqu’ils se réclament tous, à des degrés divers, de l’idéologie en question, le salafisme n’est pas considéré par l’intelligentsia anglo-saxonne comme responsable des horreurs commises ces dernières années par Al Qaïda, Daech, par les talibans ou par Boko Haram. Rappelons à ce propos qu’en son essence le salafisme est apolitique, contrairement à l’idéologie des Frères musulmans, fasciste et politique par définition ; seulement, le rejet par les salafistes, les «purs», de la politique, implique d’une part une séparation radicale d’avec les païens, séparation à la vérité intolérable dans une société pluraliste ; et d’autre part n’exclut aucunement, on le sait, l’usage de la violence à fin de prosélytisme et de soumission religieuse. Le salafiste, contrairement au «frériste», ne vote certes pas, mais il peut tuer, et s’il le fait, ça n’est jamais hasard : c’est le Coran lui-même qui impose la mise à mort des mécréants et l’asservissement des infidèles, c’est lui qui fait du djihad une prescription religieuse, et le pur, le salafiste, le sait fort bien.
Il ne s’agit pas de dire, comme certains en ont accusé Margolin, que tout musulman est un djihadiste potentiel. Pour une vaste majorité de musulmans, l’islam est un mode de vie, un ensemble de croyances, de valeurs – familiales notamment –, de références littéraires et artistiques où le religieux et le civilisationnel se confondent : s’ils lisent le Coran, y compris ses passages les plus scabreux, ils n’y prêtent pas davantage attention que les juifs ou les chrétiens ne le font de la Bible, laquelle peut être révérée sans que chacune de ses paroles n’ait force de loi. Il est à croire que la plupart de nos concitoyens musulmans, tout comme les cinquante victimes innocentes de Christchurch, entretiennent un tel rapport à l’islam, un rapport innocent.
Notons au passage que cela n’exclut pas un certain conservatisme, en matière de mœurs à tout le moins : le peu d’études que nous ayons sur le sujet montre par exemple une moins grande tolérance, voire une nette intolérance de la population musulmane du Royaume-Uni à l’égard de l’homosexualité ; mais pour regrettable que soit cet état de fait, il doit être soigneusement distingué des pratiques violentes encouragées par les radicaux, et plutôt mis sur le même plan que le puritanisme stupide – et méchant – qui a pu s’exprimer dans les rangs de la Manif pour tous. En revanche, attribuer les débordements de cruauté dont une organisation comme Daech a pu se rendre coupable, dont les maîtres islamistes de Tombouctou ou d’ailleurs de Téhéran – et là, c’est d’un autre islam(isme) qu’il s’agit, différent en ses fondements théologiques mais pas moins redoutable que l’autre –, attribuer cette barbarie à une ignorance des textes, le fameux «ils n’ont pas lu le Coran» répété depuis le 11 septembre, relève bien de la manipulation et du mensonge.
Le Coran, il y a, comme pour tout texte, plusieurs manières de le lire. Le soufisme et les autres traditions mystiques de l’islam en ont par exemple subverti le sens légal, parfois jusqu’à suggérer que la véritable religion ne résidait pas dans l’application des prescriptions rituelles : cet islam-là, il ne m’appartient pas de dire s’il est authentique ou non, mais je sais que l’orthodoxie musulmane ne le considère pas tel ; disons aussi qu’il est moins ancien que l’autre. L’autre, j’entends par là, sous ses nombreuses formes, l’islam «juridique», celui qui a construit en près de mille cinq cents ans, une civilisation dont le Coran est la base légale autant que théologique. Qu’une religion soit en même temps un système juridique, une règle politique, une doctrine économique, voilà qui peut étonner notre France protestantisée : la laïcité, qui sépare la sphère de la foi, de celle des affaires publiques, n’est que le stade ultime du christianisme qui, dès l’origine, séparait «ce qui est à César» de «ce qui est à Dieu». L’islam ignore cette distinction, et disons au passage que le judaïsme, pour ce que j’en sais, se situerait quelque part entre le christianisme et l’islam : en l’espèce, toutes les nuances qu’il conviendrait d’apporter lorsqu’on parle de ces trois «religions» comme si elles étaient trois unités compactes et uniformes ne changent rien.
L’islam juridique n’est pas toujours littéraliste, il peut durcir ou assouplir ce que prévoient les textes, il peut aussi parfois extrapoler : les hommes filmés par Margolin, eux, appartiennent à cet islam du droit, de la pureté du droit, et ils n’extrapolent pas, ni dans un sens ni dans l’autre – car il est aussi difficile, si l’on croit à la valeur légale du Coran, de gracier un voleur ou de condamner l’esclavage, que de permettre, comme l’ont fait les juges de Raqqa, de brûler vif un pilote jordanien. Aussi, ne trouverez-vous dans Salafistes, d’excès, si je puis dire, ni de cruauté ni d’humanité : ces guerriers, ces juges, ces docteurs de la loi, filmés principalement au Sahel, ne font que mettre en œuvre l’application scrupuleuse et sans abus, de ce que prônent Coran et hadiths. Celle, en somme, qui eut cours dans tout le monde musulman jusqu’à la colonisation. Voilà ce qui, j’en suis convaincu, a le plus embarrassé les censeurs.
La dernière fois que j’ai eu à discuter de ces questions avec François Margolin, c’était à New York. J’avais demandé à l’un de mes professeurs de Columbia, Mark Lilla, s’il accepterait de se joindre à nous pour un déjeuner : si, pour ma part, je n’avais pas pu revoir le film, lui venait de le découvrir, dans la salle de cinéma d’East Village où il était projeté devant la presse. Comme toujours avec ce genre d’œuvres (Margolin fut l’un des proches de Claude Lanzmann), il y a quelque chose de vertigineux à s’entretenir de la sorte, froidement pour ainsi dire, autour d’un déjeuner, dans une ville prospère et pacifique, des horreurs dont elles traitent. On ne sait jamais trop par quel bout prendre le film, le livre dont on parle. «Pourquoi avez-vous fait cela», demanda Lilla à Margolin, et celui-ci de répondre qu’il avait toujours, comme cinéaste, voulu parler du mal. Etrangement, je n’avais pas songé à lui poser cette question, pourtant essentielle. La réponse ne l’était pas moins, car l’art a, je crois, partie liée avec le mal.
Or voilà précisément ce que la censure ne peut tolérer. Je voudrais conclure cet hommage en rappelant brièvement une autre affaire, récente, de censure, une affaire dont la concomitance avec la décision du Conseil d’Etat, a de quoi étonner : il y a deux semaines, nous apprenions que l’UNEF avait réussi à faire interdire la représentation des Suppliantes d’Eschyle, une pièce qui traite du droit d’asile, de la manière dont il convient de traiter les réfugiés, et de l’oppression des femmes. La raison alléguée : les masques choisis par le metteur en scène relevaient, à en croire ces talibans analphabètes, de la pratique américaine du blackface. Des masques comme en portaient les acteurs athéniens, allons bon ! Pour la plupart des Français, ce mot de blackface est d’ailleurs incompréhensible : il s’agit d’une forme de moquerie, que l’on retrouve jusque dans les premières années du cinéma américain, condamnable certes, surtout aujourd’hui, mais évidemment très éloignées des préoccupations de Philippe Brunet, le metteur en scène incriminé, un helléniste de grand talent, d’origine partiellement japonaise et connu, je vous le donne en mille, pour l’intérêt nourri dont il a naguère fait preuve envers les cultures d’Afrique, qu’il croit indissociables de la Grèce antique – jusqu’à monter il y a quelques années une «Antigone abyssinienne».
Cette censure absurde dit quelque chose de l’époque. On a peur et l’on interdit. On veut être à l’aise, «safe», on veut des vérités simples et définitives, on veut des cases où faire entrer toute la prolixité du réel, on veut être rassuré. Mauvais temps pour le théâtre, pour le cinéma, pour les images et pour les mots : l’art est essentiellement cathartique, l’art doit, toujours, faire mal. La barbarie, latente ou non, que l’élite de notre pays observe médusée depuis l’automne, ne fait que prouver ce que j’avance : là où l’on ne peut plus dire ni montrer, tôt ou tard la violence resurgit, et tous les efforts des prudes n’y peuvent rien changer. L’autorisation de Salafistes est donc une bonne nouvelle, et pour l’art, et pour la paix. Souhaitons seulement qu’elle fasse jurisprudence.