«J’aimerais parler de notre adversaire. Un milliardaire qui traite les femmes de grosses nanas et de lesbiennes à tête de cheval. Eh non je ne parle pas de Donald Trump. Je parle de Michael Bloomberg». En boxe, on appellerait ça un uppercut. En rap, une punchline. Elizabeth Warren, sur l’estrade du très agité débat démocrate de mercredi soir, a été incisive, brillante. Et sa cible, Michael Bloomberg, penaud et embarrassant. Depuis qu’il s’est lancé dans la course, Bloomberg avait réussi à se ménager un petit mouvement de hype. A coups de centaines de millions de dollars, il était passé de 0 à 15% dans les sondages. Le coût de cet hold-up fait de sa campagne la plus chère de toute l’histoire, même à ce stade. «Bloomberg…», se prenaient à rêver les démocrates, et les journalistes américains de gauche (il est vrai, presque dans une situation de conflit d’intérêts, puisque Bloomberg est un patron de presse, et qu’il a transformé New York en cette ville paradisiaque pour les hipsters, sociologiquement, tout ce dont raffole les éditorialistes de la côte Est). Après tout, n’est-il pas une figure de la réussite, du self made man américain, à mi-chemin entre un personnage de Philip Roth et Citizen Kane ? N’est-il pas en faveur de l’Accord de Paris sur le climat, contre les armes à feu, pour l’IVG, et n’a-t-il pas le potentiel électoral (l‘electorability) qui manque aux actuels prétendants démocrates ? Ne peut-il pas convaincre les Républicains modérés, lui, l’homme d’affaires au programme raisonnable ? Bloomberg poursuivait une tactique «à la Macron», analysait l’ancien ambassadeur français aux États-Unis, Gérard Araud, c’est à dire «couper les deux bouts de l’omelette» et devenir une machine de guerre centriste contre Trump. Et, dans un premier temps, tout s’est passé à merveille. Son concurrent sur le créneau modéré, le vieil apparatchik, maladroit et légèrement fossilisé Biden, s’est lentement effondré, et Bloomberg a pris sa place de troisième ou deuxième, derrière Sanders, ce qui lui valait justement d’être invité au débat démocrate de mercredi. Précisions que Bloomberg avait refusé de prendre part aux deux premières primaires démocrates, en Iowa et au New Hampshire, concentrant sa fortune, immense, sur les États qui voteront lors du «super mardi» et enverront alors une grande part du total des délégués qui choisiront le candidat à la convention démocrate de cet été. Rien ne servait de courir, il suffisait de partir à point, avait l’air de se dire Bloomberg (mais cette tactique, déjà explorée par Rudy Giulani, son prédécesseur comme maire de New York, avait lamentablement échoué dans le passé, ce qui explique pourquoi Giulani, qui lui, n’est pas milliardaire, court depuis après l’argent, y compris, après être devenu l’avocat de Trump, en trafiquant avec l’Ukraine…) Et puis… et puis, il y a eu mercredi soir. Toute l’Amérique, qui connaissait, mis à part l’élite, assez mal Bloomberg, ancien maire de New York, l’a découvert. Et il est très vite apparu que Bloomberg était une sorte de Joe Biden, en encore plus apparatchik, en davantage maladroit, en singulièrement plus fossilisé. Il avait le visage arrogant, roulait des yeux, et avait l’air de se demander où fallait-il signer le chèque pour que toute cette mascarade prenne fin. Très habilement, Warren a asséné les coups là où cela fait mal : Bloomberg lui-même est accusé de misogynie. Il s’est embourbé sur la question d’accords de confidentialité, ces «deals» signés avec des femmes qui s’étaient plaintes de mauvais traitement. «Oh, elles ont dû mal prendre une blague», a ricané Bloomberg, ce qui, dans le Mont Olympe de la gauche américaine à l’heure de #metoo qu’est le débat démocrate, revenait à balancer une raquette dans le public comme un tennisman mécontent à Roland Garros. Et les autres n’ont pas été en reste. Même le malhabile Joe Biden a paru étincelant contre Bloomberg, en lui rappelant la politique de contrôle au faciès, manifestement raciste, mise en place par Bloomberg quand il était au pouvoir à New York. Bref, Bloomberg, fulminant et toisant de sa superbe les autres candidats, paraissait être un la piñata de la soirée, comme ces ballons remplis de bonbons que tout le monde s’amuse à frapper dans les anniversaires pour enfant.
Le plan «Macron» de Bloomberg n’a donc pas l’air de marcher, à la fois car le candidat est aussi aimable et désirable qu’un expert-comptable mégalomane, et à la fois car sa façon de se payer une élection présidentielle comme un duplex dans le Queens met légitimement mal à l’aise une Amérique traversée par un moment populiste, et où la lutte des «petits» contre les «gros», fait, depuis au moins Theodore Roosevelt, partie de la mythologie politique commune. Mais, qu’est-ce que cela nous donne ? Bloomberg a décidé de s’engager dans la course car Sanders, le candidat auto-proclamé du «socialisme américain», avait l’air de pouvoir l’emporter, ce que Bloomberg jugeait désastreux pour les démocrates (Sanders, trop à gauche, offrirait un boulevard à Trump) et désastreux pour son pays (l’Amérique n’ayant pas besoin, dans son esprit, d’une remise en cause aussi profonde du capitalisme). Mais, paradoxalement, Bloomberg est précisément en train d’offrir un boulevard à Sanders. Tous les autres candidats démocrates hier étaient ligués contre le milliardaire, et pas contre le socialiste, dont la position de leader lui vaudrait d’ordinaire bien des attaques. Bloomberg a fait disparaître, ou est en train de faire disparaître, le rival centriste de Sanders, Joe Biden. Les autres candidats centristes, Klobuchar et Buttigieg, ont passé leur soirée d’hier à se disputer le créneau modéré, tout en tapant sur l’ancien maire de New York. Bloomberg sert donc de paradoxal paratonnerre à Sanders : les gens de gauche peuvent être en désaccord avec la virulence du vieux sénateur, mais tout le monde déteste encore plus le milliardaire septuagénaire à la morgue si manifeste. Même Elizabeth Warren : elle a eu son «momentum», son climax, en novembre, où elle paraissait, aussi à gauche que Sanders, plus modérée, plus intellectuelle, plus sympathique. Puis, elle s’est effacée, et les primaires du New Hampshire, État qui est presque le sien, puisqu’elle est élue du Massachusetts voisin, se sont révélées catastrophiques. Hier, acculée, elle a été cette femme pleine de dignité et d’ironie qui ravit bon nombre d’Américains, cette professeure brillante et gouailleuse, prête à la bagarre, en un mot, une excellente candidate. Trump a passé la campagne de 2016 à déclarer qu’Hillary manquait de «stamina», d’énergie, de tripes, sous-entendant lourdement qu’elle avait des problèmes de santé et de mental. Hier, Warren était une combattante, pleine de «stamina». Oui, mais si elle a brillé, elle n’a pas causé le moindre souci à celui qui est son rival objectif, Bernie Sanders. Elle aussi, tout aussi paradoxalement, semble être l’instrument de la victoire de Bernie : elle attaque, pour lui, les autres candidats.
Il reste un dernier paradoxe. Si l’on prend les sondages, ou même les résultats de la primaire dans le New Hampshire, Bernie Sanders qui y avait gagné à 70% contre Hillary il y a quatre ans, a gagné, certes, mais avec 35% des voix. Il y a donc 65% du Parti démocrate qui est plus modéré que Sanders. D’où la quête désespérée de cette figure centriste qui pourra ramasser ce pécule – Bloomberg semble être carbonisé, Biden, épuisé, Klobuchar, une jeune sénatrice brillante, pas à la hauteur, et Buttigieg ne se départ pas de son ton de premier de la classe et de son infatuation désagréable pour quelqu’un qui n’a été que maire d’une petite ville de l’Indiana. C’est la leçon que les démocrates devraient tirer de la campagne de 2016 chez les Républicains, plutôt que de s’enfoncer dans leurs jeux du cirque, certes, très divertissants, mais inquiétants si l’on veut que l’Amérique change de Président cette année. En 2016, Trump ne convainquait que 30% des républicains, et il y avait donc une majorité virtuelle, pour tout autre candidat plus modéré, plus normal. Mais l’émiettement, les ambitions, les haines recuites, tout cela a fait que Trump a éliminé méthodiquement, un à un, tous ceux qui auraient pu rassembler contre lui le centre du Parti. Il risque d’arriver la même chose avec Bernie. Il est aussi hétérodoxe chez les démocrates que Trump ne l’était chez les Républicains. Mais ils ont tous deux une image de sincérité, un enthousiasme populaire, une gueule de personnage, et même avec leur maigre tiers de l’électorat, ils parviennent arithmétiquement à diviser leurs adversaires pour mieux régner. Tout reste encore possible. Mais ne croyez pas ceux qui vous disent que Bernie est trop à gauche, ou trop bizarre pour gagner, ceux qui inventent des Bloomberg séduisants sur le papier mais désastreux en réalité. La politique américaine n’est plus centriste : elle est une histoire de colère, et d’idéologie. Et dans cette ère, des tribuns populaires peuvent gagner.





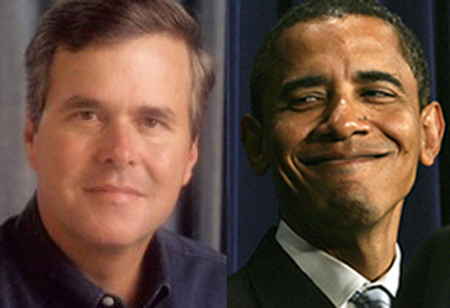


« dans le New Hampshire, Bernie Sanders qui y avait gagné à 70% contre Hillary il y a quatre ans, a gagné, certes, mais avec 35% des voix. Il y a donc 65% du Parti démocrate qui est plus modéré que Sanders » même en admettant que le résultat d’une primaire à un moment précis dans un Etat particulier (le NH) puisse être représentatif des intentions de votes de la totalité des démocrates (ce que la victoire écrasante de Sanders dans le Nevada, qui reflète bien mieux la démographie américaine, vient infirmer) il est particulièrement abusif d’en tirer la conclusion massive que « 65% des démocrates sont plus modérés que Sanders » (sous-entendu : il est bien trop « extrémiste » pour eux comme le suggère la comparaison avec Trump). Non, tout ce que cela montre c’est que 65% des électeurs du NH ont préféré un autre candidat, ce chiffre étant donc entièrement relatif à l’offre politique, à la concurrence électorale et aux préférences relatives (non l’appréciation dans l’absolu) des électeurs. C’est d’ailleurs ce que montre la comparaison avec les résultats de 2016, évoqués bien mal à propos: face à d’autres candidats (en l’occurrence la pourtant si modérée Hillary Clinton) Sanders pourrait faire le double. Avec un tel raisonnement biaisé on pourrait tout aussi bien conclure que Biden est trop modéré pour 80% des démocrates… Pour rappel, selon les enquêtes Sanders fait partie des hommes politiques les plus populaires des États-Unis (y compris chez les indépendants et certains républicains) et est le second choix de la grande majorité des électeurs de Biden et Warren (tout en restant assez plébiscité chez les autres électeurs). Cette analyse boiteuse n’a donc pour fonction que de minimiser l’émergence du progressisme chez les démocrates (y compris donc chez ceux qui ont voté pour d’autres candidats dans le NH, il faut d’ailleurs souligner que les centristes ont été obligés de reprendre nombre d’idées de Sanders pour s’adapter à la mutation idéologique de l’électorat, ce qui permet encore une fois de comprendre que les résultats du NH n’ont rien à voir avec la supposée modération des démocrates) et d’amorcer le parallèle infamant avec Trump (dont on prétend qu’il pourrait plus facilement battre Sanders bien que cela soit démenti par les sondages et par les analyses socio-démographique de la défaite de Clinton).