« Je suis Bruxelles » ne veut pas dire grand-chose. De toutes les manières, politiquement, géographiquement, culturellement, que d’ailleurs nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, nous sommes réellement Bruxelles et nous le savons. Bruxelles est à deux heures de Paris, Bruxelles, c’est l’Europe ; à Bruxelles on parle français… Dans ce cas, il s’agit donc d’une vague protestation, faite comme pour s’acquitter d’une bonne action et presque sans y penser, et un peu pour dire aussi que, par ailleurs, on ne compte certainement pas se battre autrement. Cette gentillette solidarité n’empêchera pas, l’instant d’après, de trouver toutes les excuses du monde aux fascistes de Molenbeek ou d’Argenteuil.
Palmyre, Lahore, c’est différent. Nous ne savons pas intuitivement à quel point « nous sommes » ces deux espaces. Et pourtant.
Dieu merci, Facebook a renoncé à sa politique, étrangement raciste, disons-le, en mettant en place après l’attentat de dimanche, le même safety check pour la ville pakistanaise que pour Paris ou Bruxelles. Comme beaucoup d’Occidentaux, on m’a demandé de prévenir mes amis de ma situation et c’est ainsi que j’ai appris ce qu’il s’était passé. Bug, tactique ou signe ? Dans ce chaos d’informations toutes plus effroyables les unes que les autres (attentat-suicide, Pâques, manège pour enfants, soixante morts…), on nous rappelait que oui, nous étions un peu Lahore également. Qu’il fallait peut-être, pour une fois, le dire ou au moins le penser.
L’un de mes élèves, pakistanais vivant aux Etats-Unis, me disait il y a peu qu’il n’en voulait même pas aux Occidentaux de se désintéresser des massacres terroristes qui frappent son pays. Pour eux, expliquait-il désabusé, le Pakistan doit être une grande « war zone ». J’ai alors frémi car il y avait du vrai dans son propos et je ne suis hélas pas moins occidental qu’un autre à cet égard. En Afrique, aurait un jour dit Mitterrand, un génocide de plus ou de moins… Ces phrases, si elles ne tuent pas directement, endorment notre humanité. Et un jour viendra peut-être où quelque part sur terre, au Japon, à Singapour, au Chili, on dira la même chose de Paris : un attentat de plus ou de moins dans une zone de guerre, qu’importe ?
Lahore, c’est pourtant un peu nous, oui. La même haine, la même infernale saloperie a frappé Paris, Bruxelles et Lahore. Avec pour but non seulement de tuer, mais encore de laisser aux survivants, ineffaçables, des marques au corps et à l’âme.
Nous sommes une seule humanité, douloureuse, blessée, une seule chair, et nous avons un seul ennemi. Alors bien sûr, Daesh et les Talibans, c’est différent. « Techniquement », comme on dit. C’est différent comme Franco et Mussolini étaient différents, mais Daesh, Boko Haram, les Talibans et toutes les autres dénominations du totalitarisme islamiste ont les mêmes cibles : amants de la mort, ils en veulent à la vie, à la liberté, au savoir, à l’homme même. Ces ordures qui donnèrent l’ordre de massacrer des enfants, coupables d’être chrétiens ou de s’être hasardés, musulmans, à proximité de chrétiens fêtant la Résurrection de leur Dieu, lançaient naguère de l’acide au visage de fillettes, les laissant monstrueusement défigurées pour avoir eu l’impudence d’aller à l’école.
Moi qui ne suis pas chrétien, une chose m’a bel et bien frappé dimanche. C’est qu’on saurait difficilement pousser plus loin le contraste entre ceux qui haïssent la vie et ceux qui la célèbrent : Pâques est censée commémorer la victoire de Jésus sur la mort. Le passage du désespoir au triomphe métaphysique. Les islamistes, eux, ne désespèrent jamais, mais ça n’est pas qu’ils fassent confiance à la vie : ils savent qu’après vient, déjà écrit et qui donnera sens à un présent tout juste bon à être sacrifié sur son autel. Ils ne doutent ni de Dieu ni d’eux-mêmes, et c’est pourquoi ils ne peuvent que haïr tout ce qui, en cette vie, résiste à l’absolu despotisme de l’idole invisible devant laquelle ils s’anéantissent – et nous avec.
Je n’ai pas pu m’empêcher de penser dimanche à un autre massacre, non moins atroce : c’était en Israël, il y a quatorze ans, et les victimes étaient des Juifs rassemblés pour célébrer Pessah, la Pâque juive. (La Cène, le dernier repas de Jésus et de ses disciples, eut lieu comme on sait un soir de Pâque…) Fête de la libération des esclaves, fête du printemps aussi, où la dignité humaine prend le pas sur la prosternation, où la vie l’emporte sur la mort, où l’homme fait justice de toutes les idoles. C’était en 2002 et cette Pâque fut bien amère.
C’est toujours la même histoire. En tout cas, j’avoue mal comprendre comment ces énergumènes espèrent nous convaincre de leurs âneries en les défendant de la sorte, par les bombes, par le feu et le sang. Le savant Sébastien Castellion, notamment traducteur du Cantique des Cantiques en français, s’opposa fameusement à Calvin qui avait fait brûler vif Michel Servet pour hérésie en 1553. « Tuer un homme ce n’est pas défendre une doctrine », affirma hautement Castellion, « c’est tuer un homme. Quand les Genevois ont fait périr Servet, ils ne défendaient pas une doctrine, ils tuaient un être humain : on ne prouve pas sa foi en brûlant un homme mais en se faisant brûler pour elle ». Je ne crois pas que l’on prouve sa foi en mourant pour elle, mais pour l’autre point, c’est fort justement qu’il disait qu’on ne prouvait rien en massacrant. A part sa bassesse.
Les chrétiens sont probablement aujourd’hui le groupe religieux le plus persécuté au monde, ce qui a l’air de laisser de marbre nos militants anti-islamophobie. Dans maints pays, il faut aujourd’hui pas mal de courage pour croire en l’Evangile, à tout le moins en faut-il pour l’afficher. D’une certaine manière, il en faut aussi pour demeurer musulman et humaniste à la fois, ce qui est le cas, peu ou prou, de la plupart des Français nés dans cette religion : il en faut car à regarder ce spectacle lamentable, on comprend les paroles d’Adonis pour qui Daesh sonne tout simplement le glas de l’islam. « C’est un prolongement, certes. Mais c’est aussi la fin », affirme le poète syrien.
Les chrétiens, minorité d’un pays intensément musulman et indépendant depuis 1947, sont massacrés par des musulmans. Ils sont de même ethnie et ce ne sont pas des colons. Ils sont pauvres, issus principalement des Intouchable de la religion hindoue. L’attentat de Lahore signe donc bien la destruction en acte de la rhétorique « postcoloniale » (raciste à la vérité) selon laquelle tout ce qui advient à ces populations dépourvues de libre arbitre serait le fait de l’Occident.
Le pouvoir est partout et quand on a à la fois celui du nombre et celui des bombes, on l’a assez complètement pour que ce grossier schéma explose. Le roi est nu, comme dirait le petit garçon d’Andersen : si impérialisme il y a, ce n’est pas de « notre » côté qu’il se trouve.
Nous, nous sommes avec les martyrs. Nous sommes Paris, nous sommes Bruxelles et Bamako, nous sommes le Nigéria et la Turquie, nous sommes Lahore.
Lahore : Akbar, le plus tolérant des souverains moghols, les rois musulmans des Indes, en avait fait sa capitale, lui qui à la fin du XVIe siècle mit fin au statut discriminatoire des dhimmis et appela à sa cour hindous et même chrétiens. Lahore, la cité des Jardins de Shalimar. Eh oui ! Avant d’être un parfum de Guerlain, Shalimar est le nom de ce fabuleux joyau de la culture indo-persane. Kipling vécut à Lahore ; le réformiste Iqbal, père du Pakistan, y mourut et y est enterré.
Nous sommes Lahore et nous sommes Palmyre, aujourd’hui libérée des griffes de Daesh, mais après avoir été martyrisée, ses temples saccagés, ses statues détruites. « Daesh a réduit le temple [de Bêl] en poudre, littéralement », affirmait l’historien Maurice Sartre, spécialiste de l’Orient hellénisé, aux journalistes du Point. Le temple de Bêl – qui, identifié à Zeus, n’était autre que le Marduk des Mésopotamiens, et peut-être même le YHVH des Hébreux, vainqueur du Léviathan et des monstres marins –, nous disait tant de nos propres racines théologiques et esthétiques : à la fois gréco-romain avec son portique et ses chapiteaux corinthiens, et sémitique, avec son entrée sur le côté, ses créneaux et ses fenêtres « comme en ont les maisons des humains, c’était du jamais-vu » (Paul Veyne). En fait, c’est ainsi qu’avait été bâti le Temple de Jérusalem et c’est à leurs ancêtres orientaux plutôt qu’aux temples grecs que les églises – comme les synagogues et les mosquées – doivent leurs fenêtres.
Palmyre, ville araméenne, arabe, grecque, ayant prospéré à l’ombre de la Perse sassanide, féconde de tant d’influences, babyloniennes, syriennes, phéniciennes… « A Palmyre, le fond était araméen, mais la composante arabe avait fini par l’emporter en nombre », écrit Veyne. « Voilà donc une antique cité araméenne où des Arabes sont venus se sédentariser et dont ils ont adopté la langue »… avant que le grec ne vienne, non pas concurrencer l’araméen, mais le compléter, l’étendre. C’est que la civilisation arabe est largement antérieure à l’islam, lequel occupe relativement peu de siècles dans cette longue histoire. Et il fut un temps où les Arabes, polythéistes encore, parlaient aussi le grec. Rome ne vit d’ailleurs aucun inconvénient à ce que le dénommé Philippe, dit Philippe l’Arabe, devînt son empereur en 244 de notre ère…
Cette cité du désert était un Occident en miniature, pourrait-on dire, puisque ce qui allait devenir l’Occident de nombreux siècles après sa chute serait précisément la rencontre de la civilisation sémitique et de la civilisation indo-européenne.
Pour le grec, ça n’était pas la langue seulement : tout le Croissant fertile eut l’araméen pour lingua franca. Le grec fut bien plus qu’une lingua franca, il fut le premier, le plus durable et le plus merveilleux des instruments d’arrachement à soi. C’est l’hybridité en résultant que Paul Veyne a su mettre en lumière : elle persista, suggère-t-il, tant que n’existait pas de culture religieuse qui ne veuille « entendre parler de rien d’autre que d’elle-même ». C’est que, pour reprendre la si jolie formule de Veyne, « s’helléniser, c’était rester soi-même tout en devenant soi-même ». De soi à soi, en passant par l’autre, en s’universalisant.
Palmyre reste associée dans les mémoire à la reine Zénobie, alliée puis ennemie de Rome. Une souveraine raffinée et tolérante, qui s’entoura de philosophes et accueillit en sa cité une grande diversité de cultes. Juifs et manichéens (les sectateurs de Mani, nouvelle religion à l’époque, que nous connaissons surtout par ses adversaires, dont Augustin qui fut d’abord manichéen lui-même) y trouvèrent asile. On a parfois suggéré que Zénobie était convertie au judaïsme, ou « sympathisante ». C’est en tout cas à Palmyre que l’on a retrouvé l’une des plus anciennes inscriptions en hébreu connues, le début du Shema Israël, la « profession de foi » du judaïsme. Ce n’est peut-être pas hasard si une légende reprise par Flavius Josèphe faisait de Salomon le fondateur de Palmyre, « Tadmor » en hébreu et en araméen.
Zénobie aurait pu faire de son fils l’empereur de Rome. Si Aurélien, l’empereur dont la muraille enserre toujours le Centro Storico de la Ville Eternelle, n’avait pas mis fin à l’épopée palmyrénienne, la reine arabe aurait probablement marché sur la capitale. En 274 elle était battue et, semble-t-il, exécutée.
Daesh a voulu nous montrer à quel point il abomine tout cela, c’est-à-dire tout ce que nous adorons. Le théâtre de Palmyre, où l’on joua peut-être Euripide et Sophocle et sans doute quelques unes de ces pantomimes ou de ces farces qui célébraient tout simplement l’amour de la vie de la culture gréco-romaine, a connu sous son contrôle un usage tout à fait différent. Le 4 juillet 2015, on y a par exemple exécuté vingt-cinq hommes, alignés devant la colonnade du fond. Bien d’autres mises en scènes horrifiques y eurent lieu, toujours dans le même but.
« Mais pourquoi, en août 2015, avoir fait exploser et détruit ce temple de Baalshamîn ? », interroge Veyne. Un premier élément serait la haine de l’islam pour le passé arabe dont je viens de parler, celui d’avant Mohammed, la haine du polythéisme auquel se livrait ce peuple de guerriers et de poètes avant qu’il ne se convertisse au syncrétisme judéo-chrétien du caravanier mecquois. Une autre réponse est que « ce monument est vénéré par les Occidentaux actuels, dont la culture comporte un savant amour pour les ‘monuments historiques’ et une vive curiosité pour les croyances d’ailleurs et de jadis. Or les islamistes veulent manifester que les musulmans ont une autre culture que la nôtre, […] et qu’ils ne respectent pas ce que vénère la culture occidentale ». Nous cracher leur mépris à la face. Nous dire à quel point ils nous sont supérieurs, ces anciens cancres devenus conquistadores.
Et pourtant, si c’est la capacité à voir de l’universel ailleurs que chez soi, à dire non en somme à l’ethnocentrisme, qui fait la supériorité d’un homme et d’une culture, alors force est de reconnaître, quelles que soient nos fautes, la grandeur de la nôtre : « à nos yeux », écrit encore Veyne, « s’il arrivait malheur à une des admirables mosquées de Damas, d’Istanbul ou d’Andrinople, ce serait une perte pour toute l’humanité. » La différence est là. La différence, c’est que la destruction des Bouddhas de Bamiyan fit verser des larmes aux méchants Occidentaux, comme aujourd’hui celle de ces temples à créneaux où il y a mille huit cents ans des Arabes aux noms imprononçables priaient Bêl, Baalshamîn et la déesse Allat.
Lahore par le sang de gamins qui ne voulaient, comme nous autres pauvres mécréants, que vivre ; Palmyre parce qu’il est des larmes aux choses, parce que les pierres parlent à qui sait entendre : notre humanité est là, nos valeurs universelles, blessées. Meurtries au nom de l’un : un seul Dieu, disent-ils, c’est-à-dire en fait, dans leur esprit, un seul livre, une seule histoire, un seul sens. Leur monothéisme est une autocratie érigée en théologie, une pure et simple idolâtrie.
Nous savons pourquoi nous nous battons. Pour la vie, pour la pluralité. Dans Joseph Anton, son autobiographie à la troisième personne, Rushdie dit avoir été ému aux larmes d’apprendre que l’on avait retrouvé l’emplacement du Théâtre du Globe, de cet endroit où pour la première fois avaient retenti les dialogues de Shakespeare. « The love of the art of literature was a thing impossible to explain to his adversaries, who loved only one book, whose text was immutable and immune to interpretation, being the uncreated word of God ». Tant que nous aurons la force de pleurer Palmyre, tant que nous aurons la force de demander justice pour le sang des enfants de Lahore, tant que partout dans le monde, où que l’on soit né, l’on saura opposer le merveilleux pluralisme de Shakespeare à la tyrannie d’un seul livre, la bataille ne sera pas perdue. Encore ne faudra-t-il pas oublier que, comme le dit Pascal, la justice sans la force est impuissante.


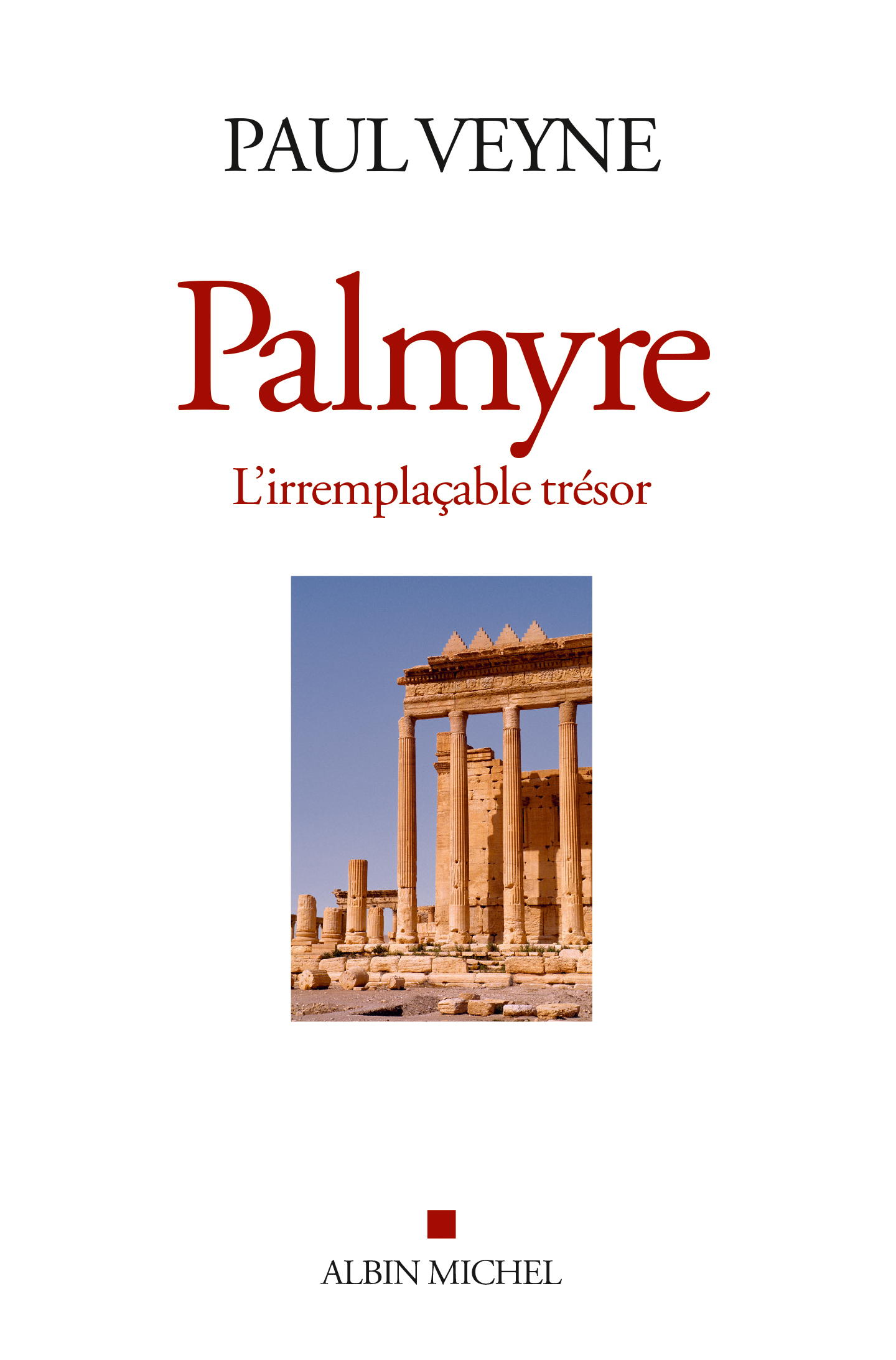






Toutes mes félicitations pour cet article ou plutôt déclaration de vos convictions que je partage.
Votre effort pour démontrer le danger du deux poids deux mesures face aux attentats à travers le monde est tout à fait louable. Cela dit, mettre tous les terroristes dans le même sac prête plutôt à confusion.
Magnifiques passages sur Palmyre…
Merci pour cette recontextualisation et cette mise en perspective dont certains auraient bien besoin !
Un texte qui fera taire, je l’espère, les voix vous prêtant un discours raciste.