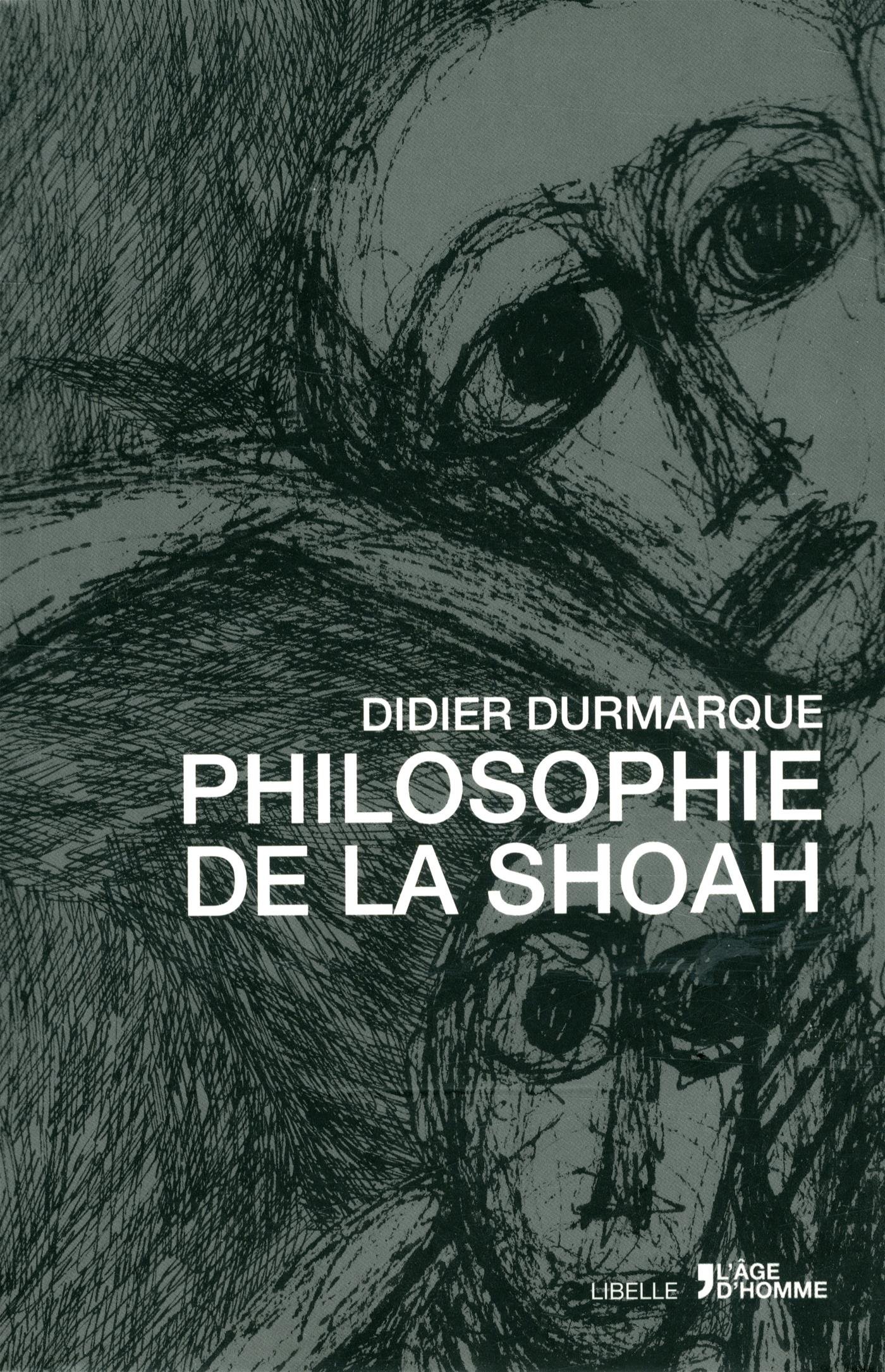Nous ne connaissons pas l’œuvre d’Imre Kertész!
Quand je dis « nous », je n’évoque pas la sagacité de cet immense philosophe qui, dans ses Dialogues désaccordés, juge l’auteur « surfait et politique »… parce qu’il ne l’a pas lu.
Non ! Nous ne connaissons pas l’œuvre d’Imre Kertész au sens où nous n’arrivons pas à « naître avec » !
Comme Kierkegaard, nous savons que devenir ce que l’on comprend est la seule et unique façon de comprendre.
Alors, on lit Kertész. On le sait parfois comme on retient les choses intelligentes. Mais force est de constater qu’on n’a pas pris la mesure du renversement philosophique, du nouveau Sinaï, comme aime à le dire l’auteur, je veux parler du nouveau Sinaï de la Shoah :
« La révélation du Sinaï a perdu sa validité avec l’accomplissement d’Auschwitz. »
L’œuvre de Kertész nous échappe parce que, tel le Zarathoustra de Nietzsche, Kertész arrive trop tôt. Nous avons constamment les yeux collés sur la réalité qu’il fait voir.
Quand je dis qu’on ne connaît pas l’œuvre de Kertész, je parle d’un double fond d’ignorance, d’ingestion sans digestion… parce qu’il faut dire aussi que l’époque dont parle Kertész est indigeste. C’est peu dire.
Ce premier fond renvoie à ce que Heidegger nommait l’équivoque : « Tout a l’air d’avoir été véritablement entendu, saisi et prononcé et ne l’est au fond même pas, ou bien il n’a pas l’air d’en être ainsi mais c’est ce qui a au fond pourtant lieu. » Pour reprendre une des plus belles formules de Lévinas, nous avons lu Kertész sans sauver le texte de son malheur de livre.
Pourtant, à sauver le texte, on oserait penser que l’histoire ne nous a pas appris la Shoah, qu’elle est un pan nécessaire mais non suffisant : « Le camp de concentration est imaginable exclusivement comme texte littéraire, non comme réalité (pas même – et peut-être surtout pas – quand on le vit). » Quand l’événement est impensable en tant que tel, c’est un paradoxe fructueux que cet événement demande à la pensée de le mettre à l’épreuve, d’en faire un problème.
Or, que nous dit Kertész ? La Shoah est la modernité par excellence, de sorte que rien n’est plus moderne que la Shoah ! La Shoah dit la modernité !
Plus fondamentalement, la Shoah renvoie à l’absence de Dieu, cette transcendance qui est néant et qui a causé Auschwitz :
« Voici le vrai nom de la transcendance : le néant. Elle n’en est pas moins transcendante. »
Causer Auschwitz, c’est se dire dans Auschwitz et produire l’événement comme cause finale :
« Auschwitz est la réponse à la création divine. »
« La vie est un vaste camp de concentration
institué par Dieu sur la terre pour les hommes
et que l’homme a développé en camp
d’extermination de l’homme. »
Seul Tadeusz Borowski avait été aussi loin dans son analyse des camps. Sans Dieu, il n’y aurait pas Auschwitz. Kertész accomplit, ici, la métaphysique heideggérienne qui pense l’être comme néant dans l’expérience de l’angoisse.
Ainsi, la Shoah est la modernité par excellence : « Je persiste à penser que l’Holocauste est un traumatisme de la civilisation européenne, et que la forme que ce traumatisme prendra dans les sociétés européennes – culture ou névrose, construction ou destruction – sera pour cette civilisation une question vitale. »
De même, la Shoah est la ratio cognoscendi de cette transcendance qu’on appelle Dieu et qui est néant. Tout se passe comme si Kertész exigeait une philosophie de la Shoah comme vision, de sorte qu’il cherche à la penser, sans véritablement la poser. Et surtout pas la poser dans le contresens, dans l’indécence d’un système.
La Shoah montre non seulement l’homme, mais la modernité, l’essence de la technique, c’est-à-dire la rationalité qui peut se passer de l’homme, l’administration qui peut se passer de l’homme, la technique qui peut se passer de l’homme, l’économie qui peut se passer de l’homme, l’homme qui peut se passer de l’homme, le monde qui peut se passer de l’homme, en somme le néant. Pour une nouvelle civilisation planétaire.
Les leçons qu’on peut tirer de la Shoah sont non seulement immanentes, mais transcendantes. Quelque chose de Dieu se joue dans la Shoah, sur-git, un point pivot, mouvement (jeu) et résistance, c’est-à-dire problème, philosophie, nouveau Sinaï, décomposition et dépassement. Kaddish de l’Etre. Après Auschwitz, plus de création.
« Dieu est Auschwitz. »
Le second fond de cette ingestion, dont il ne reste plus rien, fait l’objet de la plainte de Kertész. Depuis la remise du prix Nobel de littérature en 2002, Kertész estime être passé du statut d’écrivain au statut de marque, de marchandise, de contenant sans contenu, sorte de coquille vide, métonymie de la modernité.
Dans La Crise de la Culture, Arendt écrit que la différence entre la culture et la consommation repose sur le fait qu’il reste quelque chose du bien culturel après son appropriation. La « marque » Kertész est telle qu’elle recouvrirait l’œuvre, l’entretien infini qu’elle exigerait avec son lecteur. Comme un musée où l’on veut voir toutes les œuvres sans pouvoir en retenir une seule, la consommation de Kertész empêcherait son appropriation. Sauver le texte de son malheur de livre !
Pour prendre cette injonction à la lettre, j’aimerais penser et tenter de prendre la mesure de la phrase la plus énigmatique de l’œuvre de Kertész, phrase qu’il n’explique jamais autre part, mais qui sonne comme une assertion décisive, définitive et troublante, qui vous laisse sans repos :
« Les deux grandes métaphores du XXe siècle : le camp de concentration et la pornographie. »
Je reviens toujours sur cette phrase parce qu’elle me donne à penser. Je n’en ai jamais fini avec elle. On en finit très vite avec une formule ou un slogan, avec un credo ou un proverbe. On a affaire, ici, à une phrase d’une autre trempe, à une espèce de saisie, d’arrachement du réel. Il y a des phrases qui ne se donnent jamais comme telles. Au lieu de les fuir, il faut s’y engouffrer. Elles n’appellent pas la consommation, mais la formation.
A la fois image, optique, transport et déplacement, la métaphore montre et arrache ce qu’elle donne à voir. Mais pourquoi donc lier camps de concentration et pornographie ? Cette conjonction a-t-elle le sens d’une succession ou d’une coexistence ?
Figures de l’obscène qui montrent ce que l’on doit cacher, fétichisation du corps, réification du corps, quand l’homme se passe de l’homme. Encore. Modernité. La conjonction de l’assertion de Kertész semble avoir le sens d’une unité.
Dans cette déclaration, dans la problématique du corps, il y a une sémantique, voire une sémiotique du corps. Le corps fait sens dans sa propre réification : poupées non gonflables, Figuren : « Celui qui disait le mot « mort » ou « victime » recevait des coups. Les Allemands nous imposaient de dire, concernant les corps, qu’il s’agissait de Figuren, c’est-à-dire de… marionnettes, de poupées, ou de Schmattes, c’est-à-dire de chiffons.[1]
Dans la déclaration de Kertész, le corps est le contraire de la chair, il se désincarne. Il fait signe vers l’absence d’identité, il la signifie vers ce que Kertész nomme l’homme fonctionnel :
« La réalité de l’homme fonctionnel est une réalité apparente, une vie qui remplace la vie, une fonction qui le remplace lui-même. »
Le corps comme fonction, instrument, chose, signe la disparition de l’homme, l’absence d’être. « N’être avec » au lieu de « naître avec ». Descente d’identité qui, selon Chalamov, nous rapproche du minéral. Rien sous forme de quelque chose, c’est-à-dire essence de la technique. Un néologisme pourrait s’imposer ici : « desêtrification ».
« Après la philosophie de l’existentialisme il ne peut visiblement y avoir qu’une seule philosophie : le non-existentialisme. C’est-à-dire la philosophie de l’existence inexistante. »
Kertész ouvre le chemin d’une philosophie de la Shoah, d’une école au sens étymologique, école comme optique de la modernité et de l’Être qui mettrait cet avertissement à son portail:
« Les foules ne deviennent pas nazies ou quelque chose de similaire par révolte, mais plutôt par conformisme. »
[1] Shoah de Claude Lanzmann, paroles de Motke Zaïdl et Itzhak Dugin.