Bonjour Yann, ça va ?
Je suis en pleine forme, cher Bertil. Je rentre de Brasilia, où je vis comme tu le sais une partie de l’année. Berlin, Brasilia, Budapest sont les trois villes, en dehors de Paris, où je passe pratiquement tout mon temps. C’est ma trilogie des villes en « B ». Berlin pour Marcuse, Budapest pour Lukàcs et Brasilia pour Marx… Roberto Burle Marx, évidemment ! (Rires)
C’est étrange. Il n’y a pas grand-chose à y faire à Brasilia…
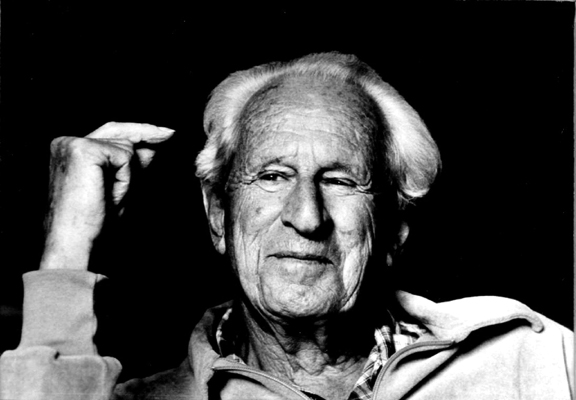
Justement. Je n’y fais strictement rien. Je nage. A la piscine municipale, puisqu’il n’y a pas la mer. Le Brésil sans mer est sans doute plus intéressant que le Brésil avec mer. Et puis, l’ennui, car je sens que c’est la question que tu vas me poser, n’est pas un problème pour moi. Je ne peux prétendre que je ne m’ennuie jamais : mais j’aime de plus en plus m’ennuyer. L’ennui est une anfractuosité dans le temps, et il est important d’y loger régulièrement. Dans ce pays spécial, l’ennui, ou plutôt depuis ce pays, j’entreprends des choses que je ne pourrais entreprendre dans aucun autre espace, dans aucune autre temporalité. C’est d’ailleurs ce qui me frappe dans l’ennui : c’est que l’espace et le temps semblent s’y confondre, ils se ressemblent, ils semblent faits d’une seule et même texture, étendue. Je ne sais jamais si c’est l’espace déployé devant moi qui m’ennuie, ou le temps. L’étendue spatiale, ou l’étendue temporelle, c’est-à-dire la durée. Les deux sont superposées, indiscernables. Dans le véritable ennui, il y a autre chose : l’incapacité, non seulement de créer, d’écrire, de dessiner, mais également de penser. Lorsque je nage, il m’arrive fréquemment de m’ennuyer, mais au moins je nage, et si mon cerveau est livré à l’ennui, mon corps, pendant ce temps-là, est occupé, et occupé pour la bonne

cause. Il est occupé à se faire du bien. Mais je parle en réalité de l’ennui sans nage : quand le corps ne fait rien de plus que le cerveau, que les deux sont strictement livrés à eux-même, abandonnés à la pure gratuité du temps qui s’écoule et de l’espace qui se propose. Eh bien, dans cette anfractuosité du temps qu’est l’ennui et où je ne « pense » pas, je parviens à un état qui n’a rien de mystique mais qui cependant est, en quelque sorte, « supérieur » à la pensée, en tout cas se situe au-delà. Ce n’est pas de l’ordre du rêve, ni même de la rêverie, c’est une enclave à part, pour un mode de penser qui ne sait pas qu’il est en train de penser. Ce n’est donc pas, non plus, de la méditation. Car même dans l’oubli qu’elle peut s’ordonner, la méditation se sait en train de méditer. Brasilia, effectivement, est la ville où je m’ennuie le plus. J’y suis certain, et c’est ce qui me plaît là-bas, de ne pas me livrer à autre chose qu’un temps qui n’a pas de forme, à une étendue qui n’a pas de limite, et inversement. Rien de ce que j’écris à Brasilia ne saurait, par exemple, relever de l’art, de la littérature. Je vise autre chose, sans comprendre exactement ce que je suis en train de faire. Du moins, j’y lis énormément, entre deux séances, très longues, de crawl.
Tu lis toute la journée ?

Pratiquement. Au moins huit heures par jour. Surtout, ce que j’aime, je m’en rends compte, c’est d’être situé loin, très loin des agitations politiques, de leur indécence, de leur relativité. Cette atroce politique française. Et puis, dans mes trois villes de prédilection, dans mon triangle Brasilia-Berlin-Budapest, j’ai cette sensation, vivifiante, que les hommes et les femmes ne sont pas simplement posés dans les rues, et dans les immeubles de ces rues, pour produire et consommer, pour consommer et manger, pour manger et dormir, pour dormir et baiser. Ce sont des villes moins mécaniques que Paris, moins barbares, moins livrées à la pornographie du « tout, tout de suite » et du « moi d’abord ». Paris est une ville que je ne peux pas voir en peinture. Ou plutôt : que je ne peux voir pratiquement qu’en peinture. Au Brésil, la nécessité n’est pas dans la consommation, la brutalité n’est pas dans l’obsession du confort : il n’y a pas d’érotomanie de l’égoïsme, de mépris par ultra-sustentation. Ce n’est pas, comme on le voit à Paris, une société qui s’adore repue. C’est un monde patient, optimiste, dans lequel existe la misère, mais où le contentement de soi est moins marqué : on y est moins athée. On s’y considère moins divin que Dieu. Ce qui n’est pas le cas dans notre capitale egothéiste où chaque individu fait commencer le monde avec lui-même et le borne à sa seule personne.
Sur quoi te bases-tu pour affirmer cela ?
 On s’en rend compte dans les détails minuscules. Les gens qui sont incapables de faire la queue dans une simple boulangerie sans grommeler, tant ils jugent insupportable, insultant, qu’on puisse leur imposer douze secondes d’attente. On s’en rend compte en traversant sur les clous : une légère pression sur la pédale de l’accélérateur, tandis que nous allons d’un trottoir vers l’autre, nous rappelle que le chauffeur entend, de manière rentrée, retenue mais à peine, nous écraser. Son importance est jugée par lui plus évidente que l’importance donnée, octroyée, cédée, concédée à autrui. Autrui est devenu le décor flou des aventures importantes et passionnantes de chacun. A Paris, l’individu est assuré d’être prioritaire sur l’ensemble de ses semblables, de ses « ensemblables ». Chacun exigeant d’être prioritaire, on en est venu alors à créer des priorités différentes au lieu de conserver le modèle classique de la même attente pour tous : les cartes des cinémas proposent des modalités diversifiées d’attente. Il y a des attentes modérées, mais elles sont en retard par rapport aux attentes quasiment nulles, elles-mêmes enviant les attentes sans la moindre attente. En prenant son ticket, maintenant, nous choisissons le mode d’attente, ou plutôt le mode de non-attente qui va avec. Nous choisissons le film et la queue de ce film. Nous choisissons le film et la manière de faire la queue pour voir ce film. Une fois arrivés, nous découvrons, à notre grand désarroi, qu’il y a là des gens qui font encore moins la queue que nous ! Nous sommes très surpris, très meurtris, parce que nous étions véritablement persuadés d’être, en matière de non-attente, de vrais privilégiés. Nous pensions, naïvement, être à la pointe de ce qui se fait de mieux dans le domaine du moins de queue possible. Mais non : une formule plus efficace, un privilège plus neuf encore, un privilège tout frais, un passe-droit inventé la semaine dernière, mis au point hier, est venu ringardiser le précédent. Il y a donc, désormais, une longue concurrence, une grande bataille, une cruelle compétition entre gens qui n’attendent plus. Les queues ne sont faites que de gens qui ne font
On s’en rend compte dans les détails minuscules. Les gens qui sont incapables de faire la queue dans une simple boulangerie sans grommeler, tant ils jugent insupportable, insultant, qu’on puisse leur imposer douze secondes d’attente. On s’en rend compte en traversant sur les clous : une légère pression sur la pédale de l’accélérateur, tandis que nous allons d’un trottoir vers l’autre, nous rappelle que le chauffeur entend, de manière rentrée, retenue mais à peine, nous écraser. Son importance est jugée par lui plus évidente que l’importance donnée, octroyée, cédée, concédée à autrui. Autrui est devenu le décor flou des aventures importantes et passionnantes de chacun. A Paris, l’individu est assuré d’être prioritaire sur l’ensemble de ses semblables, de ses « ensemblables ». Chacun exigeant d’être prioritaire, on en est venu alors à créer des priorités différentes au lieu de conserver le modèle classique de la même attente pour tous : les cartes des cinémas proposent des modalités diversifiées d’attente. Il y a des attentes modérées, mais elles sont en retard par rapport aux attentes quasiment nulles, elles-mêmes enviant les attentes sans la moindre attente. En prenant son ticket, maintenant, nous choisissons le mode d’attente, ou plutôt le mode de non-attente qui va avec. Nous choisissons le film et la queue de ce film. Nous choisissons le film et la manière de faire la queue pour voir ce film. Une fois arrivés, nous découvrons, à notre grand désarroi, qu’il y a là des gens qui font encore moins la queue que nous ! Nous sommes très surpris, très meurtris, parce que nous étions véritablement persuadés d’être, en matière de non-attente, de vrais privilégiés. Nous pensions, naïvement, être à la pointe de ce qui se fait de mieux dans le domaine du moins de queue possible. Mais non : une formule plus efficace, un privilège plus neuf encore, un privilège tout frais, un passe-droit inventé la semaine dernière, mis au point hier, est venu ringardiser le précédent. Il y a donc, désormais, une longue concurrence, une grande bataille, une cruelle compétition entre gens qui n’attendent plus. Les queues ne sont faites que de gens qui ne font  pas la queue. Quant à ceux qui la font vraiment, les arriérés, les oubliés du progrès, ceux qui font la queue d’avant l’époque de la non-queue, ceux qui attendent dans une fille d’attente et non dans une file de non-attente, ceux-là, ils ne trouvent plus de terre d’asile, ils ont abandonné, on ne les voit plus, on ne sait pas qui ils sont. On se demande s’ils ont jamais existé. Tout le monde, donc, est privilégié au même moment et jouit au même moment du strictement même privilège. Tout le monde est le premier, partout. Tout le monde est invité d’honneur, tout le monde a reçu une invitation spéciale, tout le monde est VIP. Tout le monde monte sur le podium. C’est la démocratisation par l’exception, une sorte de communisme par le sommet, une élitisation de l’égalité. Une élitisation de masse. De l’exceptionnel de groupe. Du cas par cas par grappes. Du tri-sur-le-volet généralisé. C’est de l’unicité de masse. C’est par cars entiers, par charters pleins que l’on est le seul, que l’on est unique au monde. Ce n’est plus l’exception qui confirme la règle, puisque la règle est devenue l’exception. C’est : exception pour tous. De la rareté par pelletées. Du nominatif industriel. De l’unique à la chaîne. Du sur-mesure en prêt-à-porter. Tout le monde est le premier, à commencer par le dernier. Tout le monde est major, en particulier le minor. Il y a une avidité humaine à être célébré, et corrélativement, et subséquemment célèbre, qui s’est universalisée. C’est du nombrilisme en série. Au Brésil, en Hongrie, à Berlin, je note que chacun reste à sa place. A Paris, chacun est à la première place. Chacun est le seul.
pas la queue. Quant à ceux qui la font vraiment, les arriérés, les oubliés du progrès, ceux qui font la queue d’avant l’époque de la non-queue, ceux qui attendent dans une fille d’attente et non dans une file de non-attente, ceux-là, ils ne trouvent plus de terre d’asile, ils ont abandonné, on ne les voit plus, on ne sait pas qui ils sont. On se demande s’ils ont jamais existé. Tout le monde, donc, est privilégié au même moment et jouit au même moment du strictement même privilège. Tout le monde est le premier, partout. Tout le monde est invité d’honneur, tout le monde a reçu une invitation spéciale, tout le monde est VIP. Tout le monde monte sur le podium. C’est la démocratisation par l’exception, une sorte de communisme par le sommet, une élitisation de l’égalité. Une élitisation de masse. De l’exceptionnel de groupe. Du cas par cas par grappes. Du tri-sur-le-volet généralisé. C’est de l’unicité de masse. C’est par cars entiers, par charters pleins que l’on est le seul, que l’on est unique au monde. Ce n’est plus l’exception qui confirme la règle, puisque la règle est devenue l’exception. C’est : exception pour tous. De la rareté par pelletées. Du nominatif industriel. De l’unique à la chaîne. Du sur-mesure en prêt-à-porter. Tout le monde est le premier, à commencer par le dernier. Tout le monde est major, en particulier le minor. Il y a une avidité humaine à être célébré, et corrélativement, et subséquemment célèbre, qui s’est universalisée. C’est du nombrilisme en série. Au Brésil, en Hongrie, à Berlin, je note que chacun reste à sa place. A Paris, chacun est à la première place. Chacun est le seul.
Tu expliques cela par la religion ?

Entre autres. Mais oui, la religion joue dans cette affaire un grand rôle. Le Brésil est un pays farouchement religieux, ce qui fait beaucoup de bien. Le Brésil est religieux de partout. Avec une liberté incroyable, une mobilité inouïe : les frontières d’une religion à l’autre sont très souvent poreuses, ce qui n’est pas tellement concevable en France. Au Brésil, on trouve évidemment des catholiques, des juifs et des musulmans, mais aussi bon nombre de Mormons – notamment à São Paulo et à Recife, qui sont des villes que je connais bien et que j’aime beaucoup -, mais aussi des orthodoxes melkites, des umbandistes, des candomblistes, des baptistes, des adventistes, des spirites, des druides, des animistes, des néo-païens et… des positivistes ! Tu imagines le bazar ? Il faut, au moins une fois dans sa vie, assister à une séance d’exorcisme au Brésil. Ce fut mon cas à Foz de Iguaçu. Sur une scène, devant huit-cent personnes, avec micro et sono d’enfer, si j’ose dire. Je puis dire que ça secoue. Le Français, lui, ne connaît pas tout cela. Il ne peut y avoir accès : il est trop engoncé dans son minable autothéisme étriqué.
Que faudrait-il faire pour en sortir, pour s’arracher à cet autothéisme ?

La guerre. Une guerre des Français comme moi contre les Français comme eux. Un Français comme moi, c’est un Français qui essaye, dans la mesure du possible, de conserver un regard intéressé, mais critique, voire sévère sur les notions de progrès, de civilisation des Lumières, de technologie technologisante. Le mot de « civilisation », qui n’a guère de sens, est servi aujourd’hui à toutes les sauces. Il y a des hommes qui ont parlé dans le temps, et leur parole s’est soit tue pour toujours, soit propagée jusqu’à nous. Le reste n’intéresse que les historiens. Mais l’histoire n’est selon moi rien d’autre qu’une occupation, passionnante il est vrai, mais anecdotique, secondaire, seconde, annexe, par rapport à l’étude de la parole, à la propagation du dire, à la littérature sous toutes ses formes. L’aspect scientifique, « objectif », de l’histoire, ne doit jamais nous intimider, bien au contraire : la science est toujours seconde en regard de ce qui est subjectif, c’est-à-dire de l’homme même. Il faut répéter, sans cesse, qu’a priori nous n’avons jamais besoin de la science, puisque c’est par son déploiement, par son élaboration, par son expansion, par son développement, qu’est créée rétrospectivement son aspect nécessaire – que son irréversibilité, et ses apports effectivement bénéfiques, paraissent non seulement évidents, mais vitaux. La parole est première, elle est humaine. La science est seconde, elle n’est ni humaine ni inhumaine. Elle ne « dit » pas. La science n’est pas intelligente. L’histoire non plus. Toute cette lumière sur le passé, au fond, n’est pas si fondamentale que cela. On peut vivre sans aller dans les musées. Ce n’est pas sous cette forme, sous sa forme historique que le passé existe le mieux. Il y existe simplement le plus. Mais pas le mieux. L’histoire au sens de « Geschichte », de passé qui a bel et bien eu lieu, a d’autres façons de se propager que par l’histoire au sens de « Historie », d’historiographie, de science historique, de géométrie analytique des événements. Simplement, le passé préfère se présenter,
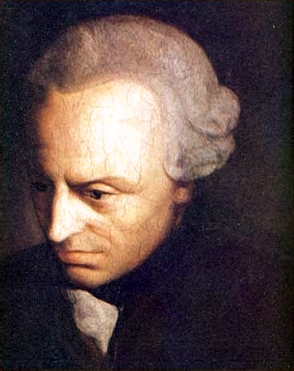
depuis les Lumières – comme tout le reste d’ailleurs : l’écoulement des fluides et les habitudes des groupes humains – sous une forme rationnelle, ou du moins raisonnable. Mais Kiergekaard, dans ses Miettes, l’avait déjà génialement vu : l’objectivité n’empêche pas la folie. Elle n’en est jamais le contraire. Elle peut même en être le masque, l’abri. On peut sans doute aller plus loin encore, en affirmant que la folie est une forme absolue d’objectivité, qu’elle ne peut s’affirmer que par, que dans l’objectivité. L’bjectivité est le chemin qu’a trouvé la folie humaine pour s’exprimer, se répandre. Le positivisme est particulièrement adapté à la folie, à la démence d’Auguste Comte. Le kantisme n’est rien d’autre que la folie pure de Kant. L’aristotélisme est cousu sur la folie d’Aristote. Ces hommes, ces hommes de génie, n’ont pas « raison » – ni tort : ils ont utilisé la raison pour donner forme à leur folie. Cette folie, à l’état informe, n’eût pu être écoulée, n’eût pu être esquissée, matérialisée, formulée. Dans le débridement, l’à-peu-près, le hors limite, le hors cadre, l’illimité, le hors sujet, le décentrement, cette folie n’aurait pas trouvé son tremplin, son écriture, sa formulation, ses formules, ses imbrications, sa logique, son chemin, ni même ses conclusions. Une folie qui erre n’est plus une folie : c’est une utopie, un instant de fumée, une évaporation. La folie a besoin de théorèmes qui lui donnent corps. De raisonnements qui la jugulent. D’hypothèses qui l’enferrent. De déductions qui l’enferment. Que les conclusions soient « vraies » ou non, cela n’est pas le problème : bien souvent, elles le sont. Mais de quelle vérité parle-t-on ? D’une vérité objective qui n’est rien d’autre qu’une vérité formelle. La science est d’abord apophantique. La vérité, avant tout, se doit d’être humaine. C’est celle de la parole. Elle ne s’embarrasse jamais de la raison raisonnable, encore moins de la raison rationnelle. C’est la vérité humaine de la mémoire contre la vérité formelle de l’histoire. C’est la vérité humaine de la littérature contre la vérité formelle du «

littéraire ». C’est la vérité humaine de la parole contre la vérité formelle de la science. C’est la vérité de la vérité contre la vérité de l’exactitude. C’est la vérité, humaine, de la subjectivité contre la vérité, formelle, de l’objectivité. La formalisation d’une folie – qui débouche souvent sur une folie de la formalisation – prend souvent des airs de vérité immuable, éternelle, qui peut déstabiliser, intimider : les mathématiques en sont un exemple flagrant. Pourtant, aucune mathématique ne parviendra jamais à dire la vérité comme la parole, comme la littérature. Rien de pire, en réalité, pour s’éloigner de la vérité, que d’être raisonnable, d’une part, et gavé de connaissances, d’autre part. Je suis contre une certaine obésité du savoir. Il faut s’alléger. Halte à toute forme de rétention. Il faut digérer. Comme le dit PierreBoulez dans un fabuleux entretien télévisé de 1972 : « opérer des saignées »… C’est ce que ne comprennent pas la plupart des e-diots, avec leurs e-books, avec leur « tout numérique » : ils pensent que je suis contre l’e-book parce que je suis à mort pour l’objet livre, l’objet livre à conserver, à sacraliser, à stocker, à empiler. C’est le contraire ! Ce que j’aime avec le livre, c’est justement qu’il finit par mourir, que tous les livres ne subsistent pas, ne survivent pas, qu’il en est une quantité considérable que les années ne  retiennent pas, dont la postérité ne veut pas. Je dis alors que ces oeuvres, il faut les laisser à leur belle ou terne agonie, qu’il faut accepter de les voir s’en aller dans l’oubli, oui, disparaître pour toujours, être perdus à jamais. La numérisation du livre, et des archives, alourdit le patrimoine : c’est une maladie scientifique, rationnelle, que de vouloir surcharger le patrimoine. Il faut l’alléger, bien au contraire. Accepter de voir partir des ouvrages en fumée, qu’ils aient ou non rencontrés leurs lecteurs – Kafka était tout à fait honnête lorsqu’il a demandé à Max Brod de brûler ses oeuvres. Il les avait lus en public : la parole qui en émanait saurait de toute façon être transmise – ou pas. La parole finit toujours par se transmettre. Les livres qu’on oublie, à tort et à raison, sont des livres, soit qui ne disaient pas, soit qui ne disaient plus, qui n’avaient plus rien à dire, qui n’avaient plus rien à nous dire.
retiennent pas, dont la postérité ne veut pas. Je dis alors que ces oeuvres, il faut les laisser à leur belle ou terne agonie, qu’il faut accepter de les voir s’en aller dans l’oubli, oui, disparaître pour toujours, être perdus à jamais. La numérisation du livre, et des archives, alourdit le patrimoine : c’est une maladie scientifique, rationnelle, que de vouloir surcharger le patrimoine. Il faut l’alléger, bien au contraire. Accepter de voir partir des ouvrages en fumée, qu’ils aient ou non rencontrés leurs lecteurs – Kafka était tout à fait honnête lorsqu’il a demandé à Max Brod de brûler ses oeuvres. Il les avait lus en public : la parole qui en émanait saurait de toute façon être transmise – ou pas. La parole finit toujours par se transmettre. Les livres qu’on oublie, à tort et à raison, sont des livres, soit qui ne disaient pas, soit qui ne disaient plus, qui n’avaient plus rien à dire, qui n’avaient plus rien à nous dire.
Et s’ils avaient quelque chose à nous dire, que nous n’avons pas encore vu, ou pas encore su voir ?
 Et alors ? Cela n’a aucune importance. Ce genre de raisonnement peut nous mener très loin. Il faut savoir s’accoutumer de rendez-vous ratés. C’est cela, aussi, vivre dans une société d’adultes. Savoir s’alléger. Se saigner. Se sacrifier et sacrifier les produits passés du génie humain. Tout garder, se gaver comme des oies, ne rien perdre, ne rien laisser s’égarer est une névrose : une maladie de la rationalité. Une folie. Une folie que les Lumières ont contribué à aggraver. Il est intéressant de remarquer qu’aucun, je dis bien : aucun, des internautes et autres « twittos » qui ont critiqué mes prises de position contre l’e-book n’en ont compris la raison, le fondement. Un imbécile, parmi eux, m’a je crois reproché d’être un moraliste du Moyen-Age : ce cuistre, comme par hasard, travaille dans le « patrimoine du livre ». Qu’il y reste ! Qu’il étouffe enseveli sous les tonnes et milliards de tonnes de pages, numériques ou non, des livres qu’il conserve à l’infini, névrotiquement, au radin et crispé prétexte que cela « pourra servir un jour » – sans doute dans les générations futures. J’aimais le livre, j’aime le livre précisément parce qu’il est éphémère ! Parce qu’il est appelé à laisser, à céder sa place au livre suivant. Les e-diots, évidemment, ne peuvent comprendre des raisonnements un peu fins, un peu élaborés, puisqu’ils ne savent plus lire : ce sont des liseurs. C’est le texte qui les lit. Un liseur est la version passive du lecteur. Le lecteur lit le texte. Le liseur est lu par le texte. Il est essoré, il est repassé, il est lessivé. C’est intéressant, d’ailleurs : parce que nous constatons que ce sont les mêmes qui sont obsédés par le passé et par le futur : les mêmes e-diots qui, au nom des générations futures, veulent tout conserver des générations passées. Qui est le grand absent dans tout cela ? Ironie du sort : seul le présent est absent.
Et alors ? Cela n’a aucune importance. Ce genre de raisonnement peut nous mener très loin. Il faut savoir s’accoutumer de rendez-vous ratés. C’est cela, aussi, vivre dans une société d’adultes. Savoir s’alléger. Se saigner. Se sacrifier et sacrifier les produits passés du génie humain. Tout garder, se gaver comme des oies, ne rien perdre, ne rien laisser s’égarer est une névrose : une maladie de la rationalité. Une folie. Une folie que les Lumières ont contribué à aggraver. Il est intéressant de remarquer qu’aucun, je dis bien : aucun, des internautes et autres « twittos » qui ont critiqué mes prises de position contre l’e-book n’en ont compris la raison, le fondement. Un imbécile, parmi eux, m’a je crois reproché d’être un moraliste du Moyen-Age : ce cuistre, comme par hasard, travaille dans le « patrimoine du livre ». Qu’il y reste ! Qu’il étouffe enseveli sous les tonnes et milliards de tonnes de pages, numériques ou non, des livres qu’il conserve à l’infini, névrotiquement, au radin et crispé prétexte que cela « pourra servir un jour » – sans doute dans les générations futures. J’aimais le livre, j’aime le livre précisément parce qu’il est éphémère ! Parce qu’il est appelé à laisser, à céder sa place au livre suivant. Les e-diots, évidemment, ne peuvent comprendre des raisonnements un peu fins, un peu élaborés, puisqu’ils ne savent plus lire : ce sont des liseurs. C’est le texte qui les lit. Un liseur est la version passive du lecteur. Le lecteur lit le texte. Le liseur est lu par le texte. Il est essoré, il est repassé, il est lessivé. C’est intéressant, d’ailleurs : parce que nous constatons que ce sont les mêmes qui sont obsédés par le passé et par le futur : les mêmes e-diots qui, au nom des générations futures, veulent tout conserver des générations passées. Qui est le grand absent dans tout cela ? Ironie du sort : seul le présent est absent.
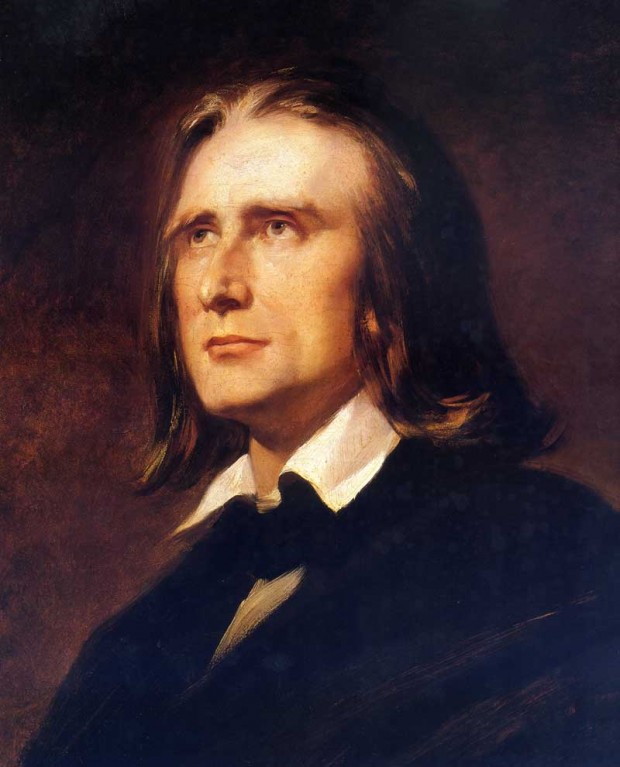
Très juste. Très fin.
Les psychanalystes connaissent bien cette névrose. Elle est morbide et infantile. Le présent qui est ici absent, ce n’est pas le sur-présent twitté, l’omni-présent commenté et sur-commenté, qui est à lui-même son propre futur, mais le présent véritable de l’homme qui, présent au monde, préfère la mémoire à l’histoire, et l’avenir au futur. Je jubile : les e-diots patrimoniaux sont les mêmes qui vivent dans un faux présent infatué de lui-même, artificiellement prolongé par lui-même. La preuve que leur passé patrimonial est aussi étouffant qu’est invivable leur futur fantasmé. Les générations futures les méprisent déjà autant que les méprisent encore les générations passées.
Et sinon ? Un dernier mot, sur autre chose ?
Sinon ? Liszt bien sûr.
Entretien réalisé le 15 février 2012.







Vous êtes contre » l’obésité du savoir « , mais vous nous sortez une citation toutes les trois lignes. Est-ce-que tout le texte est à prendre au second degré ?
Mon cher Yann,
Je vais répondre brièvement à cet entretien brillant, juste dans ses radicalités contre l’abêtissement contemporain, mais souvent aussi, éminemment contestable quant au fond.
Sur l’exception pour tous, ce communisme de l’exception qui prend chez toi les traits d’une caricature des queues de cinéma et des coupe-files pour tous, il se trouve que, conduisant un scooter dans Paris, je laisse très rarement, passer les piétons avant moi. Me, first. Le Moi premier, l’exceptionnalité du Moi est première. Je suis pour la lutte (réglée, et donc, par force, fraternelle) entre les Moi, ces pures exceptions. Elle débouche simultanément, elle est la condition de leur reconnaissance mutuelle (qui n’est en rien porteuse de leur fusion, de leur syndicalisation (ici, dans une même queue). A ce titre, vive l’exception ! Je me pense, me connais, m’estime, m’aime (ou pas), est la condition préalable du (juste) commerce avec autrui, serait-ce, quand il y a lieu, la rivalité, voire la guerre. L’individualisme, condition de la démocratie (ce règne salubre du dissensus, cette saine querelle des dissemblables entre eux), est en péril, face aux grégarismes, aux communautarismes, aux moutonnismes, aux queues composées de semblables, oui. L’exception (sans confusion, ni mariage des exceptions entre elles, sinon dans l’élection des Happy few), cette exception qui est l’autre nom de la différence propre à chaque individu vis-à-vis de tous les autres, est une de nos dernières armes, de nos dernières défense,à l’ère de la civilisation des masses, de leur dictature molle, de l’enlaidissement du monde. Vive, en quelque sorte, l’autothéisme. Vive, bien davantage, l’autoathéisme. Je suis encore moins d’accord avec ceci, de toi : « La parole est première, la science est seconde, seconde au regard de ce qui est subjectif ». La parole reine ? Ce flux, ce flot, cette schize ? Vive la schize ? A cette parole « vierge », première, native, quasi-rousseauiste, opposons, oui, la langue, le langage, la science du langage. Le langage comme science. Tu vas jusqu’à écrire : « La science n’est pas intelligente ». La parole le serait-elle davantage ? Par quelle « exception », quel miracle ? Le subjectif, tu emploies le mot, n’est rien d’autre que le mot soft pour l’imaginaire, au sens de Lacan. Vivent le subjectif, l’imaginaire ? Bien du plaisir, cher Yann. Tu ajoutes : l’objectivité serait le masque de la folie, la raison (ainsi chez Aristote, chez Kant, chez Comte) serait le masque de la folie. La preuve par Comte. (A ce compte-là, si l’on garde en l’inversant ta proposition, le fantasme devient-il le masque du vrai ? Je te laisse la réponse…). Il y a quelques esprits que les « lumières », la raison n’ont pas rendu fous, et même pas du tout fous, qui tiennent que l’objectivité, l’activité rationnelle de l’esprit sont même les meilleurs remèdes à la folie des hommes, qu’elles servent à explorer la dite-folie, à commencer quand celle-ci se déguise sous le masque de l’évidence, de la fausse raison, du sens commun. Un certain Freud, par exemple. « La vérité objective, écris-tu, n’est rien d’autre qu’une vérité formelle. » Oui, et alors ? Où est le mal, la faute ? Formel, un gros mot ? Vivent les vérités formelles, « inhumaines ». Les vérités « humaines » ? On sait trop bien où certaines de ces vérités « humaines », c’est-à-dire, soyons clair, les passions, ont mené et mènent toujours les hommes et ceux qui les conduisent (si l’on peut dire). Humain, trop humain, disait Nietzsche. Quant à opposer mémoire et histoire, vive, là encore, l’Histoire, garde-fou de la mémoire, ce fourre-tout, ce trop de mémoire, cet envahissement, cette non-distanciation. Tu dis encore : « La parole finit toujours par se transmettre ». Je serais tenté de dire à la fois, hélas oui (le religieux), et hélas non : les paroles meurent. Seule, l’Histoire les sauve. Archéologie du monde.
Amitiés. Gilles Hertzog