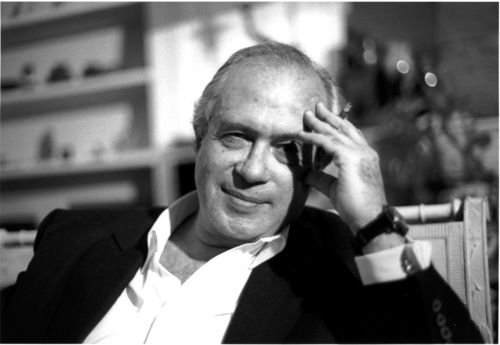Jacques Lacan s’est entiché de James Joyce, de Finnegan’s Wake surtout.
Vladimir Nabokov avait admiré Ulysses mais pensait que Finnegan’s Wake n’était qu’un informe et ennuyeux amas de folklore bidon, un pudding froid, un ronflement persistant venant de la pièce d’à-côté, et qui n’était sauvé de la fadeur la plus absolue que par quelques rares intonations merveilleuses (nothing but a formal and dull mass of folklore, a cold pudding of a book, a persistent snore in the next room […] and only the infrequent snatches of heavenly intonations redeem it from utter insipidity).
Martin Amis, comparant Nabokov et Joyce, dit que le premier vous invite chez lui, vous offre le meilleur fauteuil, vous sert son meilleur whisky, vous met à l’aise, fait preuve d’une exquise courtoisie. Sa conversation est engageante, riche, généreuse, intelligente, surprenante. Il vous offre un repas fait de mets très fins ; il est un hôte parfait. Le second au contraire vous avait d’abord donné une fausse adresse ; il vous avait donc fallu chercher l’immeuble et lorsque vous l’aviez enfin trouvé vous vous étiez rendu compte que vous aviez abouti dans un quartier dépeuplé, à l’abandon. L’ascenseur était en panne, vous aviez dû gravir les étages à pied et c’est au treizième seulement que vous aviez enfin trouvé son nom sur l’une des portes, entr’ouverte. Vous aviez frappé (la sonnette ne marchait pas) mais personne n’était venu vous accueillir. Une voix à peine audible vous avait dit d’entrer. Vous aviez poussé la porte avec difficulté : une poubelle, pleine, y était appuyée ; votre hôte était arrivé enfin, mal rasé, vêtu de guenilles pas très propres. Il vous avait aussitôt entraîné à la cuisine, sans vous dire un mot, et vous avait servi pour tout repas une tranche de jambon blanc et un verre d’eau. Cette pitance à peine avalée, il vous avait dit qu’il n’avait guère plus de temps à vous accorder, qu’il fallait l’excuser, son Œuvre l’attendait. Pourquoi est-il si inhospitalier ?
Ne se pourrait-il pas que ce qui est arrivé à la langue anglaise avec Joyce, et donc qui nous est arrivé avec lui, qui ne cesse depuis de nous arriver, lui soit arrivé, à lui d’abord ? Ne devrait-on pas, autrement dit, plutôt penser que c’est parce qu’il était lui-même en proie à quelque chose qui, contrairement aux apparences, le laissait sans pouvoir, qu’il ne maîtrisait pas, quelque chose qui était trop puissant, trop menaçant, qu’il a produit cette écriture que l’on dit illisible, immaîtrisable, incernable, ininterprétable même ? Une écriture composite d’organes linguistiques hétérogènes greffés les uns sur les autres, qui nous contraint à prendre conscience de ce que sont pour nous les normes narratives, discursives (et non seulement syntaxiques, grammaticales ou sémantiques). Une écriture pour laquelle nous n’avons pas de nom et qui peut sembler monstrueuse. C’est-à-dire une écriture avec laquelle, dans laquelle apparaît quelque chose qui ne s’était encore jamais montré, qui n’avait pas été anticipé, qui venait, comme Jacques Derrida l’a dit, frapper la vue, effrayer précisément parce que aucune anticipation n’était prête pour l’identifier, une écriture qui traumatisait – et d’abord celui à qui et par qui elle arrivait. Pourquoi sinon aurait-il cru devenir fou en 1929 et écrit à son ami James Stephens pour lui demander s’il accepterait de se consacrer « heart and soul », cœur et âme, à l’achèvement du livre si d’aventure lui-même devait y renoncer ? Ne faudrait-il pas penser que ce qui lui était arrivé et qu’il avait appelé Finnegan’s Wake lui avait retenti sur les reins et que c’en avait soudain été fini, qu’il avait imaginé qu’il allait en mourir, que soudain cette fois il pleuvait vraiment fort, trop fort, et qu’il n’avait plus que sa peur à se mettre sous le crâne ? Que s’il avait eu un instant l’âme concentrée, il ne l’eut bientôt plus qu’en loques ? Ne faudrait-il pas encore penser qu’il s’est vu devenir, avec ce qui lui arrivait, absolument étranger non seulement à sa famille mais également à presque tous ceux à qui Finnegan’s Wake était destiné, alors qu’il avait plutôt rêvé qu’ils le laisseraient entrer dans la maison, lui feraient prendre des habitudes et avec lui en prendraient de nouvelles, qu’une espèce de domestication réciproque pourrait avoir lieu et qu’ainsi un avenir commun s’ouvrirait ? Ne faudrait-il donc pas se demander ce qu’il eût voulu et ce à quoi il eût pu légitimement s’attendre ? Qu’après avoir provoqué des réactions de rejet, après avoir été jugé inacceptable, intolérable, incompréhensible, d’une certaine manière monstrueux, il fut à son tour approprié, assimilé, acculturé, qu’il transforma le champ de la réception, de l’expérience sociale et culturelle, de l’expérience historique ?
Faut-il penser qu’il a pu être aussi naïf ? Est-ce crédible, qu’il ait été capable à la fois, simultanément, de ce qu’il a lui-même reconnu comme ayant été un rapt, un acte de guerre (« I’ll give them back their English language. I’m not destroying it for good », écrivit-il à Max Eastman, « Je leur rendrai leur langue anglaise. Je ne la détruis pas une fois pour toutes. »), et de la naïveté de croire qu’on lui accorderait une hospitalité sans condition, un accueil reconnaissant, une gratitude – bref : qu’on pourrait l’aimer ? A-t-il pu tout à la fois, simultanément vouloir détruire leur langue et vouloir qu’ils lui en rendent grâce, qu’ils l’aiment pour le mal qu’il leur avait fait ? Pouvait-il, dans ces conditions auxquelles il ne pouvait rien, que lui-même subissait, vraiment croire qu’on pût l’aimer ? Mais qu’est-ce qu’aimer Joyce ? Je ne suis pas le premier à poser la question.
Pour répondre, pour seulement commencer d’y répondre, il faudrait d’une part déjà savoir si l’objet de cet amour est le corpus, tout le corpus qu’il signe de son nom, ou encore seulement tel ou tel livre, telle ou telle partie de ce corpus, Finnegan’s Wake par exemple, ou surtout, ou exemplairement ; et il faudrait d’autre part savoir ce que peut vouloir dire « aimer » dans ce contexte. Je ne le sais pas encore, je le saurai peut-être plus tard, je verrai bien. Pour le moment, je m’en tiens à risquer une hypothèse : ce serait aimer ce, ou celui, qui ne cesse de m’interdire d’anticiper sa venue, qui me refuse le droit que malgré moi, lecteur, depuis des siècles, depuis des millénaires je revendique, de faire l’expérience de la continuité, du rassemblement comme aurait dit Heidegger, de l’anticipation, de la dépendance à un sens constitué au préalable, du recueillement, des retrouvailles avec la vérité, avec le pur signifié sans obstruction du signifiant. Ce serait aimer l’incalculable, le dissocié, l’épars, le disparate, l’insaturable, l’impossible. Ce serait aimer l’affolement, la folie peut-être, la folie de la dispersion sans unité, sans bon sens, sans sens du sens. Ce serait aimer, plus que l’intraduisible, plus que l’illisible, croire qu’il n’est de lisibilité quede l’illisible ; que l’illisibilité, comme le pensait encore Jacques Derrida, n’arrête pas sur un front d’opacité, au contraire, qu’elle fait repartir et la lecture, et l’écriture, et la traduction, toute radicale, irréductible, absolue qu’elle soit. Ce serait aimer croire que lire, dans sa plus noble, sa plus haute acception, c’est cela, cette très paradoxale opération, qui obéit à la même logique que celle à laquelle obéit le pardon : il n’y aurait de lecture que de l’illisible comme il n’y aurait de pardon que de l’impardonnable. Faut-il alors penser que lire, lire vraiment, ce serait toujours pardonner ? Que « aimer Joyce », ce serait lui pardonner ce qu’il a écrit ?
Je ne sais pas. Toujours est-il que si les Dubliners m’avaient enchanté, Ulysses et Finnegan’s Wake, en revanche, m’étaient assez rapidement tombés des main. Je trouvais ces textes inhospitaliers. J’entends par là que je n’arrivais pas, en eux, à me rassembler sur ce qui y est dit. Ce qui veut peut-être simplement dire que ces livres m’interdisaient le plaisir de tourner en rond : je n’y retrouvais plus la trace du cercle herméneutique si rassurant sur lequel partout ailleurs je me remettais sans m’en rendre compte. L’expérience de lecture à laquelle j’étais convié, si je voulais la faire, me contraindrait, ce me fut tout de suite évident, à apprendre à jouir autrement de ce qui m’était le plus familier et dont je prétendais avoir acquis une assez bonne maîtrise : ma langue. Je n’étais plus maître chez moi, dans ma langue ; mes habitudes de lecture, acquises de haute lutte, ne me servaient soudain plus à rien. C’était comme si je n’avais plus de légitimité, je ne savais plus ce que lire pouvait vouloir dire, la lecture que je faisais, à supposer que ce que je faisais pût encore s’appeler « lecture », ne me permettait pas de dire quoi que ce fût. Et c’est à une expérience similaire que Jacques Lacan nous a conviés dans le champ de la psychanalyse.