L’homme pense, Dieu rit. L’antienne est connue. Parfois, l’homme rit aussi et c’est là que ça dérape. Le rire glisse et devient soudain ricanement. Il faut alors le sauver de lui-même. Comment ? Par l’ironie, tiens. L’ironie en toutes choses, comme un pied de nez envoyé à l’insolence du monde. L’ironie, justement, est l’autre nom d’un jeune homme de quatre-vingt quatre ans. Après nous avoir fait rire coup sur coup pendant cinquante ans, il nous donne à lire sa vie. Disons-le d’emblée, ne lisez pas ce livre si vous cherchez le clinquant de scandales qui n’amusent que ceux qui les alimentent. Vous seriez probablement amené à réfléchir, ce qui peut être ennuyeux. L’enjeu ici n’est pas de statuer sur la culpabilité d’un homme mais de considérer son oeuvre et sa portée. L’époque qui est la nôtre – difficile de savoir si on naît trop tard ou trop tôt – oublie que les artistes ne sont pas des directeurs de conscience. Encore moins des boussoles morales. Ils sont plantés là, à la lisière du chaos, et regardent le monde. Ils ne sont pas là pour l’empêcher de se défaire ni pour le réparer. Plutôt pour en dévoiler les paradoxes. Soit dit en passant (Stock) est un événement à plus d’un titre. Éditorial, d’abord, sentimental ensuite, patrimonial enfin. Disons que c’est l’histoire d’un homme qui rit de lui-même, des autres et du monde. Voilà, ne cherchez pas plus loin, la meilleure raison de le lire. Pour un peu, on s’intéresserait presque au rire couleur tweed, parfum Ventoline de Woody.
Le rire de Woody est un savant mélange. On y trouve le sentiment du déclin d’une ville et de son monde comme celui de la vieillesse. La peur de la déchéance physique, des muscles qui lâchent et des cailloux sanguins. Qu’importe si elle est largement fantasmée. Une peur panique, sans doute irrationnelle, de finir six pieds sous terre. Souvenez-vous, les chambres d’hôpital sont les antichambres de l’enfer et les meilleurs médecins juifs n’y pourront rien changer. Pointe aussi un homme qui a la nostalgie du New York des nineties, de ses tickets de cinéma à cinq cents, de ses étés suffocants à l’ombre des avenues trop larges, de ses filles qu’il séduisait en dissertant sur Kafka. Le petit gamin juif n’a jamais vraiment disparu. Il a juste déplacé son rêve, de Brooklyn à Manhattan. À New York, on a parfois le sentiment que la vie est plus dure avec les doux et plus douce avec les durs. La ville, justement, court à travers le livre. William Carlos Williams est pertinent ici : « un homme est, en lui-même, une ville ». Cette ville, profondément verticale, est un en-soi, une forme close qui va de Central Park à Soho. Une idée esthétique, quelque chose comme un refuge moderne face au monde moderne. New York restera sans doute le vrai personnage de ses films comme de son livre. Quelque part, en Amérique, New York radicalisait la modernité. Woody voulait en être à tout prix. La séquence d’ouverture de Manhattan (1979) dit l’essentiel à ce sujet. Le reflet d’une cigarette qui rougeoie, un couple qui s’enlace, des graffitis, des bouteilles dispersées sur le sol : un morceau de vie américaine. La vérité d’un homme se trouve souvent dans les lieux qu’il habite. Les lieux nous renseignent sur les obsessions et les désirs de chacun. Sur notre place dans le monde aussi, ce qu’on vient y chercher, souvent maladroitement. Dans cette autobiographie qui n’en est pas vraiment une, le personnage joué par Allen se fait plus précis qu’à l’ordinaire. Le lecteur saisit plus nettement l’homme derrière le masque comique. Loin de se limiter à la figure trop connue du névrosé, il joue cartes sur tables. L’occasion, pour lui, d’interroger ce que veut dire bâtir une oeuvre. C’est une drôle d’histoire, quand on prend le temps de s’y arrêter, que la vie d’un artiste croisant celle de Diane Keaton, Gena Rowlands, Judy Davis, Charlotte Rampling, Melanie Griffith ou encore Uma Thurman. Alors, oui, le cinéma de Woody Allen n’est sans doute pas révolutionnaire dans sa forme. Il ne coche sans doute pas les cases d’une époque dopée à la déconstruction. Pourtant, il nous montre qu’une façon de vivre est profondément politique, qu’un divorce peut avoir l’importance d’un soulèvement à l’autre bout du monde, qu’une révolution peut aussi s’accomplir dans les moeurs. Elle s’immisce, lentement, dans l’intimité des intérieurs feutrés avant de gagner la société entière. On pense à Husbands & Wives (1992) ou Another Woman (1988). Une séparation est déjà une révolution. Filmer un couple qui explose en vol ? Rien d’original à première vue. Sauf à en faire la satire d’une société intellectuelle qu’il aime trop pour ne pas la châtier. Comprendre ici que le cinéaste joue avec les conventions dans ses films comme dans sa vie. Il les fait sauter. Il écrit, page trente cinq, « Je n’aime pas la réalité, j’aime la magie. J’ai essayé de devenir magicien mais je me suis aperçu que je pouvais seulement manipuler les cartes et les pièces de monnaie, pas l’univers. » Débrouillez-vous avec ça.
Le rire de Woody est souvent absurde. Il nous dit que vivre sa vie, ce n’est pas exactement la comprendre. C’est souvent la regarder défiler. Un peu en spectateur d’une histoire qui continuerait sans nous. Et puis qui connaît sa propre histoire d’abord ? C’est à n’y rien comprendre quand on est en plein dedans. Elle est souvent pleine de bruit et de fureur, comme dirait vous savez qui. Regarder une vie qui va et vient au gré des yellow cabs, écrire des rôles pour des femmes puissantes et des hommes à la virilité contrariée, les lundis soirs clarinette au Carlyle, c’est tout ça Woody. Les années passent, au gré des pages. Les anecdotes plus ou moins inédites défilent. On sent bien, à la lecture, qu’il lui reste énormément de choses à nous dire, que ces « choses » n’ont rien perdu de leur actualité. Parfois le sentiment d’un homme mal compris envers qui, justement, l’histoire devrait être plus douce. Un homme, avec ses doutes, ses manières et ses histoires, qui nous apprend à rire. Rire, ce n’est jamais ricaner. C’est comprendre comment se déplacer dans l’absurdité du monde, comment vivre dans une société par définition fictionnelle. Elle est bien jolie cette société, faite de faux semblants, de belles idées et de relations superficielles. Elle n’en reste pas moins une fiction, pour ceux qui l’ignoreraient encore. Le visage de Tracy dans Manhattan (1979), la mère juive au regard sévère, le père au charisme débordant, Allan Stewart Konisberg lui-même, Mia Farrow, Soon-Yi sont parmi les personnages de cette fiction. C’est peut-être ça, la clef de compréhension de son oeuvre. Envisager sa vie, ses personnages, ses névroses, ses polémiques comme les pièces d’une fiction jamais à court d’idées. Une fiction qui aurait toujours un temps d’avance sur le réel. Elle a au moins deux mérites. Le premier, la cohérence ; le second, le refus de tout compromis esthétique. Au centre de cette fiction, où tout règne sauf le calme, vous croiserez sans doute quelqu’un de familier. Pourquoi pas vous-même. Allez-y voir, ça vaut le détour.
L’été approche ; il imprime ses premières ivresses. Elles sont souvent imaginaires. On s’imagine allongé sur un divan à Manhattan, à méditer sur un air de Gershwin ou Harry James. L’air est chaud, ça ressemble presque à de la sérénité. Dehors, le monde poursuit sa course folle. Les droits civiques, les émeutes urbaines, les statues déboulonnées, un apprenti dictateur aux cheveux blonds, une épidémie bien réelle cette fois-ci. L’Amérique, décidément, n’a jamais aussi peu ressemblée à un film de Woody. L’impression qu’un chaos de moins en moins compréhensible la saisit. Ses films, pourtant, comme son livre, nous rassurent sur l’intelligence américaine. C’est rare de nos jours vous savez, l’intelligence, quelqu’un qui vit selon la nuance. Aussi rare qu’un taxi aux heures de pointe à Battery Park. On se surprend à penser que ce qu’on aime, à travers Woody, c’est sans doute un monde trop réel pour l’être vraiment. Un territoire sur lequel règneraient Django Reinhard, la directrice artistique du New Yorker, le portier du 15 Gramercy Park South et, pourquoi pas, une thésarde en littérature moderne à NYU. On le referme un peu triste ce livre, en pensant que des Mémoires viennent généralement signer la fin de partie. Avec un peu d’espoir aussi sur la capacité du cinéma à nous renseigner sur nous-mêmes, à nous empêcher de désespérer des autres et de soi. À rire des autres et de soi. Le cinéma de Woody Allen est un gigantesque rire. Jamais un ricanement. Un rire toujours vivace, plein de dédain pour lui-même, surtout pas jaune, presque aristocratique. Un rire qui résonne encore dans ces grands appartements de Park Avenue où rien n’est imaginaire, sauf le malade.






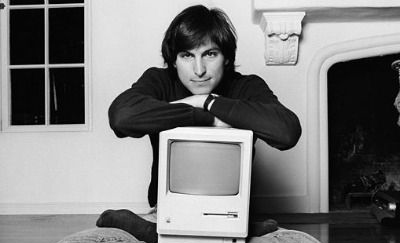

Bravo. Très bel article.