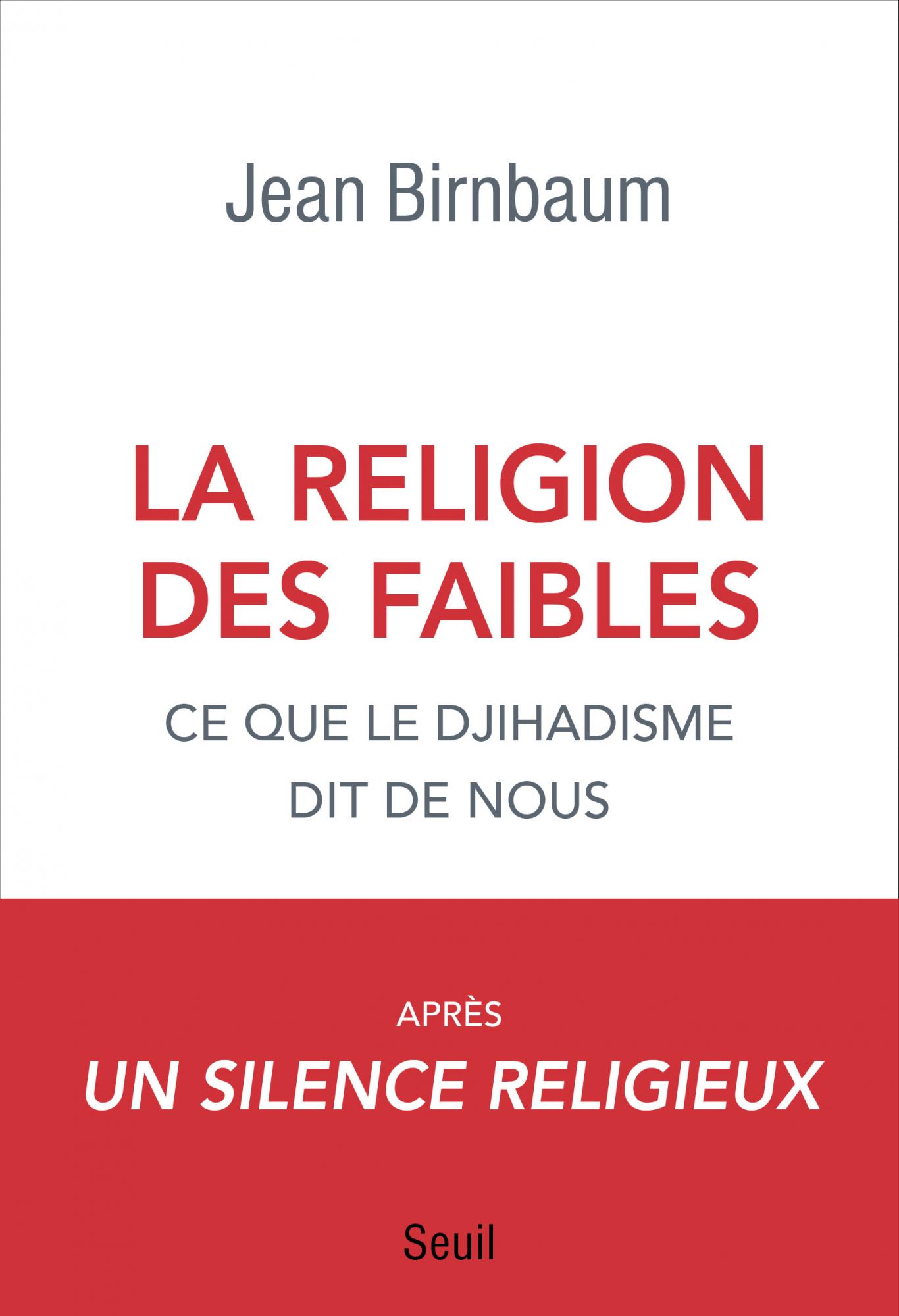L’homme peut-il être le miroir de l’homme ? Vous connaissez sans doute la fameuse énigme : deux ramoneurs tombent dans une cheminée, l’un en ressort avec le visage propre, le second la tête enduite de suie – lequel ira se laver ? Contrairement à l’hypothèse que pourrait insuffler le bon sens, la solution est contre intuitive : chacun aura observé l’autre, raison pour laquelle l’homme propre aura induit qu’il est sale, et réciproquement. Cette devinette, au demeurant sans grand intérêt (car emplie d’arguties : pour savoir si je suis sale, ne puis-je pas me contenter de passer la main sur mon front, et de voir la couleur de mes doigts ? Et puis, se peut-il vraiment que la dite cheminée ne salisse qu’un seul homme ?), suggère que le miroir humain n’est paradoxalement ni spéculaire ni poli ; que l’acte de connaissance s’opère sur fond de reconnaissance initiale ou originaire ; que, surtout, la tentation est grande de s’identifier à l’altérité. Le miroir donne à voir une similarité d’histoire plutôt qu’une communauté de destin. C’est un miroir riche en points aveugles : il empêche, notamment, de concevoir qu’autrui puisse m’être complémentaire (puisque le miroir me le présente comme identique). Dans le miroir humain, je cherche à me représenter en dévisageant autrui – et, fatalement, j’en sors doublement aveugle : de moi-même et d’autrui. C’est un miroir qui, inexorablement, appelle le malentendu – à moins d’imaginer que deux êtres soient littéralement, absolument, méticuleusement les mêmes, comme le faisait Flaubert, dans l’incipit de Bouvard et Pécuchet, en relatant la rencontre des deux protagonistes. Par une journée de chaleur accablante, alors que les Parisiens restaient claquemurés derrière leurs volets, les deux futurs amis s’assirent sur le même banc, et remarquèrent qu’ils avaient, chacun, pris le soin d’écrire leur nom sur leur chapeau. La phrase de Flaubert, «Alors, ils se considérèrent», doit être prise en son sens littéral : alors, ils se regardèrent les yeux dans les yeux, et chacun fut un miroir pour l’autre. Le miroir humain rassemble et assimile sans jamais imiter : Bouvard se fond tellement dans Pécuchet, et Pécuchet rejaillit tant dans Bouvard qu’il est impossible de dire qui, des deux, est la copie, et qui le modèle.
On s’étonnera donc de constater que, dans son dernier ouvrage, La religion des Faibles, Jean Birnbaum prenne le parti d’étudier le djihadisme, non depuis le paradigme du choc des civilisations, ni depuis ceux de la causalité (causalités géopolitique, diplomatique, militaire, socio-économique, culturelle, coloniale, mémorielle…), mais depuis le paradigme du miroir. Cet essai part d’un événement : lorsque, le 13 juin 2016, Larossi Abballa exécuta Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider (couple de deux policiers), il tint à se filmer en selfie, et à répandre sur les réseaux sociaux une justification longue de quinze minutes. Dans la clausule de son discours, il déclama une citation des hadiths du prophète : «Le croyant est le miroir du croyant. Il le met à l’abri des malheurs et le protège derrière son dos.» Puis, Larossi Abballa s’adressa aux mécréants : «Oh vous […], vous faites tout le contraire, vous nous exposez au malheur…» Birnbaum prend le parti de prendre au sérieux cette rhétorique et, en soi, ce choix constitue un coup de force : au lieu de psychiatriser le djihadiste, au lieu de répéter à tout bout de champ que c’est un débile mental, un aliéné cérébral, un détraqué psychique, un allumé, au lieu même de voir en ces invocations mystico-politiques une pellicule sans consistance, un opium chimérique cristallisant une misère socio-économique, ou un «vestige non résorbé» (selon la formule d’Ernest Mandel[1], cité par Birnbaum) l’auteur de La Religion des Faibles ne tient pas le discours djihadiste pour la voilure d’une réalité tierce. Il s’agit alors d’opter pour la méthodologie du miroir humain. Cette méthodologie présente plusieurs risques, à commencer par celui d’utiliser le miroir en tant qu’échangeur : se croire sale quand on est propre, et propre quand on est sale. Mais il y a aussi un autre risque : Birnbaum affirme, en introduction de son ouvrage, que son interprétation de la clause de Abballa est hypothétique ou potentielle («cette formule peut s’entendre autrement», «elle signifierait»). Et, en effet, on est en droit de se demander si elle ne contrevient pas à l’intention rhétorique du djihadiste. Ce dernier, en rapportant la citation des hadiths, choisit de la lire dans son intégralité : ce faisant, la phrase «le croyant est le miroir du croyant» semble devoir être comprise dans son contexte, c’est-à-dire dans son sens littéral – à savoir que les croyants d’une même foi se reflètent les uns et les autres. La volonté de faire de ce miroir un paradigme géopolitique, philosophique ou civilisationnel, ne relève-t-elle pas d’une exégèse ? Et interpréter le miroir, n’est-ce pas se refuser à sa logique ? Une dernière difficulté pourrait être relevée : accepter de se saisir du miroir en tant que motif, n’est-ce pas, pour reprendre une expression omniprésente (et totalement galvaudée, car souvent employée dans le but de faire taire) dans le champ médiatique, «jouer le jeu» de l’entité qui vient de nous attaquer ? N’est-ce pas se plier à ses représentations ? N’est-ce pas intérioriser, sinon les termes de l’opposition proposée par Ben Laden entre les «mulets» et les «lions», du moins sa structure ?
Le grand coup de force de cette entreprise réside à tout le moins dans une démarche intellectuellement courageuse : que l’on partage ou non les analyses déployées par Jean Birnbaum, on relèvera que jamais l’auteur de La Religion des Faibles n’instrumentalise les attentats pour confirmer des thèses préétablies. Et si La Règle du jeu, dans son numéro 65, avait décrié la rapidité avec laquelle de nombreux intellectuels, de tous bords idéologiques, s’étaient emparés, au moment des attentats, de la catastrophe qui survenait, pour expliquer qu’ils «avaient tous prévu», que «les événements confirmaient tout ce qu’ils avaient écrit depuis des décennies» – si La Règle du jeu s’était permise de parler des dangers de l’immédiateté médiatique, elle remarquera ici à quel point Jean Birnbaum s’efforce de prendre acte de la situation avant de l’interpréter. Son essai part de la description d’une vidéo venue tourner la représentation contre elle-même : il prend appui dans la stupeur brute que la rhétorique djihadiste peut susciter – et tâche d’en faire le point de départ d’une authentique réflexion. Le second coup de force de l’essai de Jean Birnbaum consiste en sa capacité de déminer les potentiels écueils de la tentation du miroir humain : il s’agit moins, pour l’auteur, d’instrumentaliser le miroir que de comprendre ce qui l’a rendu si longtemps inopérant. Il s’agit moins, autrement dit, de définir de façon essentialiste les deux blocs en affrontement que de scruter la «Croyance» qui, habitant «l’Occident», l’empêche de cerner le caractère profondément religieux du djihadisme. Cette «Croyance», selon La Religion des faibles, convoque tout à la fois du progressisme et de l’occidentalo-centrisme : elle s’attache à ramener toute forme de djihadisme à une tentative de désirer l’Occident. La «Croyance» est ainsi résumée : «Que l’Occident soit le creuset de l’histoire et le centre du monde, cela ne faisait aucun doute. Qu’il possède la force et exerce la domination, cela tombait sous le sens. […] Si la domination occidentale venait à être contestée, ce serait forcément au nom de ses propres principes. Cette bataille ne pourrait venir que de l’intérieur, ou à tout le moins elle serait menée par des gens qui, s’appropriant nos idées et nos valeurs (liberté, nation, démocratie, socialisme…) les retourneraient contre nous pour pouvoir en être : la guerre à l’Occident serait une guerre intestine.» Si la croyance peut être définie comme une idéologie, c’est qu’elle se nourrit des contradictions que lui portent le réel pour y voir des confirmations de ses dogmes : plus les djihadistes crient leur altérité profonde, plus ils s’affirment en guerre de civilisation, plus ils clament l’inaltérable gouffre qui sépare le monde des lions et celui des mulets, plus ils expriment leur désir d’Occident. Ne faudrait-il pas faire preuve, en la matière, d’une certaine «naïveté» herméneutique ? Ne faudrait-il pas plutôt prendre aux mots les discours djihadistes ? On en revient ainsi à la démarche adoptée par Michel Foucault qui, lors de ses reportages iraniens de 1978, préféra une écriture de l’événement à une analyse, marxienne ou post-marxienne, des conditions matérielles servant de foyer à la révolte en ébullition. Il faut lire, par exemple, son article «Téhéran : la foi contre le chah»[2], pour mesurer l’importance qu’il accorde au caractère chiite de la révolte en cours : «Le chiisme, en face des pouvoirs établis, arme ses fidèles d’une impatience continue. Il leur souffle une ardeur qui, d’un seul tenant, est politique et religieuse.» Ou encore : «Vous savez la phrase qui fait ces temps-ci le plus ricaner les Iraniens ? Celle qui leur paraît la plus sotte, la plus plate, la plus occidentale ? La religion est l’opium du peuple.» Et Birnbaum de soutenir que, lors de l’émission de la fatwa contre Salman Rushdie, lors de l’affaire des caricatures danoises, lors de l’affaire Charlie Hebdo, les intellectuels fidèles à la «Croyance» n’ont pas su retenir la leçon de Foucault selon laquelle «le problème de l’islam politique est un problème essentiel pour notre époque et pour les années qui vont venir.» A ce titre, l’analyse que Jean Birnbaum propose du dispositif intellectuel d’Emmanuel Todd (Qui est Charlie ?) ou du Comité invisible (A nos amis) est éclairante. Le chapitre qu’il consacre également à la question du «choc des civilisations» l’est également : il rappelle une donnée fondamentale, à savoir que le fameux Choc des civilisations de Huntington n’était nullement une invitation à la guerre des civilisations. Car dès le début du fameux ouvrage, son auteur précisait le désir qui animait sa pensée : «Nous éviterons une guerre généralisée entre civilisations si, dans le monde entier, les chefs politiques admettent que la politique globale est devenue multicivilisationnelle et coopèrent à préserver cet état de fait.» D’où il suit que Huntington déduisait de ce postulat le refus du concept de «civilisation universelle», et l’importance de déployer une géopolitique plurielle.
Dans cette perspective, une fois le phénomène de l’islam politique saisi dans son altérité, comment constituer le «nous» auquel renvoie le miroir ? Birnbaum demande : «A quoi tenons-nous ?», et il faut entendre cette question dans sa double signification – par quoi sommes-nous rassemblés ? Quel capital nous est précieux ? Birnbaum renvoie alors à un entretien qu’il avait eu avec Derrida : comment concilier déconstruction de l’occidentalo-centrisme (déconstruction tout court), et possibilité de dire «Nous, les Européens» ? Et Derrida d’évoquer la possibilité d’une «autre Europe» qui pourrait endosser une «responsabilité nouvelle» en s’opposant tout à la fois à «la politique d’hégémonie américaine» et au «théocratisme arabo-islamique». Cette Europe, ajoute-t-il, ne se confond ni avec l’Europe libérale, ni avec l’Europe géographique. Derrida apporte une précision fondamentale : il tient à mentionner que cette Europe est le fruit de sa croyance – «ça c’est ma foi, ma croyance.» La croyance s’écrit ici en minuscules : elle n’est pas celle d’un occidentalo-centrisme, ni d’un progressisme béat mais d’une Europe travaillée par sa mémoire, renversant les mécanismes de la «Croyance». L’Europe de Derrida est vulnérable là où celle de la «Croyance» s’avérait arrogante (conviction de centralité), et elle est ferme là où celle-là courbait l’échine (aveuglement devant le théocratisme). On remarquera que tout l’objet de La Religion des Faibles revient à jouer avec la logique du miroir : si le miroir permettait à Birnbaum de porter au jour une certaine «Croyance» ajourée de contradiction, il offre désormais la possibilité de faire advenir un reflet nouveau, autre du premier. Le paradigme du miroir est celui d’un miroir en relief.
Je me suis toutefois posé une question à la lecture de La Religion des Faibles : si Jean Birnbaum a raison de rappeler qu’expliquer la présence djihadiste par le passé occidental relèverait d’un occidentalo-centrisme réducteur, ne faut-il pas rappeler, pour autant, combien les erreurs de l’Occident (entendons par-là plus l’Amérique que l’Europe) ont été lourdes de conséquences au Levant : guerre d’Irak menée par Bush en 2003 en dehors de toute légitimité, cynisme d’Obama abandonnant l’Irak à la répression de Maliki, faiblesse d’Obama ne s’opposant pas à Bachar el-Assad ? Cette hypothèse mériterait d’être développée plus longuement et ailleurs – et, sans doute, par quelqu’un de plus qualifié que moi –, mais j’aurais tendance à penser que le Proche-Orient a été le théâtre de l’impossible réparation des torts occidentaux. En ce qui concerne le djihadisme qui se déploie au Levant, il faudrait étudier la région en replaçant sa situation actuelle dans une perspective historiquement plus large : remonter à la Première Guerre mondiale ; relire la correspondance entre Mc Mahon et Sayed Hussein Ben Ali (qui promettait, en échange d’une participation militaire à la guerre, la création d’un Etat autonome et souverain) ; redécouvrir l’immense trahison que marquèrent les accords Sykes-Picot, mais aussi l’article 22 de la Charte de la Société des Nations, hallucinant d’hypocrisie, justifiant le retournement de veste de l’Occident[3], ou encore les propos tenus par Clémenceau lors de l’envoie de Henri Gouraud en Syrie[4] ; il faudrait également considérer l’avertissement de Fayçal au même Gouraud[5], et percevoir son caractère prémonitoire : Fayçal notait qu’en trahissant ses propres valeurs, l’Occident menait la région à sa perte. Et il me semble que, s’il n’est bien entendu pas possible de définir Daech comme une construction de l’Occident, il faut à tout le moins noter que la présence américaine en Irak (d’où est parti Daech) a été marquée par une polarité d’échecs : celui de l’intervention illégitime (Bush), celui de l’indifférence inopportune (Obama, qui croyait bien faire en prenant le contrepied de la politique de son prédécesseur). Il ne s’agirait pas de croire que l’Etat islamique est le fruit d’un désir d’Occident refoulé, ou le cristal de l’Occident, mais de rappeler que, comme le disait Pierre-Jean Luizard, il a prospéré partout où l’Etat irakien avait failli. Cette généalogie, purement géopolitique, s’applique uniquement à l’étude de l’implantation du djihadisme au Levant, et non à la séduction que l’islamisme exerce en Europe. Elle n’enraye pas nécessairement le paradigme du miroir, mais pourrait montrer comment ce même paradigme s’est historiquement enrayé.
[1] Introduction au marxisme, Paris, 1983.
[2] «Teheran : la fede contro la scia», Corriere della sera, 8 octobre 1978
[3] «Certaines communautés qui appartenaient autrefois à l’Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence, en tant que nations indépendantes, peut être provisoirement reconnue à condition qu’un mandataire apporte ses conseils et son assistance à leur administration jusqu’au moment où elles seront capables de se diriger seules.»
[4] «En envoyant dans le Levant un des plus grands soldats de la victoire, le gouvernement français a voulu montrer aux Syriens l’intérêt tout particulier qu’il leur porte. Nul n’est plus qualifié que lui pour assurer aux populations ce qu’elles doivent attendre de l’occupation : l’ordre, l’administration et la justice.»
[5] «Si les nations d’aujourd’hui vivaient au temps du Moyen Age où la force faisait le droit et l’épée seule tranchait les litiges, votre conduite aurait été parfaitement conforme aux lois établies. Cependant, si la grande guerre que nous avons menée aux côtés des Alliés pour obtenir notre liberté et notre indépendance a réellement atteint son but qui est la consécration du droit par le droit et l’écrasement du militarisme, si les principes du congrès de la paix – qui a proclamé la liberté des peuples et le droit de se gouverner par eux-mêmes – ne sont pas de vains mots et le pacte de la Société des Nations – qu’Alliés et ennemis ont signé –, abolissant la guerre et l’asservissement des peuples, reste à l’honneur, la force française, qui a occupé la zone et dont j’ai la direction ne peut être considérée que comme un instrument d’oppression et devra être traitée comme tel.»