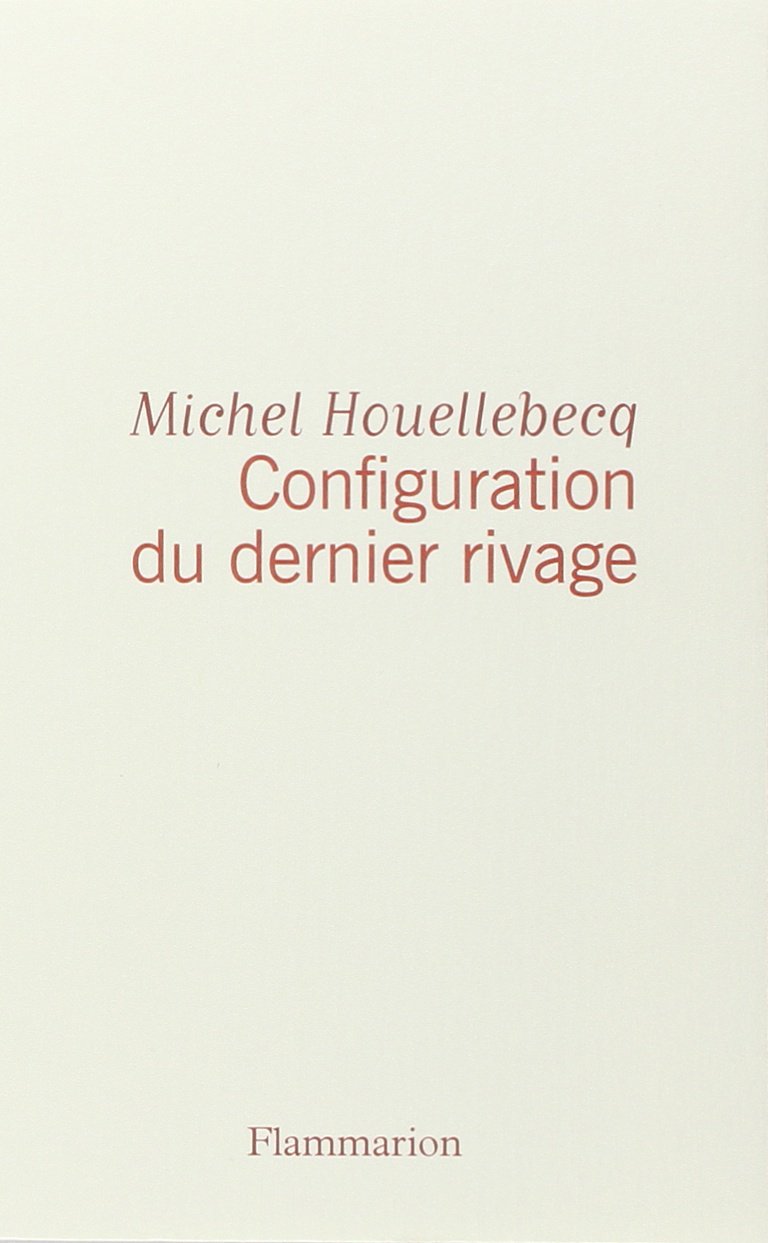A qui bon encore écrire, en 2013 ? Au XIXème siècle, Flaubert, usait d’ironie : il mettait en scène un discours, celui des romantiques, qui s’autodétruisait dans le grand vide que leurs mots creux quoique grandiloquents recouvraient. Par des procédés stylistiques fameux (les verbes de dialogue soigneusement choisis, les mots en italique, les adverbes brisant le rythme comme « alternativement »), tel un montreur d’ours, il faisait effectuer un numéro de cirque meurtrier à cette parole lamartinienne et quarante-huitarde percluse de clichés, cette logorrhée romantique recouvrant la vie d’un voile de signes et de mots sans valeurs ni vérité. Derrière le lyrisme et l’assurance petit-bourgeoise, on découvrait, grâce à Flaubert, qu’il n’y avait donc que la vacuité, la non-vie, l’ennui.
Après bien des péripéties, le discours littéraire, et plus seulement le discours romantique, s’est retrouvé mis en cause. De fait, la valeur supérieure de la parole littéraire est insuffisamment reconnue dans l’univers qui est le nôtre. Parce que le discours d’un auteur n’est plus qu’un discours parmi d’autres, noyé, perdu, dans un brouhaha de média différents et niveleurs, les écrivains ne sont plus tellement pris au sérieux. C’est aussi leur faute : la parole littéraire n’a pas inventé une forme éblouissante qui sache conter notre monde moderne et restaure ainsi la confiance passée dans le discours des romanciers. Comme le discours romantique avec Flaubert, tous les discours littéraires ont donc été soupçonnés d’être creux. Comme chez Flaubert derrière les romans et les poèmes, nous reconnûmes, béants, les artifices sans vie des littérateurs dépassés. Les bibliothèques sont alors devenues affreusement poussiéreuses.
Face à ce constat, bien des attitudes sont possibles. On peut tenter d’avoir suffisamment de génie pour inventer les formes d’écritures si pures, si vraies, si parfaites, qu’alors ce discours, en si extraordinaire adéquation avec les manières d’être, penser, voir des contemporains, suscitera une adhésion totale et trouvera l’incandescente exactitude des grandes littératures. Trouver de l’âme pour l’âme : une solution, bien sûr, affreusement compliquée. La plupart des gens, donc, ne pouvant inventer des formes neuves éblouissantes ni user des anciennes, discréditées, se contentent de ne plus écrire, ni poèmes ni romans. Ils font autre chose, des films, ou des disques. (Pour les romans, avouons que la situation est plus complexe, puisque beaucoup de romanciers en reviennent à écrire comme si de rien n’était, à pratiquer des formes de littérature déjà mortes, mais c’est alors accepter de retomber sous le coup du discrédit impitoyable adressé à toute littérature, monnayer sa place comme simple divertissement, et affronter une superbe indifférence). Il y a donc, en fait, une alternative : soit le silence désespéré, soit les romans de faux-monnayeurs, ces romans déjà vieux, inaudibles et peu considérés.
Et puis, il y a Michel Houellebecq.
Michel Houellebecq a pris acte depuis longtemps du décès des romans et de la littérature en général, dans une société consumériste et nihiliste qui ne croit plus en rien. Il sait qu’on ne peut, sans risquer le ridicule ou le mépris, et surtout l’indifférence, donner à lire à ses lecteurs des grands romans comme autrefois. Les lecteurs connaissent tous les trucs. Ils ne croient plus, à tort et souvent à raison, en la capacité des romans à nous donner à voir le monde moderne. Ils baillent d’avance. Alors que faire ? Se taire ? Michel Houellebecq, authentique grand artiste, ne peut s’y résoudre. Il voit le monde vivre et les gens y éprouver différents sentiments, et des histoires, des mots, lui viennent. Si écrire est improbable, le silence est impossible. Sa situation est donc délicate.
Michel Houellebecq a choisi une option médiane, et proprement extraordinaire : l’auto-ironie. Il sape méticuleusement tout signe de prétention littéraire, car en effet, la littérature, a priori, n’a plus le droit de se croire supérieure. Houellebecq sait que dans l’esprit du temps, son livre sera le compagnon géographique et l’équivalent économique d’un paquet de lessive, l’un comme l’autre perdu au milieu des étals de Monoprix. Alors, il a le courage de se suicider littérairement à chaque page. Dans « La Carte et le Territoire », qui est à mon avis le plus grand roman paru depuis bien longtemps, Michel Houellebecq commence par se décrire comme un personnage de sa propre intrigue, un personnage pathétique et dépressif, puis il en vient à s’assassiner lui-même d’une façon spécialement grotesque. Il fait du Flaubert, mais contre lui-même : Houellebecq a inventé l’auto-ironie, c’est-à-dire la mise en scène de l’autodestruction de son propre discours. L’auto-ironie romanesque, qui est le secret de Houellebecq, atteint avec cette mise à mort de « La Carte » un niveau génial et unique dans l’histoire. Il vous dit : « Lisez-donc ce roman dérisoire et misérable, et ricanons-en de concert ». Si l’on reprend l’alternative de tout à l’heure : le silence ou bien l’indifférence, eh bien Houellebecq ruse. Il ruse avec génie. Il se sert de la défiance géniale envers la parole littéraire, pour continuer malgré tout, presque en douce, à écrire des romans. Retourner contre soi, et donc désarmer, la suspicion goguenarde du lecteur, qui avale, sans le vouloir et sans le savoir, à son corps défendant, un très grand roman, c’est un tour de magie époustouflant et salutaire pour tous les romanciers du monde. Il vous embobine en assumant avec un courage et sans le moindre ego le mépris contre la littérature, pour pouvoir subrepticement continuer à faire vivre, en douce, la littérature. Michel Houellebecq est une sorte de Flaubert kamikaze des temps post-modernes. Le romancier christique de la société de consommation.
Je suis obligé d’en passer par ce long détour pour mieux vous parler du dernier recueil de poésie de Michel Houellebecq, « Configuration du dernier rivage » (Flammarion, disponible le 18 Avril en librairie). Car ce que notre grand écrivain avait réussi de façon proprement sublime avec « La Carte et le Territoire », canaliser le ricanement pour glisser de la littérature, et faire survivre le roman, il le réédite magistralement avec la poésie.
Là encore, nous avons les deux éléments de notre problème insoluble. Premièrement : une immense, dévorante nécessité intérieure. Une soif d’écrire, liée à une souffrance vraiment effrayante, et qui rend le silence impensable. Il vous suffit de lire quelques lignes de cette « Configuration » pour comprendre à quel point le spleen houellebecquien est sincère, vif, total. Et deuxièmement : pour exprimer cette souffrance, un éventail de vieilles formes littéraires dont il sait que l’usage ne lui apportera que de l’indifférence, du mépris, du ricanement, dans ce monde où la chair est triste, hélas. Des alexandrins ? En 2013 ? Quelle drôle d’idée. Ce dilemme, Houellebecq l’exprime d’ailleurs clairement (p.16) : « Où retrouver le jeu naïf ? / Où et comment ? Que faut-il vivre ?/ Et à quoi bon écrire des livres/ Dans le désert inattentif ?»
Alors, là encore, Houellebecq ruse. Il dégaine l’auto-ironie, avec une drôlerie et un génie équivalent, à mon avis, à ceux déployés dans « La Carte et le Territoire ». Ici, il s’agira pour Houellebecq de prendre sur ses épaules la condescendance goguenarde du lecteur moderne à l’encontre de tout ce qui est quatrain, sonnet, rimes croisées, pour, subrepticement, laisser entendre sa voix singulière, fêlée, ce souffle du tremble, pâle et dissonant.
L’auto-ironie en poésie ? Cela passe par une batterie de procédés. D’abord, dans une première section (« l’étendue grise »), Houellebecq, pour restaurer la légitimité de l’arsenal poétique, va s’amuser à montrer que non, il n’est pas dupe du côté démodé, un peu absurde, qui réside dans cette utilisation des alexandrins et des coupures à l’hémistiche. Alors, il va nous faire croire que sa poésie n’est que parodie. Il va nous donner à penser qu’il fait cela par jeu, et que s’il sort du silence, ce n’est pas non plus qu’il croit sérieusement faire de la littérature. Cela donne une succession de pastiches, parfois assez explicites, comme cette variation mallarméenne (p.12) où, de l’arc « aboli » au « coup de dés », tout est là ; cela se poursuit avec des échos de Bonnefoy ou de Bousquet, à la grandiloquence si peu houellebecquienne (« Nous habitons l’absence ») ; tandis que certains quatrains évoquent clairement Baudelaire (cette façon de couper le vers… de faire rimer « pur/obscur »… ou de terminer un poème sur une énumération d’adjectifs). Oh, on peut me dire que j’extrapole, mais je crois Houellebecq très conscient de tout cela. Un grand lecteur de poésie comme lui ne peut pas ne pas voir comme sont drôles ces versions potaches des Spleens baudelairiens : « J’ai pour seul compagnon un compteur électrique ». Un amoureux des classiques français ne peut pas ignorer l’intertextualité évidente de cette section « Mémoire d’une bite », où comme chez Apollinaire, les vers sont peuplés de larrons, étrangers, maraudeurs et malades, déclamant leur odyssées d’une traite, dans des nuits aux lunes pleines, par des vers anglicistes et des mélopées entêtantes, ce qui, dans le palimpseste houellebecquien donne : « J’ai connu bien des aventures/Des préservatifs usagés/J’ai même visité la nature,/et je l’ai trouvé mal rangée ». Mais il y aussi de l’Eluard, et ses comparaisons solaires (« L’espace entre les peaux/Quand il peut se réduire/Ouvre un monde aussi beau/Qu’un grand éclat de rire »), du zutique, de la comptine verlainienne, et mille autres échos, différents et sarcastiques, ayant tous pour fonction de montrer que Houellebecq, en tant qu’auteur, ne croit pas à ce qu’il fait, et ainsi, d’entraîner le lecteur à poursuivre une lecture, a priori condescendante.
Cette usage du pastiche, accommodant Apollinaire aux vestes Kookaï et mettant Baudelaire sous Xanax, c’est le premier dispositif d’auto-ironie de Houellebecq. Il a permis (sans que le lecteur s’en rende compte) de rendre acceptable, en 2013, donc, l’usage des formes poétiques canoniques. Houellebecq a renversé l’indifférence soupçonneuse, et peut rimer en quatrain. Le dispositif suivant, c’est une foule de flagellations, de croc-en-jambe, de scarifications que le poète s’adresse à lui-même, pour montrer que son art est dérisoire, nul, vain, et qu’il n’en est pas dupe. Je ne citerai, comme exemple parfait, que ces vers : « Promesse de bonheur sur deux pattes/Toutes fières de leurs jeunes organes,/Les jeunes filles servaient du champagne/(Je m’excuse pour cette rime bien plate) » , page 51. L’auto-ironie, elle est encore dans la composition même du recueil, Houellebecq alternant les stations lyriques, ou sincères (premier degré en quelque sorte) avec les parenthèses d’ironie franche (la désormais fameuse « Mémoire d’une bite ») ; elle est dans la métrique même, et cette façon qu’a Houellebecq, à la fin d’une succession d’alexandrins parfaits, d’en rajouter un, qui compte treize pieds, mimant l’ironie générale, le côté montreur d’ours de son propre discours, bourreau-de-soi-même-en-poète que Houellebecq déploie dans toute la « Configuration ».
Ainsi, Michel Houellebecq rachète aux yeux du lecteur, provisoirement, et au prix d’un ricanement à son encontre, la poésie, et les vieilles formes, à l’usage d’habitude impossible. Dans la « Carte et le Territoire », Houellebecq se sacrifiait (et même physiquement, à travers son personnage), pour pouvoir écrire subrepticement un merveilleux roman sur les relations père-fils, ou l’état de la France contemporaine. Ici, si Houellebecq se mutile, c’est pour nous donner à entendre une voix reconnaissable entre toutes, désespérée, grise, bouleversante. Comme tous les grands poètes, Houellebecq arrive ici à cette « hyper-subjectivation » du langage, ce qui est un mot compliqué d’Henri Meschonnic pour dire que Houellebecq a créé sa langue, une langue qui lui appartient en propre, et qui nous appartient à tous, un ton que l’on identifie sans peine, une façon de rythmer, de nommer, de respirer. Je pourrais citer bien des passages, mais cet article est déjà si pataud et interminable, quand Houellebecq est le plus souvent juste, pur, gracile. Je me contenterai donc de recommander en particulier la dernière section, ou bien les tous premiers poèmes, car c’est là que prennent vie ces paysages d’outre-science, ces landes minérales où l’âme souffre solitairement, c’est là que les mots de Houellebecq, parfois lourds dans leur neutralité pesante, parfois précieux ou techniques, toujours savamment ponctués, c’est là que ces vers lents, grinçants ou suspendus, forment des complaintes d’amour, des spleens rêveurs, des élégies bouleversantes. « Face B » est un grand, grand poème, « le » grand poème de la dépression moderne. S’animent sous nos yeux un monde urbain et un cœur mis à nu, une féérie morne sous anxiolytique, qui pourrait être complaisante, mais devient universelle, mélodie toute tendue de douleur. Les images surprennent sans cesse, la musique émeut toujours. Les rimes féminines égrènent langoureusement des amours monotones. Au final, par la ruse, Houellebecq a sauvé la possibilité d’écrire, il nous a fait traverser les champs oubliés du lyrisme et de la poésie dépassés pour retrouver l’émotion pure, il nous a donc permis ce voyage, si bien décrit : « Il faudrait traverser un univers lyrique/Comme on traverse un corps qu’on a beaucoup aimé/Il faudrait réveiller les puissances opprimées/La soif d’éternité, douteuse et pathétique ». Et voilà que, prétendant rire de lui, Houellebecq a encore écrit un livre merveilleux dans le dos du lecteur.