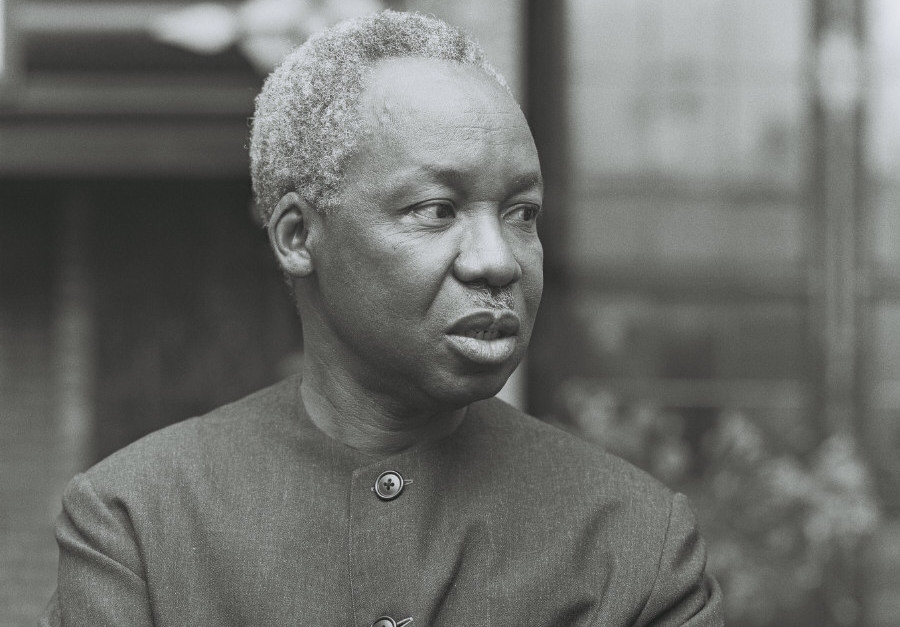L’Afrique est mal partie, prophétisait René Dumont il y a un demi-siècle. Au vu de votre expérience nourrie et variée de banquier d’affaires, spécialisé sur ce continent, cette prédiction vous paraît-elle, aujourd’hui, démentie ?
L’ouvrage de l’agronome René Dumont, paru en 1962, avait mis en avant les maux endémiques dont souffrirait l’Afrique subsaharienne : corruption, faiblesse des systèmes éducatifs et erreurs dans les stratégies agricoles mises en œuvre. Le livre, dans le contexte de la « décolonisation heureuse », c’est-à-dire l’euphorie post-coloniale, fut d’ailleurs accueilli fraîchement compte tenu de son diagnostic plutôt sombre quoique bienveillant et invitant les pays à penser leur industrialisation.
Si l’analyse de René Dumont correspond indiscutablement à certaines réalités, elle doit être nuancée. Tout d’abord, du point de vue économique, tous les pays ne connaissent pas la même trajectoire de croissance et de maturité. La Côte d’Ivoire des années 1970 pouvait être considérée comme la vitrine du continent comparée à ses voisins, le Ghana ou le Nigéria en particulier. Au début des années 2000, la situation s’est inversée avec les guerres civiles que le pays de la lagune Ebrié a connues pendant environ une décennie alors que le Ghana a émergé. Depuis 2011, la Côte d’Ivoire joue à nouveau le rôle de locomotive de la sous-région et même du continent avec un taux de croissance annuelle moyen autour de 7% par an depuis 15 ans et une transformation du pays chaque jour plus perceptible. Dans une autre partie de l’Afrique, le Maroc connaît une évolution rapide de son économie depuis une quinzaine d’années et renforce son émergence. Inversement, la Tunisie, qui était dans une trajectoire dynamique de modernisation dans les années 1990 et au début des années 2000, se trouve engluée depuis le virage manqué du printemps arabe et en perte de vitesse si on la compare au Maroc ou à la Côte d’Ivoire. Il existe donc bien des trajectoires divergentes entre les pays et en fonction des périodes prohibant tout jugement global et définitif sur la situation économique du continent.
Au niveau politique, la situation a connu également des soubresauts sur les 50 dernières années avec des avancées et des régressions. Le régime ségrégationniste de l’apartheid en Afrique du Sud est révolu, des pays se sont ancrés dans des transitions démocratiques réussies comme les élections récentes au Ghana, au Sénégal ou en Zambie l’ont démontré. D’autres sont retombés dans les affres des coups d’États, des troubles, voire des guerres civiles comme dans les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), en Libye, au Soudan ou en Éthiopie. Là aussi, parler au singulier d’une trajectoire démocratique et pacifique ou autoritaire et violente des régimes politiques africains ne correspond pas à la réalité.
Enfin, les enjeux démographiques, climatiques, les mutations technologiques qui n’existaient pas il y a 50 ans ou dans des proportions incomparables, prennent aujourd’hui une acuité toute particulière et constituent autant d’opportunités que de défis pour chaque pays africain et pour l’ensemble du continent.

Quels sont les secteurs économiques les plus prometteurs sur le continent africain ?
Factuellement, l’Afrique dispose de la taille – 30 millions de km2 soit l’équivalent de l’Europe, les Etats-Unis, la Chine, l’Inde réunis –, d’un sous-sol riche en terres rares et en minerais, de terres arables abondantes propices à un fort potentiel agricole, d’une jeunesse nombreuse et dynamique constituant à la fois un réservoir de main d’œuvre et de consommateurs. Ce sont autant de facteurs prometteurs permettant de construire la prospérité de demain.
Néanmoins, chaque pays est distinct et dispose d’avantages comparatifs propres. Cette distinction se retrouve au niveau sectoriel.
D’un côté, les pays richement dotés en matières premières agricoles, tels la Côte d’Ivoire avec le cacao, le Ghana avec le café ont intérêt à renforcer et développer leurs filières d’extraction, de production et de transformation. C’est tout l’enjeu par exemple de la filière cacao ou de noix de cajou de Côte d’Ivoire aujourd’hui.
De l’autre, certains pays, comme le Nigéria, l’Angola, le Tchad, le Cameroun, l’Algérie, le Congo pour ne citer qu’eux sont richement dotés de matières premières non agricoles comme le pétrole ou le gaz. L’enjeu n’est pas tellement dans la transformation dans la mesure où il ne s’agit là ni d’une chaîne de valeur mondiale ni d’un avantage comparatif fort dont les pays africains producteurs pourraient disposer. Il s’agit plutôt de disposer d’une bonne gestion, d’une bonne gouvernance et d’utiliser les ressources budgétaires qui en découlent de manière pertinente et efficiente pour réussir la diversification économique et préparer l’avenir. La montée en régime, dans les toutes prochaines années, de nouveaux producteurs comme la Côte d’Ivoire et le Sénégal offriront à ces deux pays des ressources financières additionnelles conséquentes et constitueront un bon test sur leur capacité à bien les exploiter et favoriser les investissements d’avenir. Enfin, les minerais stratégiques constituent indiscutablement un secteur d’avenir, et même du présent. Indispensables pour la fabrication des batteries électriques et la transition écologique comme j’ai pu le décrire dans mon dernier ouvrage « Ce qu’attend l’Afrique », ils constituent également un enjeu géopolitique fort dans un contexte de diversification des fournisseurs et de tensions mondiales exacerbées. Les pays africains qui en sont dotés, disposent donc d’un avantage comparatif qui doit être mis à profit de manière pérenne en renforçant le plus possible la transformation locale de ces matières premières et le renforcement de l’industrialisation des économies qui en découle. Mo Ibrahim avait coutume de dire il y a dix ans : « L’Afrique compte à présent plus de téléphones portables que l’Europe et les Etats-Unis mais aucun de ses mille composants n’est fabriqué sur le continent ». C’est tout le sens de la chaire Afrique de l’ESSEC « Business et industrie en Afrique » que j’ai co-fondée avec Andrea Rancoroni et que je dirige, avec des partenaires économiques et industriels pertinents sur le continent.
Si l’on sort des matières premières et des secteurs liés à l’augmentation du nombre de consommateurs (distribution, cosmétique, habillement, logement, santé), l’enjeu fondamental des prochaines années reposera sur le développement de l’intelligence artificielle sur le continent, de la production de data centers énergivores dans un contexte de rareté énergétique, à la production de données en masse qu’une jeunesse africaine formée pourrait fournir en nombre.
Y a-t-il des pays qui ont trouvé des modèles de croissance particulièrement pérennes et prometteurs, à recommander ou à imiter ?
Je rappellerai que la singularité principale du continent africain repose sur la grande fragmentation de ses économies avec un nombre très important de petites, voire très petites économies. En effet, d’un côté, sept pays africains ont concentré 68% du PIB africain en 2024 ; de l’autre, 37 pays n’ont représenté que 12,5% des 3000 milliards du PIB du continent. Autrement dit, l’enjeu consiste à élaborer des modèles de croissance adaptés à chaque type d’économie. Parler d’un modèle de croissance africain est absurde. Comme je le dis dans mon livre en citant un proverbe de Guinée-Bissau, « le bonheur de la puce peut faire le malheur du chien ». Autrement dit, un petit pays comme le Bénin a compris que son modèle de croissance ne peut évidemment pas reposer sur sa croissance domestique du fait de l’étroitesse de son marché intérieur mais sur le dynamisme de ses exportations. Le pays doit donc être doté d’une économie compétitive, développer la transformation locale de ses ressources, à l’instar du coton – ce qui a été fait ces toutes dernières années grâce à la mise en place en un temps record de sa zone industrielle de Glo-Djigbé. Grâce à cela, le pays affiche aujourd’hui l’une des croissances les plus dynamiques du continent et de la sous-région. A contrario, son voisin, l’immense Nigéria cumule les réussites… et les handicaps. Doté d’un large marché domestique, d’une démographie pléthorique – le Nigéria devrait être le 3ème pays le plus peuplé au monde d’ici 2050 –, il n’a pas véritablement trouvé un modèle de croissance juste et pérenne. Le pays peut être tenté par le repli du fait de sa taille – le Nigéria a freiné jusqu’au dernier moment son adhésion en 2020 à la création de zone de libre-échange panafricaine. Le Nigeria ne me semble pas non plus privilégier un « modèle chinois » visant à devenir l’atelier industriel de référence africain compte tenu des défis trop importants en matière d’éducation et l’éclatement du pays qui compte trente-six Etats dotés de pouvoirs régionaux forts. Mais le Nigéria pourrait s’inspirer du « modèle indien » qui fabrique le plus grand nombre d’ingénieurs au monde, pour devenir une référence dans la course au développement de l’intelligence artificielle et des millions d’intégrateurs de données que le pays serait en mesure de fournir. Le Nigéria dispose d’une capacité d’innovation et d’énergie hors norme en ce sens mais le chemin à parcourir reste encore long.
D’autres pays, comme le Maroc, ont su tirer profit de leur situation géographique et d’une éducation en sciences de qualité, en développant leur industrie, à la fois tournée vers l’Union européenne – notamment dans le secteur automobile et aéronautique –, et une stratégie dynamique vers quelques pays d’Afrique subsaharienne. Cette stratégie gagnante ne peut être adoptée par des pays enclavés comme la Zambie par exemple.
Mais indépendamment de la taille, les pays les plus vertueux affichent des caractéristiques communes et les pays moins performants affrontent les mêmes handicaps. Aux pays plus dynamiques et vertueux : des institutions politiques stables ; un système éducatif correct et même compétitif dans certains domaines ; un avantage comparatif (localisation géographique, taille du pays, ressources particulières, etc.) qu’une bonne gouvernance permet de valoriser. Aux pays moins performants : des institutions politiques faibles ; un secteur public omnipotent ; une démographie hors de contrôle compte tenu de la croissance par tête et des capacités d’absorption du système éducatif.
La France, aux dires de nombreux commentateurs, a été tenue pour une puissance qui perdrait pied progressivement dans ses bastions historiques. C’est même devenu une rengaine de la vulgate médiatique… Qu’en pensez-vous personnellement ? Est-ce une réalité tangible, ou une amplification ?
La réalité est entre les deux. Tout d’abord, il faudrait procéder à une analyse sérieuse, documentée et approfondie en fonction des différents champs d’action dont on parle : culturel, diplomatique, politique, économique, monétaire, militaire ou scientifique. Tous ne connaissent ni la même trajectoire ni la même réalité. Ensuite, le regard médiatique porté sur les déboires supposés de la France n’est pas le même vu de Paris, de Bamako, de Nairobi ou de Dubaï. Des biais, des influences, pour ne pas dire des manipulations existent pour donner de l’ampleur à ce discours avec un effet grossissant en fonction de l’objectif de groupes d’intérêts ou de puissances étrangères hostiles à la France. Il ne faut être ni dupe ni naïf.
Ce qui est en revanche certain, c’est que la France n’est plus un partenaire exclusif, en Afrique francophone comme ailleurs. Mais aucun de l’est, pas plus la Chine que la Russie ou les Etats-Unis. Partout, tous les pays africains entendent diversifier leurs relations économiques et politiques en particulier, ce qui n’empêche pas des partenariats stratégiques avec la France. Et la France elle-même noue plusieurs partenariats stratégiques dans toutes les géographies du monde. Dans cet esprit, la France s’est également beaucoup plus ouverte vers les pays des « autres Afriques », c’est à dire anglophone et lusophone. Les relations avec des pays comme le Nigéria ou le Kenya se sont approfondies ces dernières années, économiquement, politiquement, culturellement. La France est aussi par exemple, le deuxième investisseur dans le plus gros pays d’Afrique lusophone, l’Angola. La situation objective globale est donc nuancée mais appelle une analyse plus exhaustive en fonction des pays et des champs d’intérêt concernés.
Y a-t-il des spécificités économiques, financières et croissancielles de l’Afrique francophone ?
Les pays francophones ne forment pas un ensemble homogène. Les pays francophones d’Afrique de l’Ouest ont été les plus dynamiques d’Afrique sur les dix dernières années avec quelques pays locomotives comme la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Sénégal même si ce dernier affronte une situation macroéconomique plus difficile récemment. Ils comprennent également les pays sahéliens de l’AES qui, tout en affichant une autonomisation forte, bénéficient encore des liens économiques et monétaires régionaux. Ces pays partagent également la même monnaie, le franc CFA, qui, pendant les crises – COVID et guerre en Ukraine –, a plutôt joué un rôle de bouclier et d’amortisseur de chocs, rappelant l’avantage d’un régime de taux de change fixe. Les pays frontaliers, que ce soit le Ghana ou le Nigéria, qui eux disposent d’un régime de taux de change flottants, ont eu une très forte inflation et une dépréciation de leurs monnaies, ce qui leur a coûté cher économiquement et socialement. L’autre Afrique francophone, l’Afrique centrale, se trouve dans une situation économique plus difficile, liée notamment au caractère plus extractif de leurs économies davantage dépendantes du cours du pétrole. Elles bénéficient également d’un bouclier monétaire à travers la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC), ce qui les a préservées d’ajustements trop brutaux. Enfin, il conviendrait de savoir où placer les pays du Maghreb, à la fois francophones et arabophones et suivant des trajectoires distinctes. Le Maroc est en pleine transformation ; la Tunisie a contrario est en crise ; l’Algérie reste assez figée et peu ouverte aux échanges extérieurs.
Votre expérience vous alerte-t-elle sur la croissance des appétits des acteurs illibéraux, de la Chine à la Turquie en passant par la Russie poutinienne ?
Ces trois pays ne s’intéressent pas de manière homogène au continent africain. Seuls véritablement la Chine et la Turquie ont une approche panafricaine, c’est-à-dire étendue à un nombre important de pays africains, d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne. L’action de la Russie reste très ciblée sectoriellement et sur un nombre limité de pays sur lesquels elle peut avoir un levier d’action car fondamentalement elle n’a pas grand-chose à offrir à la majorité des pays africains contrairement à la Chine ou à la Turquie. Les échanges commerciaux annuels entre l’Union européenne et l’Afrique approchent 400 milliards de dollars, contre 300 milliards pour la Chine et environ 15 milliards pour la Russie. Le pétrole et le gaz russe ne sont d’aucune utilité aux pays africains du fait de la richesse de son sol et son industrie d’armement n’intéresse qu’un nombre limité de pays. La plupart des pays africains d’ailleurs, d’un point de vue géopolitique, restent très prudents et peu diserts sur le conflit russo-ukrainien. Parallèlement, l’intérêt pour certains pays africains est grandissant parmi d’autres acteurs internationaux, tant du côté des pays européens et matures comme le Portugal, la Pologne ou l’Ukraine que du côté des pays émergents comme l’Inde ou l’Indonésie. Des représentations diplomatiques ou des chambres de commerce ont ouvert ces toutes dernières années. Cette ouverture internationale, quoique limitée, me semble être plutôt une très bonne chose pour l’Afrique car elle permet de diversifier ses partenaires et donc limiter ses dépendances.
Pour le soft power français, notre langue est un atout de choix. Surtout lorsque l’on sait que l’Afrique comptera environ sept cents millions de locuteurs du français d’ici une vingtaine d’années… Comment cette donnée va-t-elle peser sur la compétition au cours des puissances dans le continent africain ?
Cette question mérite d’être approfondie car le raisonnement me paraît parfois un peu trop rapide. La francophonie tout d’abord constitue un espace qui n’entend pas être que linguistique, le développement par exemple de la francophonie économique ces dernières années l’atteste. De plus en plus de pays prennent conscience de l’avantage et du poids qu’un ensemble linguistique commun peut apporter et il est aussi intéressant de constater que le nombre de pays rejoignant l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) est en croissance (93 Etats membres, associés et observateurs en 2025 contre 70 en 2010), en dépit du retrait très circonstancié cette année du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Cela étant dit, il me semble hasardeux d’estimer que la hausse démographique africaine garantit à la francophonie ipso facto un avenir radieux. Des signaux contraires apparaissent et les mutations technologiques rendent difficilement fiables les prévisions à moyen terme, c’est-à-dire d’ici 2050, à un moment où l’Afrique devrait compter 2,5 milliards d’habitants et l’espace francophone théoriquement environ 700 millions de personnes.
Plusieurs pays africains ces dernières années ont diversifié l’apprentissage linguistique de leur jeunesse : du Maroc à l’Algérie, du Rwanda au Gabon, au bénéfice de l’anglais et parfois d’une autre langue au détriment du français. Dès lors, la profondeur au sein des populations de la maîtrise du français est moins assurée, tout comme les références culturelles, altérant ainsi l’influence du soft power francophone. Par ailleurs, la dynamique démographique de l’espace francophone africain reste assez aléatoire selon moi car il repose en réalité sur l’évolution politique et la qualité de l’offre éducative des pays et en particulier de 4 pays qui auront une démographie forte d’ici 2050 : la République Démocratique du Congo (RDC) atteindrait 215 millions d’habitants, le Niger 70 millions, la Côte d’Ivoire et la Mali environ 50 millions chacun. La RDC en particulier, dans ce contexte, risque de faire l’objet de pressions grandissantes avec la volonté de puissances hostiles ou concurrentes d’affaiblir le français comme langue de référence.
Enfin, les évolutions liées au développement des mutations technologiques sur l’espace francophone, restent peu prévisibles. D’un côté, les outils de l’intelligence artificielle devraient faciliter le franchissement des barrières linguistiques grâce aux traductions simultanées ; de l’autre, elle devrait aussi renforcer la prise en compte du patrimoine linguistique africain estimé à près de 2000 langues et dialectes, ce que le dernier sommet de Kigali sur l’IA en avril 2025 a mis en lumière. Enfin, et ce point me semble majeur et aujourd’hui occulté, une parfaite maîtrise de la langue de référence sera un atout décisif dans le cadre d’une bonne utilisation de l’IA. Car l’IA répond aux questions qu’on lui pose. Des questions bien formulées amènent des réponses calibrées et pertinentes. Plus que jamais, la clarté de l’expression, la rigueur de la syntaxe, la richesse du vocabulaire et donc une très bonne maîtrise de la langue, seront un instrument déterminant de souveraineté et de liberté des individus et d’une société, avant d’être un instrument de soft power. Il est donc primordial d’accorder une priorité massive à un apprentissage rigoureux et exigeant du français, en France comme dans l’espace francophone pour affronter ces défis.
On entend souvent dire que le prestige de la France s’est effondré, est-ce ce que vous ressentez concrètement sur le terrain, dans le compte rendu africain ?
Il s’agit d’abord de définir ce que l’on entend par le prestige de la France. Je dirai qu’il s’agit à la fois de la richesse de son histoire et de ses grands hommes, de Louis XIV à Napoléon en passant par de Gaulle pour rester dans une histoire contemporaine ; de la diversité et la beauté de ses paysages reconnue par l’importance de son attractivité touristique ; l’ampleur et la profondeur de ses domaines d’excellence et d’innovation notamment scientifiques, de Blaise Pascal à Louis Pasteur, de la maîtrise nucléaire et ses médaillés Fields. Sans oublier la finesse de sa langue, la richesse de sa culture ou son « soft power » du cinéma au sport.
Sur tous ces points-là qui peuvent relever du patrimoine français, je dirais que le prestige est intact et source d’ailleurs d’espérance quant aux défis que la France doit relever.
Car, si le prestige aujourd’hui de la France en Afrique, et en particulier en Afrique francophone, est entamé, il l’est avant tout, à mon sens, par la détérioration de la situation économique, sociale et politique qui s’est accélérée ces vingt dernières années de la France elle-même, comme je l’explique sans détour dans mon livre. Retrouver un prestige à l’extérieur suppose avant tout de profondes réformes de l’intérieur, de son modèle économique et social, de ses institutions en passant par un retour à une société de respect, d’ordre et d’exigence pour se projeter dans une société dynamique, apaisée et attractive.
Il y a enfin un biais générationnel fort. Ceux qui ont connu la France des années 70, 80 et 90 sont évidemment plus marqués par ce décalage ; les plus jeunes générations en France, comme dans les pays africains francophones, ont des références, voire des aspirations plus hétéroclites ; ce sentiment de perte de prestige me semble moins marqué dans les régions non francophones du continent qui cherchent également à diversifier leurs partenaires – et la France en fait partie.