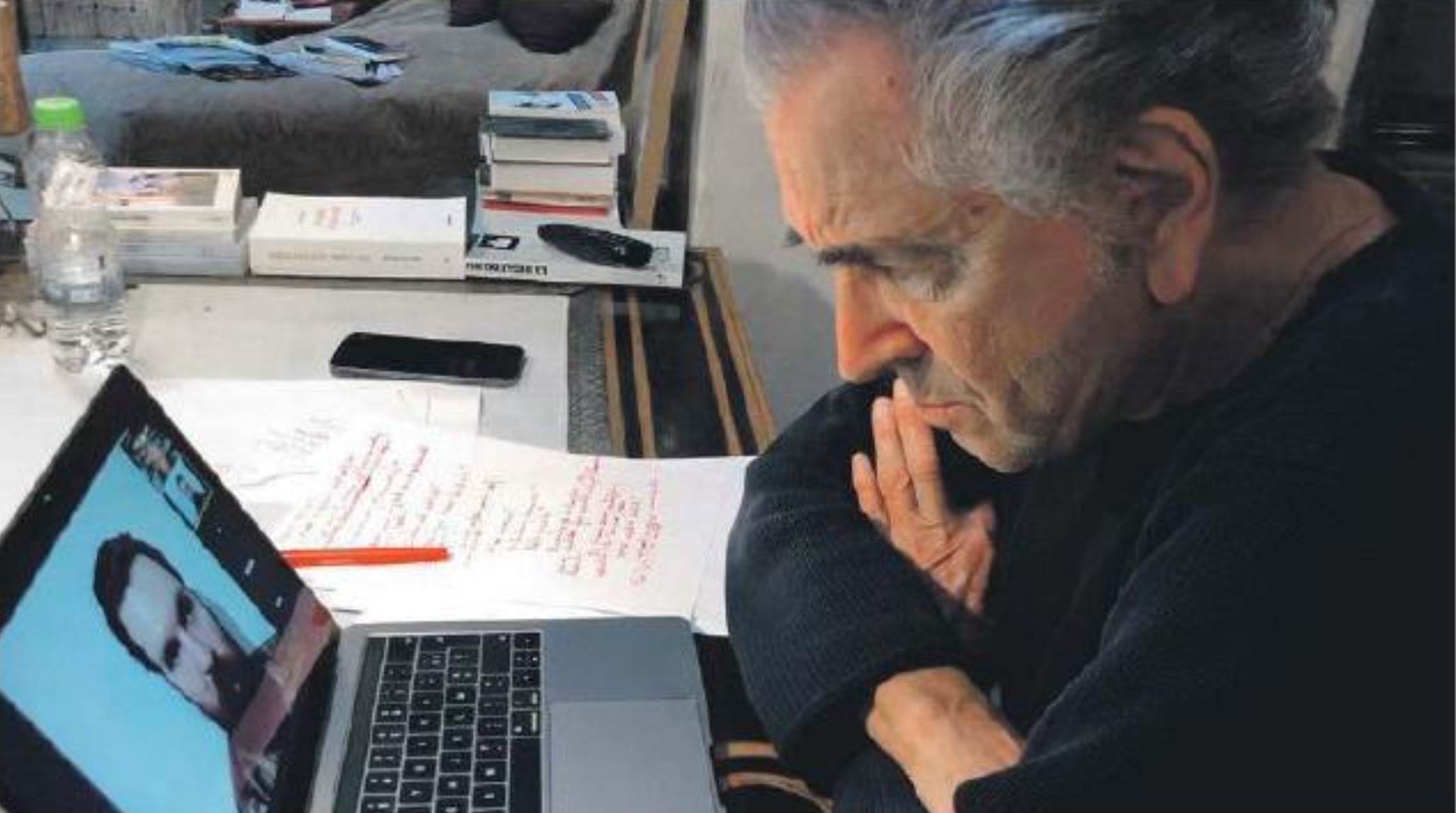Il n’y a pas tant de guerres totales dans l’histoire de l’humanité.
La guerre de Troie, bien sûr, avec l’annihilation de la cité vaincue.
La troisième guerre punique, dont le programme, ressassé, ad nauseam, par Caton l’Ancien, était le fameux Delenda est Carthago.
Peut-être la guerre de Vendée, la guerre des Boers ou, à la fin des années 1860, la guerre de la Triple-Alliance, contre le Paraguay, où les massacres de civils battirent les records de l’époque.
Peut-être aussi, en toute rigueur, dans leurs principe et intention, ces guerres contre Israël qui en ont à l’existence même de l’État et de la nation hébreux.
Et, à coup sûr, les Première et Seconde Guerres mondiales qui servirent, pour l’une, de modèle et, pour l’autre, de champ d’expérimentation au concept de guerre totale tel qu’il fut théorisé, en 1935, par le général allemand Ludendorff.
Eh bien cette guerre contre l’Ukraine, dont on ne sait toujours pas, cinq cents et quelques jours après, quel était son but de guerre, cette guerre dont il a été vite clair qu’elle n’avait d’autre objet que d’humilier, asservir et, si nécessaire, détruire un pays voisin et honni, cette guerre qui a commencé par une attaque massive sur Kyiv, s’est poursuivie par des bombardements aveugles sur tout le territoire et a confondu dans une même rage cibles civiles et objectifs militaires, cette guerre où l’on vise les théâtres et les jardins d’enfants, les synagogues et les églises, les barrages et les centrales électriques, cette guerre où l’on ajoute aux crimes de guerre les crimes contre l’humanité, aux crimes contre l’humanité les actes génocidaires et où l’on a, dans les secteurs sud et est où je me trouve à nouveau ces jours-ci, anéanti des agglomérations dont il ne reste littéralement que des cendres, cette guerre s’inscrit dans cette tradition et est l’exemple même de ce que Ludendorff et, avant lui, sans la nommer et comme pour en conjurer le spectre, Clausewitz entendaient par guerre totale.
La guerre pour la guerre.
La guerre sans visée intelligible.
Une guerre conçue et voulue, sans embarras aucun, comme le triomphe de la déraison dans l’Histoire.
Et, pour la mener, une armée et un peuple de possédés qui, à l’image de Poutine, de Prigojine et des brigands qui gravitent autour d’eux, semblent sortis de la plus noire des nuits russes.
Il y a là, je le répète, un phénomène rare dans l’histoire des hommes.
Il y a, dans le déroulement de ce que les nouveaux artisans de la banalité du mal et de sa novlangue persistent à nommer une « opération spéciale », un déchaînement de barbarie qui hypnotise et saisit d’effroi.
Et c’est l’autre raison qui rend cette guerre si singulière.
S’ajoute la menace nucléaire brandie, de loin en loin, comme si de rien n’était, par Poutine et les siens.
Je n’ai jamais trop cru, pour ma part, que le maître du Kremlin fût prêt à appuyer sur le bouton.
Y aurait-il songé que le bouton n’est pas un bouton, qu’une attaque de cette sorte implique une chaîne de commandement longue et complexe et que, parmi les dizaines d’individus impliqués dans la mise en œuvre de la décision, il s’en trouvera toujours un pour avoir conscience des règles du jeu, savoir qu’à une frappe répond nécessairement une deuxième frappe et refuser, à la dernière minute, de prêter la main à ce suicide collectif.
Et j’y crois moins que jamais depuis le putsch manqué de Prigojine, ce soudard qui se voulait Bonaparte alors qu’il n’était même pas Boulanger et qui a, pourtant, réussi à ébranler le pouvoir à Moscou : y a-t-il un officier supérieur russe qui n’ait vu, ce fameux samedi matin où tout, soudain, sembla possible, le visage défait du maître de toutes les Russies ? l’homme de fer devenu homme de cire ? le roi nu ? la symbolique de son pouvoir soudain démagnétisée ? et ne sautait-il pas aux yeux que si, d’aventure, venait à cet homme apeuré la folle idée de donner le signal de la guerre plus que totale, nombreux seraient ses généraux ayant cessé de lui prêter l’infaillibilité de principe qui, seule, fait que l’on suit le chef, comme Hitler, dans son bunker ?
Reste que le tabou a été levé.
Les mots interdits ont été prononcés.
Ils l’ont été, par parenthèse, bien avant le déclenchement de la guerre et notre soutien aux Ukrainiens puisque c’est dès le 19 décembre 2021, dans le double ultimatum à l’Occident auquel j’avais consacré un bloc-notes, que les idéologues et stratèges du Kremlin ont agité la menace d’un lancement de missiles hypersoniques sur les capitales européennes.
Et cela suffit à ce que nous reviennent à l’esprit les vertigineuses questions qu’avaient, après la Seconde Guerre mondiale, posées Hannah Arendt, Hans Jonas, Karl Jaspers, Albert Camus et qu’une modernité irénique avait consciencieusement refoulées.
Gouffre du rien.
Ontologie de l’apocalypse.
Le monde redevient « ce qu’il est », c’est-à-dire, comme disait Camus, « peu de chose ».
Revient à l’ordre du jour, comme il le disait dans le même texte, le « dernier degré d’une sauvagerie » dont la pensée nous précipite, pour le coup, dans les abîmes de la post-Histoire.
Nous autres, civilisés, réapprenons que nous sommes mortels.
De l’humanité même, et du monde, rien ne dit plus qu’ils doivent durer.
Et c’est aussi un événement considérable dont on n’a pas fini d’évaluer le choc qu’il fait dans les consciences.
(À suivre.)