Il y a d’abord le souvenir de cette phrase de Nietzsche : « Je veux le monde et je le veux tel quel », signature et mètre étalon de la revue Tel Quel dès son premier numéro, phrase qui m’aura poursuivie toute ma vie – et dont je n’aurai cessé de trouver un écho dans les livres de Sollers, avec cet enchanteur « mais oui », qui revient à intervalles réguliers dans ses textes, dans ses dialogues en particulier, comme une philosophie portative (peut-être en écho au « yes » des dernières pages de l’Ulysse de Joyce). J’ai, dès le début, aimé cet enthousiasme sollersien, ce Sollers qui ne cède jamais, dès sa curieuse solitude, sur son désir, sur son approbation de la vie (il a en partage cet enthousiasme avec un certain judaïsme de l’étude).
C’est à travers ce philtre que me reviennent depuis son décès, avec insistance, moins des œuvres (au sens de ces totalités encloses en elles-mêmes qui, dans son cas, ne dorment jamais que d’un œil sur les rayons des bibliothèques), que certains mots : passion, parfait, absolu, passion fixe, centre, qui sont comme autant de repères – ces derniers donneront, comme on sait, leur titre à certains de ses livres – à partir desquels c’est une phrase en continu qui se sera déployée, et dont le mouvement, la fluidité se rappellent aujourd’hui à ma mémoire.
Une phrase en suspens sur l’abîme, mais qui ne paraît jamais devoir chuter, car elle habite, cette phrase, de l’autre côté du temps, dans la Cité des livres (et dans son écriture, il n’y a pas de chute, au sens d’un effet stylistique ou rhétorique, qui déplacerait aussitôt cette écriture du côté de la fin – d’une fin, heureuse ou malheureuse – et même dans sa curieuse solitude, la fin n’est jamais que la promesse ou le programme d’une solitude choisie, et non subie, celle de l’écriture enfin libérée de ses carcans amoureux).
Cette phrase n’est donc pas un « phrasé » : elle éclot en continu sur la ligne d’écriture, comme un marqueur au stabilo éclaire, en le réifiant, en le détachant de ce qui le précède et de ce qui le suit, le moment clé d’un texte ou d’un paragraphe.
Dans le cas de Sollers, cette phrase est un lieu exact, chaque fois juste, mais dans un sens inaccoutumé, car nullement figé dans sa gravité, la phrase portant autant qu’elle est portée, comme une note de musique, par le passage du temps.
En ce sens, cette phrase sollersienne, comme toute son écriture, relève moins d’un art de la représentation, qu’elle ne se donne comme un art de l’avoir lieu, de l’événement, (ou comme un duende, un esprit follet, qui se faufilerait entre les murs des maisons, pour en inquiéter la pesante tranquillité) ; elle passe entre les lignes, et s’y tient, s’y arrête, dans l’emportement de son passage même : c’est la puissance du « passer » (ou peut-être « l’emportement du signifiant » comme on disait à l’époque) qui la retient, ou qui l’élève, dans son dynamisme même.
Sollers est, avec cette phrase en continu dont l’écho me revient depuis que j’ai appris sa disparition, à l’unisson de Matisse quand il évoque le mouvement à l’œuvre dans sa Danse. « Vous pouvez concevoir une danse d’une façon statique. Cette danse est-elle seulement dans votre esprit ou dans votre corps ? La comprenez-vous en dansant avec vos membres ? Le statique ne fait pas obstacle au sentiment du mouvement. C’est un mouvement placé à un degré d’élévation qui n’entraîne pas les muscles des spectateurs, mais simplement leur esprit ». En ce sens, cet espacement de la phrase sollersienne, je le retrouve aussi à l’œuvre dans la peinture de Christian Bonnefoi, quand le peintre déclare que « le mot, l’idée, le concept doivent se fondre dans la matière fluide, colorée, lumineuse du mouvement pictural ».
Cet avoir lieu exact, depuis lequel cette phrase éclot, entre apparition et disparition, est en transfusion perpétuelle avec le reste du texte, proche ou lointain, situé dans ce livre ou dans d’autres avec lesquels cette phrase « dialogue », mais comme encapsulée dans la respiration du lecteur par cet emportement rythmique qui la retient entre son arrivée et son départ. C’est un autre aspect de cette écriture-phrase (qui la distingue en ce sens de ma première interprétation matissienne) : elle infuse étrangement dans la perception du lecteur (du moins celui que j’aurai été), dans une sorte d’accommodation de son souffle et d’ouverture simultanée du sens qui se produit alors. Barthes a une formule très juste pour nommer ce moment du passage, dans son Sollers écrivain (texte écrit pour saluer, entre autres, la publication de Paradis) : il faut que le lecteur rétablisse, dans son œil ou son souffle, la ponctuation. Et il ajoute : « la ponctuation, parfois, c’est comme un métronome bloqué ; défaites le corset, le sens explose ». Ce lieu de la phrase sollersienne, c’est donc là qu’il trouvera son sens, son point d’équilibre, son principe homéostatique, son éclat provisoire entre apparition et disparition.
Et même aujourd’hui, je trouve un écho direct de cette présence de la phrase sollersienne, en ce moment si particulier, à travers l’évocation qu’il fait de Gracian dans ses Voyageurs du temps – le « fabuleux, très bizarre, très lucide, fou et subtil, Baltazar Gracian, fleur inespérée des jésuites (1601-1658) », dont il tire cette idée : « au contraire, quelqu’un qui a véritablement été n’apparait véritablement qu’après sa disparition et sa mort. Personne n’apparait s’il ne disparait. On ne prend son parti qu’une fois parti ». Tout Sollers est là.
Et cette phrase, c’est bien sûr la lecture de Paradis qui m’en aura donné la mesure incalculable. J’ai découvert ce texte alors que je vivais à Casablanca, et je trouvai dans l’appel qu’il me lançait un écho direct de mon expérience de cette ville que je découvrais – une ville dont le désordre, les senteurs, les quartiers si différents, les ruptures et les enchainements de rues et de styles, d’époques et de commerces, d’industries et de bords de mer, entre lesquels des temporalités et des strates de l’histoire si lointaines les unes des autres s’étaient donné rendez-vous, un écho de cette fluidité de Paradis grâce auquel cette ville prenait forme, s’égalisait et se stabilisait dans son désordre même.
Mais il y aura eu aussi, rétrospectivement et après cette phrase, dont l’ivresse se déplace en continu entre l’œuvre et la vie de Sollers, certains de ses livres que j’aurai lu avec l’étrange sentiment d’une complicité immédiate. Ainsi de ce premier livre, à la destinée confuse, à la fois béni – adoubé par Mauriac, sublimé par Aragon – et banni par son auteur : Une curieuse solitude. Livre que je n’aurai cessé de lire et relire à une certaine époque (en même temps qu’un autre : la Préface à la vie d’écrivain de Flaubert – une partie de la correspondance de l’écrivain, principalement avec sa nièce Louise Colet –, paru, je crois, dans la collection Pierres Vives).
Pourquoi certains livres s’accrochent-ils avec une telle insistance à votre existence, vous obligeant à revenir vers eux sur le mode d’une addiction ? La lecture obsessionnelle de ce roman tient je crois au refus du pathos qui l’anime, qui le scande déjà de part en part, à son refus de la névrose, son refus de la maladie pourtant si présente (l’asthme) ; à la justesse de ses évocations de certains états de complicité, comme fraternellement éprouvés entre le narrateur et sa Béatrice, ou de gêne partagée sur le seuil d’une porte au moment des retrouvailles, avec sa Concha.
Certains moments de ce livre ont conservé, quand je le relis, leur éclat un peu militaire, en particulier quant à l’organisation de la vie du narrateur à Paris (où je venais de m’installer au moment où je l’ai lu, en 1969) : goût de l’organisation que je partage avec Sollers, mais qui coïncidait à la même époque, dans mon cas, avec certaines errances très tristes dans les rues de cette ville, certaines désillusions amoureuses, mais dont je rencontrais aussi l’écho dans ce livre, ce qui augmentait encore ce rôle d’attracteur étrange qu’il aura joué dans ma vie d’alors : « Les premiers temps, je préparai mes sorties avec la précision d’un explorateur ou d’un savant. Le jour que j’avais choisi, je voulais qu’il éclate de plaisir et que rien n’y soit abandonné, sauf au hasard ». Mais aussi, donc : « ces distractions ne durèrent pas longtemps. L’habitude (ou la condamnation) me fut bientôt infligée d’errer sans fin dans les rues, les cafés, ne pouvant me fixer nulle part, ni m’attacher, ni m’arrêter dans cette course. Tel, me croyant enfin quelque sublime inconnu et prenant plaisir à mon anonymat, je dédaignais la foule et m’en découvrais d’autant plus solidaire qu’elle me faisait plus isolé. » Les livres de Philippe Sollers auront ainsi fait plus que m’accompagner mentalement : ils auront scandé, comme pour l’assurer d’une certaine cohérence, ma propre vie pourtant géographiquement très dispersée entre plusieurs villes, la fluidifiant en une sorte de Continuum dont la pièce éponyme de Ligeti pourrait donner la mesure.
C’est que chaque rencontre avec un texte de Sollers me fut comme un rappel à l’ordre intime de ma propre existence : que je n’habitais, moi aussi, qu’une seule cité : la cité des Livres. Dans un étrange livre-entretien, organisé en séances para-psychanalytiques, avec Catherine Clément, Sollers déclare :
« Je suis très content d’avoir établi des relations raisonnables avec beaucoup de femmes. Cela n’arrive pas spontanément. Mais on y arrive, et c’est le travail même de la raison. En principe, chaque sexe veut la mort de l’autre. Or j’ai toujours été inflexible avec la névrose : résolument opposé à l’établissement de rapports névrotiques. Joyce disait : “mother’spacies dans father’s times”, en jouant sur l’ambiguïté du mot species, l’espèce, et space, en anglais, l’espace. » Idée que Sollers avait formulée dans son roman Femmes : « Le père-les-temps, la mère-les-espaces et l’espèce… Ou encore : le père qui tempe – et même qui temporise : la Mère qui ponctue et aménage les lieux et les habitants de ces lieux… Le Père-Son… La Mère-Image… Synchro difficile… représenter le temps, et le temps des temps, et ce qui bat de temps dans le temps ; être le compteur individuel mais universel ; incarner en passant dans l’espace le point de fuite de cet espace, ce n’est pas une petite affaire…Qu’est-ce qu’un père ? Silence… Embarras… bafouillages… Religions » (Femmes, p.209).
Pourtant, lui, l’homme du temps, de « la lumière du temps dans les voix », il aura su trouver justement dans certaines villes, certaines images de villes, le point de fuite des espaces que sa phrase n’aura cessé de traverser.
Il y eut d’abord les incroyables visions de Sollers à New York, suspendues entre les notes bleues de Miles Davis ou les witz de Thelonious Monk – qui, comme le dit quelque part Gérard Genette, s’y entendait (en dissonance inventive) – et la présence si vive, si réjouissante des Juifs américains dans cette ville (ces Vifs, comme dit Pascal Bacqué).
Mais il y eut aussi Venise, théâtre du plus éclatant des Sollers. Plus encore que dans sa Fête à Venise, c’est dans son Dictionnaire amoureux de Venise que j’ai pu mesurer à quel point Sollers fut un immense lecteur – un lecteur parfait des rencontres entre une ville et ses livres. Et je comprends mieux rétrospectivement comment et pourquoi, dans ses Voyageurs du temps, il évoque ce moment merveilleux où, à la nuit tombée, il rejoint son studio parisien pour se laisser submerger par la cité des Livres, et pour écrire lui-même.
Car Venise est une ville, sans doute la plus propice à ces points de fuite de l’espace dans le temps, que Marcel Proust a lui aussi merveilleusement saisis, comme le rappelle, avec une inégalable justesse, Sollers : « Ce sont les choses splendides (à Venise), qui y sont chargées de nous donner des impressions familières et quotidiennes ». Et dont le même Sollers nous donne sa propre version : « Je suis arrivé à Venise pour la première fois en 1963. En 1978, j’ai pris le bateau pour la Grèce. Le jour, la nuit, et les îles m’ont dit bien des choses. L’Acropole, le temple de Poséidon au cap Sounion, celui d’Athéna Aphaïa à Égine, aussi. Je suis revenu à Venise avec la certitude que, sous son masque, elle était le lieu de la continuation de la révélation grecque. Je n’ai pas changé d’avis. Venise est protégée par son masque ».
Ce Dictionnaire amoureux, loin de toute mélancolie, évoque une Venise vivante dont il s’agit d’accepter cette invitation permanente qu’elle nous lance à une fête de l’esprit, grâce aux livres qui la peuplent. Une ville vivante, mais comme le serait une vision insistante et suspendue entre le temps et l’éternité, et qui lui donne cet air de fragilité qui s’attache au rêve, que l’on entend jusque dans son nom. Cette fragilité, Sollers l’invite, par exemple, dans les Esquisses vénitiennes d’Henri de Régnier : « Venise, c’est… comme un verre fragile qui se casse, une soie qui se déchire. » Et il ajoute : « Aussi, est-ce l’esprit plein de ta présence que je suis revenu vers toi. La passe franchie, et dépassées les digues qui te défendent de la haute mer, du navire qui nous portait, je t’ai aperçue un matin. Était-ce bien toi ? Il me semblait, à mesure que nous approchions, que c’était ton souvenir qui te construisait à mes yeux. Tout ce que je souhaitais de toi se réalisait instantanément par un prodige qui me paraissait naturel. Bientôt tu fus là, tout entière, mais si merveilleuse et si fragile, sous un ciel transparent comme le cristal, que j’eus peur que tu ne fusses que l’image de mon illusion, évoquée là par la force de mon désir et dont la féérie, détruite au moindre choc, ne laisserait plus d’elle, au-dessus du miroir fendu de la lagune, que la vapeur vaine d’un nuage irisé. »
Ou encore, avec Ezra Pound, entr’aperçu, je crois, par Sollers lui-même, comme dans un rêve, un soir, disparaissant derrière un pont vénitien :
« Ô soleil vénitien,
Toi qui a nourri mes veines,
Ordonné le cours du sang,
Tu as appelé mon âme,
Du fond des lointains abîmes. »
Avec Sollers, la Venise de son Dictionnaire est cette ville qui nous devient accessible à travers le kaléidoscope de la fiction qui la porte, et qui détient, seule, les clés de la ville réelle. Il faut en passer par cette altérité d’un passé qui nous est devenu presque inaccessible autrement qu’à travers l’art et les livres, pour franchir, palier par palier, les portes d’un réel qui ne se révélera jamais que par défaut. L’art n’est pas ici la représentation de la ville, mais la porte d’entrée qui nous la rend accessible au présent de son passé. Et c’est pourquoi Sollers a raison de la nommer : Veni Etiam.



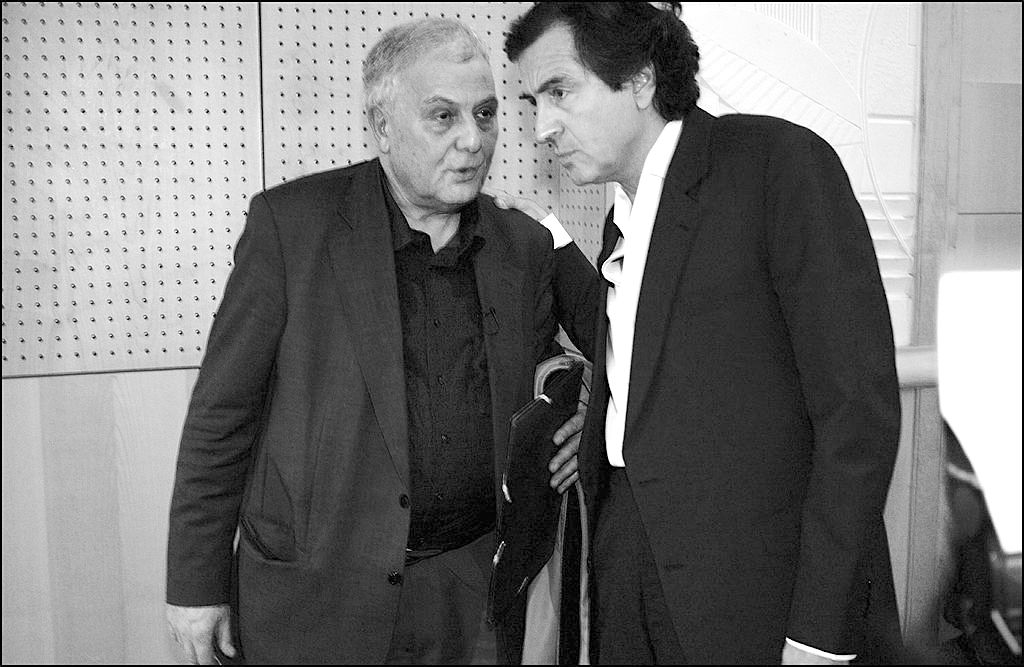



Philippe Sollers avait sans doute du talent mais il a aussi publié Gabriel Matzneff, écrivain pedophile. Philippe Sollers ne regrettait pas d’avoir publié Gabriel Matzneff, pire il minimisait ses actes pedophiles, nne regrettant pas de l’avoir publié ni d’avoir insulté à l’époque Denise Bombardier. https://pileface.com/sollers/spip.php?article2228&var_mode=calcul