Retour à New York après ces presque deux années de pandémie. Ville blessée. Ville mortifiée. Ville en train de ressusciter, mais encore loin de sa liberté unique et prodigieuse. Des masques partout. Des regards, chez les passants, d’anxiété et de méfiance. Dans mon hôtel préféré, les liftiers désuets, qui contribuaient au charme du lieu, sont cloués au sol et n’ont plus pour fonction que d’aider les maladroits à glisser leur clé magnétique sur le bouton de l’étage souhaité. Et au Temple Emanu-El, la première synagogue libérale de New York, dans cette salle immense où ils furent 2 000, avant le Covid, à venir rendre hommage à Claude Lanzmann, une audience plus clairsemée pour écouter l’auteur de The Will to See débattre avec la grande reportrice de guerre, rencontrée à l’époque de la Bosnie, Janine di Giovanni – et, avant cela, Henry Kissinger présenter, avec le patron historique de Google, Eric Schmidt, leur livre à quatre mains sur « l’âge de l’intelligence artificielle ». Les chiffres ne veulent rien dire, nous rassure le rabbin Joshua Davidson : les gens ont peur ; ils se confinent ; mais ils sont cinq fois plus nombreux à n’être pas, comme dit le Livre, « ici, aujourd’hui, avec nous » mais à nous écouter, en live stream, dans tous les États-Unis et au-delà. Un judaïsme Zoom ? Sans présence réelle ? Et, les soirs d’étude, plus de milhama chel Torah, de guerre de la Torah, autour d’un savoir partagé ? Ceci ne me console pas de cela. Mais tous les amis seront là, en revanche, pour découvrir le film à l’invitation de Jérémie Robert, consul général de France, et de Richard Plepler, le dernier producteur américain à sortir d’un roman de Scott Fitzgerald – n’est-ce pas sur la Riviera française qu’il a, par une tendre nuit, et tel un dernier tycoon, proposé à Lisa, sa femme, de l’épouser ? Et il y aura foule des grands jours pour assister à notre discussion, à la librairie Albertine, sous l’égide d’Octavian Report, avec Jonathan Tepperman, l’ancien rédacteur en chef de Foreign Policy et auteur d’un livre, hélas non traduit, sur le bon usage des grandes crises.
Le « docteur Kissinger » a 98 ans. Il est devenu tout petit. Tout fragile. Et ne détache plus les yeux, quand il se déplace, des roues d’un de ces déambulateurs qui ont envahi les rues de New York et sans lequel il ne sort plus. Mais il se souvient d’un dîner à Gdansk, il y a quinze ans, avec un Lech Walesa ivre mort ; à Paris, il y a trente ans, chez un Jean-Luc Lagardère qui, encore immortel, s’amusait à nous opposer en tout ; il se souvient même, en 1978, au moment de la sortie américaine de La Barbarie à visage humain, de notre première rencontre, à l’hôtel The Hay-Adams, à Washington, avec Marty Peretz, alors propriétaire du très mythologique New Republic, où je l’avais saoulé de mes théories de jeune normalien cuistre sur le philosophe-roi selon Platon. Et, devant cette mémoire totale, ce désir de savoir inentamé, cette joie d’être encore consulté comme l’oracle qu’il n’a jamais vraiment été, on lui pardonne tout : la Chine, le Bangladesh, la realpolitik considérée comme un des beaux-arts, le Chili, les généralités qu’il profère, tel un Norpois proustien, sur l’Occident en déclin, l’Orient compliqué ou la faillite mondiale du leadership – ainsi que ce jour, à Baltimore, où nous étions venus, avec Christopher Hitchens , perturber sa conférence et où il n’avait pas hésité à nous faire évacuer par la force. Soudain, je pense à Hitchens. J’ai la nostalgie de ses provocations magnifiques, de ses beuveries folles et de l’indomptable énergie avec laquelle il tenait, lui, l’homme de gauche, la ligne du droit d’ingérence, de l’interventionnisme humanitaire et politique, et de cet universalisme lumineux qui était déjà la réponse à la frilosité du wokisme naissant. Bien sûr qu’il était anglais : mais ne fut-il pas, comme Edgar Poe selon Baudelaire, l’un des Américains les plus poétiques qu’il ait été donné de rencontrer ?
Le rabbin Arthur Schneier, lui aussi, est très vieux. Il préside aux destinées de la Park East Synagogue qui est, soit dit en passant, la congrégation de Kissinger, et il n’a, comme en témoigne son récent conflit avec son jeune adjoint, le rabbin Benjamin Goldschmidt (qui s’est soldé par le vidage pur et simple de celui-ci), aucune intention de dételer. La presse est pleine de cette histoire. Je n’arrive pas bien à savoir si elle jouit du spectacle du vieux Lion fatigué, mais indétrôné et toujours rugissant. Ou si elle est fatiguée, au contraire, de l’activisme d’un pasteur hors normes que l’on voit, depuis cinquante ans, discuter un jour du Pakistan avec Nixon ; un autre de la crise des otages avec Carter ; un autre encore des migrants avec Mme Merkel, du Tibet avec Xi Jinping ou recevoir, en sa demeure, le pape Benoît XVI… Y a-t-il un autre pays au monde où une guerre de succession entre rabbins ferait ainsi la une des journaux ? Pour l’heure, c’est, ici, le premier vrai dîner de shabbat depuis la pandémie. Les gens, peut-être parce qu’ils sont plus religieux, sont venus, cette fois, nombreux et la salle à manger est pleine à craquer. Les chants sont joyeux. L’appel, par le doyen de l’assemblée, des noms des nouveaux entrants dans le sein de la communauté est poignant. La voix du rabbin Schneier, quand il prend, sans micro, la parole pour dire que ce 5 novembre se trouve être le jour de mon anniversaire ainsi que, cinquante ans plus tard, par un impénétrable tour du destin, la nuit de la mort de mon père, est redevenue forte, impérieuse et pleine d’une vigueur que l’on pensait enfuie. Et je ne suis finalement pas fâché que le hasard – mais y a-t-il, en ces matières, des hasards ? – m’ait fait conclure ici, en cette compagnie, un tour américain dont le point d’orgue sera ce moment très étrange de recueillement et de communion.


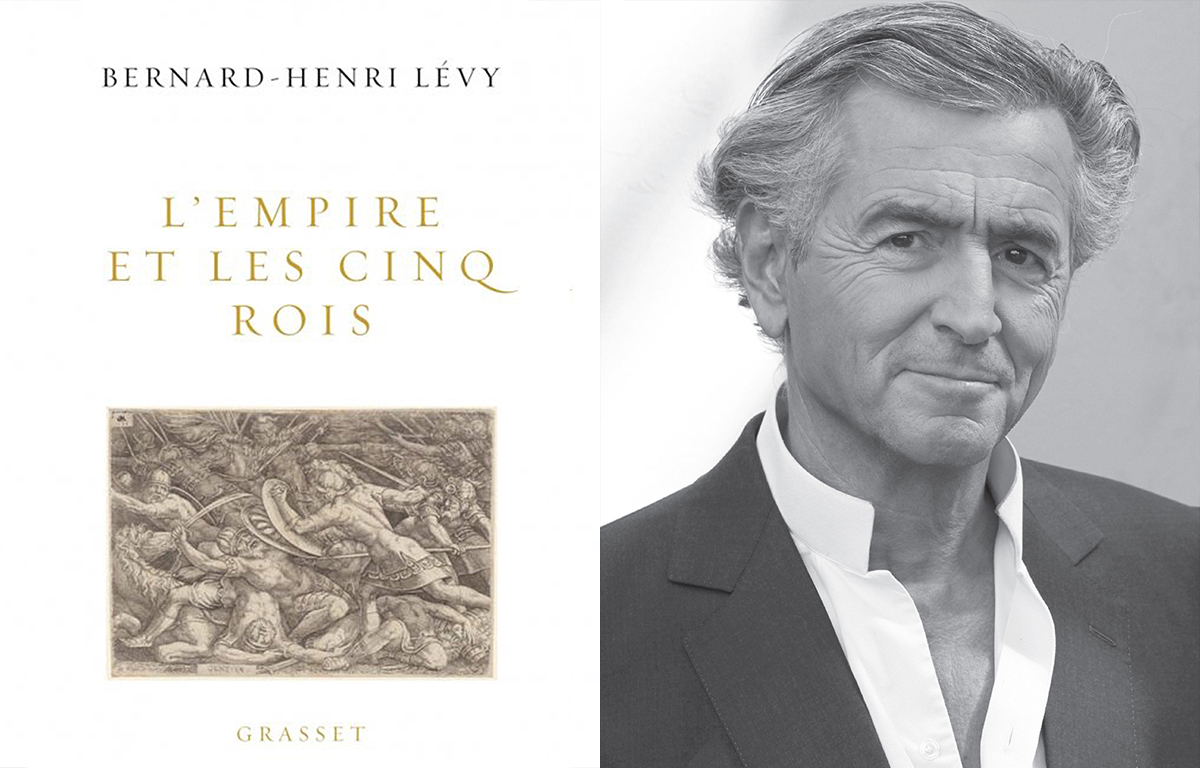





Le tribunal du Saint-Office de l’Intersection condamne les agents de pénétration de la police de Sa Majesté pour avoir infiltré, sans demander a priori la permission aux mouvances concernées, les marges d’un échiquier politique radical sur les bords, zones révolutionnaires dans lesquelles la lutte armée n’est jamais totalement exclue, et quand on parle de guerre sous l’empire décolonial, on ne pense pas spontanément à une ligne de front de chaque côté de laquelle des soldats se seraient vu accorder une chance équivalente de réchapper des tirs ennemis.
Le soutirage d’informations sur l’oreiller est un classique de l’espionnage. Ce n’est donc pas pour avoir parfaitement exécuté sa mission, mais pour l’avoir foirée que Mark Kennedy, alias Mark Stone, aurait tout lieu de contrarier le troisième pouvoir du royaume.
En effet, si la Cour royale de justice condamnait l’espion d’un État étranger, l’agent infiltré qu’elle aurait démasqué ne pourrait s’en prendre qu’à lui-même.
Il savait à quoi s’attendre en acceptant sa mission à haut risque.
Il sait qu’en cas de capture, il devra nier les accusations, tout comme sa hiérarchie qui, dans le meilleur des cas, refilera la patate chaude à un ministre des Affaires étrangères contraint de rehausser d’un cran la déraison d’État, clamant que son ressortissant est victime d’une terrible erreur judiciaire.
Mais nous ne sommes pas en train de digresser pour soutenir la juridiction d’un État qui protégerait ce même État contre les coups bas qu’un autre État lui porterait. Nous assistons en revanche aux errements d’une démocratie qui se tire une balle dans le pied alors même que le nécessaire contrôle d’un pouvoir par les autres s’y transforme en guerre civile institutionnelle et condamne son régime à l’impuissance : du système comme version la plus aboutie de l’antisystème.
On a vu des courant radicaux jouer le jeu de la démocratie, parfois dans l’espoir d’opérer un renversement en douceur, confortés par un suffrage majoritaire qui leur garderait un chien de sa chienne, tandis que les vaincus prendraient le maquis afin de ressusciter cette sublime démocratie, que le Démocrateur aurait persuadée de se pendre avec sa propre corde.
Cela dit, on ne peut pas écarter la possibilité qu’une partie de la famille rebelle n’ait d’extrême que la volonté de faire turbuler un système lénifiant, dont elle louerait au demeurant le pluralisme intrinsèque.
Dont acte. Pourquoi alors être scandalisé que des services ayant en charge la sécurité intérieure de son propre pays, aident le garant des libertés à se débarrasser des tentations totalitaires qui œuvrent à pervertir sa noble cause ?
La police d’un État de droit n’est pas un instrument antidémocratique. Preuve en sont les divagations truffées de faux témoignages présentés comme irréfutables que diffusent des conspirationnistes niant l’existence de la Shoah, la réussite de la mission Apollo 11, le caractère islamiste des attaques du 11 septembre 2001, l’innocuité des vaccins à ARN messager. L’État de droit assure la liberté d’expression de tous, y compris celle des ahurissants et de leurs ahuris.
Sauf qu’il y a des limites à tout. L’État de droit ne confère pas à ceux-là mêmes auxquels il garantit un plein exercice des libertés inhérentes à leur être, celle de priver autrui d’un droit résidant au fondement du contrat social.
Or c’est bien ce que s’apprête à faire celle ou celui que sa propre colère, fût-elle justifiée, pousse à commettre un acte de terrorisme aveugle, autrement dit, celui ou celle qu’a pour mission d’approcher une taupe de la police britannique ou française.
Afin que l’Occident demeure ce laboratoire humaniste où des principes universels assurent la coexistence pacifique de représentants de l’humanité issus de toute ethnie et de toute civilisation, sachant que celles-ci n’ont jamais été conçues pour se recouper mais dans l’optique de nous hisser à la hauteur d’un idéal qui nous transcenderait, il est urgent que les institutions judiciaires de nos démocraties représentatives n’échappent pas à la règle qui veut qu’un pouvoir, quel qu’il soit, puisse rendre compte de ses actes devant le peuple.
On ne demande pas à la justice de rétablir la justice, mais d’établir la vérité des faits. Or les faits ne sont pas par essence contraires aux apparences.
Quand un homme aveuglé par la haine, (de surcroît) sous l’emprise d’un stupéfiant, traverse l’appartement d’une famille qu’il choisit d’épargner pour enjamber la fenêtre d’une voisine qu’il racise, de manière à la démoniser pour son appartenance raciale et ainsi avoir toute latitude pour la détruire, avant de la défenestrer, le tout au nom d’Allah, il n’y a rien d’évident à ce que l’opprimé soit l’assassin et l’oppresseur sa victime.
Les origines sociales modestes d’un Français libre ne présupposent pas un engagement irréfléchi ou un élan grégaire, mais le libre choix de répondre à un appel dont l’influence, pour autant qu’elle fût considérable, n’a pas anéanti son libre arbitre mais, bien au contraire, l’a sollicité.
En cela, la démocratie mérite mieux qu’une interprétation hypersocialisante du droit pénal. Quant à sa représentation idoine, elle va devoir utiliser l’étroit pouvoir dont elle dispose face à un tribunal de l’opinion qui n’a jamais été aussi inflammable et commode à étouffer, ou au gouvernement que seraient parfois tentés d’instaurer des petits juges en roue libre qui, à trop côtoyer les articles de loi, jureraient les avoir rédigés eux-mêmes au nom d’un peuple inconséquent, qui estimerait plus judicieux de leur confier l’immense pouvoir de conduire à sa place une juste politique, dès lors qu’eux seuls auraient été habilités à en fixer la ligne unique, droite et jubilatoire.