J’ai connu Jean-Claude Fasquelle il y a presque exactement cinquante ans.
Il était svelte.
Fantasque.
Aussi fêtard que lettré.
Non moins noceur qu’éditeur.
Il était bavard, mais oui, très bavard, et même assez éloquent.
La première fois que je l’ai vu, en haut du grand escalier de bois de Grasset que l’on gravissait, le cœur battant, tel un Olympe, il n’avait pas encore cette majesté de burgrave, ou d’homéride, qui intimida, plus tard, ses auteurs les plus jeunes.
C’était un fils de famille, que m’avait présenté Jean-Edern Hallier, et qui hésitait encore entre les hussards et les maos, Jacques Laurent et Jean-François Bizot.
Et il était si aimablement doté par toutes les fortunes, à commencer par celle de l’amour et de son éternelle fiancée, la lumineuse Nicky Jegher, que je ne suis pas sûr qu’il ait, en ce temps-là, tant voulu que cela être roi, ou pape, ou même cardinal des lettres.
Ou oui, peut-être, mais à la façon du cardinal de Bernis retouché par son copain Roger Vailland.
Et puis, un beau matin, le petit prince s’est converti.
Je ne saurais dire, même si je le voyais alors tous les jours, ce qui s’est opéré en lui.
Peut-être le départ de Françoise Verny, qui fut longtemps sa régente ?
Peut-être, un peu avant, celui de Bernard Privat, son prédécesseur à la tête de Grasset, que son propre oncle, l’armateur marseillais Francis Fabre, était venu trouver pour lui dire : « ne confiez jamais les rênes de votre Maison à mon neveu Jean-Claude – c’est un dilettante ! ».
Toujours est-il qu’il a fini par croire qu’il n’y a rien de plus grand, en ce monde, qu’un grand livre.
Il est entré en édition comme on entre en religion.
Il est devenu moine-éditeur comme on dit moine-soldat.
Et, non content de faire de Grasset le repaire de quelques-uns des bons écrivains de l’époque, il a transformé sa propre demeure du square Vergennes, à Paris, puis son auberge espagnole de Cadaqués, en maisons joyeuses et hantées, annexes de Grasset, où ces enfants géants que sont souvent les écrivains savaient pouvoir trouver, à toute heure du jour, tous les jours de l’année, un conseil, un réconfort et parfois, tout simplement, le courage de ne pas renoncer.
Je me souviens des oursins qu’il allait acheter, de bon matin, sur le marché de Cadaqués et qu’il allait déposer sur un rocher peu profond où les plus mélancoliques d’entre nous allaient pouvoir s’extasier, brandissant leur épuisette et leur tuba comme un signe des dieux : « j’ai pêché ! j’ai pêché ! ».
Je me souviens de la saison des prix d’automne qu’il vivait, selon les années, comme une marche des aigles ou un Waterloo provisoire et dont Edmonde Charles-Roux ou cette autre jurée qui siégeait, elle, au Femina et que l’on appelait simplement « la duchesse » (entendre : la duchesse de La Rochefoucauld, sa première belle-mère) venaient, livides, échevelées, après le déjeuner du vote, lui rapporter les kriegspiels ou les barouds d’honneur.
Et je me souviens qu’il a fait de Grasset, non pas, comme on l’a trop dit, un gang, une bande, ou un pack de rugby, mais une compagnie de mousquetaires lancée dans la seule guerre qui, pour lui, comptât et qui était la lutte pour la vie des écrivains.
Jean-Claude est devenu un stratège immobile.
Un enragé de sang-froid.
Et un éditeur de cape et d’épée.
C’est à ce moment-là que Jean-Claude s’est tu.
Il a cessé de parler pour que parlent ses écrivains.
Il est devenu un virtuose du silence parce qu’il a préféré les écouter et prêter l’oreille à leurs mots.
Et, quand il se disait dur d’une oreille, c’était pour mieux laisser sa troisième oreille, la vraie, entendre ce qu’avaient en partage Gabo et Eco, Maurice Clavel et les premières écrivaines féministes contemporaines (Gisèle Halimi, Annie Leclerc, Christiane Rochefort…), dont on ne sait pas assez que c’est Grasset qui les a publiées.
Derrière ses lunettes perpétuellement embuées, il avait l’œil aussi prompt qu’un romancier.
Quand on lui lisait à voix haute, comme je le faisais, un manuscrit naissant, il semblait parfois s’assoupir : mais c’était, comme son ami Lucien Bodard, l’autre sphinx de la rue des Saints-Pères, pour vous en restituer ensuite la plus infime nuance.
Et il était long de mémoire, expert en transactions secrètes connues de lui seul et de quelques historiens de l’édition : un jour, il convoquait le fantôme d’Émile Zola pour éconduire celui de Maurice Barrès ; un autre, on le sentait à l’écoute d’une musique antérieure qui donnait une cadence étrange à sa lecture ; et il n’aimait rien tant, à l’inverse des surréalistes, que ressusciter un cadavre (Le Sagittaire, premier éditeur des deux André, Malraux et Breton, qu’il relança en 1975), mettre à l’étrier le pied d’un jeune proustien de soixante et quelques années (Bernard de Fallois qu’il aida à fonder, en 1987, les éditions du même nom) – et cet ultime épisode : à la toute fin de sa vie, avec l’éditrice italienne Elisabetta Sgarbi, il cofonde la Nave di Teseo, sa dernière Maison et réincarne ainsi un peu de la légende du mystérieux milliardaire rouge Giangiacomo Feltrinelli…
C’était tout cela, au XXe siècle, un grand éditeur.
Nous sommes encore quelques-uns à lui devoir le moment de notre baptême.




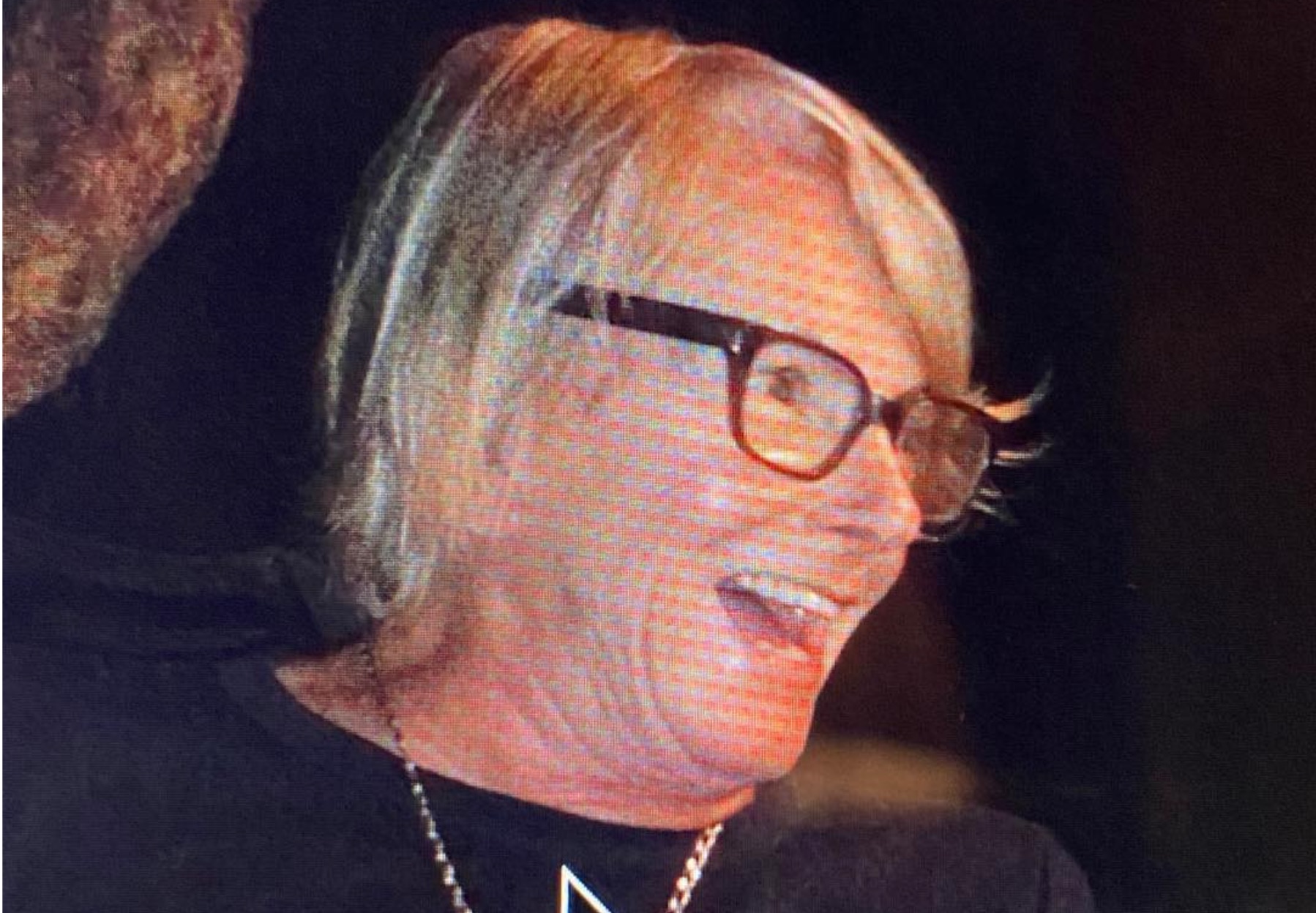



Bonsoir, j’ai relu hier soir avec plaisir votre texte « une tragédie nommée Gary » inclus dans Pièces d’identité. J’aurais aimé savoir ce que Jean-Claude Fasquelle pensait de l’affaire Gary/Ajar. Bien cordialement, AH.