Et si tous les événements actuels n’étaient que le reflet d’un dérèglement de notre rapport au temps ? Ces dernières années, le monde ne semblait reposer que sur un désir vertigineux de vitesse ; quelque fut le sens du mouvement, il fallait aller encore/ toujours plus vite. La crise sanitaire liée au Covid-19 a tout à coup mis en relief la fragilité des principes qui régissent nos sociétés. Que ce soit sur le plan politique, économique ou social, le monde vacille et cette situation contribue à accentuer les sentiments de confusion, de doute et d’incompréhension qui nous habitent : l’incertitude engendre le déséquilibre. Les mesures sanitaires prises pour combattre cette pandémie trahissent elles aussi la confusion d’une société qui oscille entre confinement et déconfinement, entre arrêt et reprise totale ou partielle des activités. Comment trouver sa voie et une certaine stabilité dans un monde en crise ? Les patients que je reçois en consultation sont sidérés par les événements qu’ils vivent. Certains d’entre eux ont tellement de mal à organiser leur quotidien qu’ils n’arrivent même pas à se projeter vers un quelconque horizon. Chacun d’entre nous semble vivre au jour le jour dans l’incertitude, et il est probable que, passé cet état de sidération, certains patients en souffrance psychique nécessiteront une prise en charge plus adaptée en milieu spécialisé. Dans un entretien au Financial Times, Anthony Fauci, le directeur de l’Institut américain des allergies et des maladies infectieuses, évoque une « extrême confusion » générée par le coronavirus qui plonge le monde dans une « parfaite tempête ». Il attribue cet état au fait que le Sars-CoV-2 présente une symptomatologie polymorphe affectant de manière très différente les personnes atteintes : certaines sont totalement asymptomatiques tandis que d’autres sont hospitalisées et doivent avoir recours à une assistance respiratoire. Il le formule ainsi :
« Je n’ai jamais vu de virus ou d’agent pathogène présentant un si large éventail de manifestations ». C’est en effet la première fois que nous sommes confrontés à une maladie qui est difficilement rattachable à un tableau clinique parfaitement clair. Est-ce une fois encore le reflet d’un monde de plus en plus incertain dans lequel même le pathologique présente des formes qu’il est difficile d’objectiver ? Maïmonide explique dans son Guide des égarés (I-2) que la faute d’Adam a mené l’homme vers une connaissance relative alors qu’il était originellement doté d’une compréhension intellectuelle parfaite, lui permettant de distinguer le vrai du faux.En mangeant du fruit de l’arbre défendu, il a perdu cette aptitude intellectuelle liée à la raison, aux choses intelligibles ; il ne peut qu’apprécier des notions subjectives qui le font entrer dans l’ère du doute, de l’indécision. Pour essayer d’inscrire le monde dans un processus de réparation, il doit s’astreindre à considérer la vie comme un itinéraire qui ne commence réellement qu’à partir de l’instant où il tente de lui donner du sens. Dès les premiers chapitres de la Genèse, la Bible raconte ce désir de mouvement des hommes. On suit les déplacements des descendants de Sem, fils de Noé, qui visent à suivre la trajectoire du soleil pour se diriger vers l’occident. Plus tard, les hébreux, sauvés de la servitude égyptienne, entreprennent un long et périlleux voyage en quarante-deux étapes pour les mener de l’exil vers la terre promise. L’analyse du texte des Nombres (chapitre 33 – verset 2) qui relate ce périple permet de constater qu’il y a deux approches de la vie, l’une qui est rythmée par une intensité existentielle et qui vise à donner du sens à son quotidien et une autre, motivée par le seul désir du mouvement pour le mouvement avec le risque inhérent d’une insatisfaction croissante liée à la nature finie de l’homme. Comme l’explique Benjamin Gross dans son ouvrage Choisir la vie : « La question essentielle, celle qui commande le comportement des hommes, est en effet celle des limites. Elle implique la difficile nécessité de savoir ce qu’est l’homme et quel est le sens de son devenir ? » La réponse se situe dans une approche différente de la vie, de la façon d’appréhender le temps, ou encore de la manière de conceptualiser la vérité. Il faut parvenir à une dynamique qui soit orientée vers un surplus d’être, seule voie qui mène en ces temps difficiles vers une espérance renouvelée. La vie, par moments, peut être empreinte de désespoir mais il faut tenter de transformer un événement douloureux en une source d’énergie vitale. La plus grande jouissance selon Rabbi Nahman de Braslav, c’est d’être en mesure de transformer une influence négative en une source d’événements positifs – une idée que le poète Edmond Jabès exprimait ainsi dans son Livre des marges :« Il y a des limites au désespoir. Il n’y a pas de limites à l’espérance. »
Ariel Toledano est médecin. Il enseigne l’histoire de la médecine à l’université Paris Descartes. Réflexions talmudiques par temps d’épidémie est son dernier ouvrage paru aux éditions In Press en juin 2020.




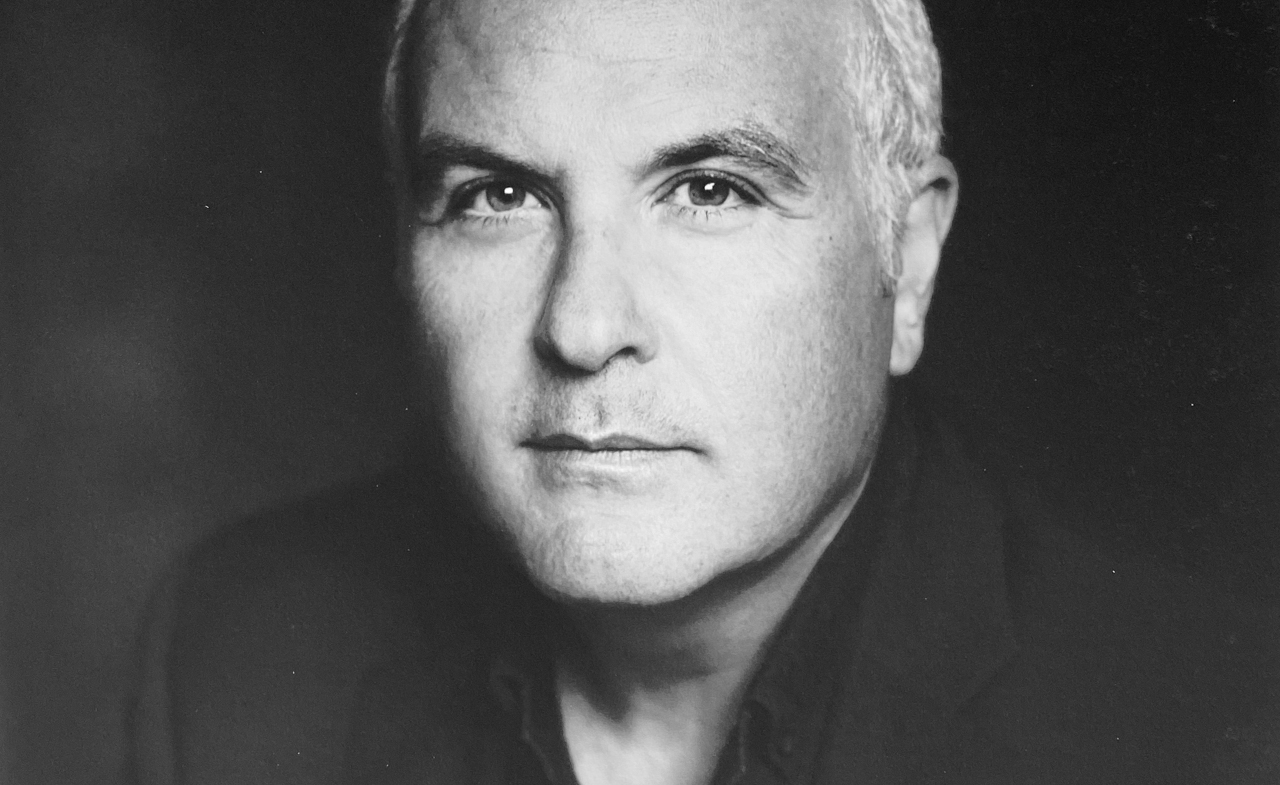



Celles et ceux qui prônèrent la normalisation des relations médiatiques avec tel ou tel partisan d’une idéologie visant à initier, par les voies de la démocratie, une refonte fascisante de l’État de droit, nourrissent encore ce sentiment d’impunité qui incite les petites éponges métalliques du récurage déculturel à passer à l’action en vue d’accroître l’étendue de leur champ d’influence.
Il existe au moins deux façons de réduire en poussière un monde dont l’édification fait de l’ombre aux déificateurs de l’étoile dans le système de laquelle nous dûmes nous cantonner aux désorbitations anales — pour toute contestation, s’adresser au Dr SF — ou de cette boule de débris lunaires qui nous convaincrait à l’occase que l’univers nous tourne autour. La première consiste à renvoyer la Terre six pieds au-dessous d’elle-même. La seconde se concentre sur la production de l’esprit des seuls animaux terrestres dont il est dit qu’ils sont livrés à l’origine avec âme intégrée, chose qui reste à prouver.
Les guerres furent de tout temps, conventionnelles et non-conventionnelles ; notre Troisième Guerre mondiale n’échappe pas à la règle. Par chance, le terrorisme est le coucou des modes de combat. Trop obsédé par son désir de détruire tout ce qui bouge, il se montre incapable de créer même un virus mortel. Si, en revanche, cette arme de destruction aléatoire lui offrait l’opportunité de plonger dans une crise de panique collective ces États-membres de la Commune ôtée qui eurent la chance de se hisser au rang de grandes puissances économiques, il s’emploierait à ce que la chair à Flash-Ball de la Lutte inachevable se conduise en vecteur efficace de la pandémie. Celle-ci répondant à de multiples causes, les stigmatophobes marqués à leur propre fer rouge auraient des arguments à se mettre sous la dent, qu’ils ne manqueraient pas d’enfoncer dans le gosier des oisillons de proie dont nous ne partagerons jamais le nid, — chacun son culte.
Ce n’est pas une question ethno-racialisante ou ethno-religiosifiante ; il suffit de quitter Paris quelques heures pour voir combien l’uniforme Blauer Block est parvenu à débalkaniser, du moins en surface, le prolétariat polymorphe des quartiers les plus perméables aux théories conspirationnistes. Les derniers récalcitrants s’illustreraient plutôt par une posture antisystème qu’il faudrait encore subdiviser en deux catégories distinctes : 1) une défiance vis-à-vis d’une probable manipulation d’État visant à faire rentrer dans le rang les enragés sociaux les plus durs à museler ; 2) un mépris répercussif envers la vie de ses semblables dont la mort sociale ne passerait plus aussi aisément sous le boisseau dès lors qu’elle se serait convertie en mort clinique.
On pourrait en rester là, mais la situation n’en serait pas moins outrancièrement préoccupante. Aussi est-il à craindre que notre descente aux Enfers sociétaux ne se poursuive en se scindant en une fourche d’affront pour le moins diabolique, puisqu’elle nous forcerait à choisir entre le désespoir suicidaire comme seule échappatoire à l’asceptisation civilisationnelle et l’espoir trucidaire de causer le plus grand nombre de contaminés possibles en qualité de porteur sain d’une arme bactériologique.
Je ne vous dirai pas si, d’après moi, l’État en fait trop ou pas assez face au risque de résurgence du virus absolutiste ; ce n’est pas mon sujet. En outre, mon incertitude quant au fait que l’agrégation des pulsions agressives de notre humus commun et leur libération par un agent mortel insaisissable et quasi invincible concerne 1 ou 0, 001 % d’une population, n’atténue que très moyennement mon amertume, sachant qu’un phénomène atteignant ce niveau de nocivité, s’il était avéré, serait d’autant moins éludable qu’il nous mouillerait jusqu’au cou.
Comme dirait l’Autre, nous aurons peut-être un jour la confirmation qu’un protocole de neutralisation de l’empereur Néocoronavirus était à notre disposition depuis le tout début de l’épidémie. En attendant de pouvoir célébrer la victoire dans une cacophonie de liesses provisoirement roboratives, nous sommes bien forcés de nous raccrocher aux protocoles en vigueur — principe de précaution oblige — qui ne nous permettent pas d’établir l’innocuité du traitement non suscité, pas plus d’ailleurs que son ivrogne nocuité. CQFD (D pour disculper).