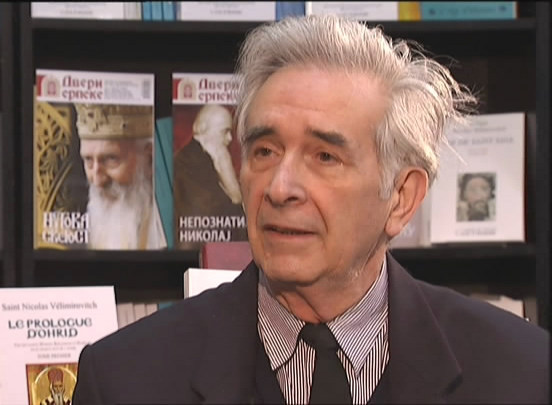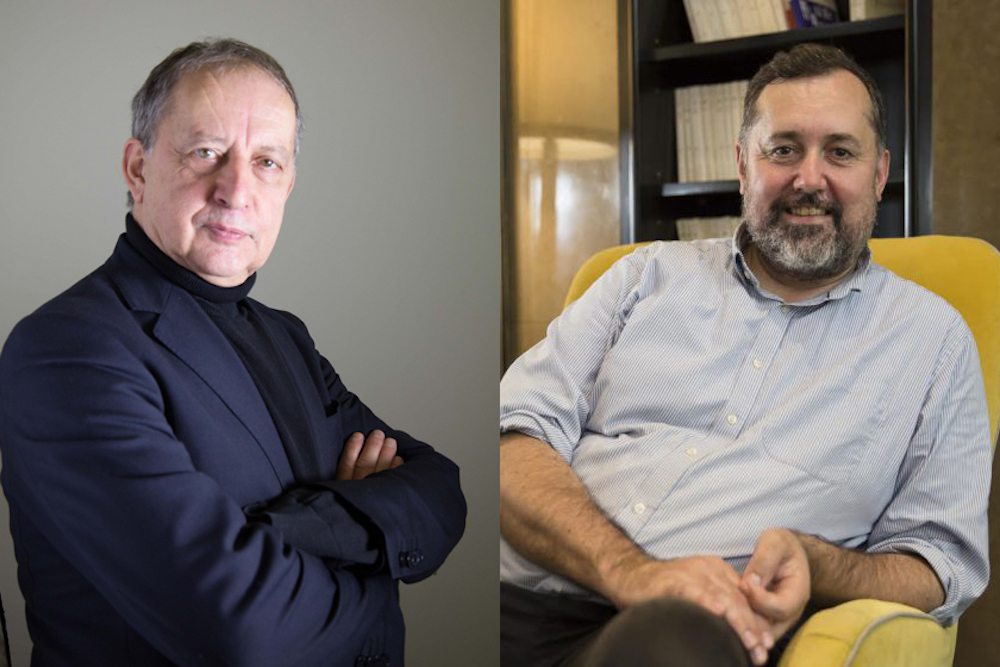Il était courant, dans les cercles littéraires des dernières avant-gardes du siècle écoulé, de professer qu’écrire devait non seulement s’entendre comme un acte intransitif, mais devait aussi s’éprouver comme un geste porté par la plus haute nécessité. C’était un temps où on lisait Maurice Blanchot, Louis-René des Forêts, Claude Simon et quelques autres. C’est cette même nécessité qui, aujourd’hui, nous donne Le Père de Gabriel[1], ce livre de Pascal Bacqué, que certains grands noms incontestables ont pu qualifier d’étonnant, quand d’autres ont constaté qu’il «était écrit» (au sens en somme intransitif que l’on vient d’évoquer).
Sa structure étrange le propulse à la fois en avant et en arrière de lui-même – structure qui ménage ainsi une ouverture, un vide, en son centre de gravité, une faille dans laquelle peut s’engouffrer ce qu’il faut bien nommer le pur présent sans reste d’une langue rendue à son génie propre – parce que plus aucune balise de sécurité fixée par les usages, les genres, ou les règles en vigueur dans la république des lettres, les tics de l’époque, ou les boursouflures, gonflées à l’instagramium, du moi contemporain, ne viendront désormais la brider.
Non que son auteur ignore ces règles, ces usages ou ces genres : il les connaît mieux que personne, et, dans ce livre même, certain personnage, tel l’oncle Soufre, ne se prive pas de les lui rappeler. Mais ces repères ont fini par corseter à ce point la langue qu’elle en est devenue transparente à elle-même, privée d’opacité, comme d’ailleurs toute son époque, et qu’il faut lui rendre son énigme.
Sa liberté, son inventivité, elle a fini par les perdre, en particulier dans le genre roman, car «Roman, cela veut dire une langue, dérivée du latin, qui depuis son premier jour attend son dernier jour, sachant trop, pour être l’enfant de la langue de Rome, qu’elle est faite pour finir ainsi que tout ce qui naît, sous le soleil, en dernier.»
De quoi s’agit-il alors ? D’un anti-roman, d’une autobiographie, d’une autofiction comme il s’en produit ad nauseam à chaque rentrée littéraire ? D’autre chose. D’un poème ? Vous approchez, mais, non, vous n’y êtes pas encore (voyez comment l’auteur traite Char).
De l’oraison funèbre adressée à un père, et prononcée par un fils scribouillard sur la tombe du défunt, où se trouve rassemblée la famille après la cérémonie des obsèques, puis du récit de la conversion de ce fils d’une famille catholique au judaïsme.
Entre ces deux termes, le texte s’étire, ou plutôt se trouve en s’étirant (comme un corps au réveil), au sens où il établit sa force motrice d’écriture des deux côtés du temps entre lesquels il se déplace : du côté du rappel de la figure de ce père, telle que suggérée pendant l’oraison funèbre, et du côté de la progressive mais nécessaire conversion du fils au judaïsme, à l’étude, à l’écriture, c’est à dire au sens et à la forme, suggérés eux aussi pendant cette même oraison, et finalement secrètement approuvés eux aussi, comme on le verra, par le père.
Si bien que ces mots prononcée à l’enterrement se dévoilent progressivement comme tout autre chose que le simple prologue d’un livre à venir : ils portent déjà, en puissance, en attente, l’énigme de ce livre qui viendra juste après, comme accomplissement de cette parole prononcée juste avant : que dit-il, le fils, à ce moment-là ?
«Dans la Genèse, au chapitre 2, on dit que l’homme a été façonné à partir de la poussière de la terre. Mais au chapitre 1, dans le même livre, on dit aussi que l’homme a été créé ; eh bien cette création du chapitre 1 n’a rien à voir avec le façonnement du chapitre 2, parce que la création ne regarde pas la matière, mais la forme. La matière est corruptible, mais pas la forme. Dire votre bien, c’est dire cette forme, c’est dire ce qui ne meurt pas, car ce n’est pas mortel. Cette forme, résumée par la formule mystérieuse « à l’image de Dieu Il le créa », est une grande énigme, bien sûr. Nous n’allons pas la résoudre aujourd’hui. Mais comme un rayon lumineux, qui certes éblouit, se divise en un spectre de couleurs quand traverse notre atmosphère, l’énigme se diffracte en ses harmoniques.»
Le livre qui suit actualise cette promesse d’incorruptibilité contenue dans le chapitre 2 et prononcée par le fils devant la tombe, l’énigme de ce façonnement de la création, à laquelle il répond par l’énigme de sa propre forme diffractée à travers les images du père, et c’est en ce sens-là que c’est un livre grave, porté par cette nécessité dont on parlait : car il est l’oeuvre même de cette promesse d’éternité, l’œuvre de cette énigme de la forme rappelée, dans une sorte de rassemblement supérieur à celui de la liturgie, à sa famille par ce fils qu’on aurait tort de juger indigne – lequel par respect du rituel de la nouvelle religion dont il se veut un pratiquant orthodoxe, s’interdit l’entrée dans l’église (ce que lui reprochera, du haut de son intellectualisme sentencieux l’oncle Soufre, déjà cité).
Pour le dire dans les termes des sciences du langage de l’époque à laquelle je faisais référence, le texte de l’oraison serait ici le «génotexte», dont le texte qui suit serait le «phénotexte», ou, si l’on veut : l’un serait en puissance, l’autre en acte. Leur entrelacement paradoxal dans ce livre est une bouffée d’oxygène, ou une bouée de sauvetage lancée à cette langue en péril dans l’océan des Lettres, portée par le mouvement même de cette langue autre qui s’avance vers son passé le plus lointain, celui des commandements de la Tora.
Mais c’est en s’avançant vers sa nouvelle religion de l’écriture, que, par ce livre, se construit rétrospectivement, comme à rebours, le personnage de ce père, qui, contrairement à l’image consacrée d’autorité que son statut de grand serviteur de l’armée lui attache, se révèle bien plus ouvert à l’aventure poétique du fils que plusieurs membres de la famille (ce père, qui saura se taire, c’est-à-dire lui donner son entière approbation, quand le fils annoncera à sa famille dépitée qu’il renonce à son hypokhâgne, pour se consacrer à l’aventure de la poésie).
C’est donc d’un même mouvement que le texte respire, de repli vers l’intérieur de ce qui fut, et de déploiement vers l’extérieur de ce qui vient, et dans lequel il puise son souffle : entre «l’inspiration», que le fils doit à ce père, qui aura su lui apprendre à marcher de son propre pas à lui, le fils, c’est-à-dire à déplier ce corps que Gabriel dit maladroit, en le prenant par la main (et la bienveillance de ce père, la douceur, la grâce, et le rythme régulier de ces pas formés sur ceux du fils, accompagneront celui-ci jusqu’au dernier, pour le guider secrètement vers ces arts mentaux qu’il pratique déjà, plutôt que vers les arts martiaux – le simple vélo est tout un sport de combat de la route et du guidon qui le pétrifie), et «l’expiration», comme libération de la Tora à même son corps et ses gestes – langage, rythme approbateur du monde en quoi consiste cette étude juive comme écriture infiniment recommencée à laquelle aspire le fils et qui était déjà là, en lui, comme il l’avait toujours su.
Car tout cela n’est jamais qu’une affaire de corps plus encore que d’esprit. Et c’est en ce point que surgit la figure de Benny Levy, et que s’ouvre, à rebours de toutes ces formes apprises dans l’ennui des salles de classe, un autre chemin au langage et à la pensée (la phrase décisive, dans ce basculement, est prononcée par Benny Levy, d’ailleurs sur un chemin de campagne qu’il arpente en compagnie de Pascal B : «Si tu deviens juif, ton père et ta mère ne sont plus ton père et ta mère.»).
Il deviendra juif, car, cette judéité, il l’éprouve avec une intensité croissante au fur et à mesure qu’il la découvre, mais comme quelque chose de déjà engrammé au plus profond de lui-même. Si bien que ce corps qui se disait malhabile, parce que rétif à cet enfermement des savoirs et des apprentissages que l’on se contente de rabâcher dans sa tête et dans les salles de classe, parce qu’on les sent trop loin de nous, il l’éprouve désormais dans cette étrange et énigmatique proximité des textes du Talmud et de la Tora, parce qu’il sent que ces textes se destinent, non à leur répétition et à leur engrangement dans un corps-silo, mais à leur enchantement dans un corps libéré et délivré de lui-même, invité et porté par le renouvellement infini des réserves de leur sens.
Le coup de force de ce livre, c’est que, de cette formule plus que restrictive, qui tombait comme un couperet, annonçant la violence d’une rupture avec un père pourtant si bienveillant, naîtra la plus heureuse des rencontres entre un père et un fils, et c’est vers l’accomplissement de cette forme relationnelle que nous conduit progressivement le livre – par le récit d’une séparation d’avec un passé (catholique, hypokhâgneux, familial, et même littéraire) dont émane, d’un même élan, la renaissance de ce père sous un jour nouveau à travers la nouvelle ligne de conduite et d’écriture du fils. Le bon docteur de Vienne avait raison : l’enfant est le père de l’homme.
En somme, cette respiration dont on parlait – cette inspiration puisée dans les souvenirs d’enfance et cette expiration qui ouvre le corps de Gabriel comme en avant de lui-même, vers l’énigme dansante des lettres de la Tora, finit par trouver son rythme à travers une écriture qui n’a plus à se justifier négativement (par rapport à une avant-garde dont on ne saurait continuer de singer les audaces désormais réifiées en nouvel académisme, ou en enfermement autopoïétique), ou un ordre dans lequel il s’agirait d’entrer (celui de la République des Lettres et de l’extinction des feux de la langue sur lequel il prospère tristement).
Cette écriture s’est enfin trouvée, ni sur le mode intransitif, ni sur celui de l’hyper-transitivité du roman aujourd’hui, mais comme au delà d’elle-même, dans cette formule souveraine de l’espoir qu’est le messianisme dans sa version juive. Les choses sont en ordre (et l’ordre des choses de ce récit déplacé sont comme un effet miroir de cet ordre des choses du monde qui tiennent ensemble, avec ce messianisme, dans leur déplacement même).
Et si une promesse avait été faite à la mère lors de l’oraison funèbre :
(«et vous, maman, qui aimez plus que tout le rayon du matin, au-dessus de la mer, regardez-y, chaque jour, en vous levant, car il y est présent, le regard plein de sens de votre Biquet, qu’il sera bientôt vain de pleurer, car vous aurez compris qu’il y demeure.»), cette promesse sera exaucée dans les pages finales du livre, par cette paraphrase étonnante de Villon : «Jean Bacqué, le jour où, lâchant votre main, je rentrai dans l’eau qui, au de baptiser par l’esprit, loin de baptiser par la chair comme continuerait l’oncle Soufre, m’oubliait, je reçus en partage, avec les hommes mais d’abord avec vous, cet espoir : Celui de devenir votre frère – vous, Jean Bacqué, mon frère humain qui après moi vivez.» .
Le récit d’une séparation se subsume alors dans celui d’une réparation – la cautérisation d’une blessure, de cette douleur consécutive à la disparition de ce père, de ce frère tant aimé.
[1] Pascal Bacqué, Le père de Gabriel, éditions Massot, 2020.