1819-2019
Qui posera une pierre pour Leopardi sur le chemin de Recanati ? Il est bien loin le temps où Sainte-Beuve retenait cette haute voix comme un chemin secret dans le romantisme effervescent, ou plutôt contre lui ou au-delà de lui. Cet au-delà nous a rejoints et nous demeurons sans force devant les prémonitions du solitaire qui égrenait ses chants entre Adriatique et Monti Sibillini. Leopardi dévore l’âme italienne, il s’est risqué jusqu’à nous, sans jamais s’imposer, sous bien des visages. On ne remerciera jamais assez les efforts gigantesques qui ont été réalisés aux éditions Allia pour nous donner à lire tout Leopardi en français. Mais en ce jour, le propos est autre, il ne s’agit plus de mesurer les avancées ou les reculs d’un ambition critique, l’heure exige une attention plus recueillie. Il y a 200 ans, exactement 200 ans, en 1819, peut-être dans des jours de septembre comme les nôtres, un jeune homme de 21 ans (Leopardi est né en juin 1798) entame un chant qui va donner un autre ton à la poésie, à la nôtre : reprenant toutes les pauses d’un Byron italien, il va soudain élever un sanglot de cristal qui prend congé de ses modèles et fait entrer dans la langue cet accident qui ne se reproduit pas : une pureté d’étoile.
Voici cette idylle XII des Canti, le recueil unique du poète. Foncièrement intraduisible, elle pourrait prendre cette forme maladroite dans notre langue :
L’Infini
Toujours me fut chère cette colline solitaire
Et cette haie qui, de tout côté,
Protège le regard de l’ultime horizon.
Mais assis et contemplant, espaces sans fin
Par-delà, surhumains silences
Repos plus que profond —
Tout cela je me le forge en pensée ; et peu s’en faut
Que le cœur ne me défaille. Et comme le vent,
Je l’entends frémir parmi ces frondaisons, moi ce
Silence infini à cette voix
Je les rapporte l’un à l’autre : et je me souviens de l’éternel,
Et des âges défunts, et de ce temps présent
Bien vivant, et du bruit qu’il fait. C’est au milieu
De cette immensité que mon penser se noie
Et le naufrage m’est doux dans cette mer.
Approchons-nous de ce miracle : oui il est assis, comme Chateaubriand s’était déjà lui aussi assis «sur les débris de son naufrage». Oui, il est seul parce qu’il a été abandonné, ou que quelque fièvre déjà le sépare de son temps. Oui, il parle encore et toujours en première personne, selon les règles de l’idylle. Mais écoutons mieux, regardons quand même ce qu’il fait : il procède non pas d’un regard plongé dans les lignes bleutées du paysage, mais de la barrière d’une haie. Il ne voit pas, il conçoit et reçoit par les seules forces de la pensée. Il forge et feint, dit-il dans sa langue. Quoi ? Un infini non pas d’essence, mais de présence, non pas principe de philosophie, mais souffle du cœur. Faut-il en rester à cette première atteinte ? Doit-on même, au nom de cet infini, opérer quelque conversion, reconnaître des priorités pour mieux se soumettre, brûler le monde pour entrer de plain-pied dans l’absolu ? Eh bien non, cet infini-là l’entend d’une autre oreille : il est un infini d’alliance. D’alliance avec le vent et les arbres, ici et maintenant, d’alliance bientôt avec l’histoire racontée par les livres, mais tout autant avec le temps présent, et sa part la plus fragile, la rumeur, celle qui monte de la vallée, celle qui résulte de l’actualité, celle qui gronde là-bas derrière l’horizon. Cet infini n’a cure de séparer, il est le lien entre les contraires, il est cette réciprocité du silence et de la voix qui restitue à la finitude ses distances, au propre son étrangement et à l’angoisse qui n’en finit pas la dilatation dont elle s’enivre. Cet infini est l’infini de la sollicitude.
Mais avons-nous bien lu jusqu’au bout ? La production en esprit de l’infini sollicite certes un travail de mémoire, mais c’est une mémoire bien étrange : on s’y souvient du passé, mais tout autant du présent ! C’est tout un devant la pensée mémorielle de s’allonger dans la tombe et de vibrer dans l’instant. Telle est la loi du son : il ne distingue pas les régimes du temps, il égalise dans sa musique tous les plans, il n’entend qu’une seule rumeur et c’est celle de l’espace.
Aux prises avec un espace intérieur, la pensée court aussitôt le risque de contredire ses oppositions constitutives. Et de fait, le poème se clôt sur un sentiment océanique qui rendait si perplexe Freud, qui se savait «animal terrestre», dans ses échanges avec Romain Rolland. Leopardi habitait un flanc de montagne qui descend doucement vers la mer à travers des hauts lieux pleins de miracles, des vignobles fruités et une longue étendue de sable. Il consentait à cette immensité sans d’autre résistance que de se faire poète. Il s’y noyait, loin de tout romantisme ponctué d’éclairs. Il n’avait plus devant lui la contradiction humaine, mais l’afflux d’une douceur surhumaine qui n’appelait qu’un consentement dilaté.
Cette mystique sensible a eu ses prédécesseurs chez les philosophes, je pense à Malebranche, toujours prompt à consulter l’Étendue qu’il disait «intelligible» pour y retrouver les secrets de la force et les lois du monde. Leopardi est moins savant, mais il perpétue cette «heureuse impuissance» dont Malebranche se réjouissait en secret dès qu’il remettait à l’espace le soin de rendre le monde intelligible. Leopardi est moins spéculatif sans doute, mais il interroge avec la même force l’espace pour y trouver les secrets du temps.
Aussi a-t-il su faire survivre jusqu’à nous un sentiment idyllique, sans Arcadie ni bergerie, fondé sur un sentiment vibratoire dont ce court poème garde la trace. Tour à tour héroïque et ironique, l’œuvre entière reposera sur cette onde initiale retenue au bord du silence. A ce jeune poète de concilier ensuite les propositions terrestres d’un néoclassicisme militant avec cette capacité d’envol adriatique qu’il avait en commun avec Titien à Venise ou Dante à Ravenne. Juge de son temps comme le nouveau Juvénal, il dénoncera les fausses ferveurs des Romantiques et les réelles froideurs du temps présent, l’alliance improvisée du réductionnisme et du progressisme, les fausses religions des modernes et la débauche des espérances dévoyées. Il se risquera même au matérialisme pour montrer l’ampleur de son pouvoir critique. Il y aura en lui de la cruauté du philologue et de l’emportement du poète. Il finira même par identifier, à force de malheurs et d’échecs, dans le Néant un candidat solide pour légitimer ce naufrage dans l’immensité qu’il appelait de ses vœux. Mais sachons ce que nous lui devons : un clair lever de lune au jour où le soleil n’éclaire plus une terre capable de satisfaire nos yeux.



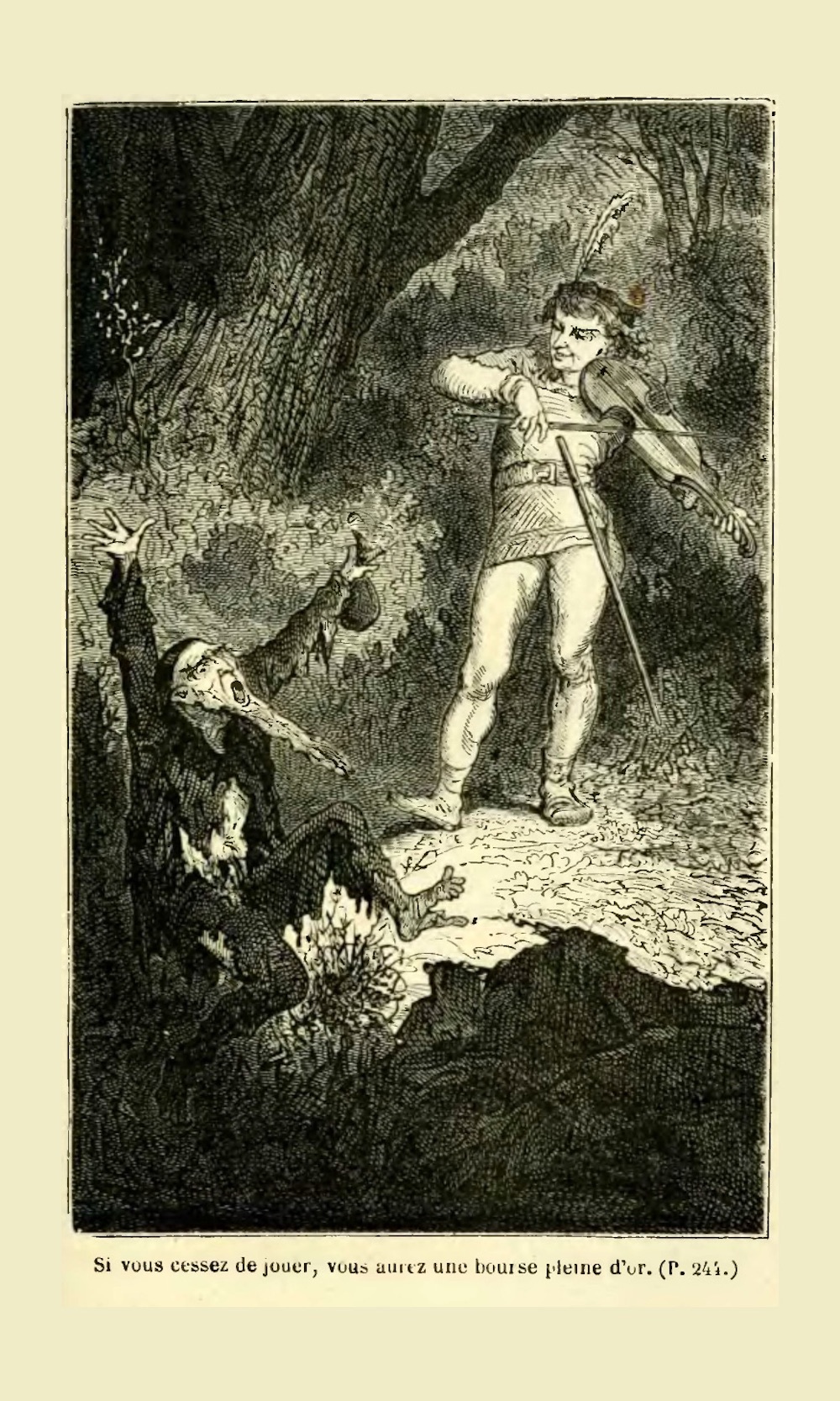


Vous relevez une, deux, quatre, huit, et déjà seize, trente-deux, soixante-quatre — ne me dites pas qu’on en est à cent vingt-huit — fois de suite le bouclier du réel afin d’empêcher que la mayonnaise révisionniste ne s’infiltre dans les représentations balafrées de votre volonté, et le surmoi buté dont vous aurez été le témoin acharné des répugnantes répulsions obsessives vous attribue sa propre signature psychique. Vous arrachez à l’angle mort du multilatéralisme les véhicules à voile et à vapeur soumis à la charî’a d’État, et l’on vous retourne en travers de la gueule le dernier féminicide en date, comme si cette atroce tache sombre, gravée dans le sol du droit, avait le pouvoir de tracer une équivalence éthique entre une République sociale-libérale et une théocratie millénariste. Vous dénoncez l’antisémitisme mâtiné de négationnisme sévissant dans les cercles où l’on est Charlie Coulibaly — je n’ai pas dit « où l’on naît » — et l’on vous ressort la carte qui met fin au débat, j’entends par là la carte de visite du délateur de Roman Polanski, celle qui colle à la peau des intellos qui eurent la mauvaise idée de s’interposer entre le réalisateur du Pianiste ou de J’accuse et tous ceux dont la profession de foi semble se limiter à ce murmure obscène : leur trouer la peau.