Cela faisait un moment que Mélenchon filait un mauvais coton.
Son côté petit joueur et perdant sans panache.
Ses insultes au-dessous de la ceinture contre Macron, Hollande, Valls, les autres.
Le bord à bord étrange, sur des thèmes aussi sensibles que le dégagisme et les migrants, avec l’extrême droite lepéniste.
Les insultes contre le CRIF.
Le procès, en mode Trump, et avec une fixation sur Radio France, de journalistes et de médias auxquels il ne pardonne apparemment pas d’avoir tardé à le reconnaître.
Ou encore l’embarrassante émission politique où on le vit, il y a quelques mois, tenter d’humilier deux femmes, Laurence Debray et Nathalie Saint-Cricq, qui avaient eu le tort de l’interroger, avec une insistance qu’il jugea suspecte, sur son tropisme vénézuélien.
Ce Mélenchon-là n’était plus «populiste». Il était odieux. Sexiste. Servile avec les puissants (Poutine, Assad). Implacable avec les victimes (les démocrates ukrainiens, les civils syriens massacrés, les Tibétains). Railleur avec «les gens», autant dire la valetaille, dont la tête ne lui revenait pas (la semaine dernière encore, cette journaliste de France 3 dont il singea stupidement l’accent méridional). Le tout sur une drôle de petite musique qui, mêlant appel au peuple et culte de la personnalité, n’était pas sans rappeler cette vieille connaissance de l’idéologie française qui s’appela le boulangisme.
•
Avec sa réaction, toutefois, à la série de perquisitions réclamées par l’enquête sur ses comptes de campagne et ses possibles emplois fictifs, il vient de franchir un nouveau cap dans son inquiétante métamorphose.
Comme pour Michel Onfray la semaine dernière, il faut le voir pour le croire.
Il faut le voir, sur YouTube, jouant au bélier vivant pour, avec une mince troupe chauffée à blanc, enfoncer la porte de ses propres locaux.
Il faut le voir, yeux révulsés, index dressé, menacer un fonctionnaire de police imperturbable, puis un procureur de la République impeccable de sang-froid.
Il faut le voir, peu avare de son haleine, presque bouche à bouche avec eux, hurlant, éructant, cherchant la bagarre, ne la trouvant pas, hurlant de plus belle, écumant.
Il faut voir, au milieu de la cohue, dans ce désordre de cris et de tables renversées, tandis que la troupe braille «touche-le, touche-le, touche-le», l’arrivée d’un lieutenant lançant «je vous avais dit qu’il était violent» à propos d’un autre policier qui, jeté à terre, reste fascinant de maîtrise de soi.
«La République, c’est moi», s’exclame encore la nouvelle Marianne faite homme. «Ma personne est sacrée», geint-il soudain, comme dans une bagarre d’alcooliques.
Et la scène serait ridicule s’il n’y avait ce regard fou, cette voix épaisse et dégondée, ce côté «retenez-moi ou je fais un malheur», qui sont la vraie sale gueule de l’âme.
•
Les plus honnêtes des Insoumis pourront toujours s’effrayer de ce qui s’est passé.
Ils pourront, comme Alexis Corbière, dans l’émission de Cyril Hanouna, tenter de faire l’agneau et de dissoudre cette séquence glaçante dans la lessive d’excuses vagues et, si cela se trouve, sincères.
Quelque chose s’est produit là.
Quelque chose s’est libéré, sur la scène politique française, qui autorise, désormais, le recours à la violence, aux arguments musclés, à la force.
Et l’on voit mal, par exemple, ce que l’on pourra encore objecter à l’authentique casseur qui, demain, dans une banlieue difficile, s’autorisera du geste mélenchonien et de son
écharpe tricolore pour, lui, toucher vraiment un représentant de la loi.
La vérité, c’est qu’il y a peu de gestes, dans une démocratie, plus suprêmement violents que celui de frapper, ou de menacer de frapper, un procureur, un policier, ou tout autre détenteur de l’autorité républicaine.
La vérité, plus exactement, c’est qu’il ne faut pas grandchose pour qu’un visage devienne trogne, que la parole cède à l’éructation puis aux coups. Et il suffit de ce «pas grandchose» pour, s’il fait des émules, que l’on passe de la gravité des pouvoirs séparés et distribués, du sérieux des procédures imposées aux puissants comme aux autres, bref, du règne absolu de la loi, à la haine, à la rage et au groupuscule en fusion qui se sent pousser, non des ailes, mais des poings et des crocs.
C’est ce passage que l’on vit s’opérer, dans les années 1930, chez un communiste nommé Doriot, maire de Saint-Denis, qui beuglait, lui aussi, son mépris des institutions et des lois.
C’est le même passage que l’on voit, dans les livres de Maurice Barrès, faire que d’autres insoumis purent transiter, à la veille de la Première Guerre mondiale, de Sorel à Maurras et de l’extrême gauche à l’extrême droite.
Eh bien, M. Mélenchon en est là.
On l’avait quitté robespierriste – on le retrouve doriotiste.
Il se voulait sans-culotte – c’est avec l’esprit des Ligues qu’il renoue.
Il sait cela, le chef. Il connaît trop son histoire de France pour rien ignorer des chemins où il est en train de s’engager.
Mais voilà. Il en a marre. Peut-être n’est-il même pas, d’ailleurs, si en colère qu’il le prétend et trouve-t-il juste le temps long. «Ce ne sont pas, dit-il textuellement, des juges, des policiers, des politiciens à la ramasse qui vont nous obliger à vivre autrement.» Entendons : «j’ai trop guetté les faveurs des Mitterrand, des Hollande, des Jospin, ces aînés qui me méprisaient et je me mets, donc, à mon compte.»
L’heure est venue, oui, songe-t-il. Et il se frotte les mains.
Même si nous savons, nous, que cette heure ne sera pas la sienne mais celle des casseurs de la République.



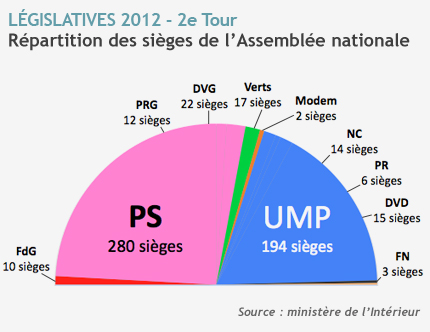




… bingo ! Tout à la joie de pouvoir caser sa leçon trop bien apprise le prout-machère Bernard-Henri Lévy nous parle ici des insoumis qui « purent transiter, à la veille de la Première Guerre mondiale, de Sorel à Maurras et de l’extrême gauche à l’extrême droite ». Pendant qu’il y était il aurait aussi pu ajouter le nom de Gustavé Hervé mais l’important est qu’il remet ici les pendules à l’heure et reconnnaît que la première guerre mondiale était bien, par sa survenue : la chose de l’extrême-droite.
– copie de ce commentaire au ‘Monde’
Oui, il y a dans cette analyse beaucoup d’observations que je partage. Le côté « grand Zampano » affiché par Melenchon n’est pas légitimé par l’excuse d’être un malheureux bateleur de foire exerçant sa puissance sur une malheureuse associée de misère dans La Strada, Non, il se croit arrivé au pinacle de la représentation populaire qui n’est pas composée de stupides moutons incapables de pressentir le caractère surfait de cette mise en scène. Certes, la majeure partie de l’intervention des forces de police et qui a été filmée n’a pas fait l’objet d’une présentation intégrale dans les média qui pour beaucoup s’en sont donnés à coeur joie pour démontrer le côté mal embouché de cet opposant systématique,se révélant soit incapable de contrôler son discours, son attitude, ses gestes à l’instar d’un histrion farouche soit il nous donne une mise en scène qui donnerait à voir ce que c’est que d’être un homme du peuple poursuivi par la malfaisance institutionnelle ! Que croit-il ? Que le pauvre malheureux endetté et expulsé de chez lui par un commissaire et un huissier va trouver dans cette mise en scène une quelconque ressemblance avec le pauvre sort qui lui est fait ? Il faudrait pour cela que ce dernier ne fasse pas partie de tous ces gens si désarmés par l’incompréhension de la chose politique qu’ils finissent par ne plus écouter ni les discours des uns, ni s’émouvoir des prétendues haines des autres contre un système dont ils ont parfaitement su se servir par ailleurs. En effet, que penser de la présence de Rackel Garrido dans un talk show animé par Ardisson pendant que le patron du parti dans lequel elle est membre du bureau conchie la presse et les média chaque fois que l’occasion lui en est donnée. Puisque « populiste » il y a dans cette affaire j’utiliserai le langage d’un réalisateur, créateur de dialogues cinématographiques bien connu : « Faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages ! » Michel Audiard.