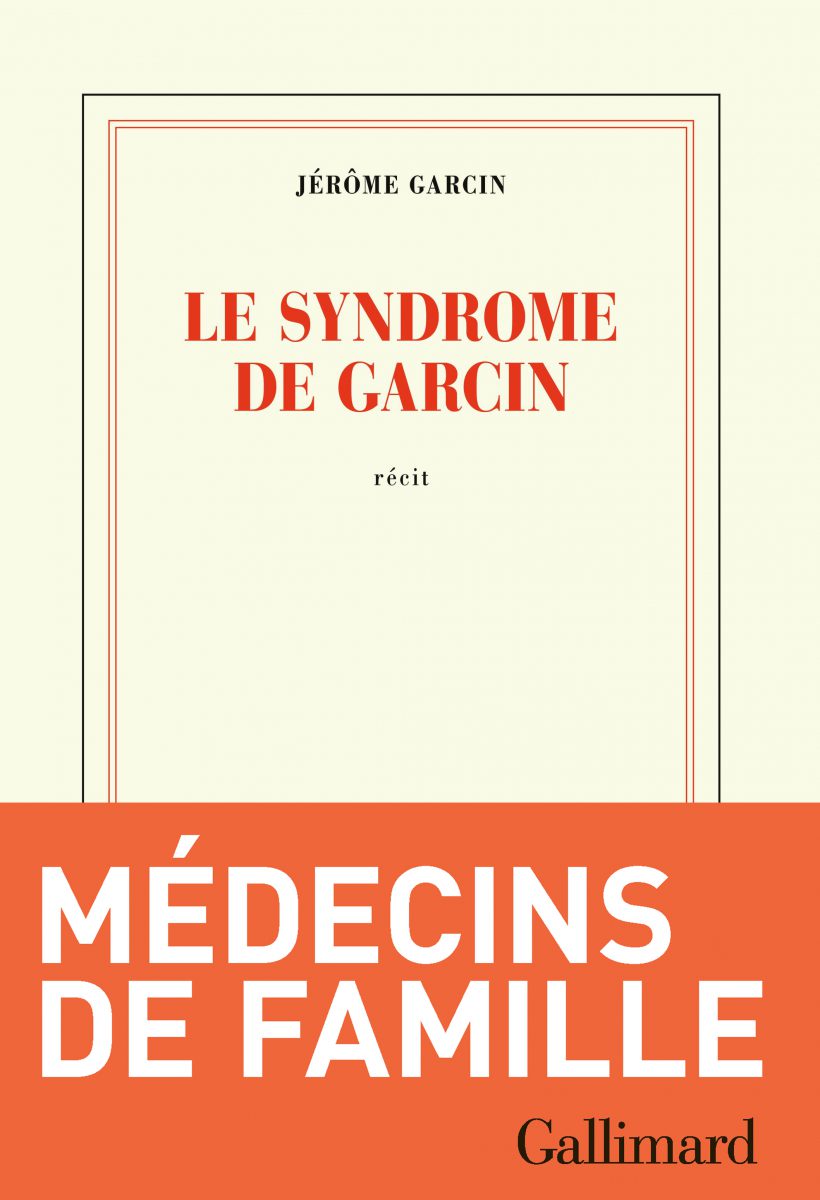La mélopée si captivante sur le temps, sur l’amour qui a uni un petit-fils et ses quatre grands-parents, en particulier sur l’admiration qu’il sut porter à ses deux grands-pères professeurs de médecine, mais aussi à son père, mort prématurément, que nous livre Jérôme Garcin dans Le Syndrome de Garcin, vous saisit de la première à la dernière page. Les deux personnages-clés de cette fresque sont Raymond Garcin, célèbre neurologue originaire de la Martinique, et Clément Launay, pédopsychiatre, tous deux chefs de services hospitaliers et derniers maillons d’une double tradition médicale – aussi bien du côté maternel que du paternel. Le troisième personnage qui s’impose est Olivier, le frère jumeau de l’auteur, mort à six ans, en 1962, fauché par une voiture. Il disparait dix ans avant la mort accidentelle de leur père Philippe Garcin, tué par un cheval, lui qui aimait passionnément les cheveux. La langue de Jérôme Garcin, son style, ses couleurs – qu’il décrive l’éruption de la montagne Pelée vécue par son grand-père le 8 mai 1902, qui fut suivie d’un Tsunami, ou les innombrables souvenirs directs ou indirects liés à ses deux grands-pères –, sont ceux d’un écrivain vibrant et tout en retenue, tendre et fort pudique à la fois. C’est sur les ruines et le désastre que la famille Garcin va se reconstruire donnant à la France quatre médecins dont deux chirurgiens-dentistes. «Il arrive que la médecine soit la fille des désastres», peut-on lire dans ces pages.
Tout juste médecin, Raymond Garcin découvrit en 1916 les champs de bataille avec ces jeunes hommes défigurés, amputés, par milliers, par dizaines de milliers, sans parler des morts. Il y découvrit aussi l’angoisse absolue qui suivait, jusqu’à la démence, l’hallucination. Nombre de blessures psychiques sont plus destructrices que celles des corps pourtant marqués à vie dans la chair et les os. C’est dans ces hôpitaux de campagne que le jeune médecin choisit de soigner ces grands malades et se spécialisa en neurologie.
L’hymne de Jérôme Garcin à ses grands-pères a peu d’égal dans la littérature française : «Les grands-pères empêchent toujours un peu les parents de vieillir et permettent aux petits-enfants de grandir» (p.38). Pourtant le XXe siècle, avec ses tragédies des deux Guerres mondiales et de la Shoah, a montré que des millions de fils et de filles de soldats tués au front ou de parents assassinés dans les camps de la mort n’eurent plus de père ni de mère ni de grands-parents pour grandir ni surtout se reconstruire. Combien de générations traumatisées ? Il est d’autant plus poignant ce chant de Jérôme Garcin.
Quelle plus belle statue pouvait-il élever à la mémoire de ces quatre êtres qu’il aima et admira que ce livre brûlant ? Grâce à lui, comme il l’écrit, «ils vivent encore […] dans la nuit où je les convoque, dans les hôpitaux et les bibliothèques où leur nom et leurs œuvres semblent défier le temps. Ils ont un visage, un regard, une voix, un parfum, une éthique, une lumière que je n’oublie pas» (p. 43-44). Eh oui, ils avaient une éthique et Jérôme Garcin en a hérité.
Une grande partie de son premier chapitre est le récit de l’aventure médicale et humaine des ancêtres de l’auteur, depuis Alexis Boyer (1757-1833), chirurgien et baron d’empire, jusqu’à son père, Philippe Garcin, le premier avec ses frères, à rompre cette longue filiation de médecins.
De son arrière-grand-père maternel, Georges Guilain, neurologue, Garcin tient probablement son goût, sa passion pour la littérature depuis les Classiques jusqu’à Taine, Renan, Saint-Simon…
Philippe Garcin choisit pour la première fois dans la tradition familiale, l’édition, et devint directeur éditorial au PUF, dont le sigle était «un quadrige emballé», «emblème si prémonitoire»…
Parmi tant de pages qui vous laissent dans un «état de communion» comme aurait dit Malraux, on ne peut passer sous silence l’évocation du pour-l’autre si éminemment lévinassien incarné par Raymond Garcin avec un désintéressement qui lui fut consubstantiel jusque dans sa lente agonie, où il «se plaignit moins de ses propres souffrances qu’il ne regretta de ne plus pouvoir apporter de l’aide, du réconfort et “le souffle de la chaleur humaine” aux alités de la Division Mazarin, dont il s’inquiétait comme de ses enfants» (p. 93). Un sens si haut de la responsabilité dans ces instants-là ne peut appeler que notre admiration.
Après quoi, Jérôme Garcin ouvre une page de mon propre «journal» par l’évocation de Jean Metellus, neurologue, poète et romancier haïtien haut en couleur, qui eut comme père spirituel Raymond Garcin et qui s’était pris d’admiration et d’amitié pour André Malraux dans la dernière année de sa vie, autour de son voyage à Haïti à la Noël 1975, puisqu’il mourut le 23 novembre 1976. Or Metellus lui envoyait des lettres d’un lyrisme exacerbé et aussi son premier livre de poèmes Au pipirite chantant. Le hasard aidant, j’ai eu et lu ses lettres à Malraux, lorsque quelques mois après, Sophie de Vilmorin me les déposa, au moment d’écrire son livre Aimer encore, sur ses cinq années de vie commune avec l’écrivain. Retrouver ce nom sous la plume de Jérôme Garcin ranime quelques souvenirs autour non d’un grand-père très aimé et admiré mais d’un maître, de mon maître premier.
Aux dernières pages de son livre à la fois intime et universel, Jérôme Garcin peut être fier d’avoir su, avec dignité et finesse, rendre vivants des êtres qui ont été constitutifs de son être et de sa vocation d’écrivain et de passeur. Ainsi Raymond et Yvonne Garcin, Clément et Madeleine Launey, son frère Olivier, son père Philippe, témoignent-ils à travers lui. De Jérôme Garcin disons qu’il est en littérature le digne héritier de ses grands-pères Raymond Garcin et Clément Launey, passionnés qu’ils étaient par les êtres. Il sait bien que l’art et l’écriture, quand elles se font mémoire, prolongent la vie des personnages et des êtres aimés, que l’on cherche tant à ressusciter. Jérôme Garcin y réussit avec panache.