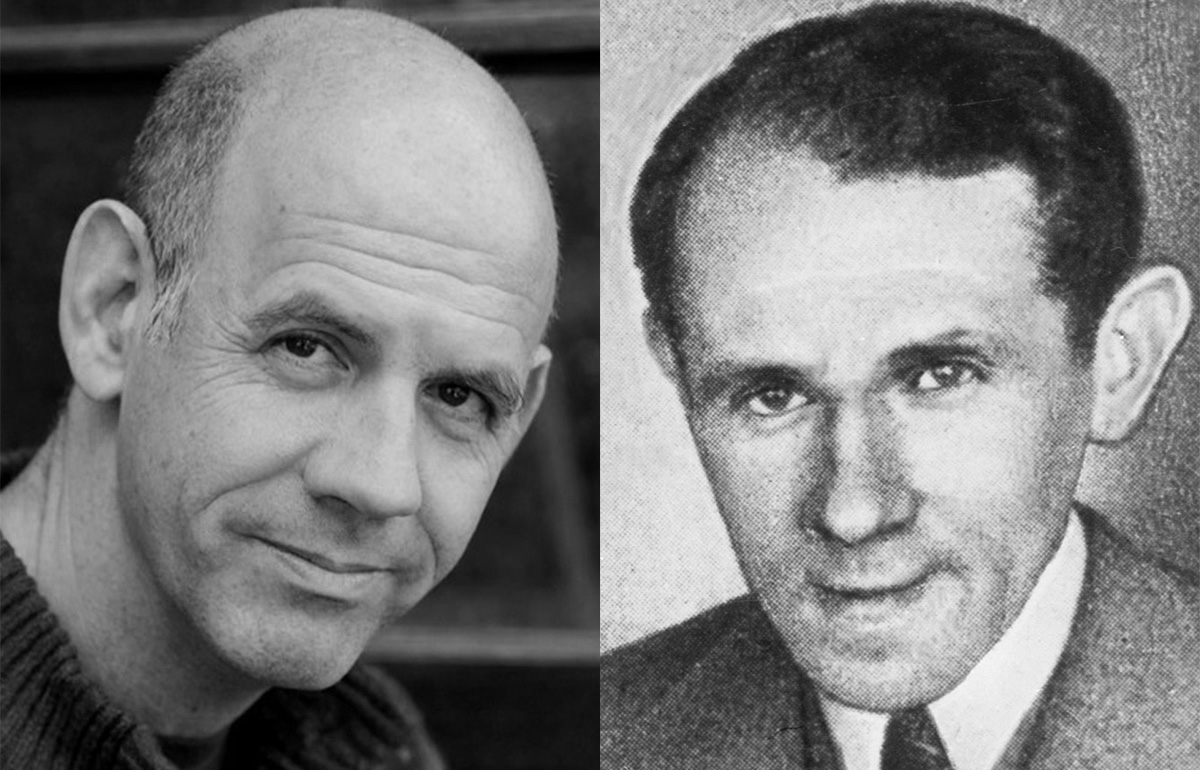Miguel Padilla ne peint plus, depuis la mort de son épouse et modèle Dolorès. Dans son appartement du quai de Béthune, il joue sur ses deux guitares – une classique et une flamenca –, écoute Bach sur des appareils acoustiques patiemment appariés pour atteindre le son parfait, tombe de sommeil sur son canapé pour de petits sommes impromptus – il écrit «dodos, roupillons». Il écrit ? Non, bien sûr, ce n’est pas lui qui écrit. Miguel Padilla est «héros et narrateur de l’aventure». Notons dès à présent que dans cette aventure, il ne se considère pas comme un personnage. René Belletto explore plus avant, dans Être, les modalités de la mise en fiction, comme on parle de mise en scène au théâtre ou au cinéma, cinéma toujours présent dans ses livres. Ici, quantité de titres de films sont cités, et apparaît une caméra au détour d’une rue de Rome, l’une des héroïnes étant documentariste.
Dans Être, il y a une histoire, à peu près linéaire, terriblement bellettienne : Miguel Padilla rencontre son presque double, un double légèrement décalé dont il se méfie immédiatement, mais avec lequel il accepte de partager une table de restaurant, et quelques confidences. Le même Miguel Padilla fait la connaissance de trois femmes en quelques jours – et même en quelques heures – qui toutes lui rappellent un aspect de Dolorès, et sont toutes bâties sur le même canon : blondes, yeux clairs, mains fines. Nathalie, Irène, Marie. Sympathie et attirance immédiate, réciproque. Elles ont, toutes les trois, une caractérisation romanesque : Nathalie la déjà morte, Irène la devineresse, Marie l’extraterrestre. Ce n’est rien dévoiler que de dire cela, elles sont différentes mais forment une seule et même femme, idéalisée. Comme toujours, chez Belletto, l’amour est tragique. Les épisodes solaires, inespérés, annoncent les catastrophes. Les trajectoires s’entremêlent, irrémédiablement. Les coïncidences sont d’évidence, elles participent d’un grand fatum que, justement, René Belletto – enfin, Miguel Padilla, son héros-narrateur mais pas personnage – récuse et renvoie aux oubliettes d’une littérature de péripéties :
«Je ne parle pas de ces prestigieuses aventures de jadis, comme écrites d’avance, ni de ces aventures sans lendemain errant à jamais entre les murs du désespoir, non, mon désir était plus ambitieux, je voulais me concevoir au cœur d’une aventure sans aujourd’hui, comme si le grand livre du Destin avait brûlé dans l’incendie de quelque bibliothèque.»
Si les histoires que nous raconte René Belletto se ressemblent à ce point, c’est bien que l’histoire n’est que le motif sur lequel joue l’auteur. C’est son art de la fugue. Ou sa façon d’appréhender les nymphéas. Spécialistes de Bach et artistes-peintres sont d’ailleurs les caractérisations premières de ses héros. Ce qui intéresse Belletto, c’est la manière de raconter. Ou, plutôt, la façon de tordre de l’autobiographique, du géographique et du fictionnel dans un espace-temps sans cesse interrogé et modifié. Par exemple : dans Être, alors que Miguel Padilla roule vers Rome pour rejoindre Nathalie, il a un accident de voiture, fait deux tonneaux, et, roulant ainsi sur lui-même, sort quasi indemne de l’accident mais se retrouve dans un coin d’Espagne. Il est toujours en Italie, mais dans une villa habitée par une de ces familles espagnoles comme on n’ose pas les imaginer, guitare, tablao, paella. Ces petits miracles narratifs – ces «tonneaux» accidentels qui propulsent tout à coup les héros dans une dimension autre – sont la marque de Belletto, l’affirmation que la fiction peut tout et doit être explorée jusqu’aux confins. Dans son roman Créature, paru en 2000, il nous avait emportés à vingt-quatre milliards d’années-lumière de la Terre. Dans Être apparaissent des rappels ténus à ce roman, qui indiquent peut-être que le titre doit être pris au substantif – un «être» et non le verbe être – comme un pendant au mot «créature». L’œuvre entière de René Belletto est une sorte de labyrinthe narratif et mental à la fois. Autant dire de labyrinthe fictionnel. Les héros, tous ou peu s’en faut, prénommés sur des déclinaisons de Michel et de Marc, sont les points nodaux d’une vaste trame où se trament des histoires qui s’entremêlent, se rejoignent et parfois débordent. Plus que de musique ou de peinture, c’est de tapisserie qu’il s’agit. Mais le motif à découvrir dans le tapis n’est pas le personnage ou l’animal caché : le motif à découvrir dans le tapis, c’est la manière dont le tapis a été pensé, élaboré. Dans l’appartement de Miguel Padilla il est fait allusion à un kilim «aux motifs serrés, couleurs dominantes : vert pâle et rose» d’un mètre soixante. Posé sur une moquette à changer d’urgence, parce qu’usée. Imaginons que la moquette à changer soit le socle littéraire et narratif dominant, ou classique, et que le kilim soit la recherche de la mise en fiction. Imaginons…
Mais le titre Être peut être pris, également, sur le mode verbal. Être – ou ne pas être. En l’occurrence, être, oui, entièrement, affirmativement. Mais… comment dire que l’on est, et ce que l’on est ? L’un des thèmes majeurs de ce roman est l’impossibilité de l’autobiographie, ou du journal intime. Comment consigner ce qui fait nos jours ? Si je suis, je vis. Si j’écris que je suis, je ne vis plus, je suis dans le registre de la mort. Je «fige» ma vie. Miguel Padilla se confie à Irène (mais est-ce lui qui raconte ?) :
«Puis, emporté par le même élan, je lui confiai mon désir et mon impossibilité non pas d’inventer une histoire (ce dont j’étais incapable tellement je n’y tenais pas), mais de raconter ma propre existence par écrit, mon renoncement jadis à tenir une sorte de journal, et les raisons confuses de cette impossibilité : passer dans les mots, c’était fuir la vie réelle, c’était mourir.»
Le pacte passé entre Irène et Miguel – elle écrit ce qu’il lui raconte, il lui raconte ce qu’il lui arrive – n’est que le premier stade d’une narration au cube dont Belletto est coutumier. Parce que le truchement, la délégation de la narration, est aussi une forme de trahison, le roman se remet au finale comme par miracle – miracle fictionnel – sur ses pieds, en pied-de-nez au lecteur. Et personne ne sort trahi de cette histoire, ni les personnages – mot que l’auteur s’ingénie à contourner – ni l’écrivain, ni le lecteur.
Être est un roman fluide, qui se lit d’une traite, que l’on ne peut laisser en suspens car le suspens et l’anticipation sur le suspens sont ses ressorts primordiaux. Tout l’art de René Belletto y est comme concentré, plus resserré ici que dans ses opus précédents, peut-être. Parallèlement à la recherche architecturale de la fiction – disons-le ainsi – un humour allusif et corrosif y est aussi à l’œuvre : le lecteur attentif reconnaîtra des motifs exploités par Houellebecq (la chaudière défaillante) et par… Dan Brown (l’itinéraire dans Rome tracé par les gestes des statues du Bernin). René Belletto est de ces écrivains paradoxaux qui parviennent à allier recherche formelle sur l’œuvre entière et surprise renouvelée à chaque nouvelle publication. Plus accessible, peut-être, que son dernier roman Le Livre, Être est l’une des portes d’entrée de l’œuvre bellettienne. Porte qu’il faut pousser, absolument, pour découvrir un univers très personnel et diablement littéraire.