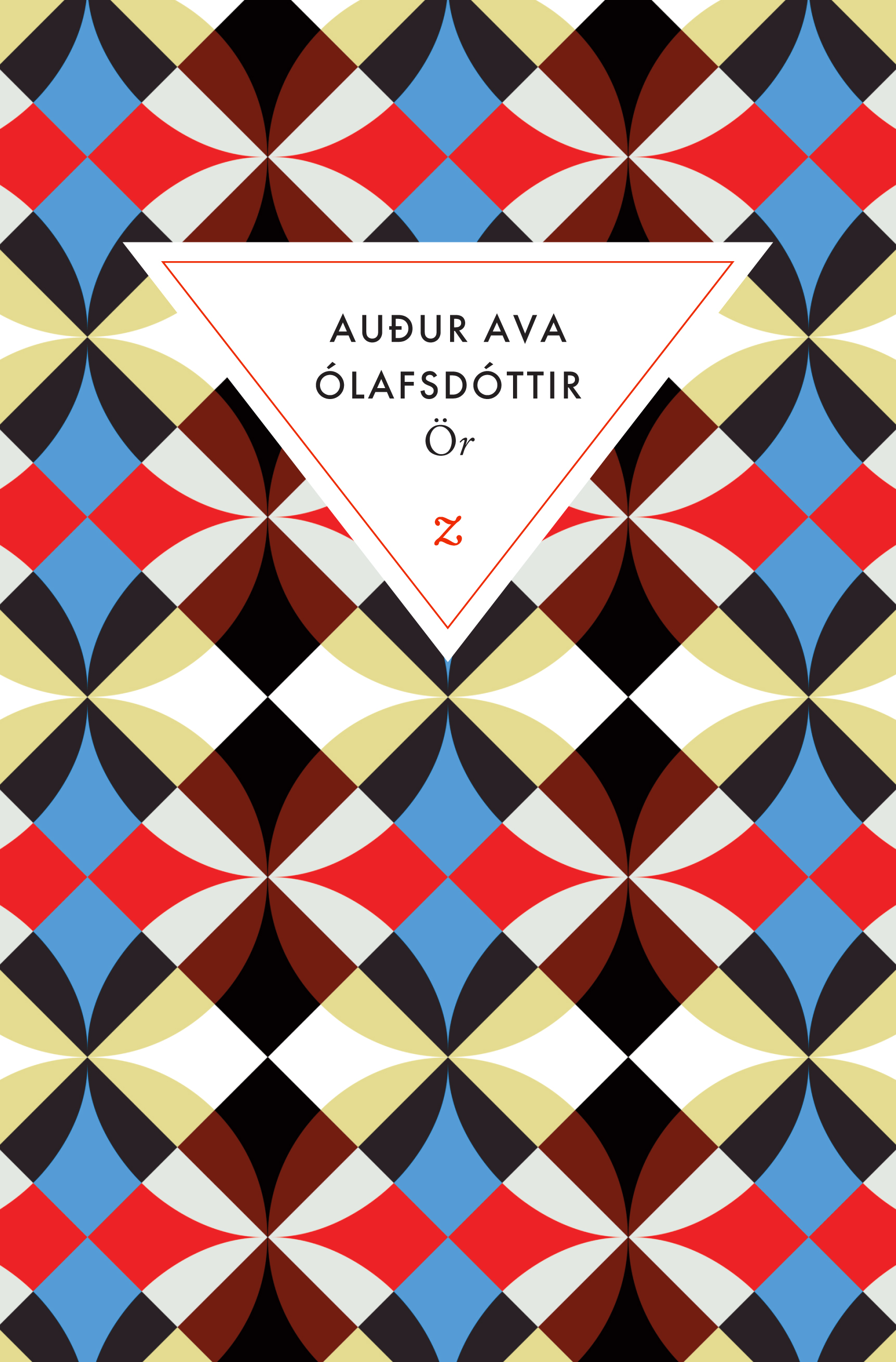Les personnages de la romancière islandaise Auður Ava Ólafsdóttir semblent vivre dans un monde flottant. A moins que ce ne soient eux, qui flottent. Les émotions qu’ils éprouvent, les embûches que la vie sème sur leur passage, les hasards et les coïncidences qui les poursuivent les atteignent de plein fouet, mais leurs réactions sont d’une gravité légère. La mort plane, mais elle est moins une menace qu’une composante inévitable. Et le sursaut dont ils font preuve le plus souvent n’est ni vraiment vital ni tout à fait animal, il est de l’ordre de l’essentiel. Un essentiel jamais exprimé en tant que tel, toujours suggéré dans les replis de dialogues écrits au cordeau où l’on entend les silences.
Auður Ava Ólafsdóttir écrit avec grâce. Avec une grâce folle, une tendresse attentionnée. Elle prend autant soin de ses personnages que de ses lecteurs. Ce refus de brusquer, et sa manière si particulière de mêler le quotidien aux questions philosophiques, donnent à ses romans une tonalité d’empathie exceptionnelle. Cette femme-là, elle sait ce qui se passe en nous, en nous tous. Dans Ör, un homme au seuil de la cinquantaine est en pleine déprime. Sa femme l’a quitté, sa mère perd la boule dans une maison de retraite, la fille qu’il a élevée et aimée n’est pas de lui, il vient de l’apprendre. Que faire ? Aller emprunter un fusil à son voisin pour en finir. Voilà la situation de départ, décrite de manière toute triviale. Auður Ava Ólafsdóttir ne prend pas les choses sous l’angle trivial, loin s’en faut. Son héros, elle le baptise Jónas Ebeneser, et elle donne aux trois femmes de sa vie – sa mère, son épouse, sa fille – le même prénom : Guðrún. Jonas Ebenezer et Gudrun : la Bible et les sagas. Ancrés dans une réalité culturelle bien circonscrite, ces noms acquièrent une force universelle. On est loin du drame petit-bourgeois, on en est même aux antipodes. Le voisin de Jónas Ebeneser, Svanur, a deux thèmes de conversation : « les véhicules à moteur et la condition des femmes dans le monde, deux sujets qu’il tente à toute force de combiner ». Les deux hommes, lorsqu’ils discutent, parlent ensemble mais ne disent pas, ils sous-entendent quelque chose qui ressemble à l’angoisse d’être au monde et de ne rien y comprendre, sur le ton de la camaraderie de voisinage. Et le lecteur est de la partie, il suit les échanges en comprenant l’arrière-fond, il est convive et non espion. Il est des leurs.
Le titre du roman n’a pas été traduit. «Ör» en islandais, signifie «cicatrice». Les cicatrices courent tout au long du roman, du nombril – cicatrice originelle – à la marque d’une césarienne, en passant par celles que l’on veut cacher sous des tatouages, et à celles, métaphoriques, que l’on transporte en soi et non sur soi. Cicatrices psychologiques qui sont aussi des blessures de guerre. Jónas veut en finir, mais il ne supporte pas l’idée que sa fille découvre son cadavre. Alors il part, voyageur sans bagages, pour un pays qui sort tout juste d’un conflit dévastateur, loin au-delà de l’océan. Sans bagages… ou presque. Il emporte sa perceuse et une caisse à outils. Peut-être que tout n’est pas perdu, et tant qu’il reste quelque chose à réparer… Dans le pays en ruines où il a réservé une chambre dans un hôtel à l’enseigne du «Silence», tenu par une jeune mère, May, et son frère Fifi, voilà que Jónas devient homme à tout faire : il purge les canalisations, refait l’électricité, consolide les portes de placard. Il est accueilli en messie bricoleur, homme providentiel comme tombé du ciel. Et peu à peu le ciel si sombre de Jónas s’éclaircit.
Auður Ava Ólafsdóttir, dans Ör, s’éloigne des paysages islandais et emmène son narrateur sur des terres indéterminées ruinées par les bombardements et les blessures intimes. La part des femmes, dans le roman, est particulièrement mise en relief. Les femmes sont en guerre, l’homme est la pierre de touche. Elles ont souffert et continuent de souffrir, mais leur sursaut est indispensable. La mise en parallèle de la restauration de mosaïques antiques où s’ébattent des femmes nues – où sont passées les tesselles de trois seins manquants ? – et de la reconstruction d’une bâtisse où projettent de s’établir des mères et leurs enfants rescapés de la guerre, dans un projet de type communautaire, est un espoir magnifique que la romancière déploie tout en délicatesse, à bas bruit. Jónas devient catalyseur d’espoir, lui, le désespéré.
Et c’est ainsi que l’on passe de :
«Je prends ma fille dans mes bras et la serre contre moi. Je ravale ce que je m’apprêtais à dire. Au lieu de quoi, je lui dis :
– Tu savais que l’homme est le seul animal à pleurer ?
Elle sourit d’une oreille à l’autre.
– Non, je l’ignorais. Je croyais que c’était le seul animal à rire.» (p.74)
à l’une des dernières scènes du roman, où Jónas apporte à May un tourne-disque et lui demande si elle veut bien lui apprendre à danser :
«- Vous mettez votre main là, et je pose la mienne ici, vous faites un pas en avant et moi un pas en arrière, ensuite c’est moi qui avance et vous qui reculez.
Nous nous retrouvons exactement au milieu du sol carrelé, puis nous nous déplaçons vers la fenêtre.
– Imaginez que c’est un voyage, poursuit-elle.
– Comme ça ?
– Oui, comme ça, comme quand on marche.» (p. 234)
Auður Ava Ólafsdóttir tord les motifs apparemment évidents de l’hôtel comme destination dernière et de la caisse à outils comme moyen de résilience. Elle fait de son narrateur Jónas un candide en attente, qui passe de l’impulsion mortifère à la vie retrouvée. La mort et la souffrance n’en sont pas moins présentes dans le texte, jusqu’aux dernières pages. Pourtant, le lecteur sort rasséréné de ce roman. C’est que la romancière, sans rien occulter du désenchantement, sait faire miroiter la petite étincelle de l’espoir. Parce que nos vies, tout compte fait, on les bricole.