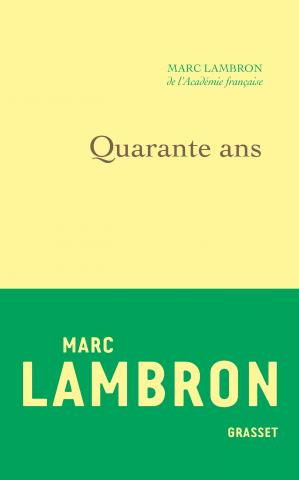Marc Lambron publie son journal. Pas n’importe lequel : celui de l’année 1997, une année noire, traversée par la mort. Après la disparition de son frère Philippe, en 1995, le 17 juillet très exactement (qui est pour moi une date également saturée de malheur), c’est le père de l’écrivain, c’est le géniteur de l’homme qui tire sa révérence. Lambron, Marc, hésite à dire les derniers moments ; il les dit du bout de la plume, et de ses forces. Puis, il abandonne au silence, avec pudeur, ce que le lecteur devinera, n’oubliant jamais que le silence n’est pas l’interruption de la parole, mais sa continuation dans l’impossible. Je ne citerai pas d’extraits de Quarante ans. Un journal étant déjà composé d’extraits d’une vie, extraire des extraits de cette vie n’aurait guère de sens ; mais vivons-nous ce que vit l’autre quand nous lisons ce qu’il a vécu ? La réponse est oui. Et cette existence de 1997, la voici qu’elle devient la nôtre vingt ans plus tard. Nous sommes, le temps de 400 pages, Marc Lambron lui-même ; il nous prête son intelligence, sa culture, ses sensations. En échange, nous lui abandonnons l’attention qu’il mérite, le silence qu’il demande et la mélancolie qu’il appelle. Certes, quelques pages paraissent bien anecdotiques devant les événements du monde – mais la prouesse n’est-elle pas, quand on veut habiter la vérité jusqu’au bout, de ne point chercher la prouesse ? Dire la vie dans sa miniature, c’est l’écrire dans sa vérité. Et s’il est un gage d’universalité, c’est bien de se fondre immédiatement dans le seul monde qui soit, qui vaille : celui qui nous entoure, nous blesse et nous ravit ; celui des lumières de la ville et des petits ponts de bois, des ruisseaux de l’enfance et des voyages improvisés.
Le Lambron surmondain qui s’ébroue dans ces lignes vieilles de vingt ans n’est pas strictement dupe : il pose son regard, versicolore, sur les dogmes du temps ; le plus souvent, c’est pour leur trouver d’étonnantes gémellités avec des événements passés, enfouis, oubliés, que l’auteur a stockés dans sa mémoire et dans la nôtre, à l’abri des intempéries et des calendriers. Le temps passe, il ne sait faire que cela. Et pendant ce temps, impuissant à le retenir autrement que par des mots, il le photographie à sa manière : en scannant les ridicules, en soulignant les frasques, en étudiant les futilités. Entre ces jeux de masque, ces dîners, ces quelques paillettes dessinant comme une galaxie sur le costume de la mort, Lambron sait ce qu’il risque : l’abîme. Pour ne pas sombrer, pour ne pas porter seul les ombres obèses de ses disparus, il dresse un catalogue pointilleux d’un Paris qui n’est déjà plus, avec ses météos pluvieuses, ses vedettes éphémères, ses gloires approximatives.
Etrangement, alors qu’il l’admire, il « rate » François Furet de quelques semaines ; ne pouvant se rendre à un dîner autour du grand historien, Lambron passe à côté de la figure qui ressemble le plus à son tempérament et le moins à son projet – un peu comme si la grande Histoire se refusait, capricieusement, à pénétrer dans la petite.
La profondeur de Quarante ans vient de son effet de distance : c’est tout un cosmos qui remonte à la surface, surgi des limbes ; un monde encore bien présent et qui pourtant, n’existe plus. Une contrée familière et qui, soudain, semble s’effondrer à mesure qu’on la redécouvre : Paris 1997 est une terre engloutie, peuplée de gens que nous connûmes et qui ne sont plus. Le monde dit là par Lambron ne cesse de s’écrouler sous les pas du lecteur, qui reconnaît chaque recoin comme on reconnaît le visage du mort, à l’instant de la visite dernière. Ce que nous pensions ne plus être est encore là ; ce que nous pensions être encore, nous comprenons qu’il n’est plus. Nous sommes les contemporains de ce palais des fantômes, fait de couloirs hantés par nous, qui sommes devenus autre chose, tout autre chose que ce nous avions prévu d’être. 1997 est une terre absente, ici redécouverte par un explorateur qui aura passé les vingt dernières années à avoir quarante ans pour toujours et à jamais. Quarante ans n’est pas un âge : c’est un pays. Nous le visitons avec ses brumes.
Lambron a écrit 1941 : puisant dans une mémoire collective, il avait fait jaillir de nulle-part, depuis nulle-part, un Vichy renouvelé, inventé : vrai. Ici, dans ce journal secoué de pudeur, il a opté pour une autre recette ; faire surgir une époque noyée, non par l’invention du passé, mais par maturation (pendant deux décennies) du présent. Par macération de l’instant dans les caves de l’attente. Du coup, 1997 brille comme un sou neuf ; c’est une statue vivante qui sort de la vase, nous éclabousse.
Lambron, Marc, est un écrivain majeur de ce temps : sans lui, qui dirait la post-modernité (terme qui n’a jamais rien signifié) avec l’empreinte d’un classique ? Ne reprochons jamais à Marc Lambron, par exemple, d’avoir cherché dans les honneurs, les hiérarchies et les institutions ce qu’il n’aurait pas obtenu par les mots les plus nus. A force de ne rencontrer, dans la vie, que sa verve, sa culture et ses facéties trahissant l’archicube, on finirait par ne plus suffisamment s’étonner, quand elle nous frappe comme ici dans ces pages, de son sens du tragique, de l’existence et de l’impossible.