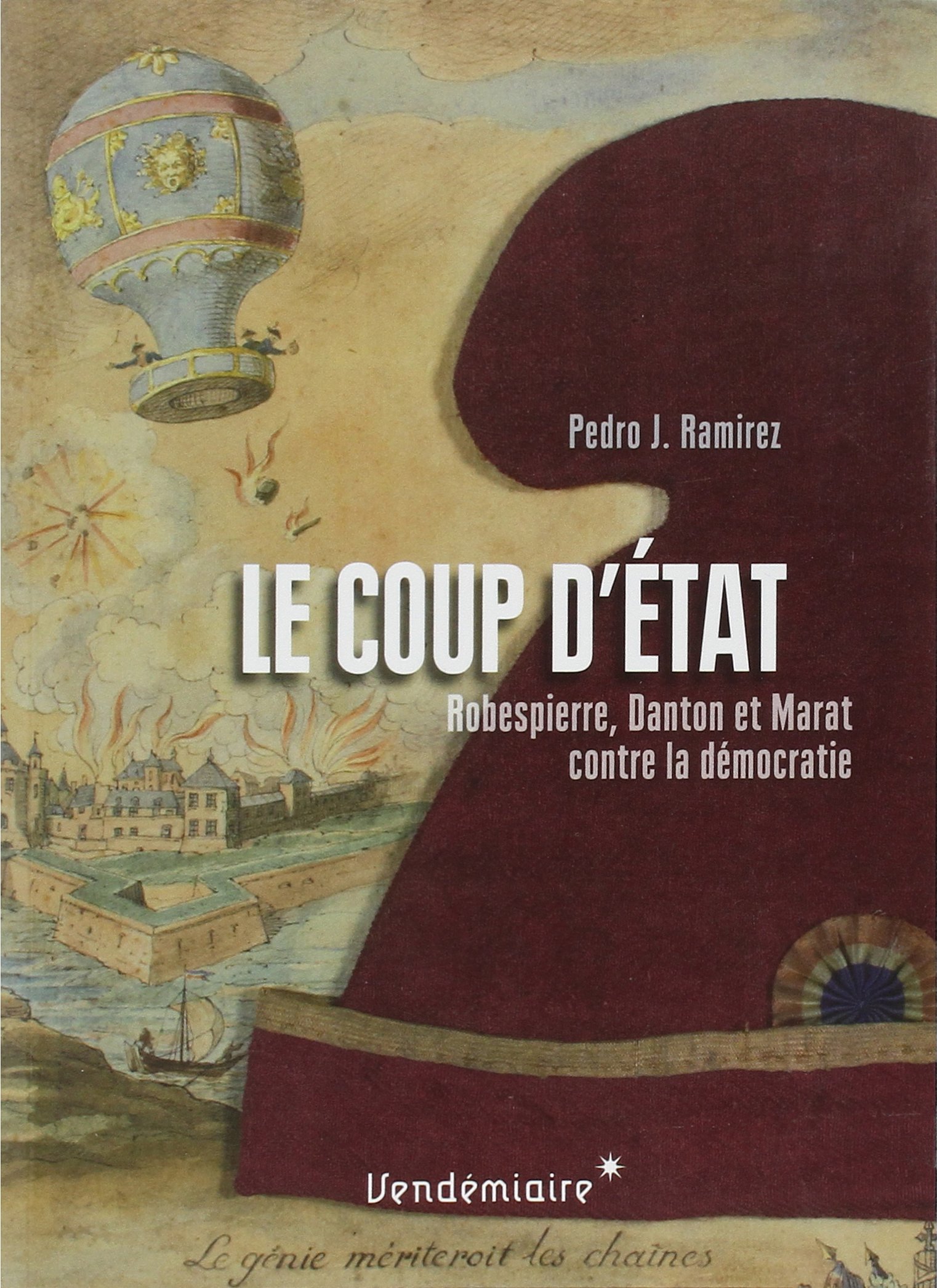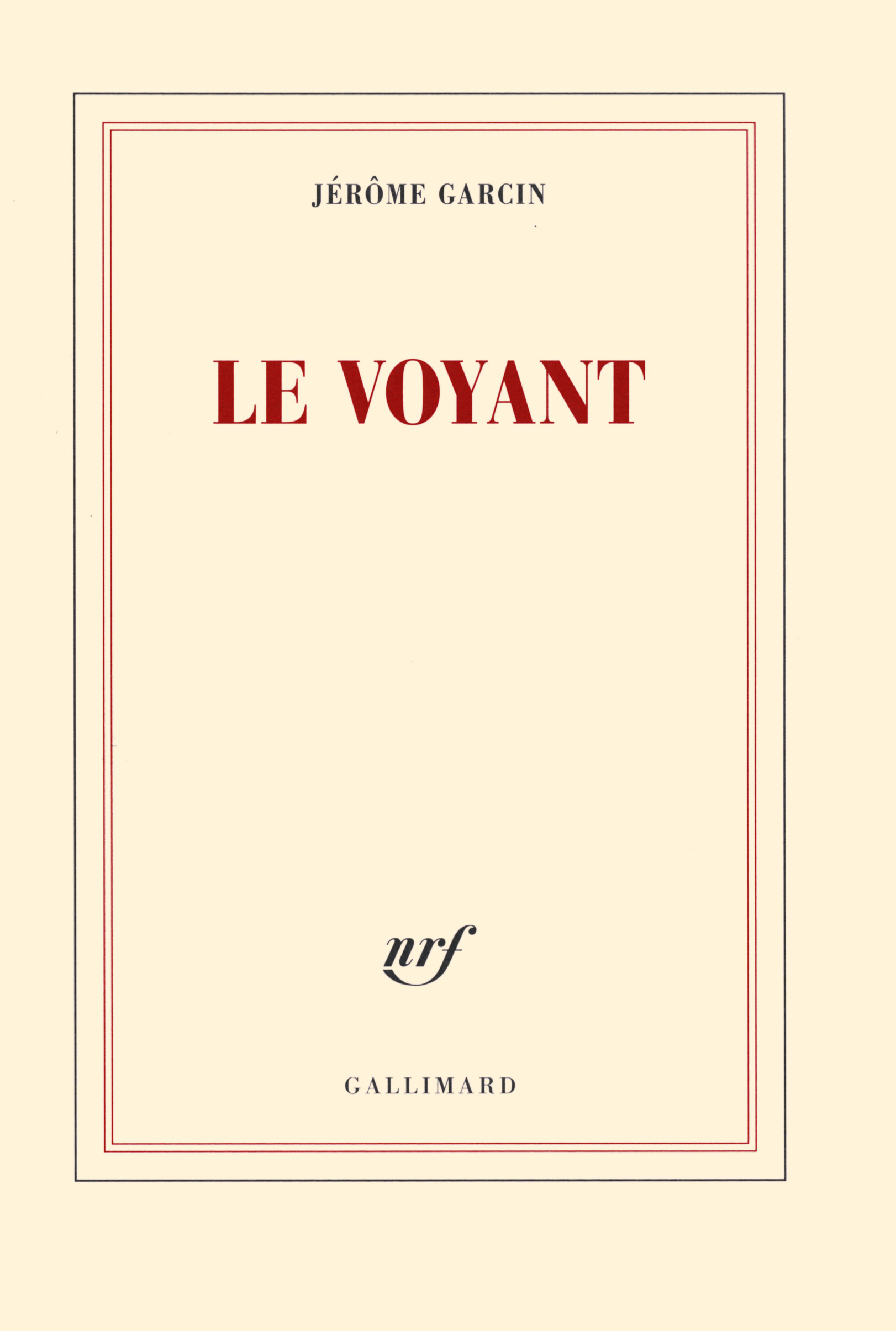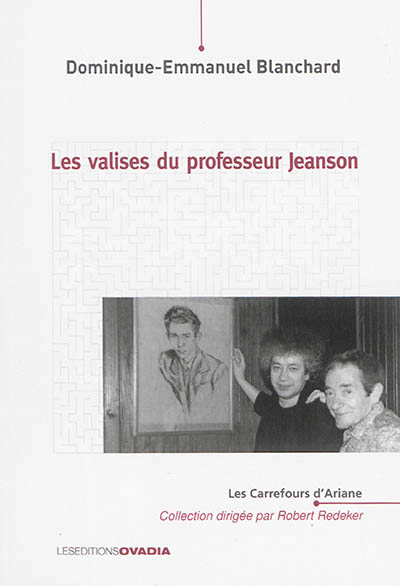Jérôme Garcin achève sa trilogie héroïque. Il y a eu son « Pour Jean Prévost », voilà vingt ans. Son « Bleus horizons », en 2013, ressuscitant le poète Jean de La Ville de Mirmont foudroyé, à 28 ans, dans les premiers mois de la guerre de 1914. Et voici « Le voyant » dont le héros est Jacques Lusseyran – cet intellectuel, aveugle dès l’âge de 8 ans, que sa cécité n’a pas empêché, bien au contraire, de fonder le réseau Volontaires de la Liberté et de devenir, à 17 ans, un héros de la France libre… Bien au contraire ? Eh oui ! Lumière de l’Idée. Œil de médium ou de cheval (ce qui, pour Garcin, revient presque au même). La conviction que c’est au-dedans, dans l’espace secret où, en chaque homme, cohabitent les vivants et les morts, que s’exerce le vrai pouvoir du regard. Le talent qu’il avait, face à une nouvelle recrue, de détecter l’âme forte ou le caractère incertain. Ou ce très beau passage où on le voit, à Buchenwald, emprunter les yeux d’un compagnon de Block que les SS ont emmené. Garcin croit à la grandeur. Peut-être est-il l’un des derniers à s’intéresser encore à cette passe qui, en chacun, et chez certains de manière exemplaire, permet de devenir plus grand que soi. J’aime ces « Vies des hommes illustres » (mais illustres, en la circonstance, par lui et par sa plume) qui sont la preuve, répétée, que l’excellence humaine, la fraternité, le courage sont de ce monde. J’aime le fil qu’il tend, de livre en livre, au-dessus de l’abîme de médiocrité qui constitue trop souvent le fond de notre époque. Vous avez le choix cet été : la correspondance Morand-Chardonne, tome 2, ce monument de bêtise et de bassesse qui fait, lui aussi, grand bruit – ou la résurrection d’un écrivain oublié, grand par la vie autant que par les livres, qui a fini sa vie professeur aux Etats-Unis parce que la République a oublié, en 1945, d’abolir la loi vichyste interdisant la fonction publique aux « handicapés »…
Autre livre de reconnaissance et de piété, ces « Valises du professeur Jeanson » que Dominique-Emmanuel Blanchard consacre, chez Ovadia, à son ami Francis Jeanson. Car qui se souvient de Francis Jeanson ? Il fut le compagnon de Sartre. L’animateur, avec lui, des Temps modernes. Il a donné son nom au réseau qui, pendant la guerre d’Algérie, recueillait et convoyait les fonds à destination du FLN. Il fut également éditeur et auteur, lui-même, de plusieurs livres (dont « La vraie vérité », qui fut l’un de ces livres secrets, un peu culte, que se repassaient encore, quinze ans après sa parution, les khâgneux de la fin des années 60). Et il était toujours là, pendant la guerre de Bosnie, aux côtés de ceux de ses cadets qui livraient bataille, une nouvelle fois, contre les forces coalisées de l’aveuglement volontaire, du renoncement néomunichois et, en Serbie, du néofascisme. Que cet homme soit si complètement oublié, que le nom d’un intellectuel à qui il est, certes, arrivé de se tromper (l’exécution, en 1952, de « L’homme révolté » d’Albert Camus) mais qui n’a manqué aucun des rendez-vous que l’histoire contemporaine a fixés aux femmes et hommes de sa génération (Blanchard insiste sur son engagement, à la fin de sa vie, dans le champ de la psychiatrie et de la misère sociale) en dit long sur l’amnésie programmée qui semble être l’une des lois de notre âge sombre. Mais qu’un écrivain plus jeune ait consacré des années de sa propre vie à reconstituer le puzzle de cette existence, à en restituer la part de cohérence mais aussi de mystère et d’égarement, à recueillir, enfin, alors qu’il avait 80 ans passés, le dernier témoignage du jeune penseur et homme d’action que Jeanson resta jusqu’au bout, voilà l’un de ces beaux et nobles gestes qui me réconcilient, aussi, avec l’époque.
Et, puisque j’en suis aux remords, un autre livre dont je me promets de rendre compte depuis des mois : celui que le fondateur et ancien directeur d’El Mundo, Pedro J. Ramirez, consacre à la Révolution française et à ce moment, si particulier, où le « bloc » se fracture et où l’insurrection des droits de l’homme accouche de la Terreur. Ce « Coup d’Etat » (éd. Vendémiaire) fait 1 000 pages. C’est un texte étourdissant, d’une érudition que l’on n’attendait pas d’un historien non professionnel et, de surcroît, étranger. Mais tout y est. Les grands épisodes et les incidents apparemment dérisoires. Les motivations des uns et les arrière-pensées des autres. Les conspirations. Les vengeances. L’écho des champs de bataille dans les salons et des salons dans les cercles des polices secrètes. Marat entrant dans l’hémicycle le front ceint de lauriers comme un triomphateur romain – et la naïveté de Vergniaud qui sait pourtant, mieux que quiconque, qu’il n’y a de coupables que les vaincus. L’opportunisme d’Hérault de Séchelles. Un certain Louis Antoine de Saint-Just, à peine sorti de l’adolescence, mais animé de l’« inhumanité tranquille » propre aux enfants soldats d’aujourd’hui. L’obsession des masques à arracher. La suspicion généralisée et devenue comme un moteur qui s’emballe. Une erreur fatale de Madame Roland. Une soirée au théâtre du député Genissieu. Si Dumouriez est un moderne Brennus et la vraie nature de ses liens avec Brissot. L’influence des revendications salariales du bourreau Sanson sur l’accélération du rythme de la guillotine. La haine partout. Les alliances qui se font et se défont au nom de la vertu. Cet instant d’inattention où Danton ne songe qu’à son mariage avec une jeunesse alors que son sort se scelle à la tribune de la Convention. A méditer si l’on pense, comme l’auteur et comme moi, que la grande Histoire se fait aussi avec des passions. A lire absolument si l’on croit, en Histoire, aux grands hommes et au hasard.