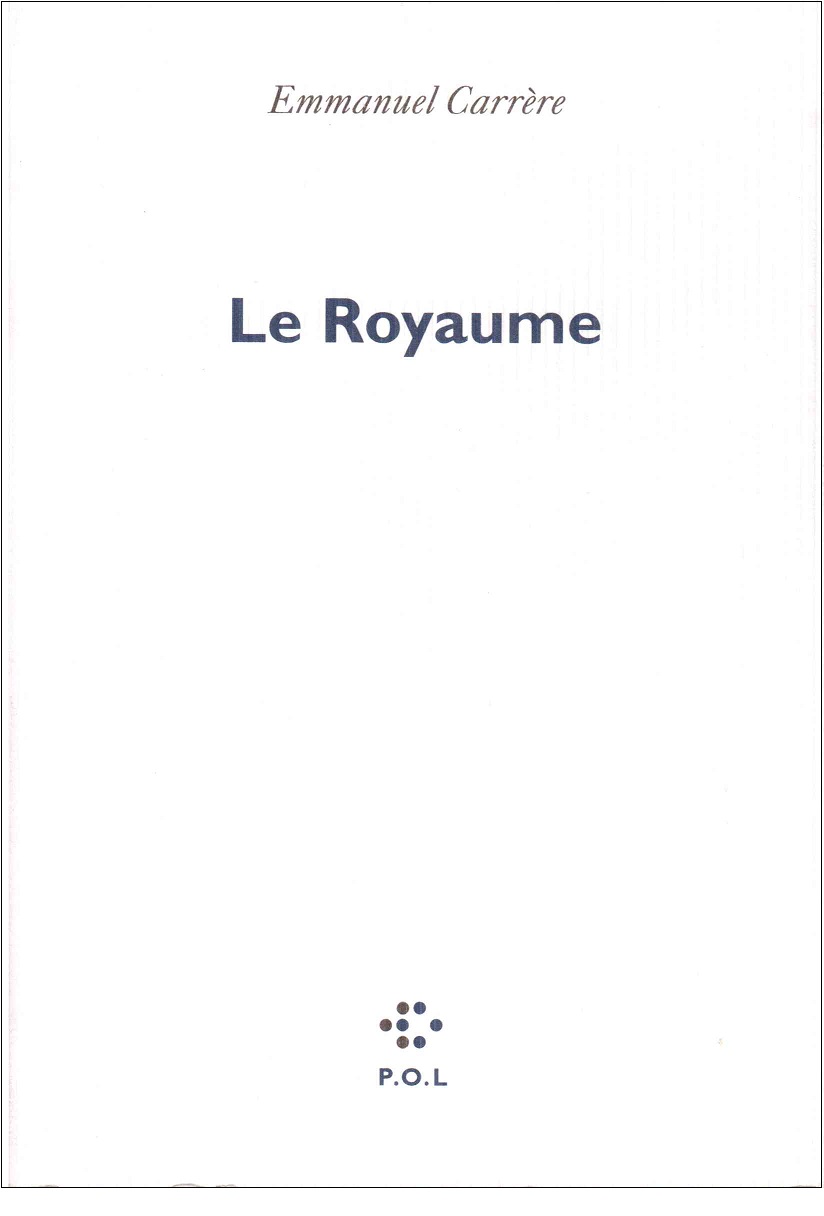Toute réflexion sur son propre art d’écrire est une projection. Emmanuel Carrère, dans Le Royaume, choisit comme plaque de réflexion saint Luc. Luc, le compagnon de Saul-Paul, le rédacteur des Actes des apôtres, le médecin macédonien, le patron des peintres. Luc, le seul goy parmi les évangélistes et, selon Carrère, le plus inventif et le plus sensible. C’est dans l’évangile de Luc que l’on s’attarde sur l’enfance du Christ, ou que les paraboles sont parfois redondantes. Luc fait œuvre d’historien, mais il est aussi conscient de raconter une histoire. Dans les Actes des apôtres, il est aussi témoin direct, ou, lorsqu’il relate des épisodes auxquels il n’a pas assisté, il les tient, sans aucun doute, de témoins directs et fiables de l’entourage de Paul.
Luc, donc. Luc et Emmanuel. Plus que Paul ou Jean, très présents, et plus encore a fortiori que Philippe ou Marc, ou Timothée, ou Flavius Josèphe, ou encore Sénèque, qui jouent des personnages de plus ou moins d’importance dans Le Royaume, c’est bien Luc qui a la plus belle part. Emmanuel Carrère, à travers lui et par lui, s’interroge non seulement sur les premiers temps du christianisme, mais surtout sur la conduite que l’on peut donner à un tel récit.
Difficile d’y échapper depuis quelques jours : Emmanuel Carrère est à la une de Télérama, de Lire, du Magazine littéraire. Le Royaume est mis partout en avant comme LE livre de la rentrée, alors même qu’il a peu de chance de remporter un des grands prix d’automne, puisque le roman précédent, Limonov, a obtenu le Renaudot en 2011. Pourquoi un tel déferlement, une telle presse, unanime ? [1] Parce que l’homme est sympathique, l’auteur touchant de sincérité parfois maladroite, la réputation déjà bien établie, et le sujet traité ample et assez peu couru.
On le sait, donc, puisqu’il a été impossible d’échapper aux bonnes feuilles et aux entretiens, Emmanuel Carrère raconte sa crise de foi. Durant trois ans, il a été croyant, et plus que croyant : dévot. La foi du converti, ravageuse, renversante. Messe chaque jour, chapelet dans la poche, prières murmurées, angoisse de savoir si l’on est prêt à recevoir la communion… Durant cette période, sa marraine Jacqueline l’a accompagné avec force et tendresse. Elle a tenu pleinement son rôle de marraine : instruire et guider son filleul sur la voie. Et lui a présenté Hervé, son autre filleul, qui devient l’ami indéfectible d’Emmanuel Carrère, même après qu’il a cessé de croire. En même temps que sa conversion, Carrère poursuit une cure psychanalytique. Le récit de cette période de chamboulements occupe la première partie du Royaume, les 142 premières pages. C’est le récit assez déprimant d’un déprimé.
Depuis la publication de L’Adversaire (P.O.L., 2000), Carrère a abandonné le roman d’imagination. L’affaire Romand l’a occupé de longues années. Mais en amont, déjà, l’écriture de fiction s’éloignait. Sans doute, avec La Classe de neige (P.O.L., 1995), avait-il atteint une certaine limite fictionnelle. Et sa biographie de Philip K. Dick, Je suis vivant et vous êtes morts (Le Seuil, 1993), le mettait déjà sur la trace d’une personnalité hors-normes. Le Royaume s’inscrit dans cette deuxième veine, une veine où l’intime de l’autre ne peut être approché qu’à partir de son intimité propre. Carrère explique que pour écrire L’Adversaire, il était hors de question de prêter à une personne réelle, Romand, emprisonnée pour des crimes horribles, des pensées qui auraient pu retourner l’individu pour en faire un personnage. Cela suppose, de la part de l’auteur, une réflexion sur la manière d’écrire. Carrère choisit le « je », l’intrusion personnelle dans le récit.
Dans Le Royaume, l’approche de Luc est similaire. Même si l’auteur n’est plus croyant, s’approcher de Luc et des premiers chrétiens relève, si ce n’est du sacré, au moins du gigantesque. Rien moins que les fondements de la culture et de la mentalité qui sont en vigueur dans une grande, très grande partie du monde. Carrère se projette, sans se cacher, sur Luc, et son récit est parsemé de « j’imagine que », « sans doute », « il me plaît de croire que », « je suis convaincu que », « je ne sais pas ». L’intrusion personnelle dans le récit se double parfois de distorsions, ou d’ajustements. Carrère va jusqu’à expliquer pourquoi il choisit telle hypothèse plutôt qu’une autre là où les chercheurs sont divisés. À propos de la datation de la rédaction de l’Apocalypse, il écrit :
Pour Renan, cela crève les yeux : l’Apocalypse a été écrite pendant cette année de chaos planétaire [= l’année 68]. […] D’autres historiens penchent pour une datation de trente ans plus tardive […]. Bien que la seconde école soit majoritaire, je me rallie à la première parce que l’Apocalypse, sinon, sortirait du cadre temporel de mon livre, or je voudrais parler de l’Apocalypse. (p.504)
On ne peut revendiquer plus clairement, et peut-être plus naïvement, la primauté du récit sur l’intention historique, même si les experts ne sont pas d’accord entre eux. Carrère ne discute pas les recherches, ne confie pas à son lecteur les termes de la dispute sur la datation. Non. Il choisit la première solution parce que ça l’arrange. Il faut qu’il parle de Patmos. Parce que c’est à Patmos qu’il est en train de rédiger ces lignes. L’épisode de l’île grecque est d’ailleurs assez sidérant : en quelques pages serrées, on passe de Jean à Ulysse, de Patmos à Ithaque, de l’Odyssée à la descente au village en scooter, de Pénélope à Hélène – pas celle de Troie, mais l’épouse de l’auteur. Toute la démarche de Carrère sur le récit se trouve condensée dans cet épisode. Il n’y a pas vraiment de passage d’un monde à l’autre, ni d’une époque à l’autre, mais il n’y a pas non plus fusion des deux. La projection vaut pour l’auteur, peut-être pas pour le lecteur.
L’une des caractéristiques les plus surprenantes du Royaume est la comparaison anachronique. Sans doute par souci pédagogique, pour que le lecteur candide visualise, ou comprenne immédiatement, des lieux ou des faits datant des quatre-vingt dix premières années de notre ère. Le procédé est efficace, parfois un peu lassant. On croise ici ou là Ben Laden, Staline, Poutine, Lénine – les allusions au système soviétique et à l’actualité récente de la Russie sont des constantes dans le livre, pour au moins deux raisons : le tropisme certain de l’auteur vers l’Est, qui renvoie aussi à une histoire familiale ; et les luttes de pouvoir dans l’ancienne URSS, emblématiques de la conduite d’un empire, et parlantes pour le lecteur contemporain. Le procédé tourne au système dans le dernier quart du livre, singulièrement dans les allusions littéraires. « Je l’imagine tâtant le terrain, s’y prenant comme les tantes du narrateur qui, dans À la recherche du temps perdu, aimeraient bien remercier Swann qui leur a envoyé un cadeau… » (p.456) et, page suivante, « Luc remballe son rouleau : autant vouloir charmer Emmanuel Kant en lui lisant La Chèvre de monsieur Seguin » (p.457).
Il y a des motifs d’agacement, c’est vrai, à lire Le Royaume. Mais le lecteur est indéniablement emporté par ce récit qui alterne, ou mêle, les premiers temps du christianisme et l’intimité de l’auteur. On pourrait croire l’histoire connue, les voyages de Paul, Pierre à Rome, la différence entre un Samaritain et un Pharisien, Massada [2], Titus et Bérénice, etc. Détrompons-nous. Un tout petit sondage amical et sans malice autour de nous peut révéler des surprises. Le Royaume est aussi – avant tout, peut-être – le récit bien documenté d’une époque historique largement méconnue, qu’Emmanuel Carrère mène avec scrupules, sincérité et sensibilité.
Notes
[1] Notons, cependant, le jugement discordant de Pierre Assouline dans son article « L’égo-péplum d’Emmanuel Carrère », sur le site de La République des livres (http://larepubliquedeslivres.com/lego-peplum-demmanuel-carrere/)
[2] Puisqu’Emmanuel Carrère cite l’ouvrage dans Le Royaume, je voudrais ici rendre hommage à Pierre Savinel, le traducteur de La Guerre des Juifs de Flavius Josèphe (éd. de Minuit, préface de Pierre Vidal-Naquet). Pierre Savinel a été mon professeur de lycée et de classe préparatoire. L’étude de la pièce Bérénice de Racine, avec lui, reste un très grand souvenir.