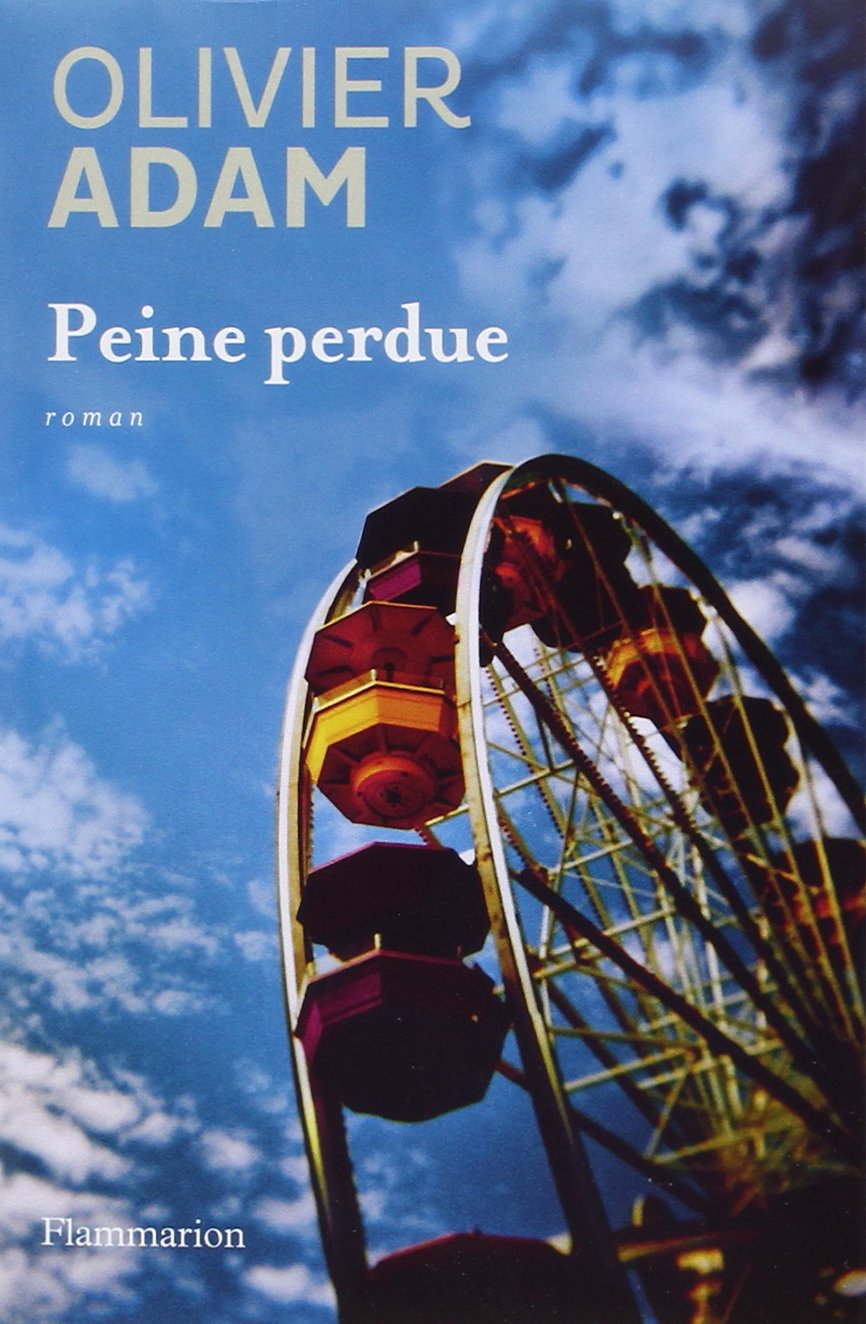Plus d’une vingtaine de personnages font entendre leur voix dans le roman d’Olivier Adam Peine perdue. En fait, ce ne sont pas leurs voix que l’on entend, mais celle d’un narrateur qui les observe, et qui les aime. Aucun des personnages ne s’exprime au sens strict du terme. Chacun est donné à voir – à lire, à déchiffrer – selon son angle propre, sans jamais dire « je », de chapitre en chapitre. La vie hors-saison d’une petite station balnéaire du Var est disséquée. Coincée entre la mer et l’Estérel, entre Marseille et sa mafia locale et Nice et sa mafia exotique comme autant de points cardinaux, la petite ville, jamais nommée, est secouée par deux cataclysmes : l’agression contre un joueur de foot, et une tempête.
Olivier Adam s’intéresse aux sans-grades. Aux gens qui sont la société, pas à ceux qui la modèlent et la broient. Il s’intéresse aux broyés, ici de façon très claire. Quand les touristes sont repartis, les parasols repliés, les transats rangés, il ne reste plus que le petit peuple qui se démène et tente de s’en sortir. La majorité des personnages qu’Olivier Adam met en scène appartiennent à la génération des trentenaires. Hommes et femmes, ils vivent chichement d’emplois modestes – femme de chambre dans un hôtel, vigile, chauffeur de bus… – quand ils en ont un. Ou de petites magouilles, de petits boulots, bungalows à repeindre, paillotte à entretenir. Ils vivent dans des HLM, ou des HLM améliorées décrétées « résidences », mais le luxe n’est pas pour eux. Le luxe, le fric, se décline sur les hauteurs, dans les belles villas surplombant la mer, inoccupées hors-saison. Une exception : une femme vit là à demeure, dans sa villa, c’est un écrivain.
La petite station balnéaire vit donc, dans le roman, deux cataclysmes concomitants. La tempête emporte et rejette des corps, pas tous. L’équipe de foot de la ville s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France, et voilà que son joueur vedette, le seul sans doute à pouvoir donner du fil à retordre aux Canaris nantais, les futurs adversaires, est tabassé à coups de batte de base-ball et se retrouve à l’hôpital, dans le coma.
La misère serait-elle moins pénible au soleil ? Et puis, quel soleil, d’abord ? Ce recoin varois que nous dépeint Olivier Adam est gris, la mer y est comparée plusieurs fois à une plaque d’aluminium, rigide, hostile. Et puis, quelle misère, au fond ? Les petites vies des petites gens ne sont pas seulement déglinguées à cause des fins de mois difficiles, des hébergements précaires et de la soumission au cacique local, un type nommé Perez qui se la joue Bernard Tapie. Les petites vies s’effilochent comme les grandes : séparations, divorces, pères se désespérant de ne voir leurs enfants qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances, incapacité à démêler l’essentiel de l’accessoire, rêves d’enfance biaisés et brisés, avenir trouble. La misère des personnages de Peine perdue – mais le mot « misère » est excessif, il n’est employé ici que pour reprendre le refrain d’Aznavour – est avant tout un inconfort existentiel : on a trente ans, ou un peu plus, ou un peu moins, on a mis des enfants au monde et on les aime, on n’est pas sûr d’être à la hauteur de la tâche ; on est un vieux couple et l’un des deux va mourir, et l’on ne peut survivre au départ de l’autre ; on est flic et l’on bosse au soleil, mais on sait que cette mutation n’est pas une promotion, que les bons flics exercent ailleurs.
Deux figures émergent de ce roman choral. Léa, en premier lieu, nous semble-t-il. Elle est l’incarnation d’un absolu. C’est une jeune fille de bonne famille, que ses parents ont installée à Paris pour qu’elle y poursuive ses études, et qui est tombée amoureuse d’un camé. Amoureuse et plus que cela. Elle a trouvé en Abel son alter ego, et sa raison de vivre. Lorsqu’il meurt d’une overdose, Léa meurt aussi, à sa façon. Elle disparaît. Dans le mutisme, et dans la fuite. L’autre figure est Antoine, le footballeur agressé. Un type en qui bout une force néfaste, un joueur doué qui aurait pu devenir le nouveau Zidane, mais que les recruteurs des grands clubs ont toujours écarté de leurs listes parce qu’il est imprévisible. Le roman est bâti autour d’Antoine, autant dire autour du foot, ce sport éminemment populaire. L’équipe de la petite station balnéaire est le « petit Poucet » de la Coupe, et cette expression résume à elle seule tous les destins du roman. Pas le petit Poucet du conte, le débrouillard, le sauveur. Mais les petits tout courts, démunis, faisant face comme ils peuvent, gagnant parfois et atteignant la demi-finale, mais retournant ensuite à leurs petits destins.
On ne doute pas un instant, dans Peine perdue, de l’empathie d’Olivier Adam envers ses personnages. De la fraternité qu’il exprime et communique au lecteur. Le motif du frère est d’ailleurs prédominant dans les rapports que les personnages entretiennent entre eux. Léa, encore elle, pense à Abel, son amour, comme à un « frère ». Olivier Adam donne à ses personnages, dans les chapitres qu’il consacre aux uns et aux autres, une manière de penser différenciée. Dans l’écriture, on les sent vivre et exister. L’auteur est au plus près d’eux [1], attentif, patient, compassionnel.
On sort de la lecture de Peine perdue comme on sort d’un film des frères Dardenne. Un peu sonné, persuadé qu’il y a là une part, et plus qu’une part, de réalité sociologique et psychologique. Mais on en sort désespéré. Et puis ensuite, on pense, peut-être, que Guédiguian aurait donné à cette portion de Var une vie plus vibrante. Olivier Adam s’intéresse aux « lisières ». Dans Peine perdue, il se place aux lisières du territoire, en bord de méditerranée. Là où le vote FN semble aller de soi, là où les axes se désaxent, où la droite est le centre, où l’idée de conscience politique est arasée par les tourments d’un quotidien où ne luisent que peu de lueurs d’espoir. D’une réalité objective Olivier Adam sait faire émerger un romanesque sensible.
Notes
[1] Lors de l’émission Les Bonnes Feuilles de Sandrine Treiner et Augustin Trapenard (France Culture, septembre 2014), Olivier Adam a fait référence à Carver (« écrire à hauteur d’homme ») et à Henri Calet (« écrire à ras d’homme »).
Peine perdue : La trentaine broyée
par Christine Bini
15 septembre 2014
[Rentrée littéraire] Après « Les lisières », Olivier Adam revient avec « Peine perdue ».