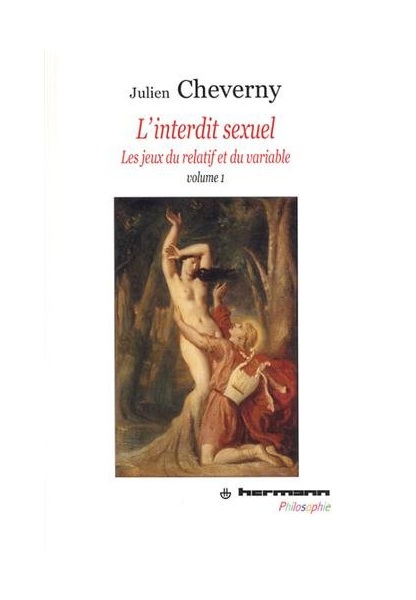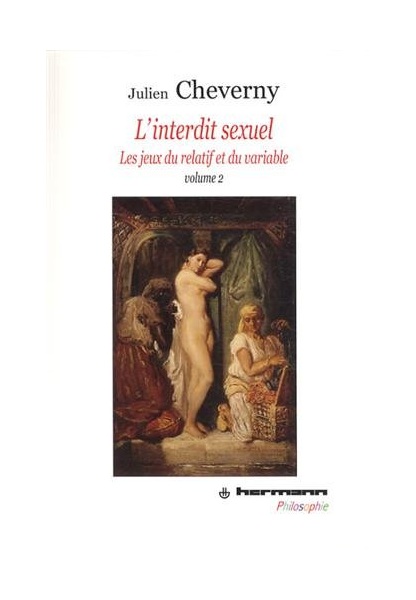Julien Cheverny (alias Alain Gourdon) publie une somme intitulée L’Interdit sexuel, les jeux du relatif et du variable[1] comprenant 640 pages. Son premier tome parcourt quelques quatre millénaires et demi puisqu’il part de l’Egypte ancienne, pour remonter par le peuple hébreu avec sa Torah puis par l’Inde avec sa philosophie des várna — signifiant en sanskrit « couleur » — ou ordre socio-religieux, que l’on traduit par caste, et du karma, le destin, jusqu’à l’islam, chacune de ces grandes familles religieuses étant l’objet d’une étude critique poussée depuis hier jusqu’à aujourd’hui. La Grèce antique est aussi largement présente au cours des premiers chapitres (près de 100 pages, soit un tiers du premier vol) mais aussi Rome. Impasse est toutefois faite sur la Chine, en particulier — mais pas sur l’Afrique.
Comment au cours des siècles l’interdit sexuel fut-il vécu, compris, affiné dans les différentes traditions du monde sémitique comme du monde européen, est LA question qu’appréhende l’auteur.
Le premier chapitre de cette somme « En deçà du Même et d’Autrui » nous conte la sexualité sous l’Égypte qui ne répugnait pas à l’inceste du père avec sa fille, moins encore du frère avec sa sœur. Pour les Égyptiens de l’Antiquité, la zoophilie seule fut considérée comme une dépravation.
Dans l’introduction générale aux deux volumes, la problématique de Julien Cheverny est clairement exposée : « Toutes les civilisations ont cherché à régler les mœurs sexuelles et ont institué des interdits pour régenter et ordonner la vie des êtres humains. Le présent traité examine les interdits majeurs et leur restitue leur sens : comment comprendre la prohibition de l’inceste en Occident ? Quel est l’enjeu de l’interdiction de pratiques homosexuelles en terre d’Islam ? » Ce sont là quelques-unes des questions majeures que pose le traité qui se veut une étude comparative et critique des thèses à travers Foucault ou Lévi-Strauss notamment.
Ce sont les Grecs après les Hébreux qui réglementèrent la vie et les pratiques sexuelles dans le monde méditerranéen puis en Europe. Platon après Moïse prohiba l’adultère, mais celui-ci prohiba pour la première fois un grand nombre de pratiques depuis l’homosexualité jusqu’à l’accouplement entre toute personne ayant un degré de parenté jugé incompatible, tel le neveu avec sa tante, etc. À ces interdits, fut ajouté bien des siècles après, dans l’Europe chrétienne, la polygamie de façade tout du moins. Mais dans toute cette analyse critique de l’interdit sexuel, il faut aussi resituer ces lois à l’époque où elles sont advenues comme principes fondamentaux pour une vie dans une société orientée vers une transcendance, un rapport à un ordre supérieur, divin, et ce faisant, constater le progrès moral que chaque interdit apportait avec lui.
On peut constater par exemple que peu de lois religieuses prescrivirent l’interdiction de la pédophilie, sauf naturellement dans le noyau familial.
Si l’inceste fut condamné en Grèce, Platon y voyait même « un objet de haine de la divinité » et « entre les choses les plus vilaines la plus vilaine qui soit » (74), l’homosexualité avec, dans la plupart des cas, la sodomie qui lui est liée avait acquis ses lettres de noblesse. Cheverny constate que « Pour un candidat d’ascendance illustre, ne pas être l’objet d’un amant déclaré prenait le sens d’une disgrâce ou d’une malchance, s’il ne constituait pas l’indice ou la résultante d’une mauvaise éducation » (84).
Si l’ensemble des interdits bibliques se sont retrouvés dans les morales chrétiennes et musulmanes, auxquels l’islam en rajouta d’autres, si souvent au détriment des femmes (j’y reviendrai), le catholicisme, pour sa part, suivi d’assez prêt par l’orthodoxie, y ajouta le célibat pour ses prêtres sous le pape Grégoire VII (1074) et l’abstinence pour les moines et les moniales (sans que l’on saisisse bien où commençait l’un par rapport à l’autre !). Remarquons toutefois que les prêtres des églises catholiques orientales sont souvent mariés.
Le chapitre que J. Cheverny consacre aux interdits bibliques est encadré justement par ceux consacrés à l’éthique sexuelle d’Israël d’une part, puis à l’éthique sexuelle de l’islam d’autre part. Dans ce dernier, nous retiendrons en particulier les pages sur l’excision et sur le statut de la femme en général. Il y a aussi beaucoup à dire sur la position du judaïsme radical, en Israël surtout, concernant les femmes, qui est tout simplement intolérable. Nous l’avons dit et redit. Cheverny écrit sur l’excision :
« L’homme cherche à susciter chez celle, qu’il a au préalable sexuellement mutilée, une admiration, qui le rassurera, en lui faisant oublier ses insuffisances propres » (217).
Ce n’est pas en vain que l’auteur de ces lignes rapporte ensuite celles de Germaine Tillion : « Très généralement spoliée malgré les lois, vendue quelques fois, battue souvent, astreinte au travail forcé, assassinée presque impunément, la femme méditerranéenne est un des serfs du monde actuel » (217-128). Ajoutons pour notre part : pas seulement la femme méditerranéenne !
Le constat qu’établit Cheverny sur les réformes à l’intérieur comme à l’extérieur du monde arabo-musulman (Pakistan, Bangladesh, Afghanistan mais aussi l’Inde à l’écrasante majorité hindoue) ne fait que constater une fois de plus la ligne rouge franchie par tant de pays du Sud (mais pas seulement), concernant le rapport accablant entre interdit sexuel et discrimination faite aux femmes.
L’interdit sexuel frappe davantage les femmes dans tous les pays ou communautés théocratiques alors même qu’elles demeurent les plus abusées — et ce quelque soient la religion, la culture, l’économie des pays, des peuples. Après les femmes, ce sont les enfants qui sont le plus abusés alors même que toutes les morales religieuses comme laïques ont inscrit dans leur loi leur respect et leur dignité à part entière.
Cheverny cite cette description terrible de Lawrence Durrel à propos du sort des femmes dans l’histoire : « Pendant des siècles, elles ont été parquées avec les bœufs, marquées, circoncises, nourries de confitures et de graisse rance, elles sont devenues des cuves à plaisir, ondulant péniblement sur des jambes blanchâtres, sillonnées de grosses veines bleues » (219).
Entre les religions de l’Antiquité et les temps modernes, l’évolution de la conscience de l’interdit n’est plus séparable du niveau de libération de la femme car, dans toutes les sociétés, ce sont les hommes qui, dans une écrasante majorité, légifèrent et ce sont toujours eux qui l’ont fait dans l’ordre religieux.
Cheverny soulève un cas passionnant d’un interdit de principe qui, sous certaines conditions, devient un principe positif. Certes cela reste attaché à une spiritualité propre, le judaïsme, mais existe aussi dans quelques autres traditions fort minoritaires. Si coucher avec son beau-frère pour une épouse « participe de l’adultère comme de l’inceste », cette « double violation de l’interdit » tombe si le frère meurt et que la femme dans un commun accord avec l’intéressé, cela va sans dire, veuille épouser l’un de ses frères, comme le recommande le principe du lévirat, car dans le judaïsme, faire des enfants est un devoir sacré même pour un mari défunt.
Sur toutes ces questions et bien d’autres, l’auteur propose une analyse comparatiste des travaux de Freud et de Murdock, comme celles de Foucault et de Lévi-Strauss. Ce qui peut étonner le lecteur de cette véritable somme, c’est le peu de cas fait au viol comparé à la place consacrée dans chaque partie à l’inceste autant qu’à l’adultère, pour ne pas parler de l’homosexualité. Car enfin, le viol est l’une des pires violences subies par les femmes d’un bout à l’autre du monde, qui ne fut ni n’est licite dans aucune civilisation — même si certaines justices dans certains pays ont trop eu tendance à fermer les yeux devant les plaintes des victimes — surtout quand elles sont des femmes.
Par ailleurs, l’interdit sexuel au-delà du sens premier a des sens obvies. Dans tant de religions les femmes n’ont pas le droit de prétendre au statut de prêtre, de rabbin, d’évêque, de brahmane (sauf dans les mouvances libérales ou « massorti », dans le judaïsme en particulier). Dans certaines, elle peut, certes, être vénérée comme une sainte voire comme la « Mère » de Dieu. Elle n’en accède pas pour autant à la prêtrise.
Une femme grand rabbin ou Pape serait merveille… On ne peut qu’être révolté contre le pouvoir phallique dont les hommes en religion (comme partout) usent avec une si bonne conscience depuis tant de millénaires.
Vers la fin de son livre, Julien Cheverny livre une réflexion profonde qui fait débat et qui problématise la question du licite/illicite à propos de la prostitution, de l’avortement allant jusqu’au « droit à la procréation incontrôlée des handicapés ». L’un des constats de l’auteur est que notre société permissive n’est plus une « société érotique » mais « désérotisante(…) d’abord en raison du recul des interdits et des transgressions qui les atteignent, elle l’est aussi, dans la mesure où, moins il y a de relations prohibées et d’actes défendus, moins il y a de chances pour que la preuve de l’affection amoureuse passe par l’échange sexuel » (335).
Le constat est grave, qui ne donne que plus de poids sans doute aux inflexibilités des tenants des religions, mais cela excuse-t-il ces hommes qui s’en sont déclarés unilatéralement depuis des millénaires les gardiens de l’auctoritas, contraignant la femme dans un rôle qui n’a rien de prédestiné mais qui est, au contraire, intolérable au regard de le vraie foi autant qu’au regard de la morale laïque la plus haute, qui est impartiale et ne doit à aucun moment faire cas du genre dans la répartition des pouvoirs?
La somme de Julien Cheverny ouvre là un débat des plus capitaux, car il y va de l’avenir de notre civilisation.