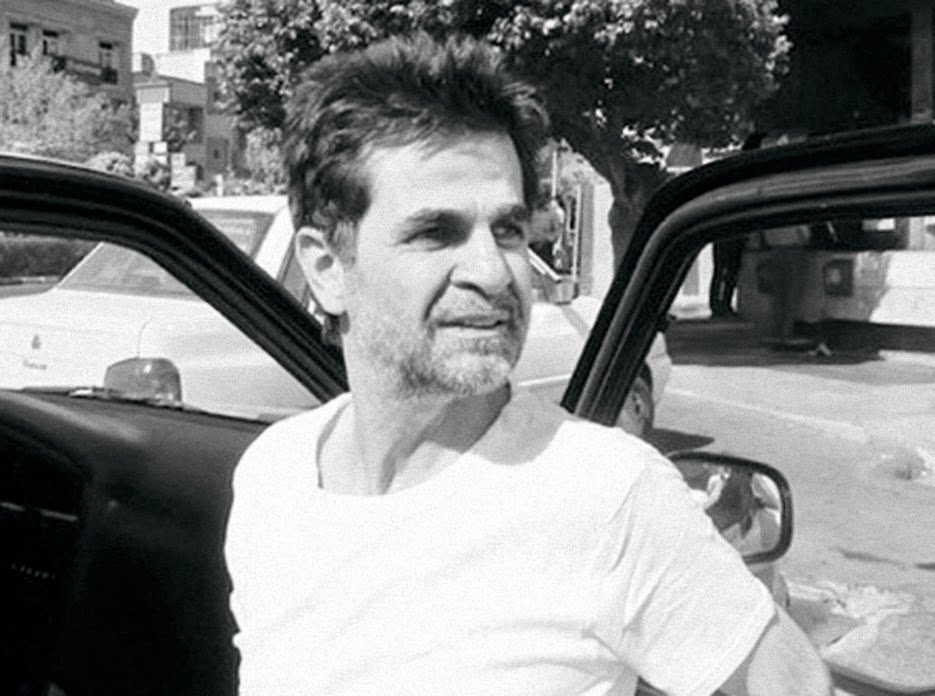On a longtemps tenu Quentin Tarantino pour un crétin génial, mais je crois qu’insensiblement, son statut tient désormais de celui de génie débile. Qui est vraiment Quentin Tarantino ? Tout a commencé quand on a découvert le boutonneux au physique de lycéen de cinéclub, et son « Reservoir Dogs », puis son « Pulp Fiction » : la critique a d’abord adoré, avec une condescendance admirative, ce brillant pasticheur au propos délicieusement creux, capable d’étirer à l’infini des dialogues sur la signification de « Like a Virgin ». Il faisait des « parodies », des « films de genre » aux références multiples, sans aucune vision du monde : la quintessence de la post-modernité, c’est-à-dire ce recyclage, ressasage du passé, convoqué sans révérence ni respect, dans l’ordre et le désordre, mais au sein d’un être-au-monde fait d’hyper-lucidité, d’hyper-ironie, et confronté à l’absence d’idéal pour l’avenir, à l’impossibilité d’inventer un futur (je ne sais pas si Jean Baudrillard serait vraiment d’accord avec cette définition de la post-modernité. A mon humble avis, cependant, « Pulp Fiction » résume assez bien les défis du monde contemporain. Mais c’est un avis). Bref, pour la critique, et pendant vingt ans, Tarantino, cela ne voulait rien dire, mais c’était très amusant.
Et puis, tout à coup, Tarantino s’est mis à avoir des idées. Mon Dieu. Il a fait « Inglorious Basterds », où il y avait une quantité également excessive de génie et de désinvolture. Parce que c’était la Shoah, on a justement démontré à Tarantino qu’on ne pouvait s’amuser d’un génocide comme de la bedaine de Travolta. Et voilà, c’en était fait : d’idiot sympathique qui bavassait en s’amusant, Quentin Tarantino était devenu un styliste lyrique flamboyant, brillant metteur en scène, mais aux idées comment dire, hum… farfelues. Qu’il se taise, et nous refasse des films sans prétentions ! Mais Quentin Tarantino s’est entêté, et il a eu raison.
Car avec « Django Unchained » c’est toute la profondeur d’un immense cinéaste qui transparaît.
Car avec « Django Unchained » c’est, réussie, achevée, la programmatique d’« Inglorious Batserds », qui est réalisée.
La critique a commencé par présenter « Django » comme une parodie de western. La critique, c’est désolant, est donc restée arc-boutée sur l’ancien Tarantino, le nihiliste un peu gamin, un peu potache, qui, en effet, ne disait pas grand-chose et se contentait de singer les genres du manga ou du polar. Mais Tarantino, depuis les Basterds, a évolué. Du satiriste post-moderne qu’il était, il est devenu engagé. Et autant le dire immédiatement : Django n’est pas du tout un western. Le seul point en quoi Django est un western, c’est que sa fin est, légèrement, trop longue, comme dans tous les westerns. Pour le reste, la structure narrative n’est en rien celle d’un film où Clint Eastwood chique pendant trois heures un morceau de tabac (en gros : chute et rédemption d’un héros solitaire). Django a plus à voir avec les contes médiévaux : un héros, une princesse à sauver, un royaume maléfique, un dragon qui le hante. C’est d’ailleurs une référence explicitement évoquée à l’écran. Django a une structure narrative qui vous rappellera avec délices les schémas actanciels de votre enfance hypokhâgneuse : problème, odyssée, adjuvant, obstacles, final de retrouvailles. C’est bien plus une parodie de Lancelot et la Dame du Lac que de Sergio Leone. On y parle plus d’amour courtois, et de geste chevaleresque, que de cow-boy et de saloon. Et l’esthétique, picaresque, du compagnonnage brigand a plus à voir avec « La Grande Illusion » qu’avec « Le Bon, la Brute et le Truand ».
Ce qui est formidable, dans Django, c’est qu’avec ce canevas simplissime, Tarantino réussit à embaquer et émouvoir le spectateur pendant trois heures. On peut médire Tarantino, mais je ne connais personne d’autre qui, avec tant d’élégance, des plans aussi sublimes, des acteurs aussi incroyables, arrive à produire un concentré d’émotions pareil : rire, horreur, excitation, surprise. D’accord, il y a des scènes vraiment affreuses, avec vraiment beaucoup de sang. Mais le fait est que ce n’est pas grotesque, et c’est même très emballant. Il y a un moment où il faut reconnaître, derrière une faculté à nous faire avaler avec plaisir des litres d’hémoglobine, ce qui s’y cache réellement : un grand sens de la mise en scène.
Mais « Django », c’est bien plus que cela. « Django » , au-delà du spectacle époustouflant de beauté et d’émotions, au-delà des acteurs en état de grâce, au-delà des bandes-originales dingues, c’est une œuvre-monde, un quart-livre aux ambitions poétique, politique et morale, qui, cependant, comme tous les oignons ou les grands romans, ne s’épuise jamais dans cette triple lecture en forme d’effeuillage.
D’abord, parlons de l’atmosphère tarantinesque, faite de lyrisme brillant et de grandeur épique. On est dans le Sud et les champs de coton, écume crémeuse et incessante des capsules éclatées. Il y a des plantations, des fauteuils en osier, des après-midi étouffantes sous les galeries aux parquets cirés. Les gens parlent en perlant leurs phrases sur un ton bougon, comme dans les chansons de Johnny Cash. Ce sont les nuits « pleines de lucioles, de glycines, et d’odeurs de cigare » comme l’écrivait Faulkner. Vous avez l’impression de connaître ça par cœur ? Justement, c’est parce que cette mythologie Mississipi, bateau à roues et esclaves brûlés de soleil, c’est parce que cet univers-là, fait d’aristocratie de la servilité et de cases pour servantes girondes, ces horizons-là nous évoquent intimement et forcément la Case de l’Oncle Tom, c’est pour ce lien nécessaire dans notre imaginaire que Tarantino s’empare de ces paysages. C’est une entreprise unique de triangulation poétique : reconquérir un univers devenu, au fil des ans, l’apanage du Ku Klux Klan. C’est un travail, presque sémiotique, de reconquête mythologique : offrir aux esprits une possibilité de voir le Sud de l’époque, de l’autre côté de la cagoule.

Et puis, et surtout, Tarantino a un vrai projet politique : écrire, comme le disait Walter Benjamin, l’histoire du côté des vaincus. Car Tarantino fait un film contre le vieux Sud, se déroulant deux ans avant la Guerre de Sécession, mais un film qui n’est pas non plus du côté des futurs abolitionnistes. Il ne veut pas faire un film à la gloire des yankees patriotes, ces Lincoln qui ont certes émancipé les Noirs, mais pas non plus arrêté la ségrégation. Tarantino ne filme pas les cow-boys et leurs conquêtes, arrachées au prix du sang des Indiens, comme pouvait le faire les Leone ou les John Ford. Tarantino, lui, s’intéresse précisément aux oubliés de l’Histoire, aux damnés, aux sans-grades, ce sel de la terre au visage de Job. Car, pour citer encore Benjamin : « Ce sont toujours les héritiers des vainqueurs qui marchent sur les corps de ceux qui gisent à terre; l’historien y songe avec effroi et s’écarte autant que possible de cette transmission. » Pour autant, Django n’est pas Spartacus. L’histoire de ce Noir vengeur, qui va châtier les esclavagistes jusque au seuil de leurs plantations, ce n’est pas une épopée collective, qui, à son tour, infléchirait l’Histoire dans le sens d’un progressisme rénové (sur le mode : « je vais vous raconter la lente et glorieuse émancipation des Noirs »). Non, Django, c’est une fable anhistorique, qui parle pour les esclaves de toutes les époques, les Nègres serviles des présents répétés. D’ailleurs, très habilement, Tarantino tisse des liens, via la bande son et les costumes, avec la blackxploitation et l’esthétique rap des ghettos new-yorkais. La figure de Django, sa lutte vengeresse, émancipatrice, elle est donc hors du temps, allégorique, poétique, et, disons le, messianique. « Les luttes libératrices sont nourries par l’image des ancêtres enchaînés, plus que par celle d’une postérité affranchie »écrivait Benjamin, décidément insurpassable. Ainsi, vous l’aurez compris, il y a donc bien du Messie chez Django, et du tikoune chez Tarantino.
Mais au fait, n’est-ce pas choquant, de montrer ce spectacle atroce d’esclaves fouettés ? N’est-ce pas amoral, indécent, scandaleux, ces corps suppliciés ? Ces questions sont légitimes, et Tarantino y a longuement réfléchi. Il livre, dans Django, ses réponses en forme d’art poétique. Car notre génie du septième art a une vision cathartique du cinéma : en nous montrant la violence, la ségrégation, la haine, la vengeance, il veut purger nos cœurs enkystés de ces passions mortifères. Pour autant, a-t-on le droit de tout montrer ? N’y a-t-il pas des limites au théâtre des calvaires ? Vers le milieu du film, le personnage de Chritopher Waltz est confronté, à l’intérieur du récit, au même dilemme que Tarantino le réalisateur. Du microcosme au macrocosme, le problème artistique est ainsi élégamment résolu.
Car le personnage du Dr Schultz doit, pour pénétrer la plantation du méchant Di Caprio, faire jouer au personnage de Django le rôle d’un négrier. Un négrier : Schultz comme Django, ennemis de l’esclavage, sont horrifiés, et très mal à l’aise, à l’idée de singer ainsi l’incarnation du Mal. Django a du mal à rentrer dans le rôle, y mettant une sorte de distance. Peau noire, masques blancs. Arrive un moment de vérité : Di Caprio martyrise, pour s’amuser, un de ses esclaves, du nom de d’Artagnan. Il se tourne vers Django, censé être ce cruel négrier (mais c’est en fait, vous l’avez reconnu, le héros libre et rebelle, ce Noir insoumis que nous suivons depuis le début du film). Di Caprio nargue donc ce comédien de Django, un sourire mauvais aux lèvres, et lui demande : dois-je tuer le pauvre d’Artagnan, en faisant lâcher les chiens ? Et là, précisément Django se retrouve aux prises avec le même dilemme que Tarantino réalisateur : dois-je, pour la vérité du spectacle, sacrifier la morale et montrer l’immontrable? Django sait que, s’il sauve d’Artagnan, lui-même ne sera pas crédible en négrier. Alors, parce que l’intérêt supérieur de l’art l’exige (il faut que Di Caprio croie en cette fable pour que la comédie puisse se jouer, et la justice, triompher), Django abaisse son pouce, et d’Artagnan est déchiqueté. C’est une scène bouleversante, et très intelligente, qui montre avec éclat que Tarantino est un grand génie. Contre tous les jansénistes qui hurlent à la cruauté du théâtre, contre les nouveaux Saint-Augustin et les nouveaux Rousseau qui veulent censurer les représentations, Tarantino nous livre une ode à la catharsis, à l’art, au théâtre. Il démontre qu’il n’est pas insensible aux problèmes moraux que provoque son œuvre, et qu’il a, là-dessus, un avis très profond.
Ainsi, « Django » est passionnant à plus d’un titre. Tarantino, avec une élégance de style, un lyrisme flamboyant, une ironie de procureur, convoque les références, mélange les époques, découpe les concepts, manipule les analogies, dans un plaidoyer contre les fascismes universels, pour la fraternité humaine, et les pouvoirs de l’art à changer la vie et réparer le monde.
Quel beau programme philosophique, n’est-il pas ?