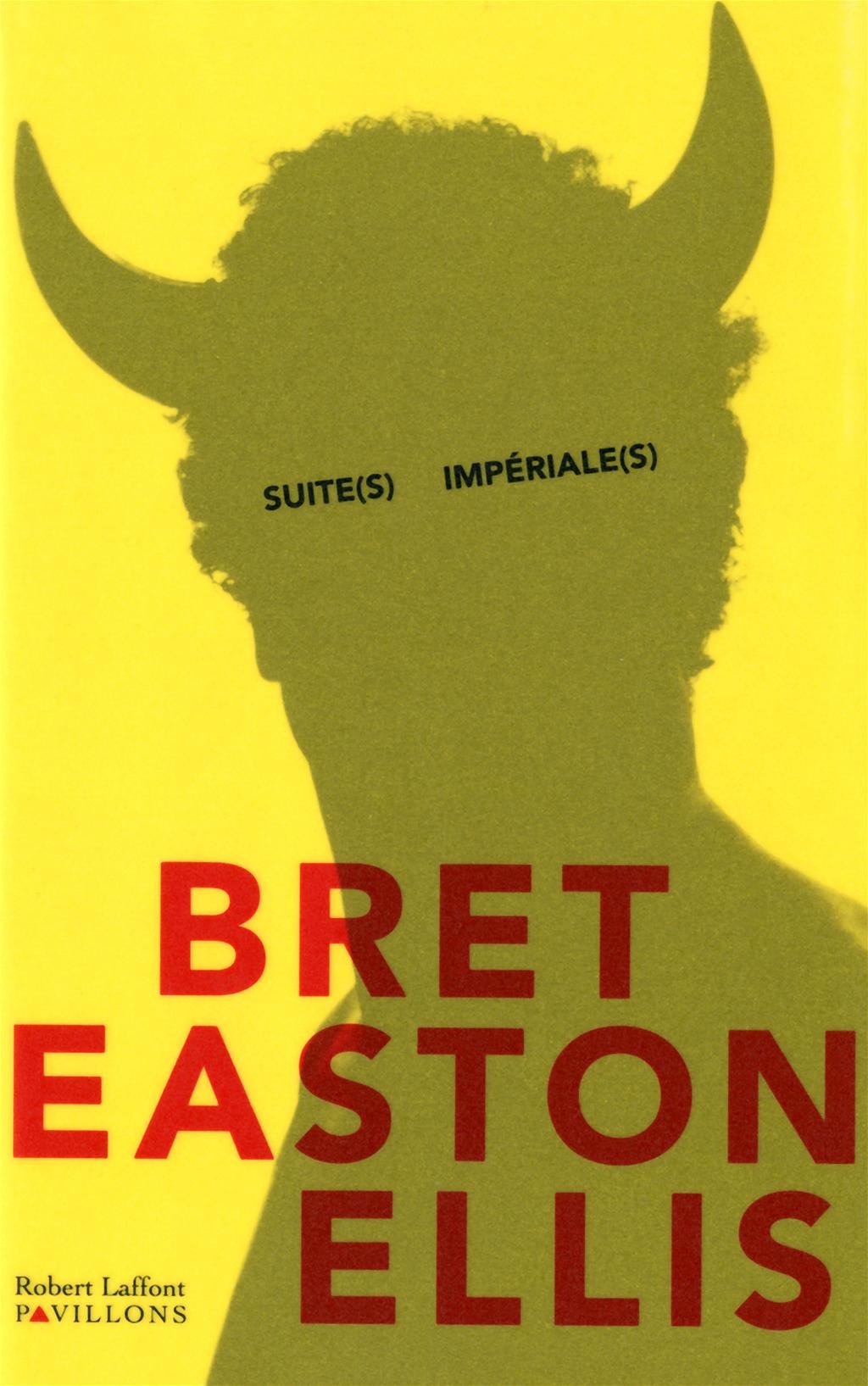On connaît désormais par coeur l’évangile selon Sollers (et moi probablement plus qu’un autre pour l’avoir bu pour ainsi dire au biberon) : plus personne ne sait lire, ou presque ; tout le monde oublie tout ; l’apocalypse est en cours, le nihilisme quotidien ; il faut refaire l’Encyclopédie de toute urgence… C’est sur base de ce constat sévère (si peu), outrancier (allons donc), un brin provocateur (?), ironique (oui/non/qui sait), que Sollers entre en campagne et engage sa Guerre du goût. Nous sommes en 1994, neuf ans après la publication de Théorie des exceptions. L’offensive, mûrie de longue date, prend un coup d’accélérateur. Au vu de la dévastation générale, les morts, au nombre desquels Hölderlin, Sade, Casanova, Mozart, Denon, Rimbaud (on vous laisse le soin de continuer la liste), sont, selon lui, les seuls personnages romanesques réellement dignes d’intérêt. Les seuls, ou presque. Le roman contemporain ? Ronron. L’âge d’or du roman, aujourd’hui ? Foutaises. Les vivants ? Des morts qui exploitent des morts qui sont plus vivants qu’eux. Il s’agissait (il s’agit encore pour moi encore que tout autrement) d’aller à l’essentiel.
J’ai assez vite adopté cette vision du monde. J’ai moi-aussi, modestement, participé à cette guerre (je songe ici à mon premier fait d’armes, “Le Testament d’Artaud” publié par les soins de Sollers lui-même). Je la trouvais donc, cette guerre, non seulement louable, mais juste et nécessaire. Je réfutais les arguments censés descendre Sollers. Je les trouvais idiots et spécieux. À chaque apparition télévisuelle, Sollers flanquait de l’urticaire à mon entourage : je jubilais. Sollers brouillait les pistes et montait dans mon estime. Se lançait-il dans un éloge de l’amour libre, moyennant un petit détour par le Vatican ? Cris d’orfraie et volée de bois vert. J’étais catholique et d’une sensualité à fleur de peau : je jubilais à mort. Avais-je le malheur de lire Paradis, on me regardait avec compassion. L’évoquer trahissait ma fixation. J’ironisais ou laissais dire. Je comprenais son jeu et sa profondeur. Vie de l’esprit : roman. Passion physique violente : roman. Intrication des deux ? Chef-d’œuvre.
L’amour de l’art est une joie et une joie particulièrement contagieuse. Il suffit d’accepter ce cadeau. Vos cinq sens sont là pour l’accueillir. Il n’y a pas d’accès plus direct à la connaissance. L’équation vient de Dante, fait escale chez Stendhal (De l’amour), explose dans les romans de Sollers (Passion fixe, L’étoile des amants), elle est simple, la voici : Plus vous aimez, plus vous comprenez ; et plus vous comprenez, plus vous aimez. Et ainsi de suite, à l’infini.
On aura peut-être remarqué que la plupart des romans de Sollers paraissent en janvier. On s’achemine lentement vers plus de lumière. Bientôt les bourgeons pointent leur tête. Le temps se libère. Une grande nuit semble encore tout recouvrir mais déjà, là, à portée d’yeux, une constellation d’étoiles. En réalité, Sollers a besoin de ce fond de dévastation sans lequel son motif ne se détacherait de la toile de manière aussi saillante. Trésor d’amour, comme tous ses précédents romans, pourrait avoir pour exergue le mot de Hölderlin : Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve. On peut à partir de là disposer les sujets de la composition. Nom du pays : Venise. Le thème : l’amour. Sa représentation : Minna Viscontini qui, comme par hasard, s’avère être une lointaine descendante du grand amour avorté de Stendhal. Lequel écrira un jour : “Si j’avais été habile, je serais dégoûté des femmes jusqu’à la nausée, et, par conséquent, de la musique et de la peinture, comme X ou Y. Ils sont secs, dégoûtés du monde, philosophes. Au lieu de cela, dans tout ce qui touche aux femmes, j’ai le bonheur d’être dupe comme à 25 ans.”
On notera donc qu’un certain degré d’innocence peut immuniser du dégoût ; l’expérience a lieu, sans regret, sans amertume. On a connu.
Trésor d’amour. Fraîcheur, légèreté, doigté, introduction savante à la vie et l’œuvre de Stendhal, bonheur de lecture, et pourtant…
J’ai beau croire cette guerre opportune, je doute de la stratégie mise en œuvre. Qu’il faille défendre les morts contre le décervelage galopant, soit. Qu’il faille pour la cause polariser la pratique artistique sur deux attitudes contradictoires, d’un côté la description froide et objective d’un monde sans issue (façon Houellebecq) ; de l’autre la démonstration d’une issue possible faisant front contre le nihilisme (façon Sollers), me laisse pantois. S’il y a bien une chose qui me foute en pétard c’est bien ce type d’alternatives. Je sens là les effets néfastes de la religion Heidegger. Et avec ça un puissant relent d’esprit de sérieux. Je vois déjà poindre la police anti-nihiliste à tous les coins de rue. La rédaction de l’humanité en deux camps. Ce jeu-là ne m’amuse pas ou, pour être tout à fait précis, a cessé de m’amuser. Je quitte la table et préconise la politique du grand écart (à ne pas confondre avec la politique du cul entre deux chaises, nuance). Je prends Haydn et Meshuggah. Bacon et Richter. Wells et Carpenter. Sollers et Ellis. Aucun à priori métaphysique ne motive mon goût, ma créativité, si ce n’est cette unique et simplissime question : Que puis-je savoir de l’humanité à laquelle, paraît-il, j’appartiens ?
“La grande certitude” qu’évoque Sollers dans son dernier opus ne fait pas bon ménage avec l’art du roman. D’où sa dent à son endroit. Écoutons plutôt : “La vérité, c’est que la description de cette société en rotation n’a plus le moindre intérêt, de même que les individus qui l’habitent. Que des milliers de romans s’essoufflent encore n’a plus aucun sens, on sait tout d’avance”.
Et en effet, avec ce On sait tout d’avance, quiconque entendrait signer la mort du roman ne s’y prendrait pas autrement. Ce que fut l’expérience du Paradis de Sollers s’éteint dans cette affirmation dont nous voici les otages. On sait tout d’avance. Qui n’aurait plus la capacité de s’étonner, de découvrir, et qui, par conséquent, pourrait difficilement nous surprendre. On sait tout d’avance. Je vous invite à faire le mur. On sait tout d’avance. Entendu, nous reviendrons peut-être plus tard…

Pur Ellis…
Je quitte donc la Sérénissime, heureux souvenirs, pas d’amertume, aucun regret. J’écris, je lis, je vis. Vivre, lire, écrire. À l’instar de l’espace-temps, ces trois dimensions sont infiniment moins étanches qu’on ne croit. Parole de voyageur quantique. Ouais, entre autres. En attendant : Qui suis-je ? Qu’est-ce que l’homme ? Je passe ma vie en compagnie de personnages de roman dans l’espoir d’arracher quelques pans de vérité à l’opacité du réel…
Je débarque à L.A. en début d’après-midi. Il fait chaud, les humanoïdes sont bronzés, blonds et splendides, et je dégouline de sueur. Je brandis le dernier roman de Bret Easton Ellis… Suite(s) Impériale(s)… J’attends comme ça, un peu con, cinq dix minutes, au terme desquels un homme, grand, la quarantaine, s’avance vers moi.
Clay ne me demande pas si j’ai fait bon voyage, et une phrase me revient à l’esprit : Les gens ont peur de se retrouver sur les autoroutes de Los Angeles. Le diable a élu domicile dans la Cité des anges. En toute bonne logique. Est-ce que tu crois en l’existence du diable ? Clay hausse les épaules, embraie, la Mercedes bondit en s’engageant sur Sunset Bd.
– J’ai peu de temps. Et je comprends : j’ai tout mon temps. Clay m’emmène aux endroits clés de Suite(s) Impériale(s) : la maison de Trent et Blair Burroughs sur les hauteurs de Bel Air, le Beverly Hills Hôtel, le W hôtel, un immeuble de Los Feliz derrière lequel on a retrouvé le corps de Julian Wells torturé à mort, Palm Springs (C’est ici que vit le diable), le désert, le panneau publicitaire sur Sunset Boulevard où je peux lire “Disparaître Ici”, le cimetière Forever d’Hollywood où repose Julian (Ils projettent des films ici l’été, je m’en souviens en examinant le mur blanc géant du mausolée qui sert d’écran), après quoi nous finissons chez lui au Doheny Plaza. Il est passé minuit, nous ouvrons une première bouteille de champagne et glissons progressivement dans la non-zone…
Tu voudrais une réponse, alors qu’il n’y en a pas qu’une.
– Bret s’est demandé ce que nous étions devenus depuis les “évènements” de Less than zero, je pense que c’est comme ça que ça a commencé, dit Clay. Nous avons repris contact. Je lui ai exposé ma version. C’était sans grande surprise. Ma vie n’avait pas changé, du moins pas radicalement. Sauf qu’à l’époque, j’aurais été bien incapable de répondre à une question simple du genre : “Que fais-tu ?”. Aujourd’hui, ouais, je pourrais : “Je co-produis des films, j’adapte des romans au cinéma, j’écris des scénarios”. À part ça ? Peu de chose. Le fossé qui se creuse entre soi et soi. Chaque jour davantage. Un fossé toujours plus flippant, plus grand, plus abyssale, malgré les sommes exorbitantes claquées en analyses, malgré les efforts pour ne pas sombrer dans l’ivrognerie, la folie, la coke. Un peu moins de coke, donc, mais un peu plus de Valium. Nous surfons sur les vagues de nos addictions. Nos vies sont si désabusées, déboulonnées, déboussolées et vides que nous sommes prêts à tuer pour des filles qui ne valent pas mieux que nous (Clay me montre une série de photo sde Rain Turner). Nous ne savons pas ce que signifie le mot gratuité (la photo de Rain : sur un balcon, les jambes écartées, un portable dans une main et une cigarette éteinte dans l’autre, debout près d’un matelas couvert d’un drap bleu dans une chambre anonyme, les doigts déployés sur le bas de son abdomen). Et nos désirs n’ont aucune limite. Tu sais ce que Rip nous disais déjà à l’époque : “Le droit ? Quand on veut quelque chose, on a le droit de le prendre. Quand on veut faire quelque chose, on a le droit de le faire.” Oui, Rip, par exemple, en quoi sa putain de vie a-t-elle vraiment changé ? Méconnaissable depuis son ravalement de façade (il est refait de telle façon que ses yeux écarquillés ont l’air d’exprimer une surprise perpétuelle ; c’est un visage qui imite un visage…), il a étendu sa sphère d’influences, c’est vrai, et se révèle plus cynique et sadique que jamais. Pas le plus petit état d’âme. Daniel Carter réalise des films gores à succès, et accessoirement se tape mon ex-petite amie. Julian Wells est monté en grade, à la tête (le temps qu’on ne la lui dérouille) d’un réseau de prostitution haut de gamme, discrétion assurée. De très belles filles, de très beaux garçons, des gamins venus ici pour réussir, qui avaient besoin de fric et voulaient être sûrs, au cas où ils deviendraient Brad Pitt, qu’il n’y aurait pas la moindre preuve de leur implication dans un truc pareil.
Parfois, il m’arrive de pleurer en songeant que l’humanité n’a eu lieu que pour aboutir à ça.
– Les romans ne sont pas des manuels de morale, dis-je, en me reversant une coupe. Ce ne sont pas les exploits de la vie active qui produisent les grandes œuvres, mais bien plutôt l’échec, les peines obscures, l’ennui, l’aride insignifiance des jours.
La vérité de votre noirceur est éclatante.
Clay baille grossièrement en regardant par la baie vitrée : Vous disiez ?
– Euh, rien.
Et il poursuit.
– “Je crois que nous savons plus éprouver le moindre sentiment”. Je me souviens qu’Alena me disait ça. Nous sommes tenus à demeure à la périphérie de l’enfer. Ou pas. Tout dépend de ton état d’esprit, en fait.
Dans la chambre du quinzième étage du Doheny Plaza, tout commence dans une toile de David Hockney pour finir dans un film de David Lynch. Des fantômes surgissent du passé. Des objets disparaissent. La température ambiante varie selon une logique qui m’échappe. Et j’essaie de rester calme tandis qu’une angoisse diffuse resserre son étreinte sur ma poitrine.
J’allume mon MacBook pendant que Clay débouche une seconde bouteille de champagne. Sur l’écran, Ellis tente de répondre à la question : “Est-ce que vous êtes comme Clay, votre personnage ?”… Chaque fois que les romanciers sont contraints de rappeler l’évidence, à savoir que vous avez, vous, personnages de fiction, une existence distincte de la leur, j’ai envie de sortir mon flingue. En quoi et pourquoi Clay serait-il un clone d’Ellis ? Comme si c’était aussi simple que ça. Comme si là était la question. On peut noter des ressemblances, of course. Mes yeux vont de Clay à l’écran. Et je me dis : ok, deux adolescents à l’air vieux… Et ,de toute évidence, leur mode de vie et leur garde-robe, et leur collection de bagnoles, et blablablabla… Bien sûr… N’empêche : Clay is not Bret !… Bret is not Clay ! Réverbération. Diffraction. Raison du roman, you understand ?!
De nouveau sous les yeux le book de Rain Turner, c’est plus fort que moi. Pour tromper mon trouble, je dis à Clay : drôle de roman d’amour…
Mais Clay se remplit une coupe et ne réagit pas.
Puis, à brûle pourpoint, récite par coeur sa réplique : J’ai appris qu’elle vivait dans un appartement sur Orange Grove, du côté de Fountain, et qu’elle le partage avec une autre fille, ce qui facilitera les choses. La transparence de la transaction : elle le fait très bien et j’admire ça. Tout ce que qu’elle dit est un océan de signaux. En l’écoutant, je constate qu’elle est beaucoup de filles à la fois, mais quelle est celle qui me parle ?
Style pur et droit comme une ligne de coke. Pur et lisse comme l’épiderme d’une adolescente. Et unique et parfait pour rendre la beauté de leur abyssale noirceur psychologique. Ellroy. Ellis. Cerbères de L.A. cité maudite.
Dans l’appartement de Doheny Plaza, retentit Man out of Time d’Elvis Costello.
– Je suis tombé amoureux de Rain Turner (de son vrai nom : Denise Tazzarek, imaginez ça à Hollywood : désastre), comme on peut tomber raide dingue d’une fille qui essaie de rester jeune parce qu’elle sait que ce qui compte le plus, c’est l’apparence juvénile… La surface présentée par Rain est en réalité tout ce qu’elle est et, comme chez toutes les filles qui ressemblent à Rain, il y a quelque chose de fascinant à l’observer en train d’essayer de comprendre pourquoi je m’intéresse à elle plutôt qu’à une autre.
Ouais, me dis-je, comme il y a chez toi, petite pourriture, quelque de chose de pervers à jouir de la situation (Ses attentes sont tellement immenses que vous vous retrouvez cerné par elles ; ses attentes sont tellement énormes que vous comprenez que vous pouvez les contrôler…). Tu sais ce que tu fais, ce qu’elle attend de toi (obtenir un rôle dans ton film), et que tu ne pourras pas lui apporter (talent : nul), même si tu lui fais croire le contraire. Darwinisme social. Darwinisme sexuel. Paranoïa. Mafia. Carrousel du donnant-donnant. Là, je m’accroche pour tout bien comprendre. Rain Turner sort avec Julian Wells, ce qui ne l’empêche pas de coucher avec Rip (riche, influent) et Montrose (riche, producteur). Seulement voilà, il faut bien qu’un zigue parmi ces prétendants au néant perde complètement la boule pour ce mignon fessar farci d’ambition. Et c’est Rip, Montrose en saura quelque chose : le premier envoie le second enfer.
Notons au passage que Rip est aussi l’abréviation de Requiescat in pace (qu’il/elle repose en paix) et plus drôle, en français : reconnu d’intérêt pédagogique.
Rip donc, pédagogue à ses heures, face cachée of death (un visage qui imite un visage), cruel, dominateur (pas de quartier), manipulateur, sans doute, mais archi-lucide : “Tu es trop intelligent pour te laisser trop embarquer (…), il doit donc y avoir quelque chose d’autre qui te fait jouir”… Et aussi : “Quelqu’un ne te rend pas ton amour et ne te le rendra jamais. En tout cas, pas comme tu voudrais qu’elles le fassent et pourtant tu peux quand même les contrôler un certain temps, à cause des choses qu’elles veulent obtenir de toi. C’est un sacré système que tu as mis en place et fait durer.”
Ça te fait complètement perdre la tête. Mais c’est la vérité. Et on a presque de l’empathie pour toi. Parce que, comme nous tous, tu sais te montrer sous ton meilleur jour. Parce que tu sais parfaitement jouer les innocents. C’est ce qu’il y a de plus flippant chez toi.
Tu tabasses une meuf, elle se retrouve à l’hosto. Tu graisses la papatte de son avocat. Et puis tu oublies.
On apprend ça page 193. Habile dispositif par lequel Bret nous démontre, Clay, que tu n’es pas si clair que ça. Tu n’es qu’un reflet et/ou un moment de la spirale paranoïaque qui souffle autour de toi. Tout le monde est beau, sain, cramé aux UV, au point que ça te donne envie de gerber. Surveillance. SMS. Flash. Sourire. Traque. Trucage. Votre appartement est-il sûr ? Pas sûr. RDA ? Non, L.A. Des gens disparaissent. On voit des individus torturer d’autres individus sur des vidéos diffusées sur le net. Julian ? SMS. Message d’intimidation. Vérité. Toc. Trucage.
Tu te demandes qui tire les ficelles et tu voudrais une réponse.
Le truc Clay, c’est qu’il n’y en pas qu’une.
Je garde bien entendu toutes ces réflexions pour moi. Nous terminons une énième bouteille de champagne, Clay envisage de retourner vivre à New-York (les options paraissent décourageantes dans un sens comme dans l’autre), mais peut-être pas. Et au moment de m’endormir, je vois la silhouette d’un garçon mort, debout dans la chambre, et avant de sombrer j’ai le temps de l’entendre dire :
Qui que vous soyez, n’oubliez pas une chose :
À chaque instant, vous pouvez disparaître ici.
Suite au prochain épisode.