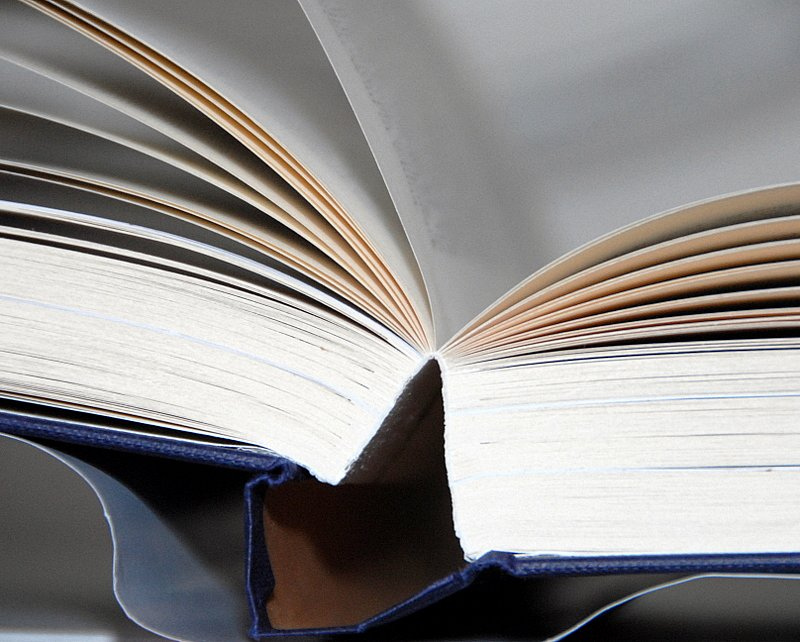Je ne sais jamais si l’on écrit par faiblesse, par goût des épanchements, quand un état mélancolique nous submerge et que seule, peut-être, l’écriture sera ce qui sauve ou bien si, au contraire, l’on écrit pour sortir de soi, de ces zones qui font certainement la vie d’une âme mais qui ne forment généralement pas une œuvre, une création qui s’adresse à tous. Ce sont deux options, aussi, qui dépendent d’une décision ; deux orientations, clairement, qui requièrent une détermination différente. Aujourd’hui, je ne sais pas, justement. Au moment d’écrire ces quelques lignes, comme un aveu de faiblesse, le rêve sous-jacent de penser qu’il est possible de tenir ensemble, dans le texte, ce qui le fomente et ce qui le déploie, les misères, dont nous ne sommes pas fiers, les idées nobles qui nourrissent la machine. Où l’écriture puise-t-elle sa nécessité ? A quel régime de conditions se soumet-elle ?
Avec le temps, à force, également, d’écouter les remarques discrètes et bienveillantes de quelques amis, je tiens un petit caillou, à défaut d’un roc, cette idée que j’ai fait une revue pour ne pas écrire. Pour contourner l’obligeante et redoutable nécessité, pour contourner un rêve, une passion, comme un obstacle. J’ai voulu les mots des autres, les faire travailler à ma place, avec le désir secret, à l’image de l’écolier qui glisse, avant d’aller se coucher, ses cahiers sous son oreiller pour retenir une leçon, que le Saint-Esprit opère. Passion des œuvres, certes, et des vies qui les portent. Mais, oserais-je l’avouer ?, l’idée, quelque part, d’un profit à retirer pour alimenter mon propre désir.
Comment ne pas reconnaître, par exemple, comme un principe fondamental, pour moi, ce que Jean-Jacques Schuhl a assumé d’entrée de jeu ; c’est-à-dire cette recherche d’un idéal typique, d’un livre qui ne se composerait que des phrases des autres et formerait par assemblage un texte neuf et inédit. Il y a une version métaphysique de cette approche, qui se pare d’un luxe d’érudition (version Borges etc.), mais il en est une autre, plus intéressante et feutrée, dans ce goût de Jean-Jacques Schuhl pour les marionnettes, voire les automates. Collage, assemblage, reprise, copier/coller, ah, beauté de ce geste, de ces allers et retours entre la chair et le plastique, la surface et les profondeurs jusqu’à son point d’étouffement dans une sécularisation magique.
Et puis, tout aussi bien, je repense aux phrases d’Annemarie Schwarzenbach, cette espèce de journal continu que son œuvre entière, qui passe par le roman et le récit de voyage, constitue comme le sismographe de ses états d’âme, de ses pérégrinations intérieures dont les vrais voyages n’étaient que le reflet fidèle et rêvé. A priori, le travail est inverse, comme si son âme était scripte et que son écriture était directement branchée sur la région sensible du cœur, de ses tripes, formant le journal de sa bile noire.
Jean-Jacques Schuhl, Annemarie Schwarzenbach, deux approches opposées de l’écriture et de l’œuvre, mais qui pourtant, en quelques manières, se rejoignent dans l’absence de médiation. De part et d’autre, l’écriture est comme une opération directe, sans intermédiaire, dans l’apparence.
Car, finalement, je ne voudrais pas me voiler la face, ne pas être trop rapide ; en somme, ne pas mésestimer le travail et l’effort que requiert toute construction, qu’elle soit branchée sur l’âme et le souci des profondeurs ou sur le rapport des faits et des surfaces. Vieux débat qui n’est pas sans rappeler, mutatis mutandis, ce qui dans les années 60 se jouait entre les propositions du Nouveau Roman et celles d’un Romain Gary publiant son Pour Sganarelle.
Entre le sol et l’envol : l’écriture. Je trouve cette métaphore, que je fais mienne, dans le récent livre de Miguel De Azambuja : « Parfois, pour éviter la chute, quelques-uns évitent le sol pour habiter l’envol, et pensent pouvoir vivre ainsi, déracinés, inauguraux, en étant leur propre origine. D’autres ont du mal à se lever, s’entremêlent avec le sol, finissent par s’y enterrer, la difficile vie avec les morts du pays mélancolique. Pour le dire dans d’autres mots, éviter la chute nous amène parfois vers les contrées de l’idéal ou de la mélancolie et c’est le rapport au sol, à la gravitation, qui nous permet de figurer ces deux mouvements. Les hommes pressés et les hommes enterrés ont du mal à trouver une vie qui permette le sol et l’envol, la route et les rêves.» Il n’est pas besoin d’aller chercher du côté de la flânerie ou de la psychanalyse pour arriver à tenir les deux bouts, si l’on veut bien accorder à la littérature ce pouvoir, la puissance de faire exister le fil ténu entre la chair et l’idée, le fantasme et telle ou telle peau singulière, la grande histoire et le déroulement de nos vies.
Au cœur de ce nœud, peu de choses, je n’ai trouvé que l’amour aux deux extrémités. Il y a des mots et il y a des corps, je tourne et me consume, je cherche et me cogne, inaugural et mélancolique, à tout moment, la seule question reste de savoir comment renforcer l’un par l’autre. Miracle de cette rencontre amoureuse qui produira un enchaînement de mots, bénie, aussi, cette rupture qui me plongera dans des tourments productifs. Soyons honnêtes, ces dernières années, combien de fois n’ai-je pas pris un plaisir malin à me mettre dans telle ou telle situation dans le seul espoir de produire un peu d’encre ? Dans une grande âme, tout est grand, disait Pascal. La littérature rend compossible, permet d’acclimater, apprivoiser, conserver, transformer, surtout ne rien perdre : la surface et la profondeur, la rencontre et la rupture. Un Horizon de littérature : une lettre qui tiendrait de l’impossible, qui dirait à la fois l’Adieu et la réconciliation, l’amour et la perte du désir, le recommencement et le terme, le pardon et le renoncement. Tout sera dans un clignotement, chaque chose à sa place, sans condition.