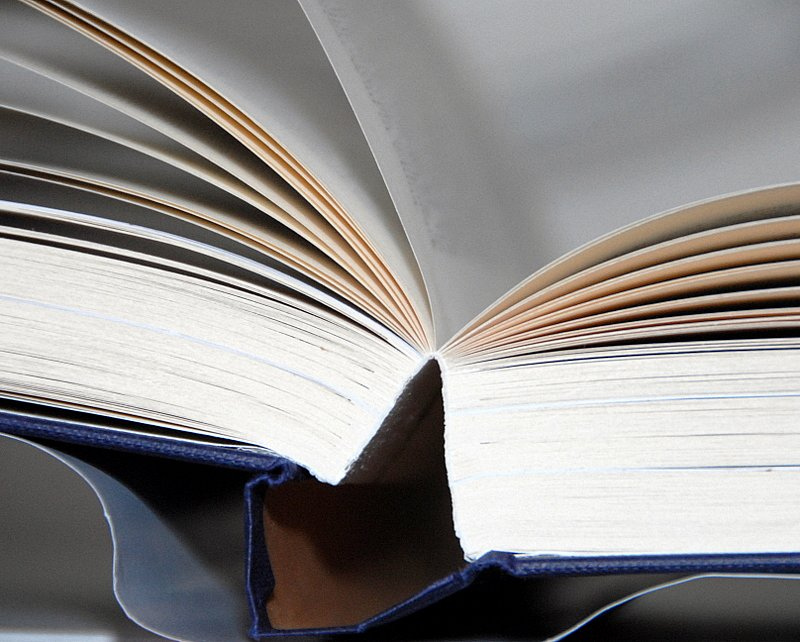Quel sens y a-t-il à vouloir imprimer du papier, à créer des volumes, à mettre ensemble des gens dont on suppose qu’ils puissent connaître un voisinage heureux et produire, par leur mise côte à côte, un peu de pensée et donner un éclairage sur la marche des choses ?
Est-il nécessaire de pointer la débâcle que connaît la presse quotidienne, de souligner le maintien, vaille que vaille, des hebdomadaires d’information et de remarquer que la seule presse qui attire encore des lecteurs, ou du moins les conserve en nombre suffisant pour fonctionner de manière économiquement saine, est une presse qui, souvent à juste titre, est dite de caniveau. Il n’est plus nécessaire, non, de pointer tout cela pour savoir et sentir qu’une forme de culture et de l’écrit liée au papier est en train de vivre des heures sombres et peu glorieuses, comme si ces pratiquants étaient de vieux monstres d’un ancien monde bientôt enseveli. Qu’est-ce qui se perd et qu’est-ce qui se gagne dans cette transformation ? L’état des lieux est-il si désastreux ? Qui imprime du papier sous forme de périodique, que ce soit la presse quotidienne ou la plus pointue des revues littéraires, ne peut pas ne pas se poser ces questions.
Certes, je sais bien que la presse, les revues ont, depuis qu’elles existent, été des entreprises à haut risque, que certains y ont perdu des fortunes ou gagné la gloire. Cela ne m’empêche pas, malgré les enthousiasmes et le goût du risque, de regarder un paysage pour le moins contrasté.
Je m’interrogeais sur cette situation, sur le regard, bien entendu, que je pouvais y porter, avant de me rendre au dernier Salon du livre. J’étais invité avec quelques camarades et amis à parler de ce qu’on appelle « une communauté littéraire » avec, comme sous-entendu, concernant mon invitation, que la forme de la revue représente une sorte de paradigme de la dite communauté. Je me devais, à leurs yeux, d’être une espèce de représentant.
Par aveuglement, peut-être, par conviction, sans doute, et, surtout, me semble-t-il, parce que j’ai comme en moi pour toute une série de choses une boussole intérieure qui m’alerte par moments et me soutient par principe, je vis sans doublure théorique. Et cela vaut pour la revue que je mène depuis quelques années et qui me valait cette invitation à une table ronde organisée par les chers amis de la Société européenne des auteurs, que nous avons fondée, à quelques-uns, il y plus d’un an. Mais, là-dessus, je reviendrai.
Ca veut donc dire quoi faire une revue dans le paysage que nous connaissons ? Et comment répondre à la terrible question de ce qu’elle reflète d’une « communauté » ? N’est-il pas vérifiable que toutes les revues littéraires ont toujours peu ou prou fonctionné sur le principe d’une communauté, quelle soit idéologique (temps des connections des avant-gardes et de la politique) ou esthétique (temps des révolutions des formes et du renouvellement des arts), pour ne pas dire que le propre des revues a toujours été, d’une certaine manière, de rejoindre le moment des formes et des engagements sous l’égide, justement, des noms de « communauté », de « groupe », ou encore de « collectif », voire de « collège ».
Alors, leçons de l’histoire ou goût personnel, je l’ignore, mais le fait est que je n’ai jamais cru à cette histoire de communauté et de rassemblement heureux d’individus qui créent, orientés vers un but précis et une volonté commune. Ce sera, si l’on veut, mon premier point. Il me semble que jamais, en moi, l’idée de rassembler n’a été un moteur essentiel ou une envie particulière pour créer et orchestrer une revue. J’ai même pris le pli inverse. Fasciné par le sous texte de la grande histoire littéraire, tenté souvent de trouver du réconfort dans les bras de ces communautés invisibles, j’ai toujours aimé ce que la littérature pouvait avoir de feutré, de secret, d’inavouable et de précieux. Mais en m’en méfiant, en voulant m’en tenir à distance, sentant, par là, le réconfort, une forme de paresse ?, en tout cas, tout sauf un moteur, ce qui pouvait, au sens propre, me secouer. Plutôt que de communauté, j’ai toujours préféré parler de lieu, d’endroit où l’on rentre et l’on sort, où rien n’est prescrit, si ce n’est l’idée que quand on y est, on s’y sente bien.
Lieu contre communauté, donc. Lieu invisible, même. Le plus cosmopolite possible, en jouant sur ce qui implique le maximum d’entropie, voulant toujours rester au plus près du rassemblement impossible.
Et puis, il y a une autre idée avec laquelle je me suis toujours senti en porte-à-faux. Une idée de puriste, si l’on veut, qui voudrait qu’on puisse opposer aux combines de la « grande édition », de ses compromis avec le monde marchant, la vie des revues comme l’assurance d’une littérature préservée, d’une littérature épargnée des affres des corps et du monde. La revue serait la garante du sel de la littérature, car fatalement, encore obscure, d’avant-garde, sans compromission, avec un attachement au texte et rien qu’au texte, car à l’abri des petites et grandes séductions. Face à cette vision, j’ai toujours voulu maintenir mon attachement non seulement au texte, mais aussi aux corps, à la sensibilité partagée dans la manière d’avancer dans la vie, dans les regards, les peaux et les postures. Je ne crois pas à cette idée que la qualité d’une publication tiendrait sous l’injonction exhaustive « le texte, rien que le texte ». Au contraire, pour moi, une revue c’est une manière aussi de rencontrer des êtres de chair, des êtres qui ont un tracé singulier et qui arrive à trouver une façon de mettre un pas devant l’autre en construisant une œuvre. Une revue reste, à mes yeux, l’espace privilégié pour être au carrefour des œuvres et des êtres qui les porte.
Et enfin, dernier point que j’énonçais lors de cette rencontre dans ce salon et qui peut se déduire des deux premiers, cette idée, cette fois, que la littérature, dans une revue, est littéraire. On est entre soi, la revue est l’horizon d’un lieu préservé où l’on sait, quelque part, que la vraie littérature est chez elle. La revue, en ce sens, comme le lieu spécifique de l’espace littéraire, entre pairs, son côté, finalement, « réserve protégée »,si l’on exagère une peu. Et pourtant, là encore, fuite devant ce piège confortable, devant cette coupure artificielle des domaines et des genres. La littérature est sans espace, car elle ne vaut que dans son immersion complète dans le monde mais également dans l’époque et la situation qui nous est faite. Sans appel possible. Elle ne tirera sa force que de cette immersion et, de ce fait, que de sa confrontation avec les autres arts, les autres pratiques. De quoi aurait-elle peur en se disposant à côté de la peinture, de la musique du cinéma, mais aussi de la mode, par exemple ?
Une vulgate situationniste nourrit les plus audacieux, ils s’en servent comme base arrière, quand elle n’est pas un impensé. On peut toujours repérer le spectacle, le signifier, le reconnaître et même parfois s’en construire. Il n’est pas interdit, non plus, de tenir compte des constats sociologiques et anthropologiques sur les méfaits d’un cinéma hollywoodien et les mutations qu’implique l’hyper présence télévisuelle. La plainte s’en alimente et détermine, parfois, de belles aventures. Mais le jeu paraît rapidement à somme nulle. Et je pourrais être vite tenté, pour échapper à ces oppositions stériles, de parler plutôt d’intoxication, cher à Peter Sloterdijk. Oui, pourquoi pas. Plus simplement, sans souci de partager une dialectique, je me rabattrai, pour l’heure, sur un pragmatisme de bon aloi. Une revue comme un acte. Une revue comme une manière de signifier, d’inscrire dans le monde, un peu de la puissance d’une idée et de la création. Etre quelques-uns à se retrouver dans un lieu qui porte au plus loin le dissemblable, qui s’attache au texte, bien entendu, à plein régime, mais aussi aux êtres qui les fabriquent, car ils sont la trace d’expériences plus que d’une idée préconçue de la littérature, et qui, pour terminer, démultiplie la présence de la littérature au regard des autres arts et formes de créations dans l’époque.
Bonheur d’écrire ces quelques lignes, ici, maintenant !