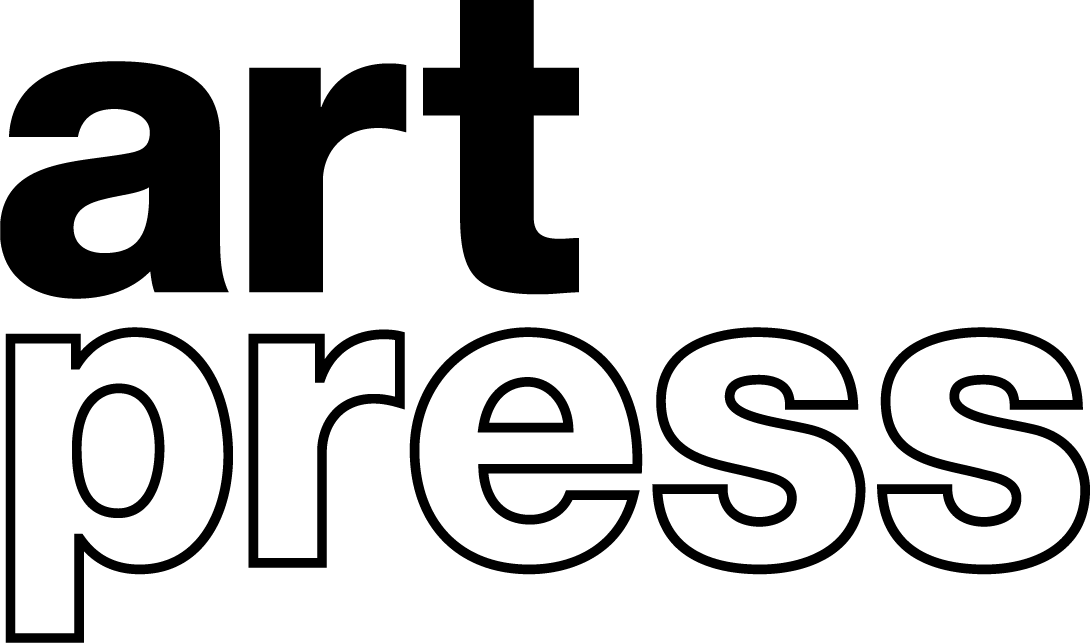Au milieu des années 70, au temps des mes débuts, paraissait, à Paris, un magazine singulier, miraculeusement indépendant, qui s’appelait Artpress.
Il y avait là Catherine Millet, sa directrice, qui n’était pas encore la romancière mondialement reconnue qu’elle est devenue.
Jacques Henric, son compagnon, qui jouissait du rare prestige de celui qui a déjà fait feu sur les ours savants, non de la social-démocratie, mais du stalinisme pur et dur.
Daniel Templon, déjà au nombre des galeristes français qui comptent en Europe ; Myriam Salomon, qui travaillait en secret à sa collection de Sol LeWitt, Martin Barré et autres Donald Judd ; Philippe Muray, au bord de son « Céline » et de son « XIXe siècle à travers les âges » ; Guy Scarpetta ; Philippe Sollers, alors directeur du terrible Tel Quel, qui y publiait en voisin ; d’autres.
Ni tout à fait magazine d’art (même si l’on y soutenait les meilleurs représentants de l’art conceptuel, du land art ou de l’arte povera) ni tout à fait revue d’idées (encore que ce soit là que les nouveaux philosophes, par exemple, trouveront, tout de suite, leurs plus solides alliés), c’était un lieu spécial, un objet médiatique non identifié, une bête sans espèce et sans réel précédent (peut-être, mais ce n’est pas non plus cela, les « Acéphale », « Contre-attaque » et autres « Révolution surréaliste » ou « Internationale situationniste » qui jalonnent l’histoire de nos avant-gardes).
Une revue d’avant-garde, mettons. L’organe central, en langue française, de cette grande révolution culturelle qui, de New York à Paris, bousculait les bien-pensances, cassait les automatismes de création et balayait l’épaisse bêtise de toutes les cultures officielles. Le meilleur de ce temps-là.
Quarante ans plus tard, rien n’a changé.
D’autres, plus jeunes, ont rejoint la troupe (Annaël -Pigeat, rédactrice en chef, succédant à Christophe Kihm et à Catherine Francblin).
Des alliances nouvelles se sont nouées (le philosophe Elie During, la décisive revue Ligne de risque).
Le meilleur, non seulement de l’art, mais de la littérature d’aujourd’hui (Christine Angot, Philippe Forest, Pierre Guyotat, Jean-Jacques Schuhl) continue d’y être chez lui.
Mais, à l’exception de Philippe Muray, les mêmes sont toujours là, plus là que jamais, tels que le temps ne les a, finalement, pas tant changés que cela.
Le ton du magazine, surtout, est resté prodigieusement intact. Frondeur et grave. Libre et fidèle à sa ligne. Ouvert aux tendances nouvelles de l’art et de la pensée (au point, sur la durée, de n’avoir pas commis de faux pas, ni d’erreur d’appréciation, notables) sans transiger ni sur les affinités fondamentales (l’article d’Henric, dans le dernier numéro, sur le chef-d’œuvre de Philippe Sollers, « Portraits de femmes ») ni sur le socle invisible posé, il y a quatre décennies, au fondement de l’entreprise (une certaine idée de l’éthique, une poétique de la politique, une politique du style). Tenant bon (contre les philistins de droite et de gauche) sur l’art contemporain quand il porte le nom de Grayson Perry, Tatiana Trouvé ou Marina Abramovic, mais prenant ses distances, en même temps, avec la singularité facile de ceux pour qui le marché est devenu seul juge des canons du juste et du beau (tant de faux artistes dont la valeur est inversement proportionnelle au prix !). Sectaire, en un mot, au beau sens qu’avait le mot, du temps où les mots avaient un sens – secare, séparer, faire le tri entre ce qui est bon et ce qui ne l’est pas. L’esprit d’Artpress.
On relira avec profit, dans l’album coédité, à l’occasion de ce 40e anniversaire, par les éditions La Martinière, le texte manifeste de Joseph Kosuth faisant de l’art (janvier 1973) la nouvelle philosophie des temps post-hégéliens.
On relira le dialogue Sollers-Godard de 1981, à propos du « Trou de la vierge », ou les premiers textes consacrés (1978) à un inconnu nommé René Girard.
On admirera la constance, dès 1975, c’est-à-dire en un temps où nous n’étions pas légion sur ce front, du soutien à Soljenitsyne et aux dissidents de ce que Milan Kundera appelait l’Europe captive.
On essaiera de ne pas manquer, même si, pour certains, ce ne sera pas sans honte, les minutes de l’affaire Paris-Moscou (la grande exposition organisée, en 1979, à Pompidou, et dont Artpress fut l’un des rares à dénoncer le munichisme constitutif) ou celles de l’affaire Finlay (du nom de ce sculpteur antisémite à qui la ville de Paris avait demandé une œuvre censée commémorer la déclaration des droits de l’homme – là aussi Artpress fut seul ; et, là aussi, Artpress l’emporta en faisant que soit annulée la commande).
Et puis on admirera, enfin, la délicatesse du chemin de crête où la revue n’a cessé de se tenir : frères, gardez-vous à droite de l’increvable ordre moral qui repointe le museau tous les cinq ans (récemment encore, telle association de protection de l’enfance tentant de faire interdire une exposition à Bordeaux) ; frères, gardez-vous à gauche de la propension que peuvent, aussi, avoir les avant-gardes à reproduire du conformisme (telles performances d’un Tino Sehgal, où le coup l’emporte sur le geste et le travail bâclé sur l’endurance vraie de l’art).
L’épreuve du passage du temps en même temps que l’expérience d’un temps qui ne passe pas. Qui dit mieux ?