Vous êtes, vous, d’un coup la nuit.
Quelque chose surgit du dedans – une déhiscence – quelque chose vient échouer et plier sous l’angoisse, nous éloignant soudain du carpe diem épicurien. Un déplacement a lieu, un état de catastrophe, un vacillement d’être-jeté dans le néant du monde.
La balance des blancs part d’une crainte, d’un tremblement, d’une chute. Atteint d’un cancer de la prostate, le sexe entre les mains de la chirurgie et du scalpel incisant, Jacques Henric fait l’expérience soudaine, abrupte de la maladie.
Dernière vision : le visage souriant d’une jeune infirmière penchée au-dessus de moi, sa mèche blonde qui lui barre le front. Comme un instantané photographique, puis l’expérience du néant
Un écrivain, s’il refuse de tricher, n’a pas d’autres choix que de dévoiler, avec minutie, le déferlement du mal qui le ronge et ronge le monde. Pas d’autres solutions que de ramener les traits de nuit à la lumière et de renverser la malédiction en exultation.
Le vivre, l’écrire – l’un ne valant qu’à la condition d’être éclairé par l’autre – accompagne alors une méditation sur le temps, sur sa mémoire et son oubli.
Comment mettre sa peau sur la table (L.F. Céline) sinon en explorant les dessous de l’humaine condition qui mettent le regard à l’envers ?
Comment se rendre souverain face à sa propre maladie ? En envisageant une santé du mal quand celle-ci traverse l’expérience du temps et ouvre un monde différent de ce monde rongé par le négatif.
Avant tout, il faut entrer dans son propre corps affaibli, dans sa propre voix dissonante et puis, sortir de soi, sortir d’une époque qui n’assume plus le doute et la détresse – et encore moins la joie et le plaisir – se dégager d’un pathos materno-social surmené par le théâtre dérisoire et accablant des événements.
Une singularité en acte refuse une communauté de destin basée sur le chantage permanent et sur la dette infinie.
S’il y a bien une volonté générale de dissimuler les mécanismes de la violence et du ressentiment, si l’insatisfaction est devenue une marchandise, Jacques Henric noue, à l’opposé, un rapport charnel à la vérité. C’est qu’il a appris, d’un livre à l’autre, à aller au démon (Malraux parlant de Goya), à suivre ces traînées sanglantes que l’on nomme Histoire, à contempler le négatif bien en face et à se défaire de toutes illusions et de toutes formes de servitude, volontaire ou négociée.
Récit totalisant ? Mais oui, toutes les images qui peuvent être arrachées au réel le sont. Jacques Henric est un des rares écrivains français dont l’écriture joue sur plusieurs registres. La mise en place de son dispositif romanesque intègre le champ des sensations et de la critique. Il y a l’expérience vécue et la mémoire de la bibliothèque, l’impensé social et l’infaillibilité de l’artiste, le sacré débarrassé de la faune des croyances et la dépense gratuite… A partir d’une foule de détails se déploie une pensée paradoxale et hétérodoxe qui excède le monde et sa représentation naturaliste.
La logique en prend un coup, bien sûr. Les événements sans cause ne sont-il pas impensables puisqu’ils contredisent notre volonté de croire en l’univers ? On entretiendra donc la rêverie, on bâtira des croyances, on érigera des dogmes jusqu’aux passions tristes que Jacques Henric, sans cesse, contourne, décrit, figure.
Écrire, c’est produire du réel avec le réel déjà traversé et, paradoxalement, c’est laisser au devenir son innocence. L’immanence dans son extension révèle aussi des vies d’artistes et d’écrivains : les fleurs noires de Dionysos prennent des formes surprenantes. Voici Aragon et Nancy Cunard, Breton et Nadja, Casanova et sa chienne morte, Léon Bloy et le vent noir de ses colères, Gary et le canon de son Smith & Weston entre ses lèvres, Joë Bousquet et ses fantasmes, des drames encore, des jalousies, des impossibles, des impasses, des crimes, des folies qui rôdent sur notre continent… autant d’épiphanies, d’instants du monde photographiés (Kodak de Cendrars ne procédait pas autrement) pour celui qui sait habiter les images de sa propre vie hasardeuse.
Tout se mêle et se révèle : le dernier visage de femme entrevue juste avant que les aiguilles plantées dans vos bras ne vous confondent avec la nuit et ces mains anonymes qui dessinèrent avec le noir de la suie cerfs et bisons sur les parois des grottes.
Tout s’écrit, la vie comme mort déguisée, la magie quotidienne du mal, la mode, les informations, la transe des traders mais aussi les femmes voluptueuses. Tout est dérisoire et glorieux sous le soleil et sa lumière qui lacère. Le caillou humain a beau glisser sur la pente, choisir l’amour long ou l’amour à vif, il doit tenir, alors que rien ne tient dans le sac monde.
Être au cœur de sa propre actualité c’est se nourrir d’expériences sensibles, de mémoires instinctives (Proust), en allant droit vers l’effectif, la notation pure et simple.
Au sentiment océanique des araignées funestes, Jacques Henric oppose Wittgenstein : la description est l’acte philosophique ultime, surtout lorsqu’elle porte sur notre expérience élémentaire, sur l’infiniment proche ou le presque lointain.
Ni document sociologique, ni miroir narcissique, mais œuvre écrite au couteau La balance des blancs doit s’entendre comme une littérature de guerre passant par-dessus l’ombre du temps.
Je vais continuer conclue Beckett dans L’innommable. Dans la traversée du pire et le chant de l’affirmation, ensemble.
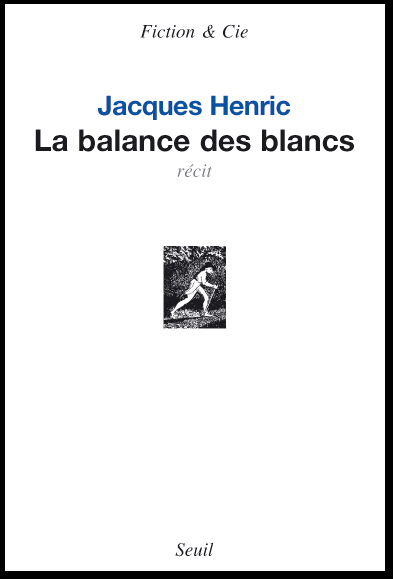 Jacques Henric, La balance des blancs, Seuil, coll. Fiction & Cie
Jacques Henric, La balance des blancs, Seuil, coll. Fiction & Cie
« Atteint d’un cancer de la prostate, le narrateur doit subir une intervention chirurgicale qui va mettre en jeu, fût-ce provisoirement, son pénis et sa virilité. Le chirurgien s’appelle… Casanova !
Dès lors, la piste du libertin de Venise est un fil rouge qui nourrit une interrogation sur l’instinct de vie, le spectre de la mort, et la place qu’y occupe la sexualité. Au sortir de cette épreuve, le narrateur éprouve le besoin de prendre un peu distance avec le monde occidental dans lequel il s’est formé, pour aller chercher d’autres perspectives dans un ailleurs qui prend essentiellement le nom d’« Afrique ». Où se trouvent le Bien, le Mal ? Est-on si sûr d’en détenir les clés ? L’équilibre fugace de « la balance des blancs » se heurte à la question de la domination, de l’exploitation, et aussi bien de l’aliénation.
À partir d’un événement de sa vie personnelle, Jacques Henric reconsidère une certaine histoire occidentale, et trouve dans l’art et la littérature quelques modèles de rupture qui, en leur temps, ont fui eux aussi leurs origines : Melville, Rimbaud, Segalen, Gauguin… Mais bien d’autres auteurs (de Joyce à Catherine Millet, de Leiris à Quignard, etc.) accompagnent cette réflexion sur le vacillement des certitudes et des évidences »
Pascal Boulanger publie des chroniques dans artpress notamment. Prochain livre à paraître en juin 2011 : Le lierre la foudre (Editions Corlevour).


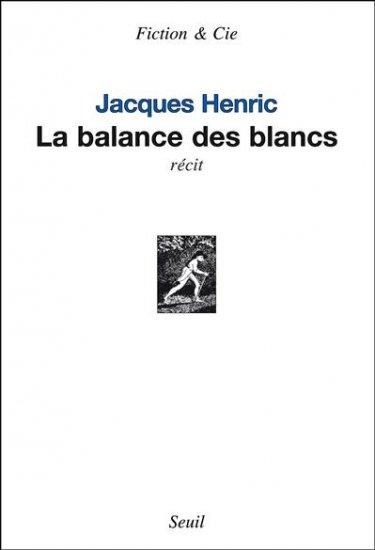






Monsieur,
j’ai bcp apprécié votre article dans La regle du jeu sur Henric et voudrais vous demander si je peux le reprendre pour notre site http://autofiction.org. Je l’ai déjà fait ce matin mais si ca vous dérange, je l’enlève.
http://www.autofiction.org/index.php?post/2011/11/01/Jacques-Henric
Bien à vous
ISabelle Grell