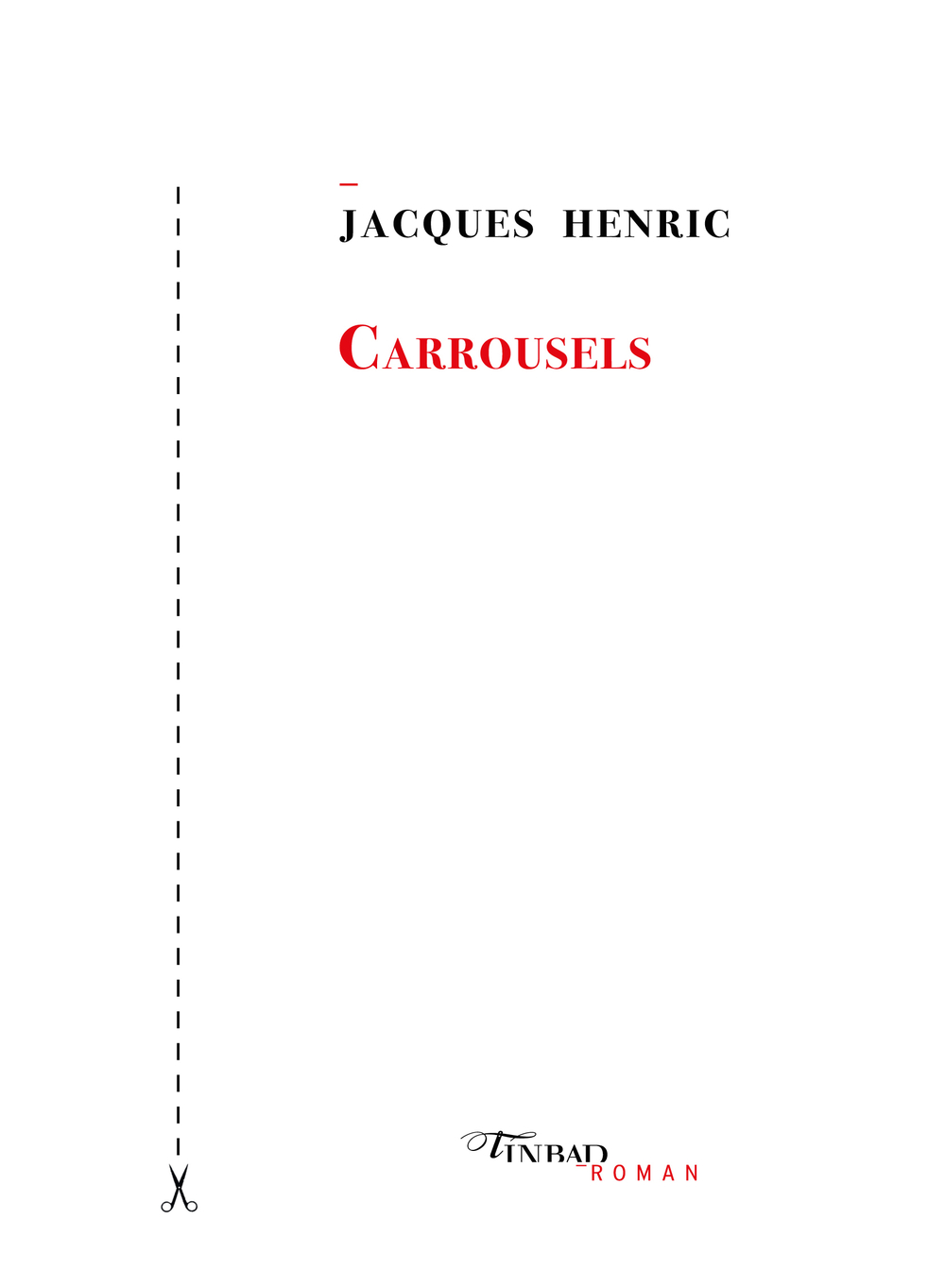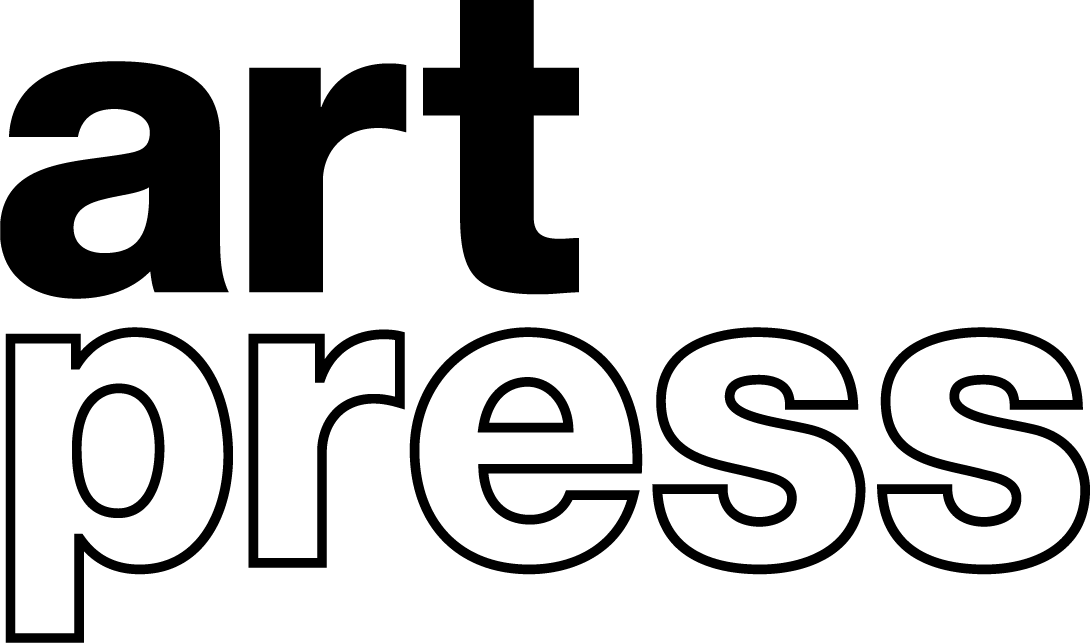L’Eve hurlante de Masaccio est le point central de cet ouvrage que Jacques Henric a publié en 1980 dans la mouvance de Tel Quel. La réédition qui nous arrive aujourd’hui, à plus de trente cinq ans de la rédaction, a pris peu de rides. L’Eve de Masaccio hurle toujours, sur les murs de la chapelle Brancacci de Santa Maria del Carmine, à Florence. Pourquoi hurle-t-elle ? Parce qu’elle vient d’être chassée du paradis terrestre. A ses côtés, un Adam roux courbe les épaules, comme honteux et penaud, quand sa compagne s’en prend au ciel.
Carrousels, on le sait, n’est ni un journal, ni un traité d’histoire de l’art. Dans ces négations se cache une autre négation : le livre n’est pas une fiction. Mais un roman, oui, peut-être. Avec une trame qui traquerait au plus près le regard de l’écrivain scrutant le monde, tentant de l’interpréter. Dans les années 80, une grande partie de la littérature s’en remettait à Freud, à Céline, à Joyce, aux Sciences Humaines et, bien sûr, à la politique. L’engagement de Jacques Henric s’est fait, politiquement, du côté des communistes. Pour l’engagement littéraire, il ne tranche pas. Sans doute est-il seul de sa catégorie, à l’époque, d’ailleurs. Dans Carrousels cette évidence est stupéfiante. Son chemin d’écriture suit la sensibilité. Sensibilité, ce n’est pas un gros mot. Ecrire, c’est produire et montrer du sensible, n’est-ce pas ? Et quoi de plus sensible que sa douleur – en l’occurrence, un épisode dépressif –, la marche du monde mesurée à l’aune des massacres, et la traque d’un « beau » révélateur dans la peinture de la Renaissance ? L’Italie, la Grèce et Jérusalem, autant de « stations » dans un chemin d’écriture, sur les routes d’une civilisation qu’Henric scrute, interroge et apostrophe.
« Il y a longtemps que le roman traditionnel ne me paraît plus pouvoir répondre de la complexité du réel » énonce-t-il dans une préface qui se conclut ainsi : « Me voilà donc, torse nu, en sueur, chaque jour émergeant d’une tenace et lointaine fatigue, écrivant dans un bizarre état de force, sensible d’abord à l’entour des poignets ». Le mot d’ « autofiction » vient tout juste d’être créé par Serge Doubrovsky, mais Jacques Henric ne s’y réfère pas. Il semble loin des théories littéraires. Dans Carrousels, il va parler de lui sans s’épargner, mais c’est aussi le monde qui l’intéresse, et sa marche désorientée. Les styles graphiques (gras, italique, romain) et les fontes (avec ou sans sérif, Garamond et Calibri) qui « composent » le livre, semblent différencier les séquences diariste, réflexive, poétique. Mais tout est imbriqué, selon une ligne, répétons-le, sensible. Carrousels est une « composition » qui s’éparpille et se rassemble. L’œil de l’écrivain est à facettes.
Que voit, et qu’observe, cet œil à facettes ? Il voit et observe une mémoire et une histoire, personnelle et civilisationnelle. La réflexion est dans le reflet, et c’est sans ponctuation que surgit Katyn :
« à Katyn la terre était bleue de soleil et de gel un mille-feuille pâte faite de corps entassés soudés enfilés les uns aux autres monstrueux collier de perles humaines chair conservée simplement rétrécie tendue épousant le squelette dans ses détails »

Les virgules, dans cette partie, ne servent aucunement de respiration, indiquent simplement le changement de paragraphe. Nous sommes au milieu exact du livre, dans des « Histoires » dédiées à Alain Cuny, comme un livre dans le livre. Mais l’œil à facettes de Jacques Henric rassemble, par-delà l’intime, l’historique et l’artistique, une vision synthétique, seulement différenciée par la typographie. Revenons à l’Eve de Masaccio : ses hurlements annoncent-ils les massacres ? Les anticipent-ils ? L’histoire et l’art semblent de répondre, et l’histoire de l’art est à revisiter. Henric affirme, plus haut, que « les historiens d’art sont d’incorrigibles cons ». Il parle alors de Masaccio, mort à 27 ans, qui ne continue et n’annonce rien. Mais son Eve ? Et son Adam ? Ils n’annoncent rien non plus, sans doute. Ils sont de l’histoire ancienne, la base d’une civilisation. Mais… cette Eve hurlante, elle hurle aussi vers une Histoire anticipée.
Dans Carrousels, tout tourne et se retourne. A ce point de vertige du manège, ou du tapis défilant dans les aéroports où l’on vient récupérer ses bagages en regardant tourner les bagages des autres voyageurs, l’écriture est comme contrainte à une syncope inhabituelle. Si l’Eve hurlante de Masaccio ne peut ni lexicaliser ni verbaliser, il revient à l’écrivain de tordre la langue pour donner à voir ce que voit l’œil à facettes. Comment allier – marier ? – la peinture et l’écriture, le contemporain et ce qui fait que l’on est contemporain ? Comment montrer, dans l’écriture, que l’on est conscient que les stations du voyage – Italie, Grèce, Jérusalem – sont des stations culturelles et personnelles, ne devenant personnelles que parce qu’elles passent par la culture apprivoisée ? Non pas tordre la langue, non pas la contorsionner, mais la scander, comme pour l’asséner :
« Le désert. Là. Dès l’air. Pas envoyé mais. Ou sans crier gare et dégringolé. Insolation si on veut. Du moins Mycènes ce sera ainsi Jérusalem idem. Cru chaud rouge et le sable. Brasillement court. »
La réédition de Carrousels permet de se pencher à nouveau sur une période intense de la littérature française, qui oscillait entre recherche pure, éclatement des perceptions et volonté d’englober la langue dans une expérience intellectuelle où le moi le disputait à la théorie. Mais Jacques Henric suivait sa propre ligne.