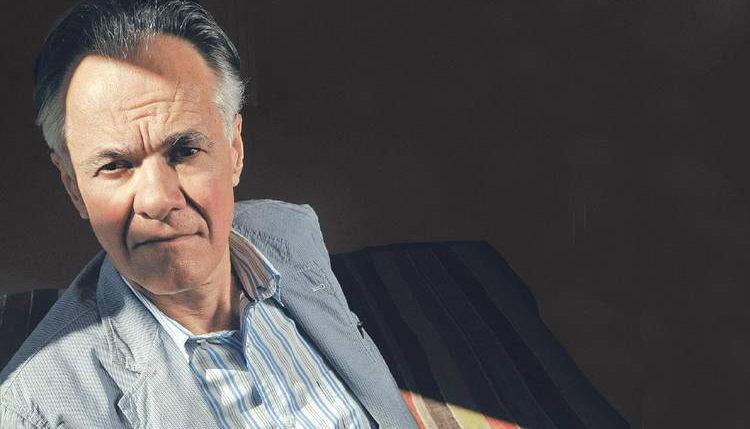Tout insomniaque oscille entre l’orgueil d’appartenir à une élite, la caste des vigilants et la tristesse de relever d’une simple nosographie, les troubles du sommeil. Avec ses pairs, il forme une confrérie de spectres, une franc-maçonnerie de morts-vivants, de joues pâles, de regards fiévreux. La fatigue est leur drogue commune. Ils échangent à voix basse leurs manies, leurs petites recettes : les uns lisent, prennent un bain, pillent le frigidaire, regardent la télévision, confiants dans les pouvoirs hypnotiques du petit écran ; d’autres plus radicaux, arpentent le bitume, titubent de rue en rue, de café en café, échouent sur les banquettes d’une boîte minable, fantômes qui fuient dans le mouvement un sommeil qui les fuit. Ils se maudissent entre eux et rivalisent dans l’énoncé de leur mal : c’est à qui dormira le mois, cumulera le plus de nuits blanches, présentera le faciès le plus émacié, les yeux les plus tirés. L’esprit de compétition les gangrène, ils affichent leurs pathologies comme d’autres leurs décorations et méprisent les faussaires infiltrés dans leurs rangs. La nuit est leur guerre quotidienne, ces vétérans n’ont aucune indulgence pour les imposteurs. Mais ils méprisent encore plus les bien-portants, ces veaux qui font huit ou neuf heures d’une traite même s’ils leur envient secrètement leur dynamisme, leur santé. Les enfants et les chats sont leurs ennemis jurés : les premiers parce qu’ils dormiraient à poings fermés au milieu d’un bombardement, les seconds parce qu’ils s’assoupissent à toute heure, lovés sur eux-mêmes, indifférents à la lumière, au monde, aux passants.
L’insomniaque se console : il se persuade que le manque de sommeil est un surcroît d’existence, une façon de se glisser dans les couloirs parallèles du temps, d’arpenter des territoires inaccessibles aux normaux. A l’inverse de ces héros de la paresse, tel Oblomov qui reste couché toute sa vie et déploie une exorbitante force d’inertie, il se veut, lui, jusqu’au-boutiste de l’éveil, il ne s’autorise aucun repos. Il finit par chérir son mal car celui-ci le singularise, l’ouvre à des réalités que le commun des mortels ignore. Il est un expérimentateur, un homme des frontières qui campe aux limites de l’espèce où l’air est devenu quasi irrespirable. Il se targue d’une sorte de lucidité supérieure, il s’identifie volontiers à ces personnages de roman noirs qui résolvent des meurtres abominables en s’imposant des privations de sommeil, en tenant, à coup d’alcool, de cigarettes, d’excitants, au bord de l’exténuement, pendant des semaines, des mois.
En vérité l’insomniaque se rassure à peu de frais : en tuant le pouvoir réparateur de la nuit, il se condamne à un engourdissement perpétuel. La vigilance dont il s’enorgueillit n’est pas celle du berger ou du chef qui pourvoit au bien-être de son peuple, c’est l’hébétude de l’ivrogne que la lucidité a fui et qui est voué à l’abrutissement. L’insomniaque fait tout à contretemps ; agité quand il devrait dormir et anéanti quand il devrait agir. L’asthénie est son oxygène, son univers, il marche dans du coton, il vit dans le flou, ses perceptions sont amortie par un filet d’ouate. Il est victime d’un désordre fondamental, pour lui la nuit n’efface pas le jour précédent, tous les temps s’amalgament, passé, présent et futur dans un éternel piétinement. Il ne respecte pas les frontières entre les ordres : il est désaccordé au sens musical du terme. Il n’est ni l’ami de la nuit ni du jour, refuse d’être domicilié à ces deux adresses. Coupable de démesure, il ne sait pas faire relâche.
La chose la plus étrange qui puisse arriver à un insomniaque est de s’apercevoir qu’il a finalement bien dormi. Il scrute son réveil, creuse sa mémoire, certain de s’être trompé : mais non, c’est bien le matin, il a passé une nuit sans histoire, il ne se souvient même pas d’avoir rêvé. Alors il se croit sauvé, le mal l’a quitté. Erreur : le mal en question l’a juste oublié un soir pour le rejoindre le lendemain. La nuit reste cette terrible contrée qu’il ne sait comment traverser, une porte qui ouvre sur l’enfer de la clairvoyance stérile, de l’effervescence vaine. Qu’il peine à s’endormir jusqu’à l’aube ou qu’il se réveille parfaitement dispos à deux heures du matin, il retombe invariablement dans l’ornière. Mais il ne se rend pas sans combattre. Il modifie son hygiène de vie, évite le café ou les alcools, pratique le sport à outrance pour éliminer le stress, caresse le rêve d’arriver épuisé au lit, ayant à peine la force de se déshabiller.
A ces mesures, il ajoute l’art de la méditation pour parvenir au contrôle de ses émotions, il apprend à respirer avec son ventre comme le recommandent les bons docteurs. Quoi qu’il arrive, il se promet de prendre la chose avec sérénité. Cette fois il maîtrisera ses nerfs. Il fait la planche à la surface du lit, bâille ostensiblement, il ferme les yeux, attend d’être happé. Par ces rituels minutieux, il espère que le sommeil se posera sur lui comme un oiseau : il tente de se souvenir de tous les évènements de la journée qui pourraient expliquer sa tension, il change cent fois de côté, inspire lentement, s’allonge à la manière des gisants. Il s’invente des fables consolatrices : c’est la pleine lune censée irriter les nerfs, rendre furieux les criminels et les fous, c’est la pollution qui encombre les bronches, c’est la chaleur irrespirable. Il appartient à cette catégorie que Franz Werfel appelait «les malades de la pression atmosphérique». Sa force vitale dépend des vents, des alizés, des aléas de la météorologie, de l’air plus ou moins gâté des métropoles modernes. Parfois la somnolence le gagne, il se sent couler, délicieusement. Enfin !
Au moment de plonger, toujours, un bruit le perturbe, une pensée incongrue lui revient à l’esprit, l’arrache à la torpeur. Le tintement d’une épingle qui tombe sur le tapis fait un fracas de tempête. La veille reprend, les puissances endormissantes sont parties pour toujours. De la guerre lasse, il avale un cachet. Mais si forte est son accoutumance, à toutes les marques, à toutes les molécules, à tous les dosages, qu’il resurgit une heure plus tard, la bouche pâteuse, parfaitement réveillé. Au lieu de se contorsionner sur le matelas, il pourrait s’amuser, danser, participer aux ébats du peuple de la nuit. Il rêve d’un pouvoir totalitaire qui assommerait le soir d’un coup de marteau entre les yeux les réfractaires à l’endormissement et prendrait en charge tous les moments délicats de l’existence. Il en vient à souhaiter une catastrophe, incendie, bombe, émeute, qui justifie son état et fasse de lui un héros, un sauveur inattendu capable de transformer son handicap en atout. C’est le propre de l’insomnie que tous les moyens mis en œuvre pour la combattre se contentent le plus souvent de la renforcer. Elle est une prophétie autoréalisatrice : la crainte de mal dormir ou de ne pas dormir entraîne immanquablement ce que l’on redoute, quels que soient les procédés mis en œuvre pour l’empêcher.
Alors commence une comptabilité folle : tous ces moments inutiles passés à chercher le repos feront demain du temps en moins. La journée à venir se présente comme un petit tas de détritus. Déjà morte avant l’aube. Demain, justement, l’insomniaque se traînera, cassé, vieilli de dix ans, jaloux des joues roses, des yeux clairs de ceux qui dorment. Et ce ne sont pas des heures mais des années qui s’accumulent au fil de l’existence et qu’il faudra rattraper pour être consolé, remis à neuf. Un interminable calendrier de récupération se met en place qui rivalise avec l’éternité. Il ne peut même pas compter sur une bonne sieste, puisque la même excitation qui le ronge le soir le retrouve l’après-midi, l’accompagne à toute heure comme une ombre grimaçante. Il arrive parfois que l’esprit travaille la nuit avec sagacité, trouve la solution élégante d’un problème, tisse des fantaisies ou des intrigues débridées. Il arrive qu’un roman naisse tout entier, par la faveur de quelque turbulence cérébrale, entre le coucher et le lever. Dans le calme nocturne, l’inspiration nous effleure, provoque des étincelles créatrices, rachète le remue-ménage idiot des paupières qui s’ouvrent et se ferment. Cette grâce est un don du ciel d’autant plus recherché qu’elle est rare. La plupart du temps, les intuitions du mauvais dormeur sont aussi creuses que le pseudo-génie conféré par les drogues. Cendres et poussières concoctées par une raison en voie d’épuisement. Les formules brillantes, les mots précieux trouvés dans l’ivresse se dégonflent à la lumière du jour.
Reste ce qui domine cette expérience stérile : la panique. Aux heures du petit matin, la vie se dresse comme une impossibilité, un verdict sans appel. Le moindre souci prend des proportions démesurées : le vertige prédomine, tous les points d’appui s’évanouissent. Une sorte d’horreur sacrée saisit le veilleur impénitent, l’abîme va le happer. Il se souvient que c’est à l’aube que la mort recrute ses clients, qu’elle jaillit du cœur, des entrailles, des artères : un pincement, une douleur, une convulsion, et la messe est dite. Dans son effroi, il devient expert en ténèbres, apte à distinguer les obscurités profondes, les ombres blafardes, les murailles impénétrables qui ne laissent aucun espoir. Il se sait condamné : chaque nuit est toujours la dernière. Le cauchemar ne cesse qu’avec le jour qui filtre à travers les rideaux, l’immeuble qui s’ébroue comme un animal engourdi, le carillon d’un édifice public, les grondements du métro. La lumière est son alliée. Moment euphorique de celui qui a côtoyé les gouffres et en a réchappé. Le lever est une sérénité conquise sur la terreur : le destin lui accorde un jour de sursis.
L’insomnie est un drame humain total, une petite leçon de métaphysique quotidienne à l’usage de chacun, enfant, adulte ou vieillard. Nul besoin d’avoir lu les philosophes pour comprendre ce qui s’y joue. La peur est un merveilleux pédagogue, un accélérateur des connaissances fondamentales. Au moins l’insomniaque connaît-il l’art d’intensifier le quotidien, de convertir le vide en plein. Pour lui rien n’est banal, il est sorti de la platitude, les actes les plus simples ont pris la densité d’une bataille. Ses nuits infécondes sont le théâtre d’une lutte sans merci, chaque soir il retrouve son démon, s’apprête à le terrasser. De sa débâcle, il fait une épopée. A défaut de vaincre son malheur, il le met en scène.
Pourtant il ne renoncera jamais à bien dormir un jour ; il sait comme les Anciens que le sommeil n’est pas un art mineur mais le témoignage d’une existence de qualité. Jusqu’au bout, il se mettra en quête de sagesse, de techniques sophistiquées jusqu’à ce qu’il tombe, les paupières lourdes, dans une narcose dont rien ne pourra le tirer. Il s’imagine déjà en ours ou en marmotte, voué à une hibernation sans fin. Et la simple idée que dans un futur proche il dormira profondément l’émeut tellement qu’il reste éveillé jusqu’au lendemain.

Texte paru dans le numéro 27 de La Règle du Jeu, janvier 2005