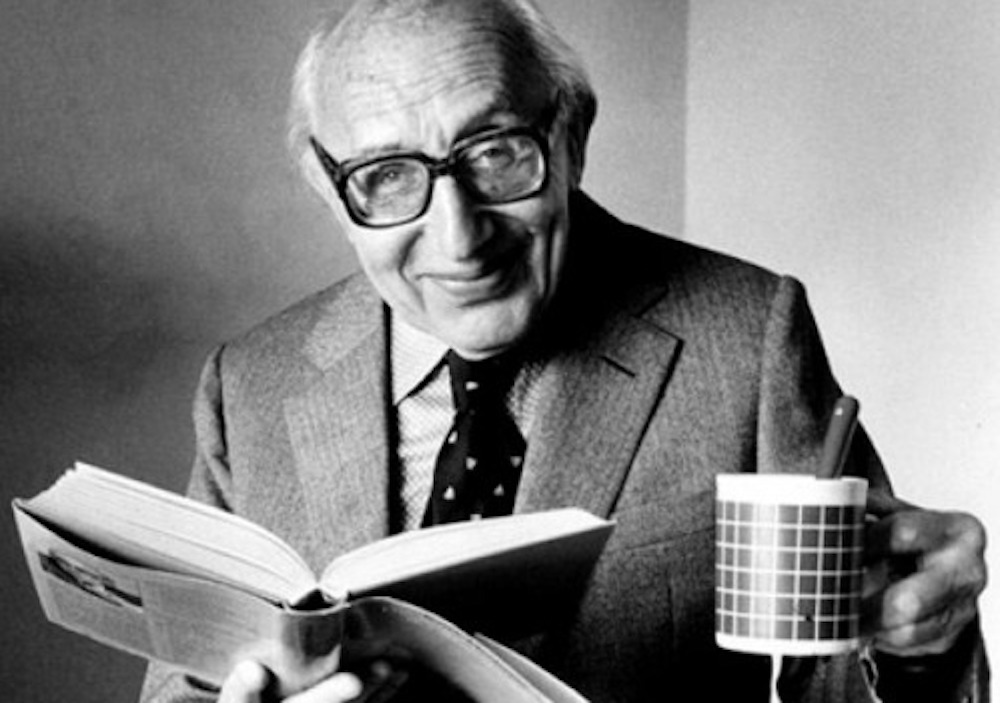Sur le principe, Justine Triet a raison. Et le Festival de Cannes est, si j’ose dire, fait pour ça. Catherine Deneuve n’a-t-elle pas détourné la cérémonie d’ouverture en lisant, en soutien aux victimes de la guerre contre l’Ukraine, un poème de Lessia Oukraïnka ? Et la top-modèle Mahlagha Jaberi n’a-t-elle pas profité de la caisse de résonance qu’est une montée des marches pour s’afficher, en hommage aux Iraniennes et Iraniens exécutés par le régime, dans une robe tenue au cou par une corde de pendu ? Le problème, c’est que la lauréate de la palme d’or se trompe de combat quand elle part en guerre contre la poussée, dans le cinéma français, de la « marchandisation » et le déclin, en conséquence, de l’« exception culturelle ». Car le fait est là. Il n’y a pas un pays au monde où le ministère de la Culture (à travers le CNC), le service public (France Télévisions, Arte), les chaînes privées (à commencer par Canal+) soutiennent si puissamment le cinéma d’auteur et, en particulier, les jeunes talents. Ce n’est pas une objection. C’est un fait.
•
Le Rassemblement national, héritier de Pétain ? C’est aussi un fait. Et, d’ailleurs, il n’y a qu’à écouter ; regarder la biographie de ceux de ses cadres que nous avions épinglés, il y a quelques années, sur le site de La Règle du jeu ; il n’y a qu’à voir comment, quand Marine Le Pen se coupe de ses vieux copains fascisants du GUD, elle se rabiboche, illico, comme si elle avait un besoin vital de cet ancrage, avec les débris de la Nouvelle Droite racialiste des années 1980. Et puis il y a des signes qui ne trompent pas. Sa difficulté, encore aujourd’hui, à avaler le discours de Jacques Chirac reconnaissant la responsabilité de la France dans la rafle du Vel’d’Hiv. Ou sa façon, chaque fois que son pays est engagé sur un théâtre d’opérations extérieures, de retrouver le vieux réflexe et de souhaiter la victoire de l’ennemi (pro-Kadhafi quand les aviateurs français risquent leur peau dans le ciel de Libye ; pro-Assad quand des instructeurs français sont en opération au Rojava ; pro-Poutine quand est déployé en Ukraine le meilleur de nos arsenaux). Pétainiste et collabo.
•
Malaise dans la décivilisation. Et cris d’orfraie quand on apprend que le chef de l’État a osé prononcer ce mot, qui est, nous apprend-on, le titre d’un livre de Renaud Camus. C’est bien d’avoir de la mémoire. Mais nous ne sommes pas obligés d’avoir une mémoire de poisson rouge. Et l’histoire des idées, en France, ne commence pas avec le sieur Camus. Les Pavlov du bashing généralisé savaient-ils que c’est Norbert Elias, sociologue d’une tout autre ampleur, contemporain d’Ernst Cassirer et de Hannah Arendt, qui, à la fin des années 1930, invente le mot ? Et que ne se reportent-ils à son dernier livre, Les Allemands, paru à la toute fin de sa vie, où il théorise une « barbarisation » des comportements et des mœurs qui fut l’un des carburants du nazisme ? Montée des haines… Nihilisme et ressentiment… Intimidation des élus… Discrédit grandissant des institutions républicaines et de leurs gardiens… Et, soudain en péril, ce plébiscite de tous les jours que sont, non seulement la Nation, mais le lien social… Nous en sommes là. On ne peut pas s’inquiéter, à juste titre, d’un retour possible des années 1930 telles que les a décrites Norbert Elias et ne pas sentir ce vent mauvais qui souffle sur la France.
•
Erdogan réélu ? Je pense aux vétérans des manifestations qui, il y a dix ans, place Taksim, espéraient en la démocratie. Aux Kurdes, qui en prennent pour cinq nouvelles années d’humiliation, de mise au ban et, parfois, de massacre. Aux Arméniens, ses autres ennemis publics, qui ne sont pas près de voir se desserrer l’étau du révisionnisme d’État. Aux déshérités des villes, dont le pouvoir d’achat a diminué de moitié en quatre ans et dont il a peut-être acheté les voix si l’on en juge par une hallucinante vidéo où l’on voit le « reis », à la sortie de son bureau de vote, distribuer des billets de banque à qui veut. Et puis je pense à Poutine, visiblement plus fort dans l’ingérence électorale que dans la stratégie, la tactique et le combat militaires – et qui, ce matin, respire. Dans le tourbillon de poussière lourde qu’a fait lever cette semaine ordinaire, il n’y a pas pire que ce sursaut d’un fascisme ottoman que l’on pensait à bout de souffle mais qui repart pour un tour.
•
Me voir attribuer, à Los Angeles, le prestigieux Daniel Pearl Award for Courage and Integrity in Journalism est une grande joie. Mais c’est d’abord un honneur : la liste des récipiendaires qui m’ont précédé depuis vingt ans ne forme-t-elle pas, à mes yeux, l’une des plus nobles compagnies qui soient – Anna Politkovskaïa, la journaliste russe assassinée, en 2006, en plein Moscou ; le blogueur saoudien Raïf Badawi, que dix années de prison et de flagellation n’ont pas réussi à faire plier ; l’indomptable. Charlie Hebdo ; et, bien sûr, Pearl lui-même ? Et puis c’est aussi une vive émotion : l’annonce me transporte, vingt ans plus tôt, au temps de cette enquête folle qui me fit, entre Islamabad et Karachi, remettre mes pas dans ceux du journaliste du Wall Street Journal kidnappé puis décapité – et quoi de plus troublant que ce rendez-vous inopiné avec cette part, si chère, et si sombre, de ma mémoire ?